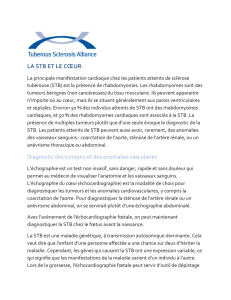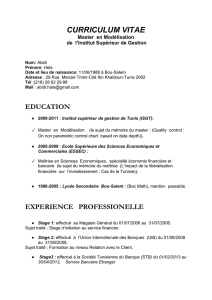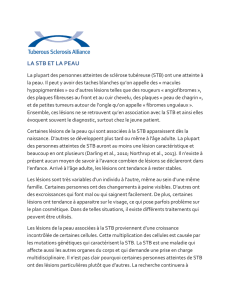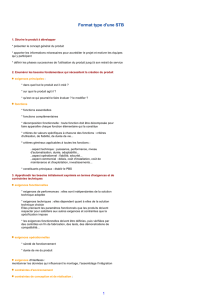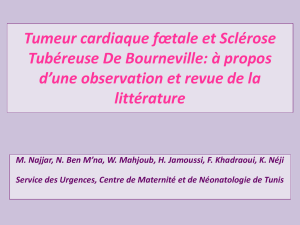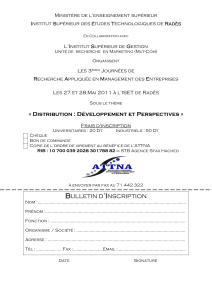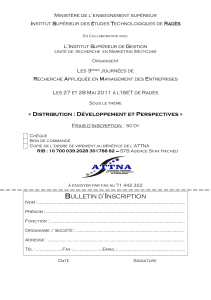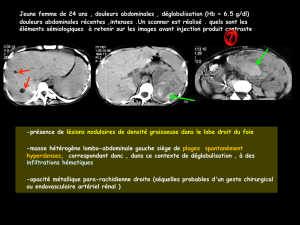Sclérose tubéreuse de Bourneville : spectres cliniques,

Mise au point
Mise au point
La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008
16
Sclérose tubéreuse de Bourneville : spectres cliniques,
démarche diagnostique, prise en charge pratique
Tuberous sclerosis: clinical spectrum, diagnosis, treatment
●● C. Chiron*
* Neuropédiatre et directeur de recherche Inserm, hôpital Necker, Paris.
POINTS FORTS
Le diagnostic de sclérose tubéreuse de Bourneville (STB)
repose sur la clinique et l’IRM cérébrale.
La STB est une aff ection autosomique dominante d’expres-
sivité variable, liée à des mutations sur deux anti-oncogènes,
TSC1 et TSC2, qui codent pour l’hamartine et la tubérine.
La STB est la première cause de spasmes infantiles.
L’examen de la peau est essentiel chez tout patient présen-
tant une épilepsie.
Le vigabatrin (Sabril®) est un traitement efficace des
spasmes infantiles qui doit être instauré précocément.
Il faut surveiller régulièrement les reins par échographie
(angiomyolipomes).
En cas de grossissement ou de multiplication des angio-
myolipomes, un suivi néphrologique spécialisé est indispen-
sable pour prévenir le risque de rupture hémorragique et de
dégénérescence maligne.
Un suivi par IRM cérébrale est recommandé pendant l’en-
fance pour surveiller les nodules sous-épendymaires situés
près des trous de Monro, qui peuvent grossir et être source
d’hypertension intracrânienne.
La découverte d’un rhabdomyome cardiaque anténatal
doit faire suspecter une STB chez le fœtus et faire rechercher
une STB chez les parents.
Le suivi de la STB chez l’adulte jeune, en particulier la
femme, doit inclure une consultation de pneumologie pour
dépister une éventuelle lymphangioléiomyomatose, rare
mais sévère.
Mots-clés : Sclérose tubéreuse – Épilepsie – Angiomyo-
lipome – Rhabdomyome
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
C
lassée parmi les phacomatoses, la sclérose tubéreuse de
Bourneville (STB) touche environ 8 000 personnes en
France, soit environ 100 naissances par an. Génétique-
ment déterminée, la STB peut toucher de nombreux organes.
La gravité de la maladie est surtout le fait de l’épilepsie et du
retard mental, mais les complications rénales, pulmonaires et
tumorales cérébrales, quoique plus rares, peuvent mettre en
jeu le pronostic vital.
SIGNES NEUROLOGIQUES
Environ 60 % des patients ont une épilepsie, qui débute le plus
souvent dans l’enfance. Il s’agit toujours d’une épilepsie partielle
mais avec, dans la moitié des cas, des spasmes infantiles avant
un an, puis un syndrome de Lennox-Gastaut après 4-5 ans.
Quand l’épilepsie reste partielle, les enfants peuvent avoir une
intelligence normale ou subnormale, avec des défi cits neuro-
psychologiques sélectifs en rapport avec la localisation des tubers
(par exemple des diffi cultés logicomathématiques en cas de tuber
pariéto-occipital droit) [1]. Les crises sont contrôlables par les
médicaments, en particulier le vigabatrin et la lamotrigine, chez
la moitié des patients environ (2, 3). Elles sont directement en
rapport avec les tubers, qui se comportent comme des foyers
épileptogènes (4), mais avec une épileptogénicité plus ou moins
SUMMARY
Tuberous sclerosis is a genetic neurocutaneous syndrome
involving 1/8.000 adults and children. Diagnosis lies on
clinical features and cerebral MRI. Onset is often epilepsy,
usually partial, but generalized seizures may be associated
within West or Lennox-Gastaut syndromes. Vigabatrin is
the key treatment of infantile spasms. Cognitive develo-
pment may range from normal to severely delayed with
autism, mainly due to epilepsy impact. Intraventricular
astrocytoma may increase in size in the brain and must
be followed. Dermatological features include achromic
spots and angiofi broma of the face. Kidneys often disclose
angiomyolipoma. Some of them carry a risk of hemorragic
rupture that should be avoided by surgical partial exeresis
or iterative embolisations. Some others may degenerate
and lead to nephrectomy. Pulmonary lymphangioleiomyo-
matosis is rare, but it involves young adult woman with a
severe prognosis. Discovering cardiac rhabdomyoma is
the most frequent way to prenatal diagnosis. Identifying a
mutation is supportive, but the prenatal counseling remains
highly diffi cult.
Keywords: Tuberous sclerosis – Epilepsy – Angiomyoli-
poma – Rhabdomyoma.
▶

Mise au point
Mise au point
La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008
17
Figure 2.
IRM avec tubers et dysplasie corticale associés dans
la STB (patient de 10 mois). L’IRM en séquence T1 montre des
tubers en hyposignal et une malformation corticale associée
en occipital gauche.
Figure 1.
La tomographie par émission de positons (TEP) avec le fl uoro-désoxyglucose (FDG) et l’alpha-méthyl-tryptophane (AMT) dans la
STB (patient de 8 ans). L’IRM en séquence FLAIR (A) montre plusieurs tubers en hypersignal (fl èches). La TEP avec le FDG (B) montre un hypo-
métabolisme au niveau de ces tubers (fl èches). La TEP avec l’AMT (C) montre une hyperfi xation au niveau du tuber épileptogène tandis que
les autres tubers sont hypofi xants (fl èches).
IRM Flair TEP-FDG TEP-AMT
AB C
marquée repérable par la fi xation en TEP (tomographie par
émission de positons) de l’alpha-méthyl-tryptophane (AMT)
marqué au carbone-11 (fi gure 1) [5]. Ainsi, lorsque un seul tuber
donne des crises et qu’elles sont pharmacorésistantes, on peut
proposer une chirurgie d’exérèse après délimitation de la zone
épileptogène par EEG intracrânien (6).
Quand il s’y associe des crises généralisées, le risque de retard
mental sévère et de troubles comportementaux majeurs du
type de la psychose et de l’autisme est au contraire très élevé.
Ce pronostic a cependant été complètement transformé par le
vigabatrin, grâce auquel, s’il est donné tôt, les spasmes de la STB
disparaissent dans près de 100 % des cas (7). Mais ce médicament
a une toxicité rétinienne avec un risque de rétrécissement du
champ visuel périphérique qui nécessite son suivi ophtalmo-
logique régulier, réalisé par une équipe entraînée.
En général, les troubles psychiatriques de la STB sont asso-
ciés à un retard mental. Le plus fréquent est l’autisme, qui
touche 60 % des enfants présentant une STB. Il est attribué à
un dysfonctionnement cortical bitemporal et sous-cortical, et
à un dysfonctionnement du tronc cérébral, du cervelet et des
noyaux caudés. Chez l’adulte, les troubles du comportement
associés à la STB sont plus rares certes, mais ils sont surtout mal
connus. Seule une évaluation neuropsychologique et compor-
tementale systématique de ces patients pourrait permettre d’en
comprendre la ou les causes et de les prendre en charge de façon
adaptée. Quelques cas de révélation de STB à l’âge adulte par
une psychose ou un état d’agitation ont été rapportés.
Le diagnostic de forme neurologique de STB repose sur l’IRM
cérébrale qui montre des tubers corticaux et des nodules sous-
épendymaires (lésions malformatives congénitales),
parfois
calcifi és et même découverts à l’occasion d’une première crise
sur une tomodensidométrie (scanner), voire fortuitement sur
une radio du crâne.
Y sont souvent associées des malforma-
tions corticales focales ou multifocales évoquant sur l’IRM des
dysplasies corticales focales (fi gure 2). Tubers et dysplasies
sont diffi ciles à détecter chez l’enfant de moins de 2 ans car
l’immaturité de la myéline diminue la diff érenciation blanc-
gris ; la séquence FLAIR aide au diagnostic à cet âge (8). Il est
maintenant certain que ces anomalies sont déjà présentes à la
naissance et ne grossissent pas ensuite.

Mise au point
Mise au point
La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008
18
Figure 3.
Astrocytome à
cellules géantes dans la STB
(patient de 12 ans). L’IRM en
séquence T1 avec injection
de gadolinium montre un
volumineux astrocytome
sous-épendymaire au
niveau du trou de Monro
droit, qui prend le contraste
et obstrue la cavité ventri-
culaire. Une indication
chirurgicale de dérivation
externe puis d’exérèse a été
posée dans ce cas.
Figure 5.
Tumeurs péri-unguéales de Koenen.
Figure 4.
Angiofi bromes
de la face.
Il n’en est pas de même des nodules sous-épendymaires qui,
pour ceux situés près des trous de Monro, peuvent grossir et
donner des astrocytomes à cellules géantes (fi gure 3), source
d’hydrocéphalie et d’hypertension intracrânienne gravissime
quand ils entravent l’écoulement du liquide céphalorachidien.
Une dérivation et/ou une exérèse chirurgicale sont alors néces-
saires,
qu’il est préférable de réaliser avant l’apparition de l’hyper-
tension intracrânienne
(9).
l’exérèse des plus gros d’entre eux. Les
tumeurs de Koenen
apparaissent en règle générale chez l’adulte, sous les ongles,
et sont indolores.
MANIFESTATIONS RÉNALES
On trouve des kystes rénaux par l’échographie chez environ 20 %
des patients. Ils se développent généralement dans l’enfance et
sont asymptomatiques. Leur nombre reste stable à l’âge adulte
(10) et ils ne nécessitent aucun traitement.
Plus préoccupants sont les angiomyolipomes rénaux, qui
touchent 60 % à 80 % des patients adultes avec STB. Souvent
bilatéraux, multiples et volumineux, ils apparaissent dans l’en-
fance, mais ne régressent pas, et leur incidence augmente à l’âge
adulte (10). Ce sont des tumeurs bénignes, mais susceptibles de
se rompre spontanément, sources d’hémorragie rétropéritonéale
potentiellement grave nécessitant alors une néphrectomie en
Les tubers sont assez proches, sur le plan neuropathologique,
des dysplasies corticales ou de l’hémimégalencéphalie. La
lamination corticale normale y est en eff et absente et on y
trouve des cellules malformées, des cellules gliales géantes
de type balloon cells et, en proportion plus réduite que dans
les dysplasies, des neurones géants. Les tumeurs intraventri-
culaires, quant à elles, sont uniquement constituées d’astrocytes
géants et ont un potentiel tumoral mais sans aucun critère
de malignité.
SIGNES DERMATOLOGIQUES
Ce sont les signes les plus fréquents de la STB : macules hypo-
chromiques (97 % des cas), angiofi bromes faciaux ou fi bromes
en plaques du visage (75 % à 80 % des cas) [fi gure 4], tumeurs
de Koenen (15 % à 55 % des cas) [fi gure 5], plaques peau de
chagrin (lombaires), lésions confetti. Mais ces signes apparaissent
progressivement, rendant parfois diffi cile le diagnostic précoce
de STB par la porte d’entrée dermatologique. De plus, ils sont
souvent méconnus avant la révélation extradermatologique de
la maladie. Les
taches achromiques
constituent le “marqueur
diagnostique” de la STB sur la peau. Elles sont multiples, de
plusieurs centimètres d’axe, souvent en “feuille de sorbier”. Elles
peuvent être diffi ciles à voir chez le petit nourrisson ou sur
une peau claire et sont alors décelées en lumière ultraviolette.
Leur nombre visible augmente pendant la petite enfance. Les
angiofi bromes
siègent sur le visage, surtout à la racine du nez.
Ils deviennent plus nombreux avec l’âge, peuvent saigner et
causer un préjudice esthétique diffi cile à gérer par les adoles-
cents. On peut proposer d’avoir recours au laser, voire de faire

Mise au point
Mise au point
La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008
19
urgence (11, 12). Les angiomyolipomes de plus de 4 cm avec un
contingent vasculaire prédominant, identifi ables par le scanner
et l’IRM, sont ceux qui présentent le plus de risques de rupture,
le syndrome préfi ssuraire se traduisant alors par des douleurs
lombaires inhabituelles qui doivent alerter (11-14). La préven-
tion de cette rupture hémorragique passe par la chirurgie ou
l’embolisation.
Le risque de tumeurs malignes du rein est augmenté dans la STB.
Elles peuvent apparaître dès l’enfance (15-17). Leur diagnostic
précoce est compliqué par la présence des angiomyolipomes
et c’est souvent leur croissance rapide qui attire l’attention (18).
C’est dire l’importance d’une surveillance régulière de ces mani-
festations rénales par une équipe radiologique expérimentée.
ATTEINTE PULMONAIRE
Il s’agit d’une lymphangioléiomyomatose (LAM), prolifération
diff use de cellules musculaires lisses anormales conduisant au
développement de lésions kystiques multiples dont l’aspect
tomodensitométrique est caractéristique. Ces lésions se révèlent
par une dyspnée, voire un pneumothorax. La prévalence de la
LAM dans la STB est de 25 % à 40 %, mais elle concerne les
patients adultes et presque exclusivement les femmes. L’évo-
lution peut se faire vers l’insuffi sance respiratoire terminale
(nécessitant une transplantation) et le décès.
ATTEINTES OCULAIRES
La prévalence des hamartomes rétiniens s’élève à 44 % chez des
patients adultes avec STB, les nodules typiques ne représentant
que la moitié de ces lésions qui sont toujours asymptomatiques,
les autres pouvant évoquer à tort un processus malin. Par ailleurs,
des aires de dépigmentation rétinienne ont été signalées chez
40 % des patients contre seulement 6 % des sujets normaux ;
elles pourraient donc être une aide au diagnostic de STB. Il faut
néanmoins une bonne expertise de neuro-ophtalmologie pour
identifi er ces lésions rétiniennes avec fi abilité.
ATTEINTES CARDIAQUES
La STB donne des tumeurs cardiaques bénignes, des rhab-
domyomes, qui sont souvent de découverte échographique
anténatale et régressent spontanément. À moins d’obstacle,
rare et lié à la localisation, par exemple, sur une valve cardiaque,
leur pronostic est excellent et leur prise en charge se limite à
une surveillance.
GÉNÉTIQUE ET DIAGNOSTIC ANTÉNATAL
La STB a une transmission dominante mais son expression est
très variable (formes seulement cutanées ou seulement cardia-
ques, formes frustes ou formes sévères, etc.) [19] et 75 % des cas
sont sporadiques. La STB est liée à des mutations sur deux gènes,
TSC1 et TSC2, des anti-oncogènes codant respectivement pour
la tubérine et l’hamartine. Ces deux protéines sont diminuées
dans le cerveau, le rein et le cœur des patients avec STB, expli-
quant l’apparition de tumeurs hamartomateuses (24). La tubérine
et l’hamartine sont des contrôleurs de mTOR (mammalian
target of rapamycin), d’où les premiers essais thérapeutiques
avec la rapamycine, un inhibiteur de mTOR, in vitro, sur des
modèles animaux et chez quelques patients avec angiomyo-
lipomes rénaux, lymphangioléiomyomatose pulmonaire ou
astrocytomes à cellules géantes,
intraventriculaires
.
Les deux tiers des cas environ sont des mutations de novo. La
recherche de mutation dans les gènes TSC1 et TSC2 est encore
assez longue et coûteuse, et on ne peut en identifi er aucune dans
environ 15 % des cas cliniquement certains. Le diagnostic reste
donc encore clinique. Dans les formes dites “frustes”, l’étude
moléculaire peut apporter une aide, mais souvent il s’agit de
mutations en mosaïque, dont l’identifi cation est encore plus
aléatoire (21). La mise en évidence de la mutation est néanmoins
la possibilité la plus fi able de diagnostic prénatal : l’IRM cérébrale
et l’échographie cardiaque anténatales restent les examens les
plus aisés, mais des faux positifs et des faux négatifs sont possi-
bles avec les deux (22, 23). Toutefois, le conseil génétique reste
extrêmement diffi cile dans la mesure où l’histoire naturelle de la
STB est mal connue, en particulier à l’âge adulte, et le pronostic
n’est pas constamment défavorable, même en cas de localisation
cérébrale. Un enfant, dont un parent était porteur, est récemment
né après la réalisation d’un diagnostic préimplantatoire (DPI).
BILAN DE SURVEILLANCE
Une fois le diagnostic posé, une surveillance régulière du patient
s’impose. La rythmicité des IRM cérébrales n’est pas formel-
lement établie car la fréquence et les facteurs de risque d’ap-
parition des astrocytomes à cellules géantes sont encore mal
connus. Néanmoins, on recommande de pratiquer une IRM
au moins tous les 2 ans s’il existe un nodule sous-épendymaire
situé près des trous de Monro et qui grossit, surtout s’il prend
le gadolinium et n’est pas complètement calcifi é (24). Dans les
autres cas, une IRM tous les 5 ans pourrait suffi re. L’absence
de lésions cardiaques ou ophtalmologiques sur le bilan initial
justifi e de ne plus surveiller ces organes. Il n’en est pas de même
du rein ou du poumon : une échographie rénale annuelle est
nécessaire dès le diagnostic posé, même chez le nourrisson, et
un bilan pulmonaire s’impose systématiquement dès la fi n de
l’adolescence chez la jeune femme.
CONCLUSION
La STB est une maladie unique en raison de la diversité de son
spectre clinique, de son pronostic, de ses traitements possibles
et de sa composante génétique. Sa prise en charge implique de

Mise au point
Mise au point
La Lettre du Neurologue - Vol. XII - n° 1-2 - janvier-février 2008
20
nombreux intervenants, aux diff érents âges de la vie. Un point
capital de la prise en charge des patients qui en sont atteints réside
donc dans la coordination de leur suivi médical et chirurgical. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Harrison JE, O’Callaghan FJ, Hancock E et al. Cognitive defi cits in normally
intelligent patients with tuberous sclerosis. Am J Med Genet 1999;88(6):642-6.
2. Nabbout RC, Chiron C, Mumford J et al. Vigabatrin in partial seizures in
children. J Child Neurol 1997;12(3):172-7.
3. Franz DN, Tudor C, Leonard J et al. Lamotrigine therapy of epilepsy in
tuberous sclerosis. Epilepsia 2001;42(7):935-40.
4. Cusmai R, Chiron C, Curatolo P et al. Topographic comparative study of
magnetic resonance imaging and electroencephalography in 34 children with
tuberous sclerosis. Epilepsia 1990;31(6):747-55.
5. Chugani DC, Chugani HT, Muzik O et al. Imaging epileptogenic tubers in
children with tuberous sclerosis complex using alpha-[11C]methyl-L-tryptophan
positron emission tomography. Ann Neurol 1998;44(6):858-66.
6. Koh S, Jayakar P, Dunoyer C et al. Epilepsy surgery in children with
tuberous sclerosis complex: presurgical evaluation and outcome. Epilepsia
2000;41(9):1206-13.
7. Chiron C, Dumas C, Jambaque I et al. Randomized trial comparing vigabatrin
and hydrocortisone in infantile spasms due to tuberous sclerosis. Epilepsy Res
1997;26(2):389-95.
8. Baron Y, Barkovich AJ. MR imaging of tuberous sclerosis in neonates and
young infants. Am J Neuroradiol 1999;20(5):907-16.
9. De Ribaupierre S, Dorfmuller G, Bulteau C et al. Subependymal giant-cell
astrocytomas in pediatric tuberous sclerosis disease: when should we operate?
Neurosurgery 2007;60(1):83-9.
10. Ewalt DH, Sheffi eld E, Sparagana SP et al. Renal lesion growth in children
with tuberous sclerosis complex. J Urol 1998; 160:141-145.
11. Steiner MS, Goldman SM, Fishman EK, Marshall FF. e natural history of
renal angiomyolipoma. J Urol 1993; 150:1782-6.
12. Nelson CP, Sanda MG. Contemporary diagnosis and management of renal
angiomyolipoma. J Urol 2002; 168:1315-25.
13. Yamakado K, Tanaka N, Nakagawa T et al. Renal angiomyolipoma:
relationships between tumor size, aneurysm formation, and rupture. Radiology
2002;225:78-82.
14. Harabayashi T, Shinohara N, Katano H et al. Management of renal
angiomyolipomas associated with tuberous sclerosis complex. J Urol
2004;171:102-5.
15. Bjornsson J, Short MP, Kwiatkowski DJ, Henske EP. Tuberous sclerosis-
associated renal cell carcinoma. Clinical, pathological, and genetic features. Am
J Pathol 1996;149:1201-8.
16. Henske EP. e genetic basis of kidney cancer: why is tuberous sclerosis
complex often overlooked? Curr Mol Med 2004;4:825-31.
17. Henske EP. Tuberous sclerosis and the kidney: from mesenchyme to
epithelium, and beyond. Pediatr Nephrol 2005;20:854-7.
18. Patel U, Simpson E, Kingswood JC, Saggar-Malik AK. Tuberose sclerosis
complex: analysis of growth rates aids diff erentiation of renal cell carcinoma
from atypical or minimal-fat-containing angiomyolipoma. Clin Radiol 2005;
60:665-673; discussion 663-4.
19. Osborne JP, Jones AC, Burley MW et al. Non-penetrance in tuberous sclerosis.
Lancet 2000;355(9216):1698.
20. Dabora SL, Jozwiak S, Franz DN et al. Mutational analysis in a cohort of
224 tuberous sclerosis patients indicates increased severity of TSC2, compared
with TSC1, disease in multiple organs. Am J Hum Genet 2001;68(1):64-80.
21. Verhoef S, Bakker L, Tempelaars AM et al. High rate of mosaicism in
tuberous sclerosis complex. Am J Hum Genet 1999;64(6):1632-7.
22. Bader RS, Chitayat D, Kelly E et al. Fetal rhabdomyoma: prenatal diagnosis,
clinical outcome, and incidence of associated tuberous sclerosis complex.
J Pediatr 2003;143(5):620-4.
23. Gamzu R, Achiron R, Hegesh J et al. Evaluating the risk of tuberous sclerosis
in cases with prenatal diagnosis of cardiac rhabdomyoma. Prenat Diagn
2002;22(11):1044-7.
24. Nabbout R, Santos M, Rolland Y et al. Early diagnosis of subependymal
giant cell astrocytoma in children with tuberous sclerosis. J Neurol Neurosurg
Psychiatry 1999;66(3):370-5.
P O U R E N S A V O I R P L U S …
Jambaque I, Chiron C, Dumas C et al. Mental and behavioural outcome of
infantile epilepsy treated by vigabatrin in tuberous sclerosis patients. Epilepsy
Res 2000;38(2-3):151-60.
Elterman RD, Shields WD, Mansfi eld KA, Nakagawa J. Randomized trial of
vigabatrin in patients with infantile spasms. Neurology 2001;57(8):1416-21.
Parain D, Penniello MJ, Berquen P et al. Vagal nerve stimulation in tuberous
sclerosis complex patients. Pediatr Neurol 2001; 25(3):213-6.
Asano E, Chugani DC, Muzik O et al. Autism in tuberous sclerosis complex is
related to both cortical and subcortical dysfunction. Neurology 2001;57(7):1269-77.
1
/
5
100%