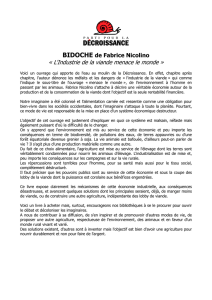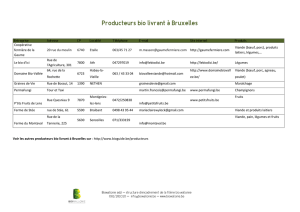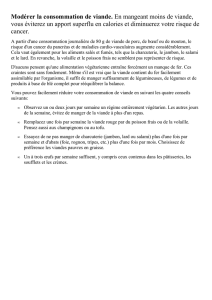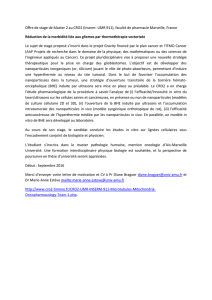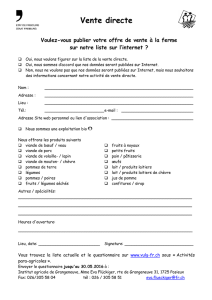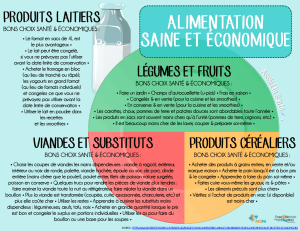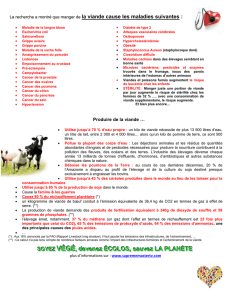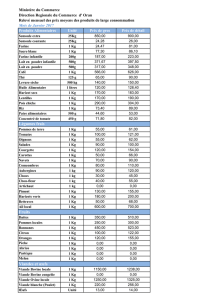Lecteur de glycémie Simple, Fiable, Spécifique particulièrement adapté

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIV - n° 9 - novembre 2010
278
Revue de presse
- 1091007 - LifeScan SAS, division de Ortho-Clinical Diagnostics France - 1 Rue Camille Desmoulins TSA 40007 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 - RCS de Nanterre B330202334.
Lecteur de glycémie particulièrement adapté
aux patients diabétiques de type 2
OneTouch® Vita®, lecteur sans codage, permet
de suivre les 3 mesures clés du contrôle
glycémique (à jeun, avant et après repas)
et aide votre patient à comprendre le lien
entre alimentation et glycémie.
Nouveau stylo autopiqueur OneTouch®
Comfort™ inclus dans le kit.
Simple, Fiable, Spécifique
24h/24 7j/7
Pour un suivi complet
en toute simplicité
VITA2_AP_02.qxd:Mise en page 1 1/10/09 10:22 Page 1
Coordination : Estelle Louiset (Rouen)
Nanoparticules couplées
au cétuximab en
thérapie anticancéreuse
Microbiote intestinal,
génétique et syndrome
métabolique
Cuisson de la viande,
épices et stress oxydatif
Traitement freinateur
du cancer thyroïdien: la
remise en question d’un
dogme?
Pasiréotide, cabergoline
et kétoconazole dans le
traitement de la maladie
de Cushing
Nanoparticules couplées au cétuximab
en thérapie anticancéreuse
Les nanoparticules d’or ou les nanotubes de carbone
absorbent l’énergie des micro-ondes ou des ondes
radio et libèrent de l’énergie sous forme de chaleur.
Contrairement aux micro-ondes, les ondes radio sont
susamment énergiques pour pénétrer en profondeur
dans l’organisme. De plus, on sait – de par leur large
utilisation depuis des décennies dans le domaine de la
communication – que les radiofréquences ne sont pas
toxiques. Couplées à un anticorps ciblant les cellules can-
céreuses, ces nanoparticules pourraient, après excitation
par des ondes radio, détruire spéciquement les cellules
malignes par hyperthermie. E.S. Glazer et al. ont testé in
vitro cette hypothèse en utilisant deux lignées cellulaires,
la lignée de carcinome pancréatique (Panc-1) exprimant
fortement le récepteur du facteur de croissance EGF, et
la lignée de carcinome mammaire (Cama-1), exprimant
très faiblement ce récepteur. L’analyse par microscopie
électronique révèle qu’après 3 heures d’incubation des
deux types cellulaires avec des nanoparticules d’or de
20 nm couplées au cétuximab (C225, Erbitux®), – un
anticorps monoclonal spécique du récepteur de l’EGF
–, seule la lignée Panc-1 internalise des nanoparticules.
L’exposition des cellules à des ondes radio de 13,5 MHz et
200 W pendant 5 minutes réduit de 64 % la viabilité des
cellules Panc-1, sans aecter celle de la lignée Cama-1.
Cette approche innovante de cytotoxicité thermique
par des nanoparticules couplées à un anticorps spéci-
que de cellules tumorales et excitées par des ondes
radio devra être testée prochainement sur des modèles
animaux pour obtenir in vivo une élévation de tempé-
rature de 37 à 41 °C au sein de la masse cancéreuse.
E. Louiset (Rouen)
• Glazer ES et al. Surgery 2010;148:319-24.
• Glazer ES, Curley SA. Cancer 2010;116:3285-93.
Microbiote intestinal,
génétique et syndrome métabolique
Le microbiote intestinal semble impliqué dans la sur-
venue d’une obésité et/ou du syndrome métabolique.
Le transfert de la ore de souris obèses chez des souris
sauvages axéniques (dépourvues de bactéries intes-
tinales) induit une augmentation de la masse grasse
des souris receveuses, ce qui traduit une plus grande
capacité de l’hôte à extraire l’énergie des aliments.
D’autres mécanismes sont évoqués, notamment une
modulation de l’insulinosécrétion induite par le glu-
cagon-like peptide-1 (GLP-1) libéré par l’intestin sous
l’eet de la fermentation des glucides indigestibles,
ou une insulinorésistance induite par l’inammation
provoquée par le lipopolysaccharide bactérien. Le
récepteur TLR5 (toll-like receptor 5), un élément du
système immunitaire inné participant à la défense de
l’organisme, est hautement exprimé dans la muqueuse
intestinale. M. Vijay-Kumar et al. ont constaté que les
souris décientes en TLR5 présentent une hyperphagie
associée à un syndrome métabolique (adiposité, dyslipi-
démie, hypertension, insulinorésistance). La restriction
alimentaire prévient le développement de l’obésité
mais pas celui de l’insulinorésistance. La survenue du
syndrome métabolique est corrélée au changement
de composition de la flore intestinale. Les auteurs
ont montré que le transfert du microbiote des souris
décientes en TLR5 vers des souris axéniques induit
partiellement un syndrome métabolique. Autrement
dit, l’apparition du syndrome métabolique est liée à
des changements de la ore intestinale chez des ani-
maux qui présentent des altérations génétiques de la
reconnaissance de cette ore. Ces travaux soulignent
l’interaction gène-environnement, l’environnement
étant ici le microbiote intestinal. La modulation de la
ore intestinale ouvre une nouvelle piste de recherche
pour la prévention de l’obésité.
J.M. Lecerf (Lille)
• Vijay-Kumar M et al. Science 2010;328(5975):228-31.
Cuisson de la viande,
épices et stress oxydatif
L’inammation et le stress oxydatif sont des mécanismes
considérés comme importants dans les processus
d’athérogenèse et de cancérogenèse. Le malondial-
déhyde (MDA) est un produit de l’oxydation de l’acide
arachidonique par la voix de la lipoxygénase, qui peut
contribuer à l’oxydation des lipoprotéines de basse
densité (low-density lipoprotein [LDL]) et à leur cap-
tation par les macrophages dans la paroi artérielle. Il
peut également interagir avec l’ADN pour former des
adduits mutagènes. Il a été rapporté que l’adjonction
de polyphénols de vin rouge à de la viande de dinde
et/ou la consommation de vin rouge avec de la viande
de dinde peut inhiber l’absorption du MDA. Z. Li et
al. ont évalué si l’adjonction à la viande, avant cuis-
son, d’épices riches en polyphénols, comme l’acide
>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XIV - n° 9 - novembre 2010
280
Revue de presse
rosmarinique, peut réduire l’absorption de
lipides cytotoxiques. Onze volontaires sains
ont consommé des hamburgers sans épices
ou assaisonnés avec un mélange d’épices
contenant de l’acide rosmarinique prove-
nant de l’origan. Quarante pour cent de
l’acide rosmarinique était retrouvé après
cuisson. De plus, la concentration de MDA
était diminuée de 71 % dans la viande épicée
par comparaison avec la viande standard. La
concentration plasmatique en MDA a aug-
menté signicativement dans le groupe stan-
dard par rapport à la base. La concentration
urinaire de MDA était réduite de 49 % chez
les sujets ayant ingéré des hamburgers épi-
cés comparativement au groupe contrôle,
témoignant d’une moindre absorption. Ainsi,
l’adjonction d’épices à la viande peut être un
moyen de réduire le processus d’oxydation
des acides gras impliqué dans l’athérogenèse
et la cancérogenèse. On sait, par ailleurs, que
la consommation de viande cuite (voire trop
cuite) est associée à un risque accru de cancer
(sein, côlon, etc.).
J.M. Lecerf (Lille)
•Li Z et al. Am J Clin Nutr 2010;91(5):1180-4.
Traitement freinateur du cancer
thyroïdien : la remise en question
d’un dogme ?
Le cancer papillaire est le plus fréquent des
cancers de la thyroïde ; son traitement est
bien codié dans les recommandations inter-
nationales (1, 2) et consiste dans la majorité
des situations en une thyroïdectomie totale
suivie d’un traitement freinateur de la thy-
réostimuline (thyroid-stimulating hormone
[TSH]) par l’hormone thyroïdienne avec ou
sans traitement radionucléaire par l’iode
131. Le traitement freinateur réduirait de
moitié le risque de récurrence après chirur-
gie, dans une pathologie dont le pronostic
reste excellent quelle que soit la stratégie
thérapeutique mise en œuvre. Il existe un
débat sur l’opportunité d’une stratégie moins
agressive dans les cancers à faible risque,
basée sur une chirurgie moins extensive et/
ou sans freination thyroïdienne. Ce débat
est alimenté par le bon pronostic de l’af-
fection et le risque d’iatrogénie osseuse
et cardiaque lié à la thyrotoxicose subcli-
nique induite par la freination prolongée.
I. Sugitani et al. ont récemment publié une
étude monocentrique prospective réalisée
sur une cohorte de 441 patients atteints de
cancer papillaire thyroïdien (à l’exclusion
des microcarcinomes) sans métastases à
distance (3). Après thyroïdectomie subto-
tale (20 % des cas environ) ou lobectomie
et curage ganglionnaire au minimum du
compartiment central, les patients ont été
randomisés en deux groupes (stratiés en
fonction du niveau de risque de récurrence) :
un groupe avec et un groupe sans traitement
freinateur par l’hormone thyroïdienne, an
d’obtenir une TSH < 0,1 mU/l ou entre 0,4 et
5 mU/l. Le suivi moyen de la cohorte a été de
6,9 ± 2,9 années ; 74 % des patients ont été
suivis pendant au moins 5 ans. Quarante-neuf
patients (11 %) ont récidivé et 9 (2 %) sont
décédés des suites du cancer thyroïdien. Le
pourcentage de récidive n’a pas été dié-
rent avec ou sans traitement freinateur (10 %
versus 13 % ; p = 0,42), avec une survie sans
maladie apparente respectivement de 91 %
et 89 %. Le taux de métastases à distance et
le taux de survie n’étaient pas non plus dif-
férents dans les deux groupes. Le niveau de
risque de récidive d’après l’évaluation initiale
n’inuençait pas sensiblement ces résultats,
les patients classés à haut risque ayant un
pourcentage de survie sans maladie appa-
rente non signicativement diérent avec
ou sans traitement freinateur. Les principales
limites de l’étude sont le caractère mono-
centrique de l’étude et le taux élevé (15 %)
de perdus de vue. Les auteurs concluent
que les patients à faible risque de récidive
pourraient tirer prot d’une prise en charge
n’incluant pas le traitement freinateur de la
TSH, celui-ci restant réservé à ceux qui pré-
sentent un haut risque de récidive, et dans
ce cas assorti d’une thyroïdectomie totale et
d’un traitement radionucléaire ablatif selon
les recommandations internationales (1, 2).
Y. Reznik (Caen)
1. Cooper DS et al. Thyroid 2009;19(11):1167-214.
2. Pacini F et al. Eur J Endocrinol 2006;154(6):787-803.
3. Sugitani I et al. J Clin Endocrinol Metab 2010;95(10):4576-83.
Pasiréotide, cabergoline
et kétoconazole dans le traitement
de la maladie de Cushing
Les récepteurs de la somatostatine (somatosta-
tin receptor [SSTR]) et de la dopamine de type
2 (D2) sont des cibles thérapeutiques dans la
maladie de Cushing. Toutefois, l’utilisation d’un
agoniste de ces récepteurs ne permet pas de
contrôler ecacement et durablement la mala-
die. R.A. Feelders et al. rapportent une série
de 17 patients, âgés en moyenne de 45,7 ans,
présentant un hypercortisolisme dû à un adé-
nome hypophysaire, qui ont bénécié d’une
administration séquentielle de pasiréotide, un
agoniste des SSTR de types 1, 2, 3 et 5, puis de
cabergoline, un agoniste D2, et enn de kéto-
conazole, un inhibiteur de la stéroïdogenèse.
Le pasiréotide, injecté en sous-cutané 3 fois
par jour à la dose de 100 µg (14 jours) puis
de 250 µg (14 jours), a permis de normaliser
le cortisol libre urinaire chez 5 patients (29 %).
La cabergoline, introduite progressivement
par palier de 5 jours (0,5, 1 puis 1,5 mg/j), a
permis à son tour de normaliser la cortisolurie
chez 4 autres patients (24 %). Au soixantième
jour, les patients qui étaient toujours en hyper-
cortisolisme (47 %) ont reçu du kétoconazole
(600 mg/j). Au terme de l’étude (80 jours), une
réponse complète a été enregistrée chez 88 %
des sujets. La normalisation du cortisol libre
urinaire s’est accompagnée d’une amélioration
des signes cliniques de Cushing incluant une
perte de poids, une diminution du tour de
taille et une réduction de la pression artérielle.
Les eets indésirables du traitement étaient
une altération de l’homéostasie glucidique et
une diminution de l’IGF1 (insulin-like growth
factor) plasmatique chez 9 des 17 patients.
Cette étude montre que le pasiréotide permet
de freiner ecacement l’hypercortisolisme
dans les cas les moins sévères. Elle suggère
également que l’administration séquentielle
des trois agents pharmacologiques, visant des
cibles thérapeutiques complémentaires, a des
eets bénéques additifs dans le traitement
de la maladie de Cushing. L’eet à long terme
du pasiréotide sur la libération d’adrénocorti-
cotrophine (ACTH), ainsi que son éventuelle
action diabétogène, restent toutefois à évaluer.
E. Louiset (Rouen)
• Feelders RA et al. N Engl J Med. 2010;362(19):1846-8.
>>>
1
/
2
100%