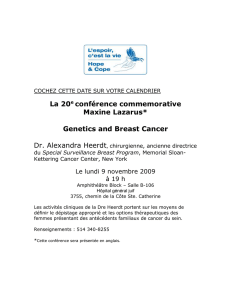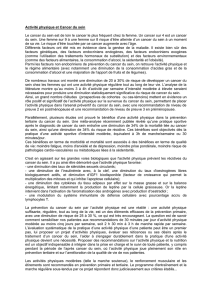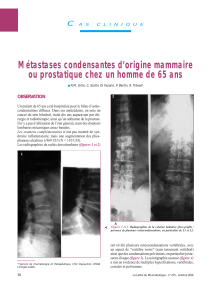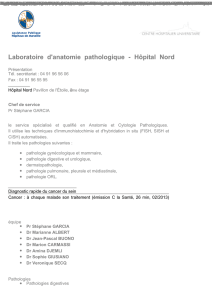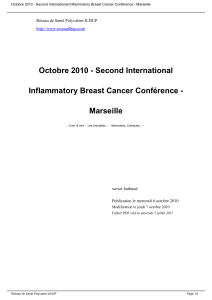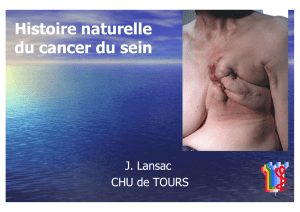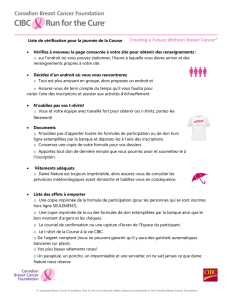DOSSIER
31
La Lettre du Sénologue - nos 13-14 - 3e-4etrimestres 2001
S
ous le terme de mastopathies bénignes, on regroupe
diverses affections du sein dont la plus importante et
la plus répandue est la maladie fibrokystique (MFK),
mais aussi l’adénofibrome, les papillomes, le nodule d’Aschoff.
Nous laisserons volontairement de côté les maladies inflamma-
toires telles que les mastites plasmocytaires et granulomateuses,
ainsi que les abcès infectieux, la tuberculose, etc.
En fait, la MFK a un cadre clinique très mal défini. Charles Gross
écrivait à son propos qu’il ne connaissait pas de sein vraiment
“normal” (1).
Les critères histologiques classiques sont :
–des formations kystiques de tailles diverses ;
–l’hyperplasie épithéliale et l’adénose ;
–la sclérose du tissu conjonctif de voisinage ;
–une métaplasie apocrine.
Les aspects sont variés avec une prédominance de telle ou telle
lésion qui est parfois exclusive : on parle alors de dystrophie kys-
tique, ou adénomateuse, ou fibreuse, etc. (2).
Mais de telles transformations sont banales à partir de l’âge de 35-
40 ans, atteignant leur maximum en périménopause pour s’éteindre
progressivement après l’installation de la ménopause (3).
Dans l’interprétation de ces altérations dystrophiques, il faut donc
tenir compte de l’âge, de l’importance quantitative des lésions,
et aussi de certains aspects qualitatifs de grande importance pour
l’évaluation du pronostic.
Une étude épidémiologique menée par le GERM (Groupe d’étude
et de réflexion sur les mastopathies) concernant les kystes avait
permis de montrer leur grande fréquence, révélés par l’échogra-
phie mammaire alors qu’ils sont très souvent totalement silen-
cieux (y compris en période de ménopause récente) (4).
Le profil gynécologique et hormonal de ces femmes n’a rien de
particulier : dates d’installation de la puberté, de la ménopause,
cycles menstruels – mais le syndrome prémenstruel (SP) y est
assez souvent marqué, encore qu’il n’y ait pas de parallélisme
entre SP et importance de la MFK. Chacun sait que certaines dys-
trophies kystiques sévères ne s’accompagnent d’aucune masto-
dynie et qu’à l’inverse une mastodynie sévère peut coexister avec
des signes objectifs de dystrophie mineure (5).
Contrairement à ce qui avait pu être avancé, la plupart des explo-
rations hormonales portant sur les dosages plasmatiques (effec-
tués en phase postovulatoire) de l’estradiol, de la progestérone et
de la testostérone ainsi que de la prolactine sont habituellement
normales. Il n’existe guère plus de 20 % d’hyperestrogénie abso-
* Hôpital Saint-Louis, Paris.
lue ou relative par insuffisance lutéale ; même les épreuves de
stimulation de la prolactine (TRH, sulpiride) sont le plus souvent
dans les limites de la normale (6, 7).
Peut-être faudrait-il chercher des modifications du métabolisme
local de ces hormones au niveau du tissu mammaire lui-même.
Mais on manque encore de données objectives en ce domaine.
Le psychisme joue, en revanche, à notre avis, un rôle important.
Il est regrettable que ce fait ne soit pas mentionné dans les trai-
tés. Pour qui a l’habitude de suivre des femmes atteintes de MFK,
les soucis, les contrariétés, les stress familiaux et sociaux entraî-
nent souvent des poussées kystiques dont la relation de cause à
effet paraît flagrante (7).
D’autres facteurs ont un rôle discuté, mal établi : le poids, le tabac,
le café, l’alcool, etc.
En fait, quel est le véritable intérêt, pour nous, de la MFK ? C’est
le risque relatif (RR) de cancer du sein (CS) qu’elle peut entraîner.
À cet égard, on peut parler de l’ère précédant W. Dupont et
D. Page et de la période qui a suivi leur publication (8).
Autrefois, on avançait que les microkystes de taille ne dépassant
pas 3 mm de diamètre, ne comportaient aucun danger, contrai-
rement aux kystes plus volumineux. En fait, les constatations de
Dupont et Page sont venues révolutionner les facteurs pronos-
tiques de risque de survenue du CS. Les auteurs ont séparé les
lésions sans prolifération dont le RR était égal à 1 pour les hyper-
plasies cellulaires sans atypie ; il passait à 1,9, pour atteindre
4,5 au cours des hyperplasies atypiques. Enfin, les antécédents
familiaux directs de CS majoraient encore ce risque, qui attei-
gnait pour les hyperplasies atypiques un risque multiplié par 11.
Mais, au départ, sans examen histologique, on ne pouvait pas
évaluer correctement le danger encouru, et il est certain que la
majorité des MFK n’est pas opérée ni biopsiée. Un nouveau para-
mètre a fait son apparition ces dernières années : c’est celui de
la densité mammaire constitutionnelle. Déjà entrevue par les tra-
vaux de Wolfe (9), elle a été abondamment confirmée par des
études de ces dernières années, démontrant que l’intensité de la
densité mammaire, appréciée par mensurations mammogra-
phiques, allait de pair avec l’augmentation du RR du CS (10).
On ne connaît pas le rôle exact que jouent les hormones endo-
gènes, estrogènes et progestérone notamment, sur cette densité
mammaire constitutionnelle.
Cela nous amène à aborder deux problèmes d’importance concer-
nant l’effet des hormones exogènes sur la cible mammaire et leur
incidence éventuelle sur le CS.
Pour la contraception hormonale, il apparaît que les mastopathies
bénignes ne se trouvent pas aggravées et qu’une bonne partie des
MFK sans atypie cellulaire peuvent se trouver améliorées sous
Aspects épidémiologiques des mastopathies bénignes
●
André Gorins*

pilule contraceptive (11). Il n’y a pas, semble-t-il, d’accroisse-
ment du RR de CS.
Plus controversé est le rôle joué par le traitement hormonal sub-
stitutif de la ménopause (THS).
On connaît les publications du Collaborative Group on Hormonal Fac-
tors(12)qui semble montrer un risque très faiblement augmenté, mul-
tiplié par 1,03 pour chaque année d’utilisation au-delà de la 5eannée,
et les travaux très récents de C. Schairer (13) et de C. Magnusson (14)
qui indiqueraient un RR augmenté par l’apport de progestatifs de syn-
thèse. Mais les résultats sont à la limite de la significativité.
En revanche, les études approfondies de W. Dupont et D. Page ont
clairement montré qu’en cas de MFK comportant une hyperplasie
sans ou avec atypie, le THS (à base d’estrogènes sulfoconjugués)
n’entraîne aucune augmentation significative du risque (15). Le
fait a été confirmé par l’étude de l’École de Boston (16). À ce sujet,
il nous semble qu’il faille faire un distinguo entre la densité mam-
maire constitutionnelle et l’accroissement de la densité sous THS,
augmentation “acquise” dont on n’appréhende pas encore la patho-
génie, mais où la rétention aqueuse et l’œdème pourraient être les
facteurs principaux.
En ce qui concerne l’adéno-fibrome, sa fréquence est difficile à défi-
nir. Véritable tumeur bénigne, composée d’une sclérose de tissu
conjonctif enserrant un épithélium plus ou moins hyperplasique,
c’est l’apanage du sujet jeune, âgé de 15 à 25 ans. La découverte
d’un nodule isolé, indolore, mobile, asymptomatique est très évo-
catrice. L’AF peut être géant, multiple, bilatéral.
Là encore, l’échographie révèle de nombreuses images de type
AF non perçues par la clinique.
Cependant, la découverte d’un nodule solide, au-delà de l’âge de
30 ans, doit rendre très circonspect, un cancer du sein pouvant
avoir tous les attributs cliniques et paracliniques d’un AF, d’où
l’intervention chirurgicale quasi systématique devant la décou-
verte d’un tel nodule, à partir de la trentaine.
L’AF est une tumeur bénigne. Il est exceptionnel que s’y pro-
duise une transformation maligne, cependant possible quoique
très rare (17).
Il faut encore revenir aux travaux de W. Dupont et D. Page (18).
Ils ont montré qu’un AF simple n’accroissait pas le RR de pré-
senter un CS, mais que ce risque était nettement augmenté (x 3,88)
s’il existait des foyers de dystrophie mammaire complexe dans
le voisinage (couronne de tissu retirée en cours de l’exérèse de
la lésion). Récemment, ils viennent de montrer que ces altéra-
tions dystrophiques du type hyperplasie atypique canalaire ou
lobulaire, lorsqu’elles étaient présentes à l’intérieur de l’AF lui-
même, n’augmentaient pas le RR de CS (19).
Il s’agit donc d’une constatation rassurante.
Nous dirons quelques mots des papillomes.
Le papillome isolé, souvent proximal dans la topographie duc-
tale, et qui se manifeste par un écoulement unipore, séreux ou
sanglant, est une lésion bénigne.
En revanche, la papillomatose diffuse, surtout dans sa topogra-
phie distale, qui peut donner lieu à un écoulement uni- ou pluri-
orificiel, doit être considérée comme une lésion à haut risque de
type “précancéreux” (2).
On ignore la prévalence exacte de ces lésions.
Le nodule d’Aschoff, dénommé aussi “cicatrice radiaire” (radial
scar) est une lésion curieuse, habituellement découverte lors de
mammographies ou d’examens histologiques ; elle donne lieu à
une petite image centrale d’où partent de longs prolongements.
Histologiquement, le centre est scléreux, riche en substance éla-
céinique, renfermant des formations glanduloformes réparties de
façon irrégulière. En périphérie, galactophores et lobules, sièges
de lésions d’adénose et d’hyperplasie épithéliale, forment une
couronne à disposition radiaire. À ces lésions peuvent s’associer
des kystes. Il n’est pas rare de rencontrer, dans cette cicatrice
radiaire, un petit carcinome débutant, de type tubuleux ou autre.
Point important, de récents travaux (20) ont permis de préciser que
ce type de lésion histologique exposait à un risque accru de CS
(aussi bien dans le sein homolatéral que dans le sein controlatéral).
En conclusion, ce qui importe, quand on est en présence d’une
mastopathie bénigne, c’est de pouvoir évaluer le risque de CS.
Est-il accru ? Et si oui, dans quelles proportions ?
La surveillance et la conduite thérapeutique sont loin d’être tou-
jours aisées.
■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Gros C. Les maladies du sein. Paris 1963 : Masson.
2. De Roquancourt A. Lésions bénignes du sein. Anatomo-pathologie. Le Sein
2001 ; 223-33.
3. Geschickter CF. Diseases of the breast. Philadelphia : Lippincott 1945.
4. Gorins A. Épidémiologie des kystes mammaires. Gynécologie 1994 ; 2 (5) : 284-90.
5. Gorins A, Netter A. Étude hormonale des mastoses. XXIIIes Assises fran-
çaises de gynécologie. Paris : Masson 1966 ; 149-90.
6. Rozenbaum H. Explorations hormonales et pathologies mammaires. Le Sein
2001 : 101-10.
7. Gorins A. La maladie fibro-kystique du sein ou soi-disant telle. Nouveaux
concepts. Le Sein 2001 ; 258-70.
8. Dupont WD, Page DL. Risk factors for breast cancer in women with proli-
ferative breast disease. N Engl J Med 1985 ; 312 : 146-51.
9. Wolfe J. Breast parenchymal patterns and their relationship to carcinoma.
In : Strax P (ed). Control of breast cancer through mass screening. Littleton :
PSG publishing company, 1979 ; 115-25.
10. Boyd NF, Jensen H, Cooke G et al. Relationship between mammographic and
histological risk factors for breast cancer. J Nat Cancer Inst 1992 ; 84 : 1170-9.
11. Lé GM, Plu-Bureau G. Contraception orale et risque de mastopathie
bénigne : revue de la littérature. Reproduct Hum Hormon 1999 ; 12 (5) : 457-63.
12. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast Can-
cer and Hormone Replacement Therapy : Collaborative reanalysis of data
from 51 epidemiological studies of 52 705 women with breast cancer and
108 411 women without breast cancer. Lancet 1997 ; 350 : 1047-59.
13. Schairer C, Lubin J, Troisi R et al. Menopausal estrogen and estrogen
progestin replacement therapy and breast cancer. JAMA 2000 ; 283 : 485-91.
14. Magnusson C, Baron JA, Correia N. Breast cancer risk following long-
term estrogen and estrogen-progestin replacement therapy. Int J Cancer
1998 ; 81 : 339-44.
15. Dupont WD, Page DL, Parl FF et al. Estrogen replacement therapy in women
with a history of proliferative breast disease. Cancer 1999 ; 85 : 1277-83.
16.Byrne C. Biopsy confirmed benign breast disease. Post-menopausal use of exo-
genous female hormone and breast carcinoma risk. Cancer 2000 ; 89 : 2046-52.
17. Diaz NM et al. Carcinoma arising within fibro-adenoma of the breast. A cli-
nico-pathological study of 105 patients. Am J Clin Pathol 1991 ; 95 : 614-22.
18. Dupont WD, Page DL, Parl FF et al. Long term risk of breast cancer in
women with fibroadenomas. N Engl J Med 1994 ; 331 : 10-5.
19. Carter BA, Page DL, Schuyer P et al. No elevation in long term breast
carcinoma-risk for women with fibro-adenoma that contain atypical hyperpla-
sia. Cancer 2001 ; 92 : 30-6.
20. Jacobs TW, Byrne C, Colditz G et al. Radial scars in benign breast biop-
sies specimens and the risk of breast cancer. Cancer 1999 ; 340 : 430-6.
DOSSIER
32
La Lettre du Sénologue - nos 13-14 - 3e-4etrimestres 2001
1
/
2
100%