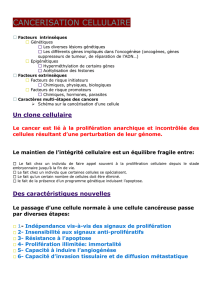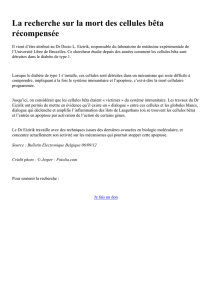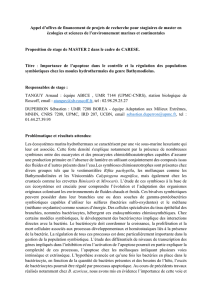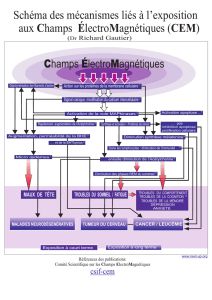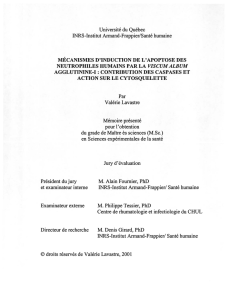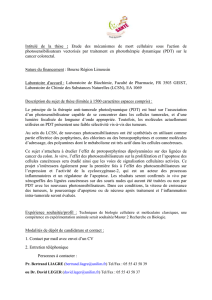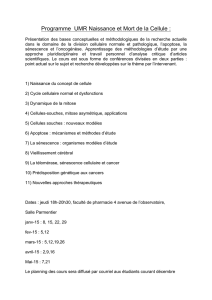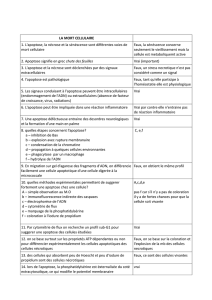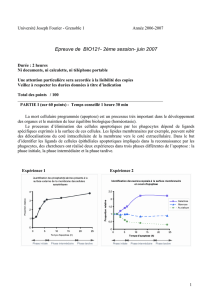alors que chaque déficit d’apoptose peut mener directement

e nombreux facteurs, et tout particulièrement les
stéroïdes ovariens, l’estradiol 17-bêta et la proges-
térone, contrôlent la prolifération, la différenciation
et l’apoptose des cellules épithéliales mammaires, humaines,
normales (1).
L’unité fonctionnelle élémentaire du sein féminin normal est le
lobule. Chaque lobule est constitué d’une dizaine d’alvéoles en
période de repos (en fin de grossesse, en revanche, ce chiffre est
multiplié par 10). Les lobules sont séparés les uns des autres par
du tissu conjonctif interlobulaire, pauvre en fibroblastes et riche
en adipocytes (2).
Les cancers mammaires les plus fréquents sont les cancers cana-
laires (70 à 80 % de tous les cancers mammaires). Ils naissent à
la jonction des canaux terminaux et des alvéoles, alors que les
cancers lobulaires, beaucoup plus rares (5 à 10 %) sont issus des
cellules alvéolaires.
À la ménopause, la fonction ovarienne déclinante puis disparue
entraîne une régression des structures épithéliales. Les unités
lobulaires, dernières apparues, sont les premières à disparaître.
Le compartiment épithélial est progressivement remplacé par du
tissu fibreux ou graisseux, ou les deux à la fois.
Les traitements hormonaux substitutifs peuvent retarder cette
involution mammaire physiologique à la ménopause.
L’homéostasie d’un tissu normal, et tout spécialement celui de
la glande mammaire de la femme, repose sur un équilibre déli-
cat entre la prolifération et la “mort cellulaire programmée” ou
apoptose. Ce type de mort cellulaire est un “suicide actif” et
finement régulé de la cellule, qui nécessite une consommation
d’énergie et un contrôle génétique (3). L’apoptose est tout à fait
différente de la nécrose (mort cellulaire) résultant d’une agres-
sion extérieure (3).
L’apoptose intervient chez la femme dans de très nombreux
phénomènes physiologiques et physiopathologiques.
Ainsi elle joue un rôle capital au cours de l’embryogenèse et de
l’homéostasie d’un tissu, en éliminant les cellules inutiles, anor-
males, non fonctionnelles ou mal placées, et en participant au
contrôle du nombre de cellules en compensant la prolifération
(l’involution) des canaux de Wolff chez l’embryon femelle, et
ceux de Müller chez le mâle, qui en sont un exemple évident.
In vivo, chez la femme, l’action des estrogènes et de la pro-
gestérone est essentielle, car régulant, in fine, la prolifération
et l’apoptose des cellules mammaires normales. Chaque cycle
en excès de prolifération augmente le risque de carcinogenèse,
alors que chaque déficit d’apoptose peut mener directement
ou indirectement à une hyperplasie, voire peut-être à un can-
cer (4, 5).
Les rythmes cycliques menstruels de la prolifération et de
l’apoptose des cellules épithéliales mammaires diffèrent fonda-
mentalement de ceux de l’endomètre.
En effet, après des décennies de polémiques, il est établi claire-
ment aujourd’hui que le pic de prolifération se situe en phase
lutéale du 21eau 25ejour du cycle menstruel selon les auteurs
(6) et non en phase folliculaire, comme dans le cas de l’endo-
mètre.
Trois à cinq jours plus tard, au 28ejour du cycle menstruel,
l’apoptose atteint à son tour un pic, équilibrant la prolifération
et permettant de maintenir constant le nombre de cellules mam-
maires, cycle après cycle.
La coordination parfaite de ces 2 processus cellulaires, la proli-
fération et l’apoptose, entraîne un très lent renouvellement du
tissu épithélial mammaire. Les cellules apoptosiques sont situées
près de la membrane basale et à chaque cycle ; seulement 2 à
5 % des cellules épithéliales mammaires sont concernées.
L’importance de l’apoptose, néanmoins, semble directement et
instantanément liée à l’importance de la prolifération mam-
maire, dans le tissu normal. En effet, lorsqu’il existe une proli-
fération plus intense, l’apoptose augmente également dans les
mêmes proportions.
Avec l’âge, les taux moyens de mitose ont tendance à diminuer
et les courbes sinusoïdales de l’apoptose semblent s’aplanir,
sans modification des taux moyens, expliquant la lente diminu-
tion du compartiment épithélial au cours de la vie. Ces données
ont été établies par comptage des mitoses et des apoptoses au
niveau des pièces de mammoplasties de réduction, effectuées
chez des femmes périménopausées, à différents moments du
cycle menstruel (4-6) spontanés et confirmés par comptage de
DNA et par incorporation de thymidine tritiée.
LES PROGESTATIFS ET L’APOPTOSE
Molécules synthétiques, ils reproduisent l’action de la proges-
térone naturelle, en utilisation lutéomimétique. Certains sont
aussi antigonadotropes et sont utilisés en contraception, soit
estroprogestative soit progestative.
Les progestatifs norstéroïdes
●Les dérivés de la 19-nortestostérone ont des effets métabo-
liques, tensionnels et sur la coagulation non négligeables et sont
très peu utilisés seuls en France, contrairement aux pays anglo-
saxons où leurs effets délétères sont plus ou moins controversés.
MISE AU POINT
23
La Lettre du Sénologue - n° 22 - octobre/novembre/décembre 2003
L’apoptose mammaire
●
C. Pélissier-Langbort
* Chargée de communication de la Société française de gynécologie, Paris.
D

MISE AU POINT
●Les dérivés de la 17-OH-progestérone ont un effet proges-
tatif lutéomimétique et une action antigonadotrope.
Ils n’ont pas d’effets délétères ni sur la coagulation ni sur le
poids ou la tension artérielle mais certains ne sont que franco-
français.
●Les dérivés de la progestérone
– Dihydroprogestérone : Duphaston®10 mg
– Médrogestone : Colprone®5 mg
●Les dérivés norprégnanes
– Acétate de nomégestrol : Lutenyl®5mg
– Promégestone : Surgestone®0,5 mg
Ces deux molécules sont antigonadotropes, n’ont pas d’effet
androgénique et sont dépourvues, comme les autres classes, de
tout effet métabolique nocif (7-11).
L’équipe de J.M. Foidart (12-13) a depuis 1998 particulièrement
étudié l’effet de la progestérone et de l’acétate de nomégestrol
sur l’apoptose (13).
Seule l’interruption du traitement progestatif induit l’apoptose.
En effet, un traitement continu par progestatif maintient l’apop-
tose, à des taux aussi bas que les cultures contrôle, mais ceci se
produit dans des conditions de culture “standard” avec un milieu
contenant 5 % de sérum. Dans un milieu “pauvre” ne compor-
tant que 1 % de sérum, A. Gompel a trouvé une apoptose avec
l’administration aux cellules T47-D, de org 2058, autre dérivé
de la norprogestérone, voisin de l’acétate nomégestrol (5) en
continu.
Que ce soit avec de l’acétate de nomégestrol ou avec un gel
local de ce produit, l’apoptose est induite par l’arrêt brutal du
traitement.
Cependant, les pathologies mammaires ne semblent pas réagir
en termes d’apoptose, comme le tissu mammaire normal
puisque, par exemple, les cellules épithéliales des fibroadé-
nomes ont maintenu des taux relativement élevés et constants
d’apoptose, quel que soit le traitement hormonal appliqué (12-
13).
Pourtant, les fibroadénomes semblent hormonodépendants, tout
au moins pour les estrogènes, comme l’explique Pasqualini (14)
qui a montré un intense métabolisme des estrogènes en leur sein,
significativement plus élevé que dans le tissu mammaire histo-
logiquement normal.
Les fibroadénomes (12) seraient donc insensibles à la progesté-
rone, tout en étant estrogénodépendants.
APPLICATIONS CLINIQUES
La contraception orale par estroprogestatifs et l’apoptose
Une étude cas-témoins récente, la Women’s Care (Marchbanks
2002) a comparé 4 575 femmes ayant eu un cancer du sein, à
4 682 femmes contrôles âgées de 35 à 64 ans. Cette étude n’a pas
montré de risque relatif du cancer du sein augmenté, ni chez les uti-
lisatrices de contraceptifs oraux, ni chez les anciennes utilisatrices.
Les résultats étaient similaires chez les femmes ayant des anté-
cédents familiaux de cancer du sein au premier degré, et chez
celles qui avaient débuté leur contraception à un très jeune âge.
La durée de la contraception n’a pas montré non plus
d’influence sur le risque.
Quant à la recherche fondamentale sur l’influence des contracep-
tifs oraux et sur le cycle menstruel du sein, elle est beaucoup plus
complexe que chez les femmes postménopausiques puisque les
estrogènes endogènes résiduels sous contraception orale s’addi-
tionnent aux estroprogestatifs synthétiques. Le schéma d’admi-
nistration combiné continu ou triphasique ne semble jouer qu’un
rôle très mineur. Quant à l’apoptose, elle ne semble pas être modi-
fiée par la prise de contraceptifs oraux estroprogestatifs (12).
La ménopause substituée et l’apoptose
Chez la femme, au cours de la ménopause non substituée, la dis-
parition de la progestérone, puis la chute drastique des estro-
gènes circulants, entraîne une diminution des cellules épithé-
liales mammaires, aboutissant à une involution progressive de
la glande mammaire.
En revanche, au cours de l’hormonothérapie de substitution,
l’apport exogène d’hormones stéroïdiennes maintient une activité
proliférative, certes bien moindre que chez la femme préménopau-
sée, mais réelle, qui donne un risque de cancer du sein équivalent
à celui des femmes dont la ménopause est tardive.
Le risque relatif augmente avec la durée de l’hormonothérapie et
ne devient réellement significatif qu’après 5 à 10 ans de traitement.
C’est déjà ce que montrait la méta-analyse d’Oxford en 1997, qui
compilait les résultats de 51 études épidémiologiques incluant
52 705 femmes avec cancer du sein et 108 411 femmes indemnes.
Le risque relatif était évalué à 1,26, ce qui est faible en épidé-
miologie (15).
Mais déjà en 1999, Magnusson étudiant pendant 10 ans une popu-
lation de 3 345 femmes suédoises atteintes d’un cancer du sein et
3 454 femmes indemnes, concluait à un risque plus élevé de can-
cer du sein en cas de traitement combiné continu par rapport aux
24
La Lettre du Sénologue - n° 22 - octobre/novembre/décembre 2003
●Lynestrénol : Primolut-Nor®
●Acétate de noréthistérone (NETA)
●(Lévo) Norgestrel
●Désogestrel Ces deux progestatifs de 3egénération ont
des effets androgéniques
●Gestodène moins importants
}
●Acétate de chlormadinone : Lutéran®5 et 10 mg
●Acétate de cyprotérone : Androcur®50 mg
Ils sont antigonadotropes et antiandrogéniques.
●Acétate de médroxyprogestérone (MPA) : n’existe plus en
France, Gestoral®10 mg : contrairement aux 2 autres molé-
cules dont l’innocuité a été démontrée, le bilan du MPA est
très contradictoire, ne serait-ce que parce que c’est le pro-
gestatif de la WHI. La poursuite du bras, utilisant l’estrogène
seul chez les femmes hystérectomisées, laisse planer un doute
sur son innocuité.

traitements séquentiels, avec arrêt du progestatif. Il est le seul à
avoir tenté de comparer les différents types de progestatifs (16).
Il a observé le risque maximal chez les femmes minces, prenant
un traitement combiné continu, à base d’estrogènes et de pro-
gestatifs norstéroïdes, dérivés de la noréthistérone, mais ces
données ne reposent que sur un petit nombre de patientes.
Plus récemment, Olsson (mars 2003) a suivi une cohorte suédoise
de 29 508 femmes. Il ne retrouve de risque significativement plus
élevé de cancer du sein qu’avec les longues durées d’utilisation
du THS, continu, combiné par rapport aux non-utilisatrices (17).
Au contraire, une élévation non significative du risque de can-
cer mammaire a été observée pour les traitements de longue
durée et séquentiels. Autrement dit, ces deux publications atti-
rent l’attention :
– sur un rôle qui semble néfaste des traitements combinés, conti-
nus et non séquentiels ;
– sur le rôle possible de la nature du progestatif.
Malheureusement, les 2 études les plus importantes actuelle-
ment, la Women Health Initiative (WHI) et la Million Women
Study (MWS), n’ont pu nous renseigner ni sur le rôle de l’apop-
tose, et donc de la nécessité ou non d’interrompre le traitement
progestatif pour la provoquer, ni sur le risque inhérent à chaque
type de progestatif.
Pour la WHI, il s’agit de la première étude randomisée, en
double aveugle (18) consacrée aux risques cardiovasculaires de
l’hormonothérapie de substitution et qui a étudié en 2eintention
le risque de cancer du sein.
Seize mille huit cent huit femmes de 50 à 79 ans, dans 40 centres aux
États-Unis, ont été randomisées entre 1993 et 1998. Elles ont utilisé
soit le produit Prempro®(Estrogen Equin 0,625 + MPA : 2,5 mg).
Après 5,2 ans de suivi moyen, il y a eu arrêt de l’essai en raison
d’un risque accru de cancer du sein, par rapport au risque estimé,
le risque relatif de cancer du sein étant de 1,49 par rapport aux
femmes ayant le placebo, et ce risque devenant significatif dès
3,5 ans d’utilisation.
Le bras ne comportant que des estrogènes seuls (chez les
femmes hystérectomisées) sera poursuivi jusqu’en 2005.
Ainsi cette étude de première importance, par sa méthodologie,
ne peut répondre à notre interrogation légitime sur l’apoptose,
ni sur la nature du progestatif : un seul traitement combiné,
continu avec un progestatif : le MPA.
Quant à la plus grande étude rétrospective, observationnelle, cas-
contrôle, réalisée à ce jour, la MWS (19), elle reprend le suivi de
1 084 110 femmes anglaises, de 50 à 64 ans.
Elle aussi confirme le risque de cancer du sein sous traitement :
– estrogènes seuls : 1,30 ;
– association estroprogestative : 2 ;
– tibolone : 1,45.
Mais elle ne retrouve aucune différence :
– ni entre les estrogènes équins ou 17 bêta-estradiol, entre voie
orale ou voie parentérale ;
– ni entre les progestatifs, qui sont toujours le MPA, le NETA (la
didrostérone est citée, mais sans en préciser le nombre de cas) ;
– ni entre les traitements séquentiels ou combinés continus.
Faut-il, s’appuyant sur les travaux de Magnusson et Olsson (16-
17), ne donner que des traitements séquentiels favorisant l’apop-
tose, en utilisant des progestatifs dérivés de la progestérone, et
non de la 19-nortestostérone, comme le progestatif utilisé dans
l’expérimentation de J.M. Foidart et son équipe ?
Il est bien sûr trop tôt pour faire des extrapolations entre l’expé-
rimentation in vivo, in vitro et la clinique, mais il semble légi-
time d’y penser.
Quant à la tibolone, il s’agit d’un progestatif norstéroïde qui a une
sélectivité tissulaire particulière et qui, dès son absorption, se trans-
forme en : 3 αOH-tibolone, 3 ß OH-tibolone, et le ∆4-isomère.
Son action semblait neutre jusque-là sur les seins et des études
sur les lignées cancéreuses MCF (7) ont été réalisées (20) avec
des résultats intéressants.
D’autres études sur les femmes ayant eu un cancer du sein sont
en cours en Europe.
D’où leur intérêt après les résultats de la MWS (20) qui trouve
un risque relatif à 1,45.
En conclusion, certes le phénomène d’apoptose n’est qu’un des
éléments de protection du tissu mammaire contre les déviances
et les anomalies, mais il est dommage de ne pas avoir une
preuve pour la pratique quotidienne. ■
R
ÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Longacre TA. Bartow SA. A correlation morphologic study of human breast and
endometriam in the menstrual cycle. Am J Surg Path 1986 ; 10 : 382-93.
2. Potten CS, Watson R and al. The effect of age and menstrual cycle of proliferative
activity in the normal human breast. Br J Cancer 1988 ; 58 : 163-70.
3. Desreux J, Noel A, Foidart JM. Chronique d’une mort annoncée. Reprod Hum
Horm 2000 ; 3 : 297-303.
4. Bellamy E, Mallcomson R, Harrisson D, Wyllie A. Cell death in health an disease
the biology and regulation of apoptosis. Cancer Biol 1995 ; 6 : 3-16.
5. Gompel A, Somai S, Chaouat M et al. Hormonal regulation of apoptosis in breast
cells and tissues. Steroids 2000 : 65 : 593-8.
6. Desreux J, Kebers F, Foidart JM et al. Effects of a progestogen on normal human
breast epithelial cells apoptosis in vitro and in vivo. The Breast 2003 ; 13 : 142-9.
7. Pelissier C, Basdevant A, Conard J et al. Administration prolongée d’acétate de
chlormadinone : effets métaboliques tensionnels et hormonaux. Gynécologie 1991 ;
42 (2) : 79-86.
8. Pelissier C, Blacker C, Fenistein MC et al. Action antiovulatoire de l’acétate de
chlormadinone. Contr Fertil Sex 1994 ; 22 (1) : 37-40.
9. Pélissier-Langbort C. Actualités de la contraception progestative. Gynécologie
internationale 2000 ; 9 : 21-2.
10. Couzinet B, Young J, Schaison G. The antigonadotropic activity of an 19-norpre-
gnane derivative is exerted both at the hypothalamus and pituitary levels in women. J
CL Endo Metab 1999 ; 84 : 4191-6.
11. Young J, Brailly S, Chassard D, Chanson P. Activité antigonadotrope de l’acé-
tate de chlormadinone. Rev Prat Gynéco Obstet 2000 ; 40 : 33-9.
12. Desreux J. Contribution à l’étude de l’effet des stéroïdes ovariens sur le sein
humain normal et cancéreux (mémoire sous presse).
13. Foidart JM, Colin Cl, Denoo X et al. Estradiol and progesterone regulate the
proliferation of human breast epithelial cells. Fertility.
14. Pasqualini JR, Paris R, Sitruk R et al. Progestins and breast cancer. J Steroid
Bioch Biol Mol 1998 ; 65 : 225-35.
15. Collaborative group in hormonal factors in breast cancer. Lancet 1997 ; 390 :
1047-59.
16. Magnusson C, Baron J et al. Breast cancer risk following long term estrogen
progesterone replacement therapy. Int J Cancer 1999 ; 81 : 339-41.
17. Olsson EL, Ingvall et al. Hormone replacement therapy containing progestins
and given continually increases breast cancer risk in Sweden. Cancer 2003 ; 97 :
1387-92.
18. Women’s Health Initiative. JAMA 2002 ; 288 : 321-68.
19. Million Women Study. Lancet 2003 ; 362 : 419-27.
20. Gompel A, Kandouz M et al. The effect of tibolone on proliferation, differenciation
and apoptosis in normal breast cell. Gynecol Endocrinol 1997 ; 11 (suppl. 1) : 77-9.
25
La Lettre du Sénologue - n° 21 - juillet/août/septembre 2003
1
/
3
100%