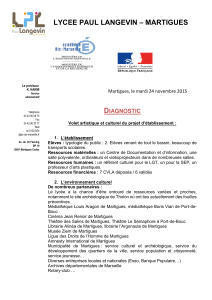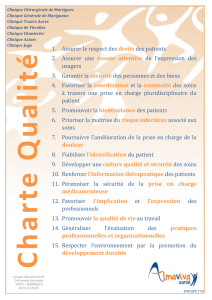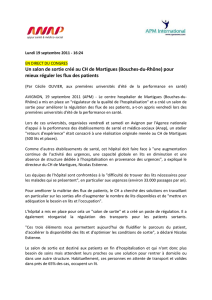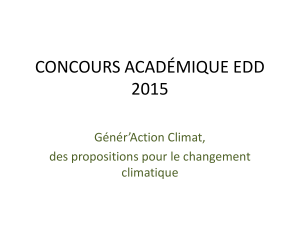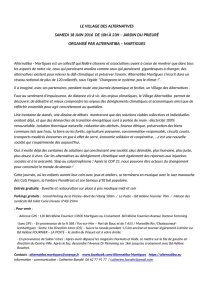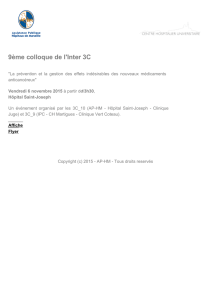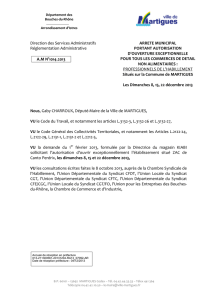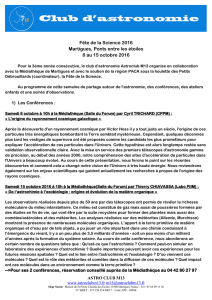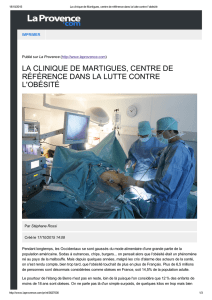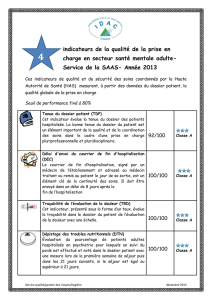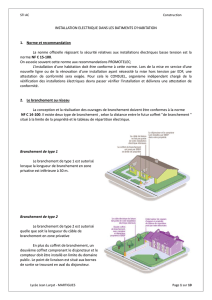Médecin à Martigues n°13 - Décembre 2011

La rencontre-débat à laquelle les Maires de Martigues et de Port-de-Bouc
ont convié les professionnels de santé locaux, le 18 octobre dernier est une
étape importante pour convenir du contenu du futur Contrat local de santé
(CLS) qui liera le territoire intercommunal à l’Agence régionale de santé. Nous
avons souhaité en effet vous consulter sur ce qui paraît, dans la pratique quotidienne ou à
venir d’un professionnel de terrain, constituer des priorités locales à traiter dans le cadre de
l’action publique. Quarante six participants ont à cette occasion exprimé leurs inquiétudes
quant au devenir de l’offre de soins de 1er recours et leur attachement aux structures en place,
tels les Centres de santé mutualistes, la Maison médicale de garde ou le Centre de cardio-
prévention, que l’État doit absolument continuer à soutenir financièrement. Des besoins de
développement en offre de soins et en offre médico-sociale ont été formulés en faveur des
nourrissons et des adolescents, des personnes souffrant de pathologie mentale, des personnes
âgées ou handicapées. L’importance de la prise en compte des caractéristiques sociales et envi-
ronnementales du territoire a également été soulignée : elle requiert une attention particulière
pour les personnes en précarité afin qu’elles ne renoncent pas aux soins, suggère la mise en
place d’enquêtes épidémiologiques et rend indispensable un soutien aux outils développés
localement en faveur de la prévention des pathologies professionnelles. Depuis cette date, des
travaux de mise en commun et de mise en confrontation des besoins et des priorités locales
ont été engagés avec l’ARS. Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour vous associer aux
décisions et à la programmation du CLS. Dr Françoise Eynaud,
Maire adjointe chargée
des Affaires sociales et de la Solidarité,
Conseillère communautaire
Éditorial
À la une...
PRÉVENTION +
Mise en œuvre du Plan local
de santé publique en 2011
>> Lire page 17
DOSSIER +
L’hospitalisation
sans consentement
>> Lire page 12
ENVIRONNEMENT +
Pollution atmosphérique et
hospitalisation dans le secteur
de l’Étang de Berre : résultats
de l’étude 2004-2007
>> Lire page 3
Vers un Contrat local de santé
N°13
...Également au sommaire
ENVIRONNEMENT +
Soirée de FMC sur les pathologies professionnelles p.2
Gouvernance du FIVA, un projet de réforme dénoncé p.2
Pollution atmosphérique et hospitalisations dans
le secteur de l’Étang de Berre : recommandations
médicales et questions-réponses avec le Dr Pascal p.4
Un projet de surveillance des cancers du rein,
de la vessie et des leucémies aiguës chez l’adulte
dans les Bouches-du-Rhône p.6
Les risques majeurs à Martigues p.6
Risques majeurs et information préventive du public p.7
PARTENAIRES +
• Un triple objectif pour le Centre hospitalier de Martigues p.8
• Formation des aidants familiaux de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer p.9
SAVOIR +
• État des lieux de la prise en charge
des violences conjugales p.10
• Dossiers MDPH, conseils pour la rédaction
de certificats médicaux p.11
DOSSIER + p.12
EN BREF p.20
Journal d’information semestriel - Gratuit - décembre 2011

ENVIRONNEMENT +Pathologies professionnelles
Une proposition du Réseau local pathologies professionnelles en partenariat avec l’APPUM
Communiqué de l’Association de défense des victimes
de maladies professionnelles
2
Médecins à Martigues N°13
21 février 2012 : soirée de FMC
sur les pathologies professionnelles
Gouvernance du FIVA, un projet
de réforme dénoncé
e Réseau local de prévention et
de soins des pathologies profes-
sionnelles composé de médecins
spécialistes hospitaliers, de géné-
ralistes libéraux et mutualistes, de
médecins du travail, de la Direction santé
publique du Centre hospitalier de Martigues,
de l’Observatoire communal de la santé de
la Ville de Martigues, d’associations d’aide
aux victimes, de représentants des assurés
sociaux et de l’APCME, propose aux méde-
cins du territoire, le mardi 21 février
2012 à partir de 20h à la villa Khariessa
à Martigues, une formation sur les patho-
logies professionnelles abordées par le
e législateur a créé en décembre 2000
(article 53 de la loi 2000-1257 du 23
décembre 2000) le Fonds d’Indem-
nisation des Victimes de l’Amiante
(FIVA), avec pour objectif d’assurer aux
victimes de l’amiante et à leurs familles une
indemnisation en évitant des procédures
longues et difficiles. Le FIVA est financé par
une contribution de l’Etat et par une contri-
bution de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles du régime général
de la Sécurité sociale. Depuis sa création
en 2002, notre association accompagne les
usagers dans la constitution de leur dossier
FIVA et entend poursuivre son action pour
obtenir une juste indemnisation des préju-
dices des victimes de l’amiante.
Le cadre juridique actuel : le Conseil
d’administration du FIVA est composé d’un
Président, magistrat indépendant de la Cour
de cassation avec voix prépondérante ; 5
représentants de l’Etat, 8 représentants des
réseau durant l’année 2010-2011. Cette
formation s’inclura dans la FMC avec le
soutien opérationnel de l’Association de
perfectionnement post-universitaire des
médecins de Martigues.
Seront abordés l’épidémiologie locale, le
dépistage précoce et les procédures de
déclaration des pathologies de la fonc-
tion respiratoire :
Broncho-pneumopathies chroniques
obstructives (BPCO)
Mésothéliomes de la plèvre
Cancers des voies aérodigestives
supérieures
Cancers broncho-pulmonaires
organisations siégeant à la Commission des
accidents de travail et des maladies profes-
sionnelles et 4 membres proposés par les
organisations nationales d’aide aux victimes
de l’amiante. Grâce à cette organisation où
aucune des parties ne dispose de la majo-
rité, le système d’indemnisation fonctionne
depuis 9 ans sans aucune dérive.
Un projet de décret contesté : le gouver-
nement programmait un décret modifiant
les modalités de désignation du Président
du Conseil d’administration du FIVA en
nommant un membre du Conseil d’Etat
choisi par les ministres de tutelle. Mais,
devant la forte mobilisation estivale des
associations de victimes et le succès de la
manifestation de l’Association nationale de
défense des victimes de l’amiante (ANDEVA)
à Saint-Quentin, le gouvernement a plié.
Le décret paru le 6 octobre nomme à la
Présidence du FIVA une magistrate de la
Cour de cassation.
mais aussi :
Cancer de la vessie et autres voies urinaires,
Cancer du rein,
Leucémies et lymphomes LNH.
Seront également présentés les parte-
naires et outils ressources sur lesquels
les médecins peuvent s’appuyer dans leur
pratique quotidienne.
Les associations continuent la mobilisa-
tion pour appuyer leur recours en annulation
du décret devant le Conseil d’Etat. Elles
rappellent que la Présidence est assurée
par un magistrat de la Cour de cassation
appartenant au corps judiciaire, et qu’à
chaque fois que les représentants de l’Etat
et les employeurs ont tenté un mauvais
coup, avec comme intention de baisser le
montant ou les conditions de la réparation,
c’est grâce à cette voix prépondérante d’un
magistrat indépendant soucieux de faire
respecter le droit que cela a pu être évité.
Pour tout contact :
Dr Christian Frapard,
médecin généraliste libéral :
04 42 44 13 76
L
Association de défense des victimes
de maladies professionnelles
(ADEVIMAP) - Tél : 04 42 43 50 23
www.ademivap.net
Permanences à la Maison de la Justice
et du Droit - Sur RDV les 1er et 3e
mardis du mois - Tél : 04 42 41 32 20
L

Communiqué de l’Association de défense des victimes
de maladies professionnelles
3Médecins à Martigues N°13
Pollution atmosphérique et hospitalisa-
tions pour pathologies cardio-vasculaires
et respiratoires, et pour cancers dans le
secteur de l’Etang de Berre
es industries du pourtour de l’Etang de
Berre émettent de nombreux polluants
atmosphériques qui font de ce terri-
toire une des zones les plus polluées
de France malgré une diminution des
rejets depuis 10 ans. Afin de conduire une
étude épidémiologique concernant les effets
de la pollution atmosphérique sur la santé des
personnes y vivant, la CIRE Sud a mené une
étude descriptive sur les hospitalisations, en
collaboration avec le Département santé
environnement de l’InVS.
Cette étude qui regroupe une zone de 29 com-
munes (soit près de 400 000 habitants) porte :
sur l’éventuel excès d’hospitalisations pour
les pathologies cardio-vasculaires, respi-
ratoires ou cancéreuses durant la période
2004 à 2007,
et sur l’identification d’une possible asso-
ciation entre les variations communales
de l’exposition aux traceurs de la pollu-
tion industrielle et des hospitalisations
sélectionnées.
Méthodologie de l’étude
Identification des effets toxiques et choix
des traceurs :
Les indicateurs ont été construits à partir
de données d’hospitalisations d’établis-
sements des Bouches-du-Rhône et des
départements voisins :
- 8 indicateurs pour les pathologies cardio-
vasculaires,
- 6 pour les pathologies respiratoires,
- 7 pour les cancers.
Le dioxyde de soufre (SO2) a été choisi
comme traceur de la pollution industrielle
afin d’évaluer le niveau moyen d’exposi-
tion pour chaque commune. Les niveaux
moyens annuels de ce polluant ont été
regroupés en 3 classes d’expositions :
référence (<4,2 µg/m3); moyenne (entre
4,2 et 6,4 µg/m3) et élevée (>6,4 µg/m3).
Dans ce type d’étude, les données d’hos-
pitalisation sont comptabilisées à l’échelle
de la commune et non de l’individu.
L’analyse a été conduite séparément pour les
hommes et les femmes. Tous les indicateurs
ont été analysés chez les adultes de 15 ans
et plus, seuls les indicateurs de patholo-
gies respiratoires ont été étudiés chez les
enfants.
Résultats de l’étude concernant
les risques d’hospitalisations
pour les riverains
Les niveaux de SO2 élevés (supérieurs à
6 µg/m3) sont retrouvés pour les communes
les plus industrialisées, principalement au
sud de l’Etang. Les communes situées au
nord-est présentent les niveaux de SO2
les plus faibles.
Les hospitalisations les plus fréquentes
concernent les maladies cardio-vasculaires
qui sont globalement plus fréquentes chez
les hommes. Pour la plupart des patholo-
gies étudiées, le risque d’être hospitalisé
est le même quelles que soient les zones
d’exposition.
Un excès de risque d’être hospitalisé
pour un infarctus du myocarde dans une
commune d’exposition moyenne ou élevée
au SO2 est présent chez les femmes : il est
respectivement de 38 % et de 54 % par
rapport aux communes de référence (cf
figure ci-contre).
Un excès de risque d’être hospitalisé pour
IDM de 26 % est également retrouvé chez
les hommes sur les communes d’exposi-
tion élevée au SO2.
Un excès de risque d’hospitalisation pour
leucémie aiguë a enfin été retrouvé chez
les hommes sur les communes d’exposi-
tion élevée au SO2 (cf figure p.4).
ENVIRONNEMENT +
Air et santé
L
référence
0
0,5
1
1,5
2
2,5
référencemoyenne moyenneélevée élevée
Exposition au
SO2
Homme Femme
Hospitalisations pour infarctus du myocarde
Risque relatif

4
Médecins à Martigues N°13
Pollution atmosphérique et hospitalisations pour pathologies cardio-vasculaires et
respiratoires, et pour cancers dans le secteur de l’Etang de Berre (suite de la p.3)
Questions - réponses avec le
Dr Laurence Pascal, médecin
épidémiologiste à la CIRE-Sud
MàM. Il est dit en conclusion du rapport
d’étude que « compte tenu des limites
des études écologiques et de la réalisa-
tion de tests statistiques multiples, il n’est
pas impossible que ces résultats soient
dus au hasard ». Cette conclusion est-elle
spécifique aux résultats de cette étude
en particulier, ou est-ce la « règle » pour
toutes les études écologiques ? Quelle est
la particularité méthodologique des études
écologiques ? Quel est l’intérêt d’y recourir
si on ne peut éliminer le hasard ?
Dr L.P. Les études écologiques géographiques
ont pour objectif d’étudier l’association entre
des variations géographiques d’un indica-
teur d’exposition et d’un indicateur sanitaire
au niveau d’une population en s’assurant
que les autres facteurs influents, comme
les conditions socio-économiques, soient le
plus semblables possibles. Ceci est impor-
tant lorsque l’on mesure comme ici les taux
d’hospitalisation car les hospitalisations sont
très dépendantes des données et habitudes
locales, de l’offre de soins en particulier.
Toutes les études épidémiologiques compor-
tent une part d’incertitude que l’on choisit
plus ou moins grande en fixant le seuil de
significativité des tests, ce n’est donc pas
propre à cette étude. Le fait de faire ces
tests sur un grand nombre d’indicateurs
augmente cette incertitude et donc la possi-
bilité que les résultats observés soient dus
au hasard.
Notre objectif dans cette étude était surtout
de mettre en évidence des pathologies à
suivre plus particulièrement et surtout d’ana-
lyser les résultats dans leur contexte, et pas
seulement sur la valeur du test statistique, en
les mettant en perspective avec les connais-
sances de la situation locale,
de suggérer
des recommandations collectives à l’in-
tention des élus et du corps médical.
ENVIRONNEMENT +Air et santé
(suite de l'article en p.4)
Compte tenu des limites des études écolo-
giques et de la réalisation de tests statiques
multiples, il n’est pas impossible que ces
résultats soient dus au hasard, ou que
certains facteurs de risques individuels non
pris en compte puissent expliquer les excès
d’hospitalisations observés.
Les résultats de cette étude soulignent
qu’en termes de morbidité hospitalière, la
situation sanitaire de la population exposée
à la pollution atmosphérique d’origine
industrielle n’est globalement pas préoc-
cupante pour les pathologies respiratoires
et les cancers. Mais elle met en évidence
l’impact de la pollution atmosphérique
sur le système cardio-vasculaire.
Homme Femme
référence
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
référencemoyenne moyenneélevée élevée
Exposition au SO2
Hospitalisations pour leucémies aiguës
Risque relatif

5Médecins à Martigues N°13
ENVIRONNEMENT +
Air et santé
Il faut comprendre que
les études de
corrélations écologiques n’ont pas pour
objectif d’apporter des informations sur
la causalité du risque.
Ce que dit cette
étude, c’est que le risque cardio-vasculaire
est à prendre sérieusement en compte, en
particulier chez les femmes.
MàM. L’étude compare les hospitalisations
entre des groupes d’habitants exposés plus
ou moins à la pollution selon leur ville
de résidence, mais tous issus d’un même
bassin d’emploi. Or ces personnes peuvent
résider sur une commune non polluée et
travailler sur une commune polluée. Ce
facteur de mobilité à l’intérieur du secteur
retenu pour l’étude n’a-t-il pas « annulé »
d’éventuelles différences entre les taux
d’hospitalisation de groupes exposés et non
exposés ? N’aurait-il pas été plus pertinent
de comparer les taux d’hospitalisation entre
d’une part les personnes résidant sur les
communes moyennement et très polluées
de ce secteur et, d’autre part, les résidants
issus de communes non polluées d’un autre
bassin d’emploi ?
Dr L.P. Comme je l’ai dit précédemment, les
hospitalisations sont très dépendantes des
données locales. C’est pourquoi il aurait
été dommageable de comparer une zone
polluée du secteur concerné à une zone
non polluée d’un autre secteur, rural par
exemple, où l’offre de soins et l’impact sur
les hospitalisations sont très différents.
Quant au facteur mobilité « zone de rési-
dence - zone de travail », il n’est pas possible
de le contrôler. Ce que l’on sait, c’est qu’au
moins 50% des personnes résident et
travaillent sur une même zone. Pour les
autres, on peut penser que les flux s’équi-
librent entre ceux qui travaillent dans une
zone et habitent dans une autre et ceux qui
font le contraire. Aussi peut-on considérer
que le biais qui est induit par l’absence de
contrôle de ce facteur est faible.
MàM. Concernant le mésothéliome pleural,
le Centre hospitalier de Martigues a comparé
son nombre de séjours pour mésothéliome à
celui de la base régionale : il est 6 fois plus
élevé au CHM et l’analyse de la variance
montre une différence très significative, or
l’étude ne met pas en évidence de variation
d’hospitalisation sur cette pathologie. Y
a-t-il une explication à cela ? Son origine
professionnelle en fait-elle un bon indica-
teur pour cette étude centrée sur l’impact
de la pollution ?
Dr L.P. Le mésothéliome pleural a fait partie
des indicateurs retenus pour l’étude, et ce à
la demande express des associations qui ont
participé au comité technique de l’étude.
Cependant la faiblesse du nombre de cas
recensés n’a pas permis d’analyser cet indi-
cateur. La conclusion n’est donc pas que
l’étude n’a pas mis en évidence de variation
d’hospitalisation sur cette pathologie, mais
que l’on n’a pas pu analyser la variation
faute de données suffisantes. A noter que sur
cette pathologie, une meilleure réponse peut
être apportée par le Programme national de
surveillance du mésothéliome (PNSM) qui
enregistre tous les cas de mésothéliomes de
trois départements de la région PACA dont
les Bouches-du-Rhône.
MàM. Autres commentaires éventuels de
votre part sur les choix et contraintes
méthodologiques…
Dr L.P. Pour une étude comme celle-ci qui porte
sur les taux d’hospitalisation, il est important
de préciser que l’indicateur d’hospitalisation
est très adapté pour mesurer des pathologies
qui nécessitent, de fait, un recours à l’hospi-
talisation, pour une opération par exemple.
Ainsi, c’est un bon indicateur pour les patho-
logies cardio-vasculaires, mais c’est moins
le cas pour les pathologies respiratoires, qui
peuvent être traitées en ambulatoire et qui
ont moins recours à l’hospitalisation.
À cela s’ajoute que le PMSI, utilisé comme
outil d’accès aux données d’hospitalisation,
est construit comme un outil à visée écono-
mique et non épidémiologique. Ainsi les
données dont nous disposons au travers des
codifications d’actes manquent parfois de
précision quant à la nature de la pathologie
qui a motivé l’hospitalisation.
Sensibiliser les médecins libéraux du secteur de
l’Etang de Berre à l’importance du lien entre pollution
atmosphérique et prévention des maladies cardio-
vasculaires, particulièrement chez les femmes.
Informer les patients présentant une pathologie
cardiaque ou chronique telle que le diabète des méfaits
de la pollution atmosphérique et des mesures à prendre
en cas de forte exposition.
Sensibiliser les médecins aux risques cancérogènes
liés aux expositions professionnelles présentes
sur le secteur de l’Etang de Berre (en particulier
amiante, benzène, rayonnements ionisants).
Accroître la surveillance des leucémies
chez les travailleurs et retraités du secteur.
Recommandations médicales
issues de l’étude
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%