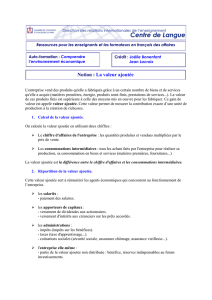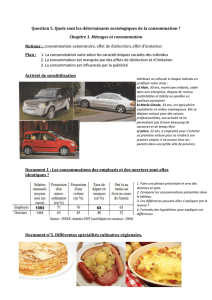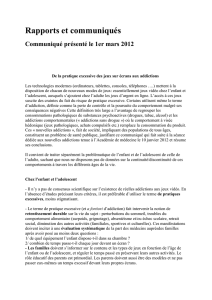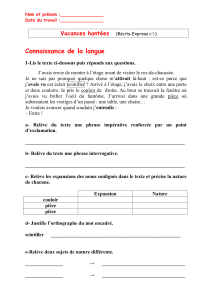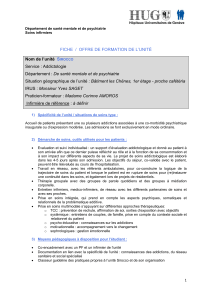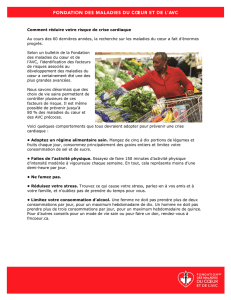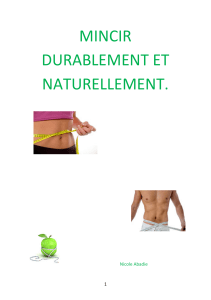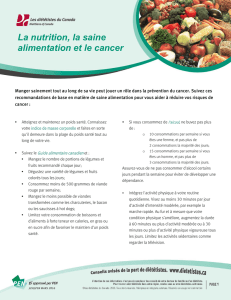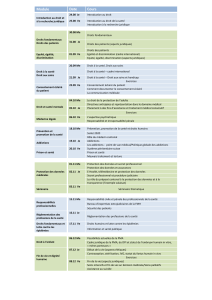Lire l'article complet

Le Courrier des addictions (11) – n ° 2 – avril-mai-juin 2009
31
Plus jamais ça !
Comment et pourquoi
j’ai appris à poser la question
des consommations de produits
Généraliste en 1977, je n’avais pas appris à po-
ser la question des consommations de produits
dangereux pour la santé mentale ou physique, ni
à annoncer une nouvelle difficile à entendre ou à
dire (un cancer, une séropositivité, etc.). Ne po-
sant pas la question, je n’avais parmi les patients,
ni fumeurs de cannabis, ni consommateurs d’al-
cool ou autres drogues. Jusqu’au jour où j’ai été
confrontée à des problèmes que je n’avais pas
appris à résoudre ! David, 17 ans, est mort dans
les toilettes d’un café, avenue d’Italie, d’une over-
dose. Je n’avais pas mesuré le danger du passage
à l’acte. Il avait tout négocié et vendu dans la mai-
son de ses parents qui se plaignaient de ses crises
d’anxiété et de ses vols. Je me suis dit : "Plus ja-
mais ça ! je suis généraliste, médecin de famille, je
vais chercher comment améliorer ma pratique !"
J’ai cherché... à ne pas rester seule
...Et à mieux choisir les formations proposées
aux professionnels, ouvrir les yeux et les oreilles
pour m’informer, écouter les patients.
J’ai retrouvé la mémoire de mon engagement
d’étudiante en militant au planning familial en
1972, avant la loi "Simone Veil", en participant
à la revue du Comité de liaison et d’information
sur la santé et les conditions de travail (CLI-
SACT). J’avais appris alors l’écoute active dans
les échanges avec les femmes en difficulté, les
ouvriers de Ferrodo touchés par l’amiante, les
mineurs silicosés de Liévin. Tous étaient avides
de connaissances, mais donnaient les leurs en
échange. Et cette mutualisation faisait avancer
tout le monde.
* PA MG UFR Paris-XI, présidente du réseau RAVMO,
Réseau addictions Val-de-Marne Ouest-RAVMO, 9, rue
Guynemer, 94800 Villejuif. Tél. : 01 46 77 02 11. Fax :
01 42 11 96 29. Email : [email protected]
Poser d’emblée la question
des consommations
Mireille Becchio*
Qu’ils soient "addicts" ou aient des problèmes psychiatriques, le plus important est que
les patients soient pris en charge, simplement, sans jugement. Comme n’importe lequel
des patients qui viennent consulter dans un cabinet médical. Comme tous les patients
souffrant de pathologies chroniques, parfois difficiles "à manager" dans la durée. Un
plaidoyer pour une pratique humble mais efficace de la présidente du Réseau Val-de-
Marne-Ouest, RAVMO.
L’expérience des patients
et des usagers
L’enseignement des patients
séropositifs
Les premiers patients VIH + soignés dans les
années 1980 "qui en savaient plus que nous",
annonçaient leur diagnostic, leur pronostic en
disant tranquillement "je vais mourir, j’orga-
nise mon après". Après les avoir pleurés, nous
n’avons plus jamais évité de "dire la vérité" si
le patient le désirait et pouvait le supporter,
y compris pour les autres maladies, cancers,
maladies chroniques. J’ai repris alors mon bâ-
ton de montagnarde, participé à la formation
des professionnels de santé à Villejuif, des
étudiants à la faculté Paris-XI et tout naturel-
lement à la création du réseau RAVMO, puis
DEP SUD, car cela répondait à un besoin per-
sonnel et de terrain.
La rencontre, les échanges avec les profession-
nels exerçant de manière différente de ma pra-
tique, les formations "réseau" ont enrichi mon
expérience et mes capacités d’écoute, de refor-
mulation et de connaissance de mes patients.
L’expérience des usagers
D’emblée, ce qui m’a plu dans le travail en ré-
seau comme nous l’avons imaginé et "osé" c’est
que les usagers, ex-usagers, faisaient partie
intégrante du travail et des projets. La com-
mission alcool, la plus active depuis les débuts
du réseau a associé dès le début des repré-
sentants d’associations d’entraide d’usagers
dépendant à l’alcool. Les groupes de parole
pour les fumeurs ont invité des ex-fumeurs,
mais aussi des experts et des professionnels
qui viennent se former à la tabacologie.
Les fiches "protocoles de bonnes pratiques"
sont le fruit du travail commun des usagers,
patients, ex-usagers, professionnels formés
ou en formation sur les addictions, les mala-
dies mentales.
Respecter le déni, sans jugement
ni banalisation
Ce sont les ex-dépendants d’alcool qui nous
ont appris à mieux poser les questions : "j’ai
attendu pendant de trop longues années que
mon médecin me pose la question de mes
consommations d’alcool". Les patients ex-fu-
meurs ont donné des clés "pour parler sans
juger ni banaliser, en acceptant le déni, en re-
venant plus tard si besoin".
Tous nous ont appris avec leur parcours chao-
tique, leur trajectoire de vie, leurs antécédents.
Tous nous ont convaincus que ce qui compte
c’est l’empathie du soignant, la relation méde-
cin-patient, pouvoir échanger avec le soignant
qui "s’assoit pour parler", regarde dans les yeux,
ne dévie pas son regard, ni son écoute. Et ac-
cepte le patient "tel qu’il se présente". Y compris
avec son déni ! Au départ, ce n’est pas le produit
qui compte, ni de savoir s’il y a plusieurs pro-
duits utilisés, mais le patient avec sa souffrance,
son vécu dans sa globalité. Et, toujours, "laisser
la porte ouverte" à la possibilité de parler des
consommations de produits.
Il ne s’agit pas de s’attacher à un produit pour en
réduire ou arrêter sa consommation, sans pren-
dre en charge le patient dans sa globalité. Sans
chercher avec lui la voie sur laquelle il va s’en-
gager "pour se reconstruire différemment, sans
produit". Arrêter le produit par un sevrage "sec”,
c’est exposer ce patient à une reconsommation,
voire au passage à un autre produit. Certains
patients vont parler spontanément, d’autres at-
tendront une consultation ultérieure, voire des
mois plus tard. Nous aurons posé la question et
tous saurons que "nous sommes à l’écoute".
Humbles et efficaces
Le message minimal
On pose la question : "Fumez vous ?" Si le pa-
tient répond "Oui", on peut lui demander de-
puis quand, dans quelles conditions, à quelle
fréquence, combien de cigarettes, puis : "Avez-
vous pensé à diminuer, voire à arrêter vos
consommations ?" Enfin, on conclut : "Le jour où
vous voudrez vous arrêter, je peux vous aider...
ou vous donner des adresses". Si nous, les profes-
sionnels, soignants ou non, assistants sociaux,
dentistes, infirmiers, pharmaciens, médecins...
posons cette simple question, nous avons tou-
tes les chances d’obtenir qu’un patient sur dix
diminue spontanément sa consommation d’al-
cool ou de cannabis, un sur vingt celle de tabac,
sans rien faire de plus ! Cela nous rend humbles,
mais combien efficaces !
Pour l’alcool, le message minimal consiste à poser
la question, puis à demander "connaissez-vous les
normes OMS au sujet des consommations maxi-
males conseillées ?" Réponse très simple, elle
aussi : deux verres par jour pour une femme, trois
verres pour un homme et pouvoir se passer de
consommation un ou deux jours par semaine.
&
O
Q
S
B
U
J
R
V
F
&
O
Q
S
B
U
J
R
V
F
&
O
Q
S
B
U
J
R
V
F
Addict juin0910 ans.indd 31 24/06/09 9:33:40

Le Courrier des addictions (11) – n ° 2 – avril-mai-juin 2009 32
Et que faire de la réponse ?
La réponse amène d’autres questions qui nous
permettent de déterminer si le patient est en
danger vital, ou danger vital différé, ou bien
consommateur excessif, ou simple usager.
Dans ce dernier cas, pas d’autre intervention
à mettre sur pied que la simple information,
le rappel des normes pour les toxiques "licites"
et encouragés par la société hypocrite via les
publicités déguisées !
Ensuite, la consultation se déroulera en inté-
grant les réponses dans la prise en charge glo-
bale du patient qui repartira avec la conclusion
de la consultation, celle-ci ayant à voir ou pas
avec ses consommations.
Au total, si nous voulons aider les patients, qu’ils
soient "addicts" ou aient des problèmes psychia-
triques, le plus important est qu’ils soient pris
en charge, simplement, sans jugement, comme
des patients ordinaires. Comme tous les pa-
tients chroniques avec des pathologies longues,
parfois difficiles "à manager" dans la durée de
prise en charge.
Patients, si vous voulez aider les médecins qui ne
posent pas encore la question, demandez leur :
"Docteur, vous ne me demandez pas si je fume et
si je bois et dans quelles conditions ?"
L’auteur signale qu’elle n’a pas de conflit d’intérêt
à déclarer avec l’industrie pharmaceutique.
v
Bibliographie
(les livres qui m’ont aidée)
– Loi du 4 mars 2002 et décret du 29 avril 2002 sur
l’information du patient.
– Buckman R. S’asseoir pour parler : l’art de com-
muniquer les mauvaises nouvelles aux malades.
Inter éditions Masson, 2003.
– Landry-DattéeN, Delaigue MF. Hôpital silence –
L’enfant et la Vérité. Calmann Levy, 2001.
– Dolto F. Parler juste aux enfants. Le complexe
du homard.
– Balint M. Le médecin, le malade et sa maladie.
Payot, Paris, 1966.
– Basaglia F. Qu’est ce que la psychiatrie. Puf, 1977.
– Tomkiewicz S. L’adolescence volée. Calmann-
Lévy, 1999. Hachette littérature, 2001.
– Buten H. Quand j’avais cinq ans je m’ai tué.
Points Seuil, 2004.
– Miller WR, Rollnick S. L’entretien motivationnel.
Inter éditions, traduction Yves Michaud et Doro-
thée Lecailler, juin 2006.
– Molimard R. Petit manuel de Défume : se recons-
truire sans tabac.
– Molimard R. La fume : smoking.
&
O
Q
S
B
U
J
R
V
F
&
O
Q
S
B
U
J
R
V
F
&
O
Q
S
B
U
J
R
V
F
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
23 septembre 2009 – Mutualité française à Paris de
14 h à 18 h – Collège professionnel des acteurs de l’ad-
dictologie hospitalière. Sous la direction du Pr Fran-
çois Paille, réunion annuelle du COPAAH autour
des thématiques suivantes : Le suivi national du Plan addiction ; Avan-
cées et difficultés de la déclinaison du plan en régions ; Rapport des
groupes de travail du COPAAH.
24-25 septembre 2009 – Maison de la Mutualité à Paris
– 3es assises nationales organisées par la Fédération fran-
çaise d’addictologie (FFA) sur le thème : Addictions, scien-
ces et société. Coordination : Dr Alain Morel.
24-25 septembre 2009 – Zurich, Suisse – 1st International Sympo-
sium on Hepatitis care in substance users. Inscriptions et renseigne-
ments scientifiques : ARUD Zurich Konradstr. 32 8005 Zurich Suisse.
Tél. : +41 44 446 50 10 Fax : +41 44 446 50 15. E-mail : sekretariat@
arud-zh.ch
13 au 16 octobre 2009 – Casino
Bellevue à Biarritz – THS 9, les
Rencontres de Biarritz. Des débats
publics de société seront organisés
sur les thèmes : addictions ; préven-
tion et traitement des co-infections
par le VIH et les hépatites B et C et réduction des risques et politique des
drogues.
Renseignements sur le site Internet : www.ths-biarritz.com. Les pro-
positions de communications sont à envoyer à l’adresse suivante : abs-
tracts[email protected].
THS 8 : Les rencontres de Biarritz, association Bizia-MdM, CHCB-
BP 08, 64109 Bayonne Cedex. Tél. +33 5 59 44 31 00. Portable : +33 6
33 56 22 97. Fax : +33 5 59 52 08 16. www.ths-biarritz.com
13-16 octobre 2009 – Journée de la Soçiété d’addictologie
francophone (SAF) au cours de THS 9 à Biarritz sous la prési-
dence du Pr Boyan Christophorov (modérateur : Dr
Didier Touzeau).
Argument : Malgré bien des idées reçues, les patients dé-
pendants des opiacés font l’expérience des phénomènes
douloureux. Ils rencontrent à la fois une hyperalgésie et
une tolérance aux opiacés. Ils nécessitent en cas de douleur aiguë une
adaptation de leur traitement faite paradoxalement pour les non-initiés
de doses plus fortes, d’une fréquence plus grande et d’une durée plus
longue d’administration. À partir des données neurobiologiques et de re-
cherches cliniques, cet atelier exposera certains aspects pratiques de cette
prise en charge.
– Introduction – Dr Pascal Courty (Clermont-Ferrand).
– Aspects neurobiologiques de la douleur – Dr Florence Noble (Paris).
– Étude TOXIDOL : évaluation des seuils nociceptifs chez des patients
sous TSO – Dr Nicolas Authier (Clermont-Ferrand).
– Étude clinique des modalités de prise en charge de la douleur aiguë
chez les patients substitués par la buprénorphine ou la méthadone –
Dr Vincent Bounes (Toulouse).
– Douleurs et interventions chirurgicales –
Dr Christian Dualé (Clermont-Ferrand).
22 octobre 2009 – Faculté de médecine de
Nancy – 2e Rencontre régionale sur le thème :
Contrôle du tabac : objectif jeunes.
26-27 novembre 2009 – Pa-
lais des Congrès Le Quartz à
Brest, centre de congrès, squa-
re Beethoven, 60, rue du Château, BP
91039, 29210 Brest Cedex 1 – 3e Congrès de la Société française
de tabacologie (SFT) sur le thème : Tabac et santé.
Arrêter le tabac en douceur : DVD interactif de Marion
Adler, tabacologue et Valérie Barres, sophrologue pro-
fessionnelle.
Addict juin0910 ans.indd 32 24/06/09 9:33:41
1
/
2
100%