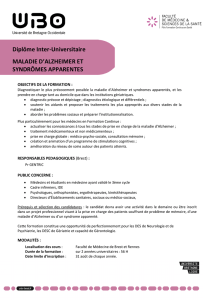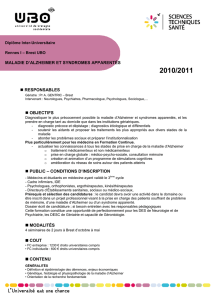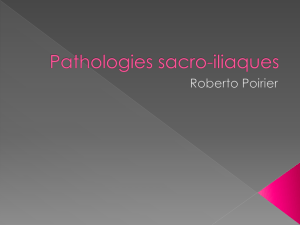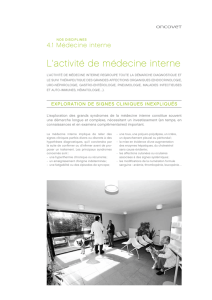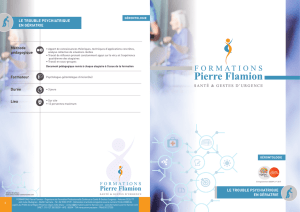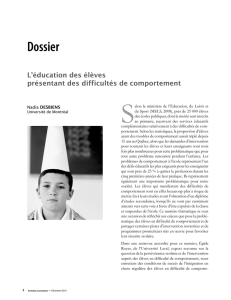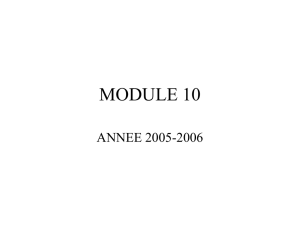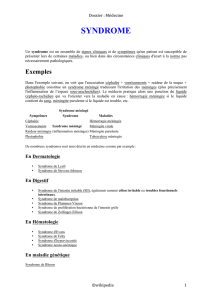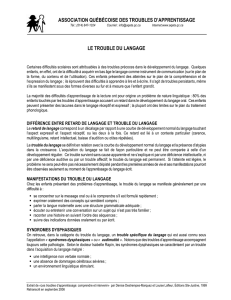R e v u e d e ... Psychiatrie et cultures Nouvelles orientations de la recherche sur les syndromes

67
Nouvelles orientations
de la recherche sur les syndromes
liés à la culture
Rutgers (États-Unis)
Le DSM-IV renferme les descrip-
tions symptomatiques de 25 syn-
dromes liés à la culture, tels que l’Amok,
le Latah et le Koro, définis par le Groupe
sur la culture et le diagnostic de l’Institut
national américain de santé mentale. La
définition du syndrome lié à la culture,
présentée dans l’introduction du glossai-
re des syndromes liés à la culture, dans
l’appendice I du DSM-IV, est la
suivante : “Le terme syndrome lié à la
culture désigne des ensembles de carac-
téristiques récurrentes, spécifiques d’une
région, de comportement aberrant et
d’expérience inquiétante, qui peuvent ou
non être reliés à une catégorie particuliè-
re de diagnostic du DSM-IV. Bon nombre
de ces profils sont considérés par les
indigènes comme des ‘maladies’, ou au
moins comme des afflictions, et portent
un nom local (...). Les syndromes liés à la
culture sont généralement limités à des
sociétés spécifiques ou des zones cultu-
relles et sont des catégories de diagnostic
localisées, populaires, qui attribuent des
significations cohérentes pour certains
ensembles d’observations et d’expé-
riences répétitives et troublantes.” La
diversité ethnique et culturelle croissante
de la population des États-Unis, mais
aussi de la plupart des pays occidentaux,
et le fait que les éditions du DSM soient
devenues des documents de référence
internationaux justifient de développer
des approches véritablement transcultu-
relles de santé mentale, tant en ce qui
concerne la recherche que les services
de soins. (Research on culture-bound
syndromes : New directions. American
Journal of Psychiatry 1999 ; 156 : 1322-7).
P. Guarnaccia et L. Rogler font la critique
Revue de presse
Psychiatrie et cultures
E. Bacon, chercheur Inserm U 405, clinique psychiatrique, CHU de Strasbourg
Il y a plusieurs raisons de s’intéresser aux syndromes liés à
la culture. On ne peut que constater la diversité culturelle
des personnes requérant des soins de santé mentale, qui
reflète la diversité culturelle croissante des sociétés occiden-
talisées. Les migrations, avec leur cortège d’adaptation cul-
turelle et d’exposition potentielle à des expériences trauma-
tisantes, constituent un défi pour la santé mentale.
Historiquement, les migrations ont eu pour origine des
motifs divers : économiques, politiques, culturels ou reli-
gieux. Elles ont pour effet la séparation d’avec la famille, la
mère patrie, souvent la perte du statut social et des biens.
Émigrer amène la personne dans un environnement culturel
qui ne lui est pas familier, implique la nécessité d’adaptation
au nouvel environnement et entraîne souvent un sentiment de
rejet, ainsi qu’une certaine confusion en ce qui concerne le
rôle, la valeur et l’identité, tous facteurs importants pour la
santé mentale des migrants. Le statut d’immigré est souvent
considéré comme un facteur de risque de développer des
troubles psychiatriques. Les migrants peuvent arriver avec
une pathologie préexistante, aussi bien que souffrir de
symptômes provoqués ou intensifiés par les difficultés des
événements récents. Une autre raison de s’intéresser aux
syndromes liés à la culture se trouve dans le fait que les édi-
tions du DSM sont aujourd’hui devenues des documents de
référence internationaux, et le DSM-IV inclut des syndromes
liés à la culture, ce qui devrait élargir l’utilité de ce manuel.

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) - n° 3 - mars 2000 68
des analyses antérieures de la relation
entre les syndromes liés à la culture et les
diagnostics psychiatriques. Le problème
des classifications précédentes était de
tenter d’incorporer les syndromes liés à
la culture dans des catégories psychia-
triques préexistantes, plutôt que les étu-
dier en tant que tels. Pour pouvoir com-
prendre les syndromes liés à la culture
dans leur contexte culturel et pouvoir
analyser leur relation avec les troubles
psychiatriques, les auteurs proposent un
programme de recherche fondé sur
quatre questions clés et l’illustrent avec
la présentation d’un syndrome culturel
latino-caraïbe dénommé Ataques de
Nervos. La première question interroge
la nature du phénomène : une manière
d’étudier un syndrome lié à la culture est
de se référer à la littérature de recherche
en anthropologie et en psychiatrie. La
deuxième question a trait à la localisation
socioculturelle du syndrome. Il s’agit
d’identifier les caractéristiques sociales
des personnes souffrant de cette patholo-
gie. Le contexte permet de spécifier les
situations sociales dans lesquelles un
syndrome lié à la culture pourrait appa-
raître. Les Ataques de Nervos, par
exemple, sont provoquées par des
menaces pesant sur l’environnement
social local du patient, comme la famille.
La troisième question vise à déterminer
comment le syndrome lié à la culture
peut être empiriquement mis en relation
avec un trouble psychiatrique. Si des
recherches systématiques ont permis
d’identifier des relations fortes entre des
syndromes liés à la culture et certains cri-
tères de diagnostic psychiatrique, on
observe rarement une relation simple
entre un syndrome culturel et un trouble
psychiatrique prédéfini. Les syndromes
liés à la culture coexistent souvent avec
un ensemble de troubles psychiatriques,
comme coexistent entre eux bon nombre
de troubles psychiatriques, et la question
de la comorbidité est ici aussi posée. Le
quatrième aspect à prendre en compte est
l’histoire sociale et psychiatrique du syn-
drome au cours de la vie du patient. La
recherche sur les syndromes liés à la cul-
ture a une utilité stratégique dans l’inté-
gration des connaissances culturelles et
psychiatriques, permettant des avancées
tant dans l’universalité des diagnostics
que pour la spécificité culturelle.
Mots clés : DSM-IV - Syndrome lié à la
culture.
Ethnicité et évolution
de la psychose
Londres (Grande-Bretagne)
Au Royaume-Uni, l’incidence de la
schizophrénie est plus élevée dans
la population noire que chez les Blancs.
N. Goater et ses collaborateurs présen-
tent les résultats de la première étude
prospective sur cinq ans de premiers épi-
sodes de psychose, réalisée auprès de dif-
férents groupes ethniques en Grande-
Bretagne (Goater N., King M., Cole E. et
coll. Ethnicity and outcome of psychosis.
British Journal of Psychiatry 1999 ;
175 : 34-42). Faisaient partie du recrute-
ment toutes les personnes âgées de 16 à
54 ans, résidant dans l’aire géographique
d’un hôpital psychiatrique londonien et
ayant eu un premier contact avec un tel
service entre juin 1991 et juin 1992. Il
s’agissait d’une population urbaine, dont
28 % étaient considérés comme prove-
nant d’une minorité ethnique. Les
patients ont passé des entretiens à cette
époque, et à nouveau un an puis cinq ans
plus tard. Les auteurs ont utilisé un ques-
tionnaire semi-structuré incluant des
données démographiques et biogra-
phiques. Les symptômes psychiatriques
étaient évalués à l’aide de la 9eédition du
PSE (Present State Examination) et du
SCL (Syndrome Checklist). Un certain
nombre d’autres informations (contact
avec les services hospitaliers, avec la
police, observance du traitement, etc.)
ont été recueillies à un an et cinq ans. Les
patients étaient répartis en plusieurs groupes :
Blancs, Noirs, Asiatiques et autres, pour
les calculs des taux d’incidence. Pour les
autres analyses, les Asiatiques ont été
combinés avec les “autres”. Parmi les
93 patients, 39 étaient des Blancs, 38 des
Noirs, 11 des Asiatiques et 5 d’autres
groupes ethniques. L’âge moyen au
moment du recrutement était de 30 ans,
et 42 % d’entre eux étaient nés à l’étran-
ger (immigrants de première génération).
Les taux d’incidence de schizophrénie et
de psychose non affective étaient supé-
rieurs à ceux des Blancs dans tous les
groupes ethniques et à toutes les dates. À
cinq ans, cet excès était statistiquement
significatif pour la schizophrénie dans
les populations asiatique et noire. Pour
24 % des patients, l’évolution de la mala-
die était positive (récupération complète
sans épisode ultérieur) à la première date
du suivi, mais cela restait le cas pour seu-
lement 8 de ces sujets au bout de cinq ans.
Les auteurs n’observent pas d’associa-
tion entre les scores à l’échelle SANS
(symptômes négatifs) et le groupe eth-
nique. L’ethnicité n’était pas associée
avec le décours de la maladie ou la stabi-
lité du diagnostic sur cinq ans, et le suivi
des patients était similaire pour tous les
groupes. En revanche, les données
confirment l’excès de cas de schizophré-
nie et de psychoses non affectives chez
des sujets noirs vivant en Grande-
Bretagne. Au cours des cinq années,
48 patients (54 %) ont été amenés à l’hô-
pital au moins une fois par la police. La
cinquième année, tous les 6 patients ame-
nés par la police étaient de race noire et
5d’entre eux étaient schizophrènes. Les
patients noirs avaient également, plus
que les autres, été retenus à l’hôpital et
reçu des injections d’urgence. L’explication
des situations plus difficiles vécues par
les patients noirs pourrait trouver son ori-
gine dans l’expression de la maladie, qui
peut varier d’un groupe ethnique à
Revue de presse

69
l’autre, ou dans la perception et les
actions des autres. Les auteurs ont obser-
vé des preuves indirectes mais évidentes
de mise en œuvre, par les psychiatres, de
discrimination ou d’images stéréotypées
des patients. Une autre observation
importante est le fait que les personnes
issues de groupes ethniques minoritaires
étaient moins susceptibles d’être admises
à l’hôpital et que l’observance du traite-
ment au début de la maladie était plus
faible chez les Noirs. Ces patients et
leurs familles pourraient avoir plus de
répugnance que les Blancs à admettre
l’admission à l’hôpital, ou peut-être sont-
ce les professionnels qui demandent
moins souvent l’hospitalisation. Ces
observations renforcent l’importance
d’unités spécialisées dans les premiers
épisodes de psychose.
Mots clés : Psychose - Schizophrénie -
Minorités ethniques - Étude prospective.
Un outil de comparaison
pour les enfants de différentes cultures
Rotterdam (Pays-Bas)
Des procédures solides et transcul-
turelles d’établissement des carac-
téristiques des sujets peuvent permettre
de faciliter la recherche, la formation et
la communication des professionnels de
santé mentale de différentes cultures.
Elles sont également utiles pour aider les
cliniciens dans l’évaluation de la santé
des nombreux enfants réfugiés ou immi-
grants. La présente étude a été mise au
point afin de tester les variations inter-
culturelles de syndromes pour douze cul-
tures (Crijnen A., Achenbach T., Verhulst
F. Problems reported by parents of chil-
dren in multiple cultures : the child beha-
vior checklist syndrome construct.
American Journal of Psychiatry 1999 ;
156 : 569-74). En comparant toutes les
cultures avec le même outil d’analyse,
l’intention des auteurs était d’identifier
celles qui dévient significativement d’un
score moyen omniculturel pour chaque
syndrome. Les Child behavior checklists
ont été analysés pour 13 700 enfants et
adolescents de 6 à 17 ans, issus de la
population générale d’Autriche, de
Belgique, de Chine, d’Allemagne, de
Grèce, d’Israël, de la Jamaïque, des Pays-
Bas, de Porto Rico, de Suède, de
Thaïlande et des États-Unis. Les pro-
blèmes comportementaux et émotionnels
des enfants étaient rapportés par les
parents et concernaient 8 syndromes. Les
effets et les interactions de l’âge et du
sexe ont également été pris en compte
dans les calculs. Neuf de ces cultures ont
fourni les données permettant d’étudier
les 8 syndromes dans les 4 groupes d’âge
et pour les deux sexes. Les études belge,
chinoise et grecque n’incluant pas suffi-
samment d’adolescents, leurs données
n’ont été prises en compte que dans les
deux groupes d’âge inférieur (6-8 ans et
9-11 ans). Les ANOVAS ont révélé des
effets significatifs de la culture pour cha-
cun des 8 syndromes : des effets modérés
pour le repli et les problèmes sociaux,
des effets de faible amplitude pour les
plaintes somatiques, les problèmes
anxieux ou dépressifs, les problèmes de
pensée, d’attention, les comportements
délinquants et agressifs. Les scores des
enfants portoricains étaient les plus éle-
vés, cependant que les Suédois avaient
les scores les plus bas pour presque tous
les syndromes. Toutefois, les différences
entre ces deux populations reflètent peut-
être des différences d’échantillonnage :
la population portoricaine provenait de
toute l’île, cependant que l’échantillon
suédois provenait uniquement des
régions de Stockholm et d’Uppsala, et le
niveau socio-économique du groupe sué-
dois était supérieur. Les filles avaient des
scores plus élevés que les garçons en ce
qui concerne les plaintes somatiques, les
troubles anxieux et dépressifs, mais des
scores plus faibles pour les problèmes
attentionnels, les comportements délin-
quants et agressifs, et ce avec une grande
stabilité transculturelle. Quoique remar-
quablement cohérentes à travers les cul-
tures, les caractéristiques développemen-
tales variaient selon le syndrome. Les
différences dans les scores relativement
faibles observées parmi les douze cul-
tures indiquent qu’une évaluation stan-
dardisée empirique est possible et peut
fournir aux cliniciens une base solide
pour évaluer les scores des différents
syndromes obtenus par des enfants de
cultures diverses. Il est toutefois indis-
pensable d’intégrer la connaissance des
variations interculturelles des différents
syndromes, de garder à l’esprit les varia-
tions possibles dans l’estimation des pro-
blèmes d’un enfant (des parents de cul-
tures différentes peuvent avoir des cri-
tères différents pour rapporter des types
de problèmes particuliers) et de se ren-
seigner sur les caractéristiques fami-
liales, pour juger de la nécessité d’une
intervention.
Mots clés : Culture - Enfance.
Comparaisons interculturelles
des symptômes dépressifs
chez les personnes âgées en Europe
(CEE)
Que les personnes âgées soient
généralement déprimées, misé-
rables et fatiguées est une opinion large-
ment répandue en Europe, tant auprès
des services de soin et d’aide sociale que
de la population générale. Il est aisé de
croire que les personnes âgées n’ont pas
grand-chose à attendre de l’avenir,
qu’elles ont peu de centres d’intérêt et
que leurs activités sont restreintes par des
niveaux divers de douleur et d’incapacité.
Cette attitude encourage un certain pessi-
misme thérapeutique et une demande de

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (17) - n° 3 - mars 2000 70
redistribution des ressources vers ceux
qui sont supposés pouvoir en retirer plus
de bénéfice. La dépression et la démence
sont les deux maladies mentales les plus
importantes de la fin de vie. Toutes deux
sont destructrices de la qualité de vie. La
dépression n’est toutefois pas totalement
répandue, en ce sens qu’elle affecte entre
9 et 24 % des personnes de plus de
65 ans, comme montré par une étude ini-
tiée par les communautés européennes
(programme Biomed). De 76 à 91 % des
personnes âgées n’ont à aucun moment
souffert de dépression. Toutefois, il est
possible qu’une proportion substantielle
de symptômes dépressifs puisse être
constatée chez des sujets que les méde-
cins ont considérés comme ne nécessi-
tant pas de traitement. S’il existe en
Europe des différences culturelles dans
l’expression de la dépression, suscep-
tibles de rendre plus difficile sa mise en
évidence, il est important de les identi-
fier. Les auteurs de cet article ont étudié
la prévalence et la distribution des symp-
tômes dépressifs dans les centres euro-
péens participant au programme Eurodep
(Copeland J., Beekman A., Dewey M. et
coll. Cross-cultural comparison of depres-
sive symptoms in Europe does not sup-
port stereotypes of ageing. British
Journal of Psychiatry 1999 ; 174 : 322-9).
Ils se sont intéressés aux personnes âgées
de 65 ans et plus, classées ou non comme
dépressives, et ont essayé de répondre
aux questions suivantes : la proportion de
symptômes dépressifs dans ces popula-
tions est-elle élevée ? Existe-t-il des dif-
férences dans la distribution des symp-
tômes parmi les personnes dépressives de
différents pays d’Europe ? Peut-on identi-
fier un ensemble de symptômes qui
seraient communs à tous les sujets dans
tous les centres ? Enfin, la prévalence
des symptômes dépressifs augmente-t-
elle avec l’âge ? Neuf centres ont partici-
pé à l’étude (un aux Pays-Bas, 2 en
Allemagne, 2 en Grande-Bretagne, 2 en
Espagne, un en Irlande et un en Islande).
La proportion de symptômes dépressifs
variait considérablement selon les
centres. Beaucoup de symptômes étaient
plus fréquents chez les femmes, et les
symptômes clairement identifiés comme
souvent associés à l’âge étaient rares.
Dans les centres présentant une faible
prévalence, les symptômes étaient égale-
ment moins nombreux chez les sujets “en
bonne santé”, mais on observait quelques
contradictions. Ainsi, des taux faibles de
symptômes parmi la population bien por-
tante ne prédisaient pas nécessairement
des taux plus faibles chez les déprimés. Il
n’y avait pas de consensus entre les
centres en ce qui concerne l’augmenta-
tion de prévalence de la dépression avec
l’âge. Dans certains centres seulement, la
prévalence de symptômes dépressifs aug-
mentait avec l’âge, mais non la dépres-
sion diagnostiquée. Peu parmi les non-
déprimés considéraient que la vie ne vaut
pas d’être vécue. Pour plus de 60 % des
personnes âgées de la population généra-
le, les taux de symptômes dépressifs
étaient faibles, les stéréotypes concernant
l’âge ne sont donc pas confirmés. Il faut
toutefois garder à l’esprit que la popula-
tion rurale n’était pas bien représentée
dans l’échantillonnage.
Mots clés : Vieillissement - Culture -
Europe - Dépression.
Pour en savoir plus
➙Cheng A,. Chang J. Mental health
aspects of culture and migration. Current
Opinion in Psychiatry 1999 ; 12 : 217-22.
Des études récentes suggèrent que le sup-
port social et l’intégration culturelle, plu-
tôt que l’acculturation, constituent des
facteurs protecteurs pour les immigrants.
➙Iancu I., Spivak B., Mester R. Weizman
A. Belief in transmigration of the soul and
psychopathology in Israeli Druze.
Psychopathology 1998 ; 31 : 52-8.
Une des croyances centrales de la reli-
gion druze est la transmigration de
l’âme. Dans de rares cas, comme ceux
présentés dans cet article, cette croyance
peut être reliée à une psychopathologie
ou provoquer une incapacité temporaire à
fonctionner normalement.
➙Kirov G. Murray R. Ethnic differences
in the presentation of bipolar affective
disorder. Eur Psychiatry 1999 ; 14 199-
204.
Une étude des caractéristiques cliniques
de trois groupes ethniques (anglais, afro-
caraïbes, africain) de patients traités par
le lithium.
➙Harrison G., Amin S., Singh P. et coll.
Outcome of psychosis in people of afri-
can-carribean family origin. British
Journal of Psychiatry 1999 ; 175 :43-9.
Le but des auteurs était de tester l’hypo-
thèse, non confirmée par leur étude,
selon laquelle les nombreux cas de psy-
chose rapportés parmi les populations
afro-caraïbes vivant en Grande-Bretagne
pourraient être le fait d’un excès de psy-
choses affectives avec un pronostic favo-
rable.
Revue de presse
Le thème de la revue de presse du mois d’avril sera :
Alcool et psychopathologie
1
/
4
100%