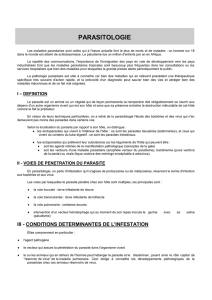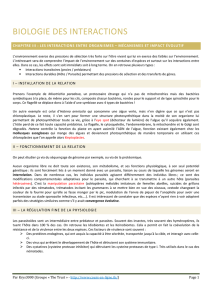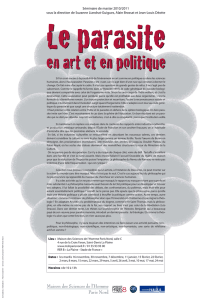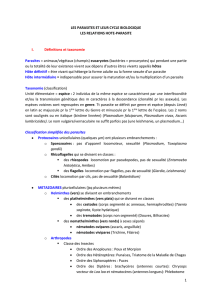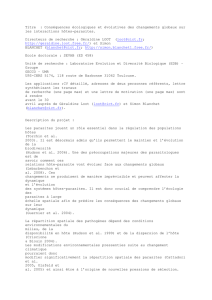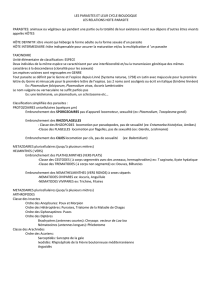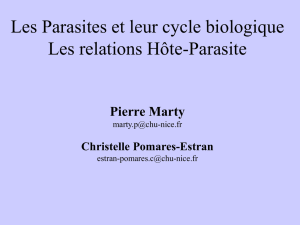Epidémiologie des maladies contagieuses, écologie des

Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 1993,12 (1), 219-234
Epidémiologie des maladies contagieuses,
écologie des mammifères, santé, gestion
et biologie de la conservation de la nature :
remarques de conclusion
M. ARTOIS *
Résumé : En conclusion des Actes du Symposium sur la santé et la gestion des
mammifères en liberté (tenu à Nancy, France, en 1991), l'auteur présente une
revue de la littérature sur l'écologie des maladies des mammifères sauvages.
Cette discipline ported la fois sur l'écologie des agents pathogènes et sur celle de
leurs hôtes. L'écologie d'un agent pathogène peut être considérée comme
synonyme d'épidémiologie, c'est-à-dire couvrir le mode de transmission et de
circulation des parasites, leur origine, leurs modes d'invasion et leur
persistance. L'écologie de l'hôte considère l'évolution de l'infection à
différentes échelles, géographique et temporelle :
a) impact sur la densité des populations et sur les peuplements, apprécié à
l'échelle temporelle de l'«observateur»,
b) effet de l'infection sur la coévolution des hôtes et des agents pathogènes,
apprécié à l'échelle temporelle de l'évolution.
Cette présentation est illustrée par de nombreux exemples tirés d'études sur
le terrain, ainsi que de modèles mathématiques. L'auteur conclut en examinant
l'effet des agents pathogènes sur la diversité biologique, la santé humaine et la
santé des animaux domestiques.
MOTS-CLÉS : Animaux sauvages - Comportement - Diversité biologique -
Ecologie - Maladies animales - Mammifères - Revue de la littérature.
INTRODUCTION
Une des principales difficultés dans l'étude des maladies des mammifères en liberté
(voir ci-dessous les remarques sur ces termes) est la méthode de quantification de la
morbidité et de la mortalité. Un autre problème est d'attribuer la mortalité à un agent
causal spécifique (75). Il est difficile de déterminer, d'après l'observation d'un cas isolé,
si
la mauvaise condition physique de l'individu a facilité l'action du pathogène ou si elle
résulte de celle-ci.
Pour le pathologiste ou le clinicien habitués à traiter des cas uniques, une approche
des problèmes de maladie faite à l'échelle de la population est généralement considérée
* Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, Laboratoire d'études sur la rage et la
pathologie des animaux sauvages (CNEVA-LERPAS), B.P. 9,54220 Malzéville, France.

220
comme trop ambitieuse. Cette approche est tout aussi difficile pour des biologistes ou
des écologistes qui ont l'expérience de l'analyse d'écosystèmes complets, car les effets
néfastes du parasite sont impossibles à décrire en termes de transferts d'énergie. Par
conséquent, ces problèmes ont rarement été pris en compte dans un passé récent. Par
chance, la prise en compte des agents pathogènes dans la description des écosystèmes,
grâce au concept de pathobiocœnose (9) ou pathocœnose (40), ont focalisé l'attention
sur le mode de vie parasitaire qui est un des plus communément adoptés à l'intérieur du
règne animal (3). L'importance des agents pathogènes dans les populations naturelles
peut désormais être étudiée de façon plus précise. En soulignant l'importance du
parasitisme dans différents peuplements de mammifères, Barbehenn (12) fut un des
premiers à suggérer que l'impact des parasites était plutôt qualitatif que quantitatif,
ouvrant ainsi la voie à des recherches ultérieures fécondes.
L'approche écologique de la maladie peut être subdivisée en deux branches :
l'écologie du parasite (ou simplement l'«épidémiologie») et l'écologie de l'hôte (c'est-à-
dire des vecteurs, réservoirs et victimes du parasite). Nous suivrons cette dichotomie en
examinant, tout d'abord la transmission et la circulation des parasites parmi leurs hôtes
(origine, invasion, persistance) et ensuite l'impact écologique de la maladie sur la
population hôte, à différentes échelles de temps.
Remarques sur la terminologie
Le terme de maladie est utilisé ici dans son sens le plus large d'infection, sans être
nécessairement associé avec la notion de symptômes. Le terme de parasite fait référence
aux micro-organismes capables de spolier leur hôte d'énergie ou de composants
biologiques aussi bien que de détruire des cellules ou des tissus. Il est d'usage de
distinguer les microparasites (c'est-à-dire virus, bactéries, protozoaires) dont la petite
taille ne permet pas un décompte précis des individus, des macroparasites (c'est-à-dire
helminthes, arthropodes), qui peuvent être étudiés individuellement.
La notion de mammifères en liberté recouvre toutes les espèces de mammifères dont
les mouvements ou la reproduction ne sont pas sous le contrôle direct de l'Homme, au
moins dans une partie de leur aire de répartition. Par conséquent, cette définition
s'étend par exemple du chat du désert de Chine, qu'aucun scientifique n'a vu vivant, au
chat errant domestique. Aucune mention ne sera faite des problèmes liés aux maladies
non contagieuses ou à l'écologie des intoxications dues aux plantes. Ce dernier domaine
a de nombreuses similarités avec l'étude des agents pathogènes.
Pour une introduction aux maladies des mammifères, voir aussi Davis et Anderson
(24) et Davis et coll. (25).
ÉCOLOGIE DES PARASITES
Modes de transmission
Le parasite doit faire face à une contrainte unique afin de survivre : son
environnement, l'hôte, est un écosystème discontinu destiné à périr (31). En
conséquence, le parasite (ou sa descendance) doit quitter son hôte et être transmis à un
autre. Ce passage peut nécessiter une forme de vie passive ou active dans
l'environnement extérieur.

221
Transmission au moyen d'un «comportement normal» de l'hôte
Dans certains cas, la transmission du parasite suit les comportements «normaux»,
mais complexes de l'hôte (par exemple, le parasitisme des renards par les tiques en
relation avec le mode d'occupation des terriers) (8). Il est donc indispensable de bien
connaître l'écologie de l'hôte afin de comprendre comment un parasite peut passer d'un
individu à un autre. La transmission de la trichinellose, qui est causée par un parasite
monoxène, est accomplie seulement par prédation, cannibalisme ou nécrophagie. Les
études épidémiologiques ont démontré l'importance du renard comme réservoir de
Trichinella sp. Le renard n'est pas connu pour des tendances cannibales ; des tests
conduits par Macdonald ont montré que les renards répugnent à consommer la chair
d'autres renards (52). Toutefois, Rossi et coll. ont montré lors du Symposium de Nancy
que le froid hivernal peut tuer des renards dans les régions montagneuses, et la famine
peut pousser les renards survivants à manger ces carcasses (72). La rage canine a
également été évoquée au Symposium de Nancy, notamment dans la contribution de
Wandeler et coll. (90). Cette étude démontre la variabilité des réseaux de diffusion et de
persistance des zoonoses et montre que les connexions entre classes d'individus et entre
espèces différentes (chiens et hommes), interviennent souvent à plusieurs niveaux
d'organisation (c'est-à-dire culturel, comportemental, alimentaire). L'interruption des
cycles parasitaires
s'est
donc révélée plus difficile à réussir que ne l'avaient espéré les
autorités sanitaires.
Moyens de faciliter la transmission
Les parasites adoptent généralement des stratégies démographiques de type «r»
(fondées sur la prolifération des formes de diffusion, telles que les œufs, les larves et les
kystes). Toutefois, Combes a montré que de nombreuses espèces modifient ou
provoquent des comportements de l'hôte qui favorisent la transmission (22). En raison
de l'infection par le parasite, les mouvements de l'hôte sont orientés en direction de
points favorables au contact entre l'hôte et le parasite. Ou bien encore, l'infection par le
parasite crée des situations de contre-mimétisme qui facilitent l'ingestion d'un parasite
ou d'un hôte parasité par un prédateur.
De nombreuses études ont confirmé, par exemple, qu'un rongeur infesté par des
larves de Trichinella ou Toxoplasma adoptera un comportement qui facilitera sa
capture par un prédateur. Toutefois, la disponibilité de proies affaiblies par l'action du
parasite pose un dilemme au prédateur : en effet, un prédateur peut soit capturer une
proie affaiblie afin de dépenser moins d'énergie, mais il court le risque de devenir
infecté, soit dépenser de l'énergie en essayant de capturer une proie saine, mais il risque
alors de mourir de faim (58). D'autres exemples de changements de comportement
induits par les parasites sont illustrés par l'augmentation des niveaux d'activité (46), la
réduction de la vitesse des déplacements (67, 68) ou bien la perte des réflexes de
néophobie (47). Le rythme biologique des microfilaires, qui migrent à l'intérieur du
corps en traversant le réseau des capillaires sous-cutanés, est lié au rythme de l'activité
nycthémérale du vecteur, un moustique piqueur (11,19,45).
Ces types de comportement résultent-ils automatiquement de la spoliation ou des
lésions tissulaires induites par la présence du parasite (par exemple, les élans
lourdement infestés par des larves hépatiques d'Echinococcus granulosus sont plus
facilement capturés par les loups) (55), ou bien le comportement est-il modifié de façon
à favoriser la transmission à l'aide de médiateurs chimiques (c'est-à-dire : hormones,
neuromédiateurs), dont la sécrétion serait modifiée par le parasite ? Les trypanosomes
modifient la sécrétion de serotonine, ce qui change le rythme circadien de campagnols

222
du genre Microtus (76). Des essais sur des hamsters dorés mâles (Mesocricetus auritus)
suggèrent que l'infection par Schistosoma mansoni produit une augmentation
différentielle de l'activité Opioide endogène. Ces Opioides influent sur la régulation du
comportement alimentaire et sur l'agressivité (49).
Peu d'attention a été portée à ces aspects dans le cas de microparasites. Il est
seulement connu que quelques Carnivores infestés par des agents pathogènes voient
leurs déplacements désorganisés, ce qui pourrait favoriser, par exemple, la transmission
de la tuberculose chez le blaireau (20) et de la rage chez le renard (Vulpes vulpes) (7).
Modèles épidémiques simples
Les progrès de la modélisation mathématique ont considérablement clarifié la
compréhension de l'écologie des maladies contagieuses. Admettant qu'une population
hôte peut être hétérogène et avoir une démographie variable, les modèles déterministes
d'Anderson et May (2) et de May et Anderson (54) ont ouvert une voie particulièrement
intéressante qui est toujours explorée aujourd'hui. L'intérêt de ces modèles est leur
simplicité. Néanmoins, à différents stades de développement d'une maladie, le hasard
peut jouer un rôle essentiel : en phase d'initiation ou d'extinction d'une maladie au sein
d'une population hôte de petite taille, ou lorsque la distribution de l'infection est
hétérogène, des modèles stochastiques plus sophistiqués sont indispensables (59) mais
ceux-ci sont moins accessibles aux biologistes.
La population peut être divisée en compartiments homogènes, en fonction du stade
de l'infection, ce qui permet de simuler chaque événement pour chaque individu. La
transition d'un compartiment (ou d'un stade) au suivant, est calculée pour chaque
période de temps par des ajustements successifs, déterminés par les observations ou les
estimations qui sont faites. Dans le cas des microparasites, les compartiments sont
constitués par les classes de la population hôte (c'est-à-dire
:
individus sensibles, individus
à différents stades de l'infection, individus malades). Dans le cas de macroparasites, les
différents stades de la population du parasite (les œufs, les larves de différents stades et les
adultes) sont simulés aux fur et à mesure de leur apparition chez les hôtes ou dans
l'environnement extérieur. Une fois connus l'effectif de la population et son taux
d'accroissement, un modèle nécessite seulement quelques paramètres de base.
Dans sa forme déterministe, l'équation de base donne le nombre d'hôtes infectés par
unité de temps de la façon suivante (5) :
dY = (ßX-d)Y
dt
où : Y = densité des hôtes infectés ;
X = densité des hôtes susceptibles ;
ß = coefficient de transmission ;
1/d = espérance de vie d'un hôte infecté, déterminée par les taux de
mortalité de l'hôte et de guérison de l'infection.
L'amplitude de «R0», le taux reproductif de base, est d'une importance cruciale.
Dans le cas d'un microparasite, R0 est le nombre de cas secondaires par unité de temps
(c'est-à-dire le nombre d'hôtes infectés par un cas initial). La tuberculose du blaireau en
fournit un bon exemple (4). Dans le cas d'un macroparasite, R0 est la descendance
moyenne d'un parasite (5). R0 est donné par :
R0 = ß/d

223
Les considérations qui vont suivre concernant la diffusion et la persistance des
maladies des mammifères, ainsi que l'impact des parasites sur les populations et les
peuplements, sont dans une large mesure inspirées par les modèles d'Anderson et May,
déjà mentionnés (2,5,53,54) et par quelques autres.
Diffusion et persistance
L'origine des maladies
A l'origine, toute maladie se propage en suivant un processus d'invasion. Cette
invasion résulte de changements brutaux dans les relations hôte-parasite, qui rendent le
parasite pathogène pour l'hôte. Le changement peut être d'origine endogène, dû à une
modification génétique de l'hôte (qui devient sensible) ou du parasite (qui devient
pathogène) ; le changement peut être exogène, mettant en contact un hôte et un
parasite qui étaient auparavant séparés. La première origine est peu probable, mais
existe en tant que processus de l'évolution. La seconde origine était également
improbable avant que l'Homme ne perturbe la biosphère en modifiant les écosystèmes
et en mettant en contact les pathobiocœnoses de la planète.
Il existe peu d'études portant sur l'origine lointaine des maladies de la faune, mais
une revue des parasitoses de l'Homme, faite par Combes (21), est à cet égard très
instructive. Cet auteur compare l'histoire évolutive de l'Homme et des macroparasites,
suggérant que les faunes parasitaires des proies ou des symbiotes de l'Homme sont
devenues capables de coloniser ce dernier comme nouvel hôte, à la suite de
changements dans le comportement humain. Ensuite ces parasites étrangers ont infecté
l'Homme, à la faveur de nouvelles adaptations génétiques mutuelles.
Invasion
Les modèles déterministes (30) précisent que le succès d'une invasion repose sur le
fait qu'un agent pathogène doit avoir accès à un groupe suffisamment dense d'individus
sensibles. Différentes stratégies permettent aux parasites envahisseurs de contrecarrer
l'effet d'une densité trop faible d'hôtes sensibles : transmission verticale (de la mère à la
descendance), contournement des défenses immunitaires (variabilité antigénique des
influenzavirus et des rétrovirus), diffusion par des vecteurs, etc. Néanmoins, dans le cas
de cycles heteroxènes, le succès de l'invasion nécessite également des conditions
favorables pour la survie et la propagation des hôtes intermédiaires. Les modèles
indiquent que les macroparasites, qui ont un cycle direct, sont de bons envahisseurs,
puisqu'ils nécessitent une densité critique seuil basse, et que les stades adultes des
parasites donnent naissance à un grand nombre de stades infestants ayant une longue
durée de vie. De façon opposée, les microparasites à transmission horizontale, qui sont
très pathogènes ou qui permettent une guérison rapide avec une immunité durable, sont
de mauvais envahisseurs.
Persistance
Afin de persister au sein d'une population, un envahisseur a besoin d'un nombre
suffisamment élevé d'hôtes. Pour cette raison, la persistance de maladies sur de petites
îles est difficile (par exemple la rage en Corse ou la rougeole en Islande). Les stratégies
employées pour contrebalancer l'effet de populations hôtes insuffisantes impliquent la
prolongation de la durée de vie des stades infectants (par exemple, de longues périodes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%