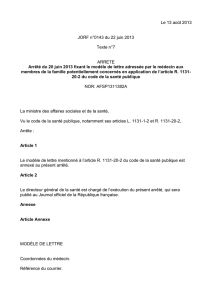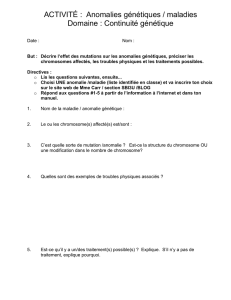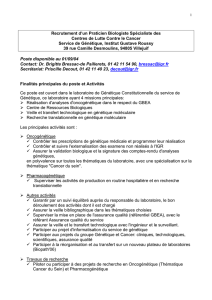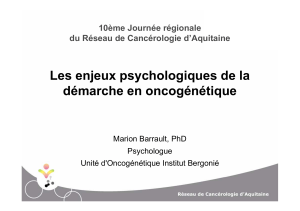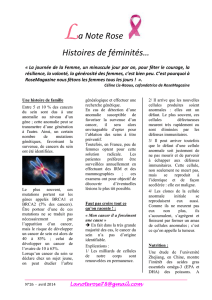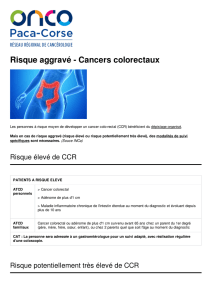10
La Lettre du Gynécologue - n° 254 - septembre 2000
L’
institut Gustave-Roussy propose depuis plusieurs
années une consultation d’oncogénétique**. Deux
populations de consultants s’y présentent : d’un côté
ceux qui ont eu un cancer et qui viennent surtout pour savoir s’ils
ont transmis quelque chose de délétère à leurs enfants ; de l’autre,
des personnes n’ayant pas eu de cancer mais convaincues qu’il
y a dans la famille une anomalie favorisant l’apparition de can-
cers.
La grande majorité des consultants sont des femmes en souci
par rapport au cancer du sein, en général plutôt persuadées
qu’elles sont porteuses d’un gène délétère.
Qu’elles aient eu ou non un cancer, elles ont des points com-
muns : vouloir sortir du doute et savoir si elles ont transmis
quelque chose à leur descendance.
ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ DE L’EXISTENCE
D’UNE ANOMALIE GÉNÉTIQUE FAMILIALE
Lors du premier entretien, le médecin oncogénéticien consti-
tue, sous les yeux de la consultante et suivant les données
d’anamnèse qu’elle lui apporte, un arbre généalogique en se
centrant uniquement sur les cas de cancers et l’âge de leur
apparition.
La première question à laquelle il va tenter de répondre est :
existe-t-il dans cette famille une anomalie génétique liée aux
cancers qui s’y sont produits ?
Lorsqu’il a suffisamment d’éléments, l’oncogénéticien peut
estimer que les cancers de la famille sont d’occurrence spora-
dique et qu’il y a très peu de probabilités pour qu’il y ait un
gène délétère dans cette famille-là.
Cette première estimation peut surprendre une consultante
venue avec sa conviction : il peut être difficile, pour une
femme dont la mère et une tante ou une grand-mère sont
mortes d’un cancer du sein, d’accepter l’idée que ces deux can-
cers puissent être liés à l’apparition normale d’une maladie
dans une population donnée.
On voit tout de suite le choc qui se produit entre une explica-
tion épidémiologique, répondant à la statistique et à la courbe
de distribution d’une maladie dans telle population ou tel
groupe d’âge, et une personne qui ne voit que la répétition de
la même maladie aux conséquences dramatiques chez des
membres de sa famille qui lui ont été très proches.
L’élément important que ce genre de situation met en lumière
est la différence entre la logique médicale scientifique et la
logique psychique : chaque individu se fait une interprétation
et une théorie des événements familiaux en général et des
maladies et des morts en particulier. Il n’est pas évident de
renoncer à ce type d’interprétation pour faire intervenir des
notions neutres et froides qui abordent la vie et la mort comme
des événements relevant de la statistique.
Mais revenons-en aux consultantes pour qui l’oncogénéticien
estime qu’il n’y a pas d’altération génétique dans leur famille :
– Pour celles qui ont eu un cancer, cette information peut
lever la crainte d’avoir transmis un risque aux enfants. Bien
qu’il puisse leur être difficile de renoncer à une explication
causale de leur cancer, elles sont le plus souvent rassurées et se
sentent déculpabilisées par rapport à la question de la transmis-
sion.
– Parmi celles qui n’ont pas eu de cancer, un certain nombre
d’entre elles ne seront pas sécurisées par les arguments relatifs
à la statistique et à l’épidémiologie (1) : pour les raisons que
nous avons évoquées plus haut, elles repartiront avec la même
peur qu’avant la consultation d’être plus exposées au cancer du
sein que la population générale.
PROPOSITION DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN
Inversement, l’oncogénéticien peut aussi estimer que les cas de
cancers rapportés par la consultante sont probablement liés à
une anomalie génétique. Il propose un test sanguin, mais une
autre difficulté intervient alors : si on ne connaît pas la muta-
tion à rechercher, le résultat risque d’être à la fois très long et
faussement négatif. L’oncogénéticien est amené à demander à
la consultante de proposer à un des membres de la famille qui a
eu un cancer de venir consulter pour donner son sang.
C’est souvent l’occasion de constater que la consultante n’a
pas parlé autour d’elle de sa démarche et ne s’attendait pas à
devoir le faire. Les conflits familiaux, les ruptures de contacts,
les alliances et mésalliances ressortent, à cette occasion, de
façon inattendue pour les consultantes : “J’ai coupé les ponts
avec mes cousines depuis 20 ans, je ne peux pas les appeler
d’un seul coup pour leur demander d’aller donner leur sang !”.
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
Consultations d’oncogénétique :
particularités et questions psychologiques soulevées
●C. Lanzarotti*
* Unité de psychiatrie et de psycho-oncologie, IGR, 94805 Villejuif Cedex.
** Je remercie le Dr Agnès Chompret, oncogénéticienne de l’IGR, qui m’a per-
mis d’observer de nombreuses consultations et a eu la patience d’en discuter
longuement avec moi.

11
La Lettre du Gynécologue - n° 254 - septembre 2000
Les difficultés de communication autour du cancer lui-même
ressortent de façon criante : “Ma sœur n’a jamais voulu me
dire qu’elle avait eu un cancer du sein. Je l’ai deviné et il n’est
pas question que je lui en parle directement”.
Les questions relatives à la causalité du cancer surgissent :
“Ma tante a toujours dit haut et fort qu’elle était sûre que son
cancer du sein était dû au stress. Je ne me vois pas aller la cher-
cher en lui disant que c’est plutôt dû à un gène qu’elle aurait
hérité et peut-être aussi transmis à ses enfants”, disait très jus-
tement une autre consultante, soulevant finement le problème
de la culpabilisation qu’une telle démarche risquerait d’intro-
duire chez quelqu’un qui n’a pas du tout envisagé la question
de la transmission.
Comme on le voit, il vaudrait mieux que toute personne se ren-
dant à une consultation d’oncogénétique ait bien réfléchi aux
incidences que cette consultation pourrait avoir sur ses rapports
familiaux, et qu’elle ait une idée claire de la façon dont elle
pourra parler de cette consultation aux proches concernés.
RÉSULTAT DU PRÉLÈVEMENT SANGUIN
Plusieurs mois après cette consultation et le prélèvement, par-
fois plus d’une année après, le résultat est disponible et la
consultante en est informée par courrier.
Pour certaines de ces consultantes, le temps écoulé a rendu
caduque la recherche génétique (2) : d’autres réponses leur ont
été apportées par la vie, ou bien elles préfèrent ne pas savoir,
ayant peur de ne pas arriver à manier une telle information par
rapport à leurs enfants et apparentés.
● Lorsque le prélèvement est négatif : pour certaines consul-
tantes chez qui l’anomalie à rechercher n’était pas connue,
l’oncogénéticien devra expliquer qu’un résultat négatif ne
signifie pas forcément qu’elles ne sont pas porteuses d’une
altération. Ce “faux négatif” possible les laisse ainsi dans une
non-clarification de leur attente. On leur proposera, dans le
doute, de bénéficier du même protocole de surveillance que
celui des femmes chez qui on a décelé une anomalie.
Pour les consultantes chez qui la mutation était connue, ce
résultat négatif est une réponse claire et définitive qui les sort
totalement du doute, et c’est sans doute un des bénéfices
importants qu’apporte le test de prédisposition : il permet de
rassurer une femme sur le fait qu’elle ne court pas un risque
supplémentaire à celui de la population générale, et qu’elle n’a
pas transmis ce risque à ses enfants.
● Lorsque le prélèvement est positif : en ce qui concerne les
consultantes ayant eu un cancer, ce résultat n’est souvent que
la confirmation de ce qu’elles avaient pressenti ; il leur permet
de sortir d’un doute angoissant et de bénéficier d’un sentiment
de maîtrise intellectuelle. Cependant, il les plonge instantané-
ment dans le problème de la transmission éventuelle de cette
mutation à leurs enfants et elles demandent alors comment
elles doivent faire : comment leur dire ? À quel âge ? Quel type
de surveillance peut-on leur proposer, etc.
Elles expriment souvent directement leur angoisse et leur senti-
ment de culpabilité, qui peuvent les pousser soit à un non-dit
pesant soit à la divulgation directe et crue d’une information
que personne n’attendait et qui plonge la famille dans une
crise.
En ce qui concerne les consultantes indemnes, le résultat ne
vient que confirmer, là aussi, leurs craintes et leurs présuppo-
sés.
Il y a des consultantes dont l’histoire familiale des cancers du
sein est telle que le résultat apporte un véritable soulagement,
celui-ci permettant de sortir du doute et de prendre des déci-
sions de façon plus tranquille.
Cependant, les consultantes ont du mal à comprendre que,
même si l’on est sûr qu’elles sont porteuses d’une anomalie
génétique, il n’est pas sûr qu’elles développent la maladie.
Cette notion de pénétrance et de probabilité entre, là aussi, en
contradiction avec la logique psychique, l’intuition et l’identi-
fication inconsciente et consciente à certains membres de la
famille.
PROBLÈME DES PROPOSITIONS DE SURVEILLANCE,
DÉPISTAGE ET PROPHYLAXIE
Il est bien évident que les consultantes chez qui l’on découvre
une anomalie sont demandeuses d’actions efficaces leur per-
mettant au pire un dépistage le plus précoce possible du cancer,
au mieux une prévention de ce cancer.
Or, le problème actuel est qu’on n’a pas encore prouvé l’effica-
cité totale des chirurgies prophylactiques, même si on les pra-
tique déjà depuis plusieurs années. Quant au dépistage, on sait
aussi que la mammographie n’est pas toujours suffisante pour
le cancer du sein, et on connaît bien la difficulté du dépistage
précoce d’un cancer ovarien.
On est donc obligé de proposer des protocoles de surveillance
et de dépistage dont l’aspect sécurisant varie chez les consul-
tantes en fonction de leur expérience du cancer de leurs
proches : une femme ayant observé que le cancer de sa mère
ou de sa sœur a été diagnostiqué tard malgré des mammogra-
phies régulières ne sera absolument pas rassurée par la proposi-
tion de mammographies et auto-palpation. C’est ce type de
femmes qui va réclamer des mesures plus draconiennes,
comme une ablation des seins ou des ovaires.
Les nombreux articles médicaux sur les indications des mas-
tectomies ou ovariectomies prophylactiques témoignent de la
difficulté de telles décisions (3). Certaines équipes ont publié
des guides décisionnels (4) pour faire face aux demandes de
chirurgie prophylactique des consultantes reconnues à risque.
Dans tous les cas, il est recommandé de prendre plusieurs avis,
et d’avoir à différentes reprises une explication détaillée avec
la consultante, des limites et des risques d’une telle chirurgie.
La prise de décision doit être appuyée par une expertise pluri-
disciplinaire dans laquelle un psychologue doit s’inscrire (5).
CONCLUSION
Doit-on inciter les femmes à consulter en oncogénétique ?
Pour l’instant, la grande majorité des femmes qui consultent
ont le sentiment d’être porteuses d’une anomalie génétique. La
question qui se pose à l’heure actuelle est celle de l’incidence
d’un test ou d’une consultation génétique chez quelqu’un qui
ne se sentirait pas à risque, ou qui ne s’interrogerait pas sur
l’aspect éventuellement héréditaire de son cancer (6).

12
La Lettre du Gynécologue - n° 254 - septembre 2000
Pour une femme, le fait de savoir qu’elle est porteuse d’un
gène délétère, qu’elle a reçu d’un de ses parents et peut-être
transmis à ses enfants, pose déjà des problèmes importants de
communication avec la famille et d’implications psycho-affec-
tives et relationnelles.
De plus, “l’annonce inattendue d’un test génétique défavorable
peut entraîner une détresse psychologique importante (7)”.
Tous ces éléments plaident en faveur d’une grande prudence
en matière de généralisation de l’information oncogénétique :
il est nécessaire de mieux comprendre les différences entre les
personnes qui vont au-devant de l’information et celles qui
n’en veulent pas, et d’avancer dans l’aide que l’on peut appor-
ter aux femmes par rapport à la communication avec leur
famille en cas de risque confirmé.
Dans un numéro de The Lancet datant d’il y a déjà cinq ans,
D. Naylor (8) soulignait qu’il est des situations en médecine où
l’on ne peut plus faire appel au concept d’evidence-based
medicine. L’oncogénétique est une de ces zones grises de pra-
tique dans laquelle on ne peut pas s’appuyer sur des données
claires et précises.
Les médecins généralistes et gynécologues, qui sont suscep-
tibles de diriger leurs patientes vers ces consultations, ont
besoin d’être informés de toutes ces questions. Il est important
qu’ils connaissent le contenu et la démarche de ces consulta-
tions, ainsi que les limitations actuelles des mesures de prophy-
laxie et de dépistage.
Il nous reste à espérer qu’un article comme celui-ci y aura par-
ticipé. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Gagnon P et al. Perception of breast cancer risk and psychological distress in
women attending a surveillance program. Psycho-Oncology 1996 ; 5 : 259-69.
2. Lerman C et al. BRCA1 testing in families with hereditary breast-ovarian
cancer. JAMA 1996 ; 275 (24) : 1885-92.
3. Hoskins KF. Assessment and counseling for women with a family history of
breast cancer. JAMA 1995 ; 273 (7) : 577-85.
4. Bilimoria M et al. The women at increased risk for breast cancer : evaluation
and management strategies. CA Cancer J for Clin 1995 ; 45 (5) : 263-79.
5. Dauplat, Bremond A, Lefranc JP. Prévention du risque génétique de cancer
de l’ovaire : l’ovariectomie prophylactique. Rapport INSERM 1995.
6. Richardson JL et al. Future challenges in secondary prevention of breast
cancer for women at risk. Cancer suppl 1994 ; 74 (4) : 1474-83.
7. Patenaude A. Acceptance of invitation for P53 and BRCA1 testing : factors
influencing potential utilisation of cancer genetic testing. Psycho-Oncology
1996 ; 5 : 241-50.
8. Naylor D. Grey zones of clinical practice : some limits to evidence-based
medicine. Lancet 1995 ; 345 (1) : 840-2.
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
ABONNEZ-VOUS...
ABONNEZ-VOUS...
ABONNEZ-VOUS...
ABONNEZ-VOUS...
ABONNEZ-VOUS...
ABONNEZ-VOUS...
ABONNEZ-VOUS...
ABONNEZ-VOUS...
voir p. 28
☞
21 revues indexées avec
moteur de recherche
☞
un e-mail offert
☞
l’actualité des grands
congrès
ABONNEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS
1
/
3
100%