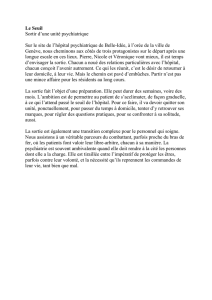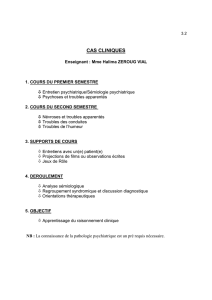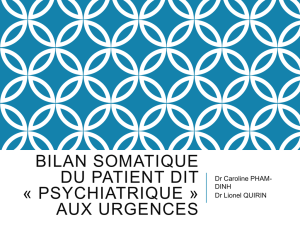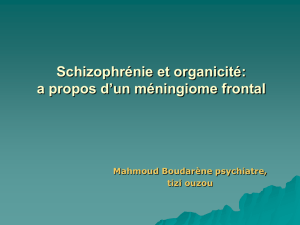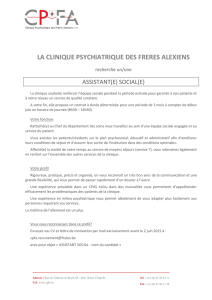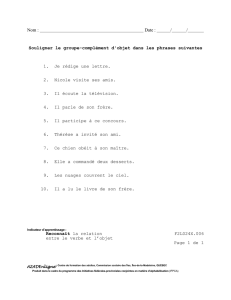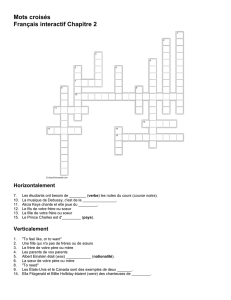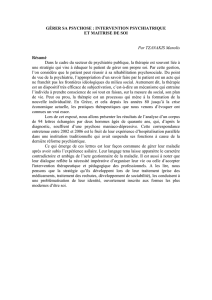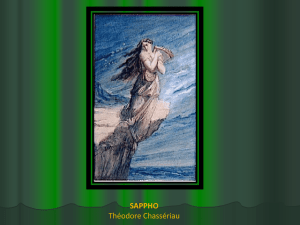Lire l'article complet

L’entourage des patients, en particulier celui
de ceux qui sont les plus perturbés, que l’on
qualifie habituellement de “psychotiques”,
ne manque jamais de s’enquérir de ce dont
leur parent souffrent. Et quoi de plus natu-
rel ? Le diagnostic permet de sortir de la
confusion générée par l’indifférenciation et
a donc un aspect rassurant. Il permet de
transformer ce qui avait un caractère
effrayant par ses aspects inconnus, irration-
nels et imprévisibles (la folie) en quelque
chose de connu, de rationnel et de prévi-
sible, permettant la mise en œuvre d’une
action efficace.
C’est dans ce climat que l’on a vu se multi-
plier ces dernières années des programmes
destinés à informer les patients et leur entou-
rage sur les troubles présentés (Pro-familles,
Pact, Alliance, Soleduc). L’idée sous-jacente
et commune à tous ces programmes est
qu’une bonne information permettra de
mieux traiter un patient qui aura pris
conscience du cours de l’affection dont il
souffre et de la nécessité de la poursuite
d’une thérapeutique. Notons que cet appel à
la raison, qui repose sur l’idée que l’être
humain est guidé dans son comportement
par des raisonnements logiques et cohérents,
semble méconnaître toute la dimension
affective, irrationnelle et souvent incons-
ciente des motivations qui conduisent à l’ac-
tion, que le sujet soit “sain” ou “malade”.
Annoncer le diagnostic psychiatrique sup-
pose dans un premier temps d’avoir réfléchi
aux implications de celui-ci. Nous en avons
relevé six.
Fermeture
Le diagnostic psychiatrique a un effet de foca-
lisation et de cadrage : à partir d’une situation
de départ dominée par l’indétermination et la
multiplicité des ouvertures, il limite le nombre
des choix possibles et des directions dans les-
quelles l’évolution est susceptible de se faire :
il oriente donc la prise en charge qui légitime-
ment en découle dans un sens qu’il sera sou-
vent difficile de modifier.
Individu
Le diagnostic psychiatrique renvoie à une
conception individuelle de la pathologie : le
sujet est à la fois lieu et origine du trouble. Le
corollaire logique sur le plan thérapeutique en
est donc la prise en charge individuelle, même
si parfois une origine exogène a pu être attri-
buée aux symptômes présentés par le patient
(dépression réactionnelle, névrose post-trau-
matique, etc.). Dans cette perspective, la
famille ne fait que réagir aux troubles portés
par le patient et engendrés par la maladie.
Représentation
Le diagnostic psychiatrique induit chez celui
qui le pose une représentation en rapport,
d’une part, avec ce qu’il sait – ou croit
savoir – du trouble qu’il a identifié et, d’autre
part, avec les expériences passées qu’il a pu
avoir avec d’autres patients du même type.
Le diagnostic psychiatrique n’est pas un pur
acte intellectuel : il comporte une dimension
affective avec laquelle le thérapeute aura à
composer. C’est ce que les psychanalystes
appellent le contre-transfert et d’autres les
résonances. Le diagnostic de schizophrénie
s’accompagne souvent de l’idée de chronicité.
Cela peut être désespérant pour le thérapeute
qui devra abandonner tout espoir de guérir
un jour son patient et qui devra, dans le
meilleur des cas, se contenter d’une stabilisa-
tion et d’un aménagement des conditions
d’existence de ce dernier. Cela peut être
confortable dans la mesure où cela dégage –
au moins partiellement – le thérapeute de la
responsabilité de l’évolution s’il est convain-
cu d’avoir donné au patient des soins
consciencieux, dévoués et fondés sur les
données acquises de la science, ainsi que le
lui prescrit l’article 32 du Code de déontolo-
gie médicale.
Ce même diagnostic de schizophrénie peut
également comporter l’idée d’une dangerosité,
d’autant plus inquiétante qu’elle est imprévi-
sible, conduisant le thérapeute à privilégier
les mesures sécuritaires plutôt que les
mesures thérapeutiques. Comment soigner
quand on est prisonnier de la peur ?
Enfin le diagnostic psychiatrique induit chez
les parents du patient et chez le sujet une
représentation qui ne peut manquer d’avoir
des répercussions au niveau de la prise en
charge et qu’il conviendra donc d’explorer.
Labéllisation
Une fois qu’un diagnostic a été porté et
accepté, tout comportement ultérieur du
sujet risque d’être rapporté à ce diagnostic.
À l’extrême, le sujet sera réduit à l’étiquette
qui lui a été attribuée : le diagnostic crée
une réalité qui engloutit le sujet ; il ne sera
plus Monsieur X ou Madame Y, mais un
schizophrène déficitaire, une hystérique,
ou un dépressif parmi d’autres. Le diagnos-
tic peut, sinon tuer, du moins asphyxier la
relation que l’on a avec le sujet.
Passivité
Le diagnostic psychiatrique implique une
position de passivité de la part du patient,
qui s’attend à ce que la solution à ses pro-
blèmes vienne de l’extérieur, qu’il s’agisse
de médicaments ou d’un changement de
comportement de la part de ceux dont il
considère qu’ils l’ont rendu malade.
Vie professionnelle
Vie professionnelle
279
Act. Méd. Int. - Psychiatrie (19), n° 10, décembre 2002
es rapports soignants-soignés
ont évolué au fil des ans. En cette
période de transparence, rien
d’étonnant à ce que, en France, la loi
du 4 mars 2002 ait édicté que : “Toute
personne a le droit d’être informée sur
son état de santé”.
Le patient, devenu un “usager”,
devrait ainsi, en consommateur éclairé,
pouvoir donner son consentement aux
soins qui lui sont prodigués. Selon
cette même loi, le patient a mainte-
nant un droit d’accès direct à son dos-
sier médical, dont il peut se faire com-
muniquer une copie, en dehors des
informations concernant des tiers, ce
qui, en psychiatrie, pose un problème
majeur, puisque la pathologie psychia-
trique étant la plus relationnelle de
toutes les pathologies, il est difficile,
voire impossible, d’envisager de ne pas
prendre en compte l’entourage du
patient lors de la prise en charge.
Toutes ces évolutions récentes trans-
forment radicalement la relation soi-
gnants-soignés : le soignant se voit
ainsi conduit petit à petit vers un rôle
de prestataire de services.
L
L’annonce du diagnostic de
schizophrénie à la famille
J.M. Havet*
*Service de psychiatrie des adultes,
CHU hôpital Robert-Debré, Reims.

Responsabilité
Le fait d’être atteint d’une maladie qui
détermine le comportement dédouane le
sujet des conséquences de ses actes.
Un autre point, non moins important, réside
dans la question de la valeur de vérité du
diagnostic psychiatrique. On sait que les
classifications psychiatriques ont évolué au
fil du temps et qu’elles ne se recoupent pas
parfaitement d’un point à un autre de la pla-
nète, en dépit des efforts déployés par
l’OMS dans sa classification internationale
des maladies. Lennart Jansson (1) a identifié
quinze systèmes diagnostiques différents
pour la schizophrénie dans la littérature de
ces trente dernières années. Il a montré, dans
son étude, que le nombre des patients pou-
vant être diagnostiqués comme schizo-
phrènes dans un échantillon de 155 patients
variait en fonction du système diagnostique
employé. On pourrait donc imaginer de dire
à des parents venant s’informer de ce dont
souffre leur enfant : “Madame, Monsieur,
j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle : la
bonne nouvelle c’est que, selon les critères
de recherche de Vienne, votre fils n’est pas
schizophrène ; la mauvaise nouvelle c’est que,
selon les critères de Saint-Louis, il l’est” !
En fin de compte, la question reste : pour-
quoi annoncer le diagnostic de schizophrénie
au patient et à sa famille ? C’est-à-dire, pour
quelles raisons et, surtout, dans quel but ?
Celui-ci ne peut-être uniquement d’ordre
médico-légal. L’objectif éthique ne peut être
que d’ordre thérapeutique. Le “droit à l’in-
formation” peut ainsi prendre un sens. Cela
suppose que celui qui fait l’annonce du dia-
gnostic sache de quelle place il parle :
“expert” ou “thérapeute”. Annoncer un dia-
gnostic de schizophrénie n’est pas équiva-
lent à annoncer un diagnostic de grippe ou
même de cancer, diagnostics qui – quelle
que soit leur gravité – laissent au sujet qui en
est atteint la possibilité de s’en distancier, de
conserver, comme le disait Henri Ey, la sta-
tion debout.
Afin d’illustrer la façon dont le diagnostic
psychiatrique peut être utilisé dans une posi-
tion thérapeutique, je voudrais brièvement
évoquer les réactions d’une famille à cette
annonce et le travail effectué lors d’une
séance de thérapie familiale autour de cette
question.
Tous les membres de la famille furent
convaincus de la réalité de l’affection :
quelque chose avait pris possession de l’es-
prit de leur frère et fils. Tous, patient com-
pris, se mirent à étudier la question : ils
achetèrent des livres en espérant trouver la
clef de ce comportement qui leur avait tou-
jours posé problème et face auquel ils se
demandaient encore comment se situer et
quoi faire.
Pour le frère du patient, la question était de
savoir si tous les troubles du comportement
qu’il présentait étaient ou non dus au fait
qu’il soit schizophrène. En d’autres termes,
fallait-il donc en quelque sorte l’excuser
pour tout ce qu’il faisait d’inacceptable ?
Le père du patient, scientifique et porté à la
rationalité, fut rassuré par le fait que l’on ait
pu donner un cadre aux troubles du compor-
tement de son fils. Il eut le sentiment, sinon
lui-même de comprendre, du moins que les
autres, les professionnels, comprenaient ce
dont il s’agissait et donc qu’une action en
rapport avec ce trouble pouvait être mise en
place pour le contrôler. La mère du patient
réagit différemment. Elle se sentit “assom-
mée” par l’annonce et affolée par les consé-
quences qu’une telle affection pouvait avoir
sur l’avenir de son fils. Après avoir vu une
émission de télévision sur la schizophrénie,
elle me demanda pourquoi on n’avait pas
encore fait d’IRM à son fils, la vision des
“gros ventricules” aurait permis, à ce qu’en
disaient les spécialistes et à ce qu’elle en
avait compris, de faire un diagnostic avec
certitude. Elle avait envie encore d’être ras-
surée. Elle voulait qu’on lui confirme preuve
à l’appui que son fils était bien schizophrè-
ne, tout en espérant que les examens les plus
poussés démontreraient le contraire.
Lors d’une séance de thérapie, le frère du
patient me demanda de quel type de schizo-
phrénie souffrait son frère. Puisqu’il avait
étudié la question, je lui demandai ce qu’il
en pensait. Il ne sut quoi répondre et je me
tournai alors vers le patient. Celui-ci me
répondit : “Je ne sais pas”, puis, après un
temps d’hésitation, “une forme… normale”.
Tous les participants à la séance, sans excep-
tion, éclatèrent de rire. Le patient
poursuivit : “Mon frère me dit souvent que
je devrais avoir des hallucinations parce que
c’est obligatoire quand on est schizophrène”.
Et il n’en avait pas. Ce n’était donc pas pour
son frère une forme “normale”. Le frère
alors rapporta qu’il avait vu une autre émis-
sion de télévision dans laquelle “ils insis-
taient sur le fait que le schizophrène avait
nécessairement des hallucinations, des
voix”. Le discours médiatique s’était appuyé
sur le DSM. Là encore il fallut remettre les
pendules à l’heure et expliquer que le DSM
n’était pas un manuel de psychiatrie, mais
qu’il était destiné aux statistiques, à l’épidé-
miologie, aux essais thérapeutiques, à la pla-
nification en matière de santé mentale et aux
assureurs, afin qu’ils sachent ce qu’ils
allaient – ou non – rembourser.
Le frère revint à la charge : il voulait absolu-
ment savoir en quoi consistait l’affection de
son frère. À nouveau, je soulignai que l’im-
portant me paraissait plutôt être de chercher
comment on pouvait l’aider. Je lui indiquais
que sa présence ici, celle de ses parents, tout
ce travail qu’ils faisaient depuis des années
étaient importants et qu’il fallait commencer
par le considérer comme un être humain
plutôt que comme un schizophrène.
Le frère n’en démordait pas : il voulait com-
prendre pourquoi il agissait de telle ou telle
manière, comment il fonctionnait. Je lui dis
que l’on pouvait faire des hypothèses et que
l’important était de comprendre que quand
un être humain agit, il a en général un but,
même s’il n’en a pas totalement conscience :
la cause n’est pas derrière, elle est devant.
Le patient confirma qu’il avait bien un but,
des objectifs dans la vie, même s’il ne put
expliciter plus avant cela devant les
membres de sa famille. Cependant, il avait
ainsi montré qu’il n’était pas si différent des
autres, même s’il était en difficulté.
Conclusion
Informer et être informé est fondamental.
Mais il ne saurait s’agir d’un phénomène
que l’on pourrait détacher du contexte dans
lequel il se produit, sauf à déboucher sur ce
que Joël de Rosnay appelle l’“infopollu-
tion”. La question qui doit toujours être pré-
sente à l’esprit de celui qui informe est celle
de la pertinence des informations et de
l’usage qui en sera fait. Dire à un patient, et
à son entourage, qu’il est schizophrène est
au mieux sans intérêt, au pire lourd de
conséquences si cette annonce ne s’accom-
pagne pas d’un travail de réflexion autour de
ce que cela signifie. L’exemple que nous
avons voulu donner, démontre, s’il en était
besoin, que les patients et leurs familles sont
prêts à effectuer cette démarche.
Référence
1. Jansson L, Handest P, Nielsen J et al.
Exploring boundaries of schizophrenia : a com-
parison of ICD-10 with other diagnostic sys-
tems in first-admitted patients. World Psychiatry
2002 ;1 (2).
Vie professionnelle
Vie professionnelle
280
1
/
2
100%