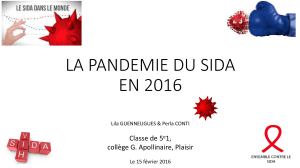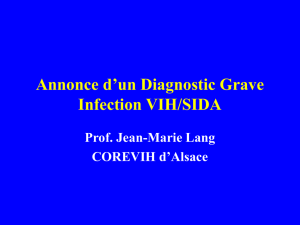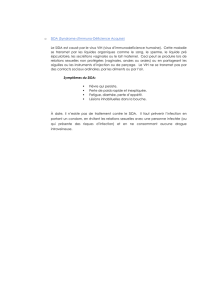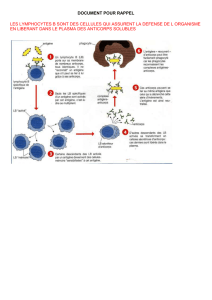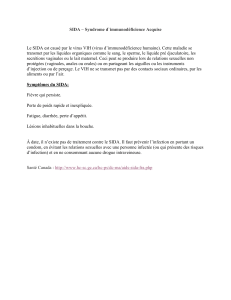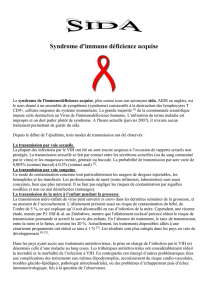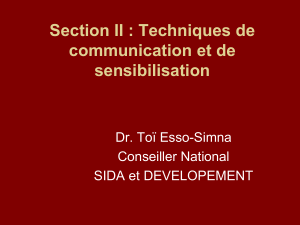Lire l'article complet

93
L’heure n’est plus
aux aux négociations
Le Courrier : Qu’avez-vous
glané au cours de la confé-
rence de Barcelone ? De nou-
velles pistes de recherche ?
Des promesses de médica-
ments ou de vaccins, une
approche plus efficace des
prises en charge ?
Gilles Pialoux : La XIVeconfé-
rence internationale sur le sida
de Barcelone, du 7 au 12 juillet
dernier, a bien été une grande
conférence, dans le sens où elle a
été, une fois de plus mais encore
plus que les autres fois, gigan-
tesque : par le nombre de ses
participants (15 000), de ses
séances plénières de communi-
cations, de ses sessions orales ou
écrites tous azimuths, de sa cen-
taine de symposia satellites, de
ses sept niveaux d’exposition de
posters, du nombre et de la qua-
lité de ses discours d’ouverture
et de clôture… de l’ampleur de
l’épidémie telle qu’elle a été
détaillée dans “l’état des lieux”
présenté par le rapport de
l’ONUSIDA… et même du
montant de ses droits d’inscrip-
tion (850 $ US) ! Pourtant, pour
la première fois, j’ai eu l’impres-
sion de ne pas avoir pu “glaner”
du nouveau, du moins dans mon
secteur de compétences. Pas de
scoop, pas de nouveau concept,
pas de nouvelles pistes physio-
pathogéniques… Peut-être ne
doit-on pas attendre de surprises
tous les deux ans et faut-il consi-
dérer comme des avancées – ce
qui est le cas ! – l’exposé des
expériences psychosociales, de
santé publique, cliniques et les
hypothèses présentées tant dans
le domaine des sciences humaines
que de la recherche fondamen-
tale… En revanche, nous avons
bénéficié de discours politiques
très forts sur le plan des in-
tentions affichées, beaucoup
moins sur celui des décisions
concrètes envisagées.
Le Courrier : Le discours
d’ouverture de Peter Piot, le
directeur de l’ONUSIDA,
semblait pourtant très clair
ainsi que l’intervention de Bill
Clinton, et même celle, beau-
coup plus modeste, de Jean-
François Mattei, notre nou-
veau ministre…
G.P. : C’est vrai, l’intitulé même
de la XIVeconférence, “Savoir et
engagement pour l’action”, indi-
quait clairement l’orientation
politique de cette manifestation,
comme ce fut le cas pour d’autres
conférences. Et le directeur de
l’ONUSIDA n’a pas pris de
détours pour parler de la situation
mondiale : “Il est maintenant clair
que nous ne sommes qu’au début
de l’épidémie et que le combat ne
fait que commencer”, a-t-il dé-
claré en rappelant les promesses
des gouvernements de s’engager
dans la lutte en versant 15 mil-
liards de dollars au Fonds mon-
dial pour le sida : “Les traite-
ments sont techniquement fai-
sables n’importe où dans le
monde et (…) même le manque
d’infrastructure n’est pas une
excuse (…). C’est une question
de volonté politique : 10 milliards
de dollars par an, c’est le mini-
mum nécessaire pour répondre
concrètement à l’épidémie (…).
Nous ne sommes pas venus à
Barcelone pour renégocier les
promesses. Nous sommes ici
pour les tenir. Nous devons com-
battre la stigmatisation : ce n’est
pas négociable. Nous devons ren-
forcer l’alliance qui permettra de
délivrer un vaccin : ce n’est pas
négociable. Nous devons offrir
prévention et traitement à grande
échelle : ce n’est pas négociable.
Nous devons trouver 10 milliards
de dollars : ce n’est pas négo-
ciable.” Bref, un vibrant plaidoyer
en faveur de la généralisation de
l’accès aux soins pour tous, et en
particulier aux traitements anti-
rétroviraux… Alors, c’est vrai,
les prix de ces traitements ont
baissé. C’est vrai, la bataille
des génériques gagne bien des
* PU-PH en Infectiologie, service du Pr W. Rozenbaum, hôpital Tenon,
et Rédacteur en chef de Transcriptase et de Swaps (le CRIPS).
Gilles Pialoux, clinicien et chercheur, a longtemps travaillé à l’hôpital-
Pasteur avant de rejoindre l’équipe du Pr Willy Rozenbaum. Il est fon-
dateur et rédacteur en chef des deux revues du CRIPS, le Comité régio-
nal d’information et de prévention sida, “un poste de communicateur”
qu’il connaît bien pour l’avoir exercé il y a une quinzaine d’années
comme journaliste médical, parallèlement à son internat.
•Transcriptase, revue critique de l’actualité internationale sur le VIH et les
virus des hépatites (10 numéros par an), créée en 1991 par le Comité régio-
nal de prévention et d’information sida sur une idée de son directeur, le Dr
Didier Jayle. Avec le soutien de la Direction générale de la Santé et des
Laboratoires Wellcome (rejoints depuis par L’ANRS, GSK, Bristol-Meyers-
Squibb, Schering-Plough, Abbott Laboratoires, Boehringer Ingelheim,
Chiron). Six le numéro. Articles en ligne : www.lecrips.net
• Swaps, revue bimestrielle santé, réduction des risques et usages de
drogues, réalisée avec la participation des CRIPS Île-de-France et Provence-
Alpes-Côte d’Azur, avec le soutien des Laboratoires Schering-Plough,
d’Ensemble contre le sida et de la MILDT, 1,52 le numéro.
Éditées par l’association PISTES, le CRIPS. Tour Maine-Montparnasse, BP 54,
75755 PARIS Cedex 15 [email protected]. Tél. : 01 56 80 33 51.
Hépatites/sida
La fin des grand’messes ?
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w
Un entretien avec Gilles Pialoux*
Propos recueillis par Didier Touzeau et Florence Arnold-Richez
La 14eConférence internationale sur le sida, qui s’est
tenue du 7 au 12 juillet dernier, plus gigantesque que
jamais, plus politique encore qu’à Durban, en Afrique
du Sud, en 2000, n’a pas apporté de scoop théra-
peutique, de nouveaux concepts, de nouvelles pistes.
En revanche, elle a définitivement affirmé une urgen-
ce : celle de passer à la vitesse supérieure dans l’ai-
de à apporter aux “pays du sud”. Une pétition de
principe soutenue avec force par les grands noms de
la politique du globe comme Nelson Mendela ou Bill
Clinton, par le directeur de l’ONUSIDA, Peter Piot,
Joep Lange, le nouveau président de l’International
Aids Society… Une “solidarité rédactionnelle” que
Gilles Pialoux et Didier Jayle, le directeur du Crips,
ont décidé de faire leur pour Transcriptase, la revue
qu’ils éditent. Gilles Pialoux a bien voulu établir
pour nous le bilan de cette dernière conférence, du
rapport Delfraissy 2002 présenté à cette occasion,
de “l’état de la question” sur les prises en charge des
co-infections sida-hépatite C.

94
Le Courrier des addictions (4), n° 3, juillet/août/septembre 2002
points mais ne règle pas tout : le
fossé reste énorme entre le
nombre de personnes qui bénéfi-
cient en Afrique de ce traitement
(20 000 à 30 000) et les 6 mil-
lions de personnes qui le
devraient, comme le rappelait
Joep Lange, le nouveau président
de l’International Aids Society.
C’est vrai encore, Nelson
Mandela et Bill Clinton, lors de la
séance de clôture, ont soulevé des
vagues d’enthousiasme, en mar-
telant avec force qu’ils souscri-
vaient à cette analyse de base que
l’argent est bien le nerf de la
guerre. “On a fait des promesses
et on ne les a pas tenues. Il faut
importer massivement des médi-
caments génériques pour les pays
qui en ont besoin”, a déclaré l’an-
cien président des États-Unis. Et
d’ailleurs, Barcelone a vu naître
le Fonds global contre le sida, une
structure financière qui regroupe
les agences de l’ONU, les pays
donateurs, les pays “deman-
deurs” et aussi des acteurs privés
pour collecter des fonds afin de
lutter contre le sida, le paludisme
et la malaria. Malheureusement,
aucun pays représenté à Barce-
lone n’a annoncé qu’il allait aug-
menter ses subventions, sauf
l’Allemagne, qui a promis 50 mil-
lions d’euros. Quant à la France,
elle n’ira pas au-delà des 150 mil-
lions d’euros promis en trois ans,
dont les premiers 50 millions ont,
semble-t-il, été débloqués. Cela dit,
un ministre, qu’il soit Jean-Fran-
çois Mattei, ou un autre ministre,
vient rarement dans ce genre de
manifestation internationale pour
faire des annonces de politique
nationale ou internationale.
Par ailleurs, le problème actuel
n’est pas seulement celui de la
mise à disposition de médica-
ments mais aussi et surtout de
l’insuffisance du nombre des
médecins et des soignants en
général, de “la limitation” des
savoirs, de l’absence de méthodes
d’évaluation spécifiques aux
pays en vois de développement. Il
faudrait, en effet, “génériquiser”
aussi, si l’on peut dire, les tech-
niques de prise en charge et
d’évaluation des thérapeutiques
afin de les rendre accessibles à
ces pays.
Changements
de stratégies dans
la lutte contre le sida
Le Courrier : Que retenir
de l’étude dite ART présentée
à Barcelone et parue dans
The Lancet du 12 juillet
concernant les pronostics du
sida en fonction de différents
critères, en particulier du
nombre des CD4 ?
G.P. : Cette étude rassemble les
résultats de treize études prospec-
tives menées en Europe et en
Amérique du Nord, concernant
12 574 patients chez lesquels on
avait débuté une trithérapie : les
facteurs pronostiques trouvés ont
été très divers selon que les
patients étaient âgés de plus ou de
moins de 50 ans, étaient ou non
consommateurs de drogues par
voie intraveineuse, avaient moins
de 350 CD4 par mm3et une
charge virale inférieure ou supé-
rieure à 100 000 copies par ml à
l’initiation du traitement. Ainsi,
la probabilité d’évoluer jusqu’à
la maladie ou de décéder au
bout de trois ans de trithérapie
allait de 3,4 % chez les patients
de moins de 50 ans, non injec-
teurs de drogues, ayant au moins
350 CD4 par mm3et une charge
virale inférieure à 100 000 co-
pies/ml, à 50 % chez les plus de
50 ans, injecteurs de drogues,
ayant moins de CD4 et plus de
charge virale, etc. En fait, il
semble bien que le meilleur
facteur pronostique soit d’avoir
plus de 200 CD4 et surtout en
début de traitement, le critère
de la charge virale passant au
second plan.
Le Courrier : D’où les recom-
mandations du rapport dit
“Delfraissy”, auquel vous avez
participé en tant qu’expert, pré-
senté aussi au cours de la
conférence de Barcelone ?
G.P. : Le troisième rapport sur
“La prise en charge des per-
sonnes infectées par le VIH”
(paru chez Flammarion) et rendu
public effectivement à Barcelone,
est un vrai et fort copieux rapport
de 390 pages et 27 chapitres, qui
énonce toute une liste de recom-
mandations nationales et aborde
des secteurs émergents de cette
prise en charge comme les
femmes, les migrants, les per-
sonnes en précarité, la vie sociale
des malades, les patients incarcé-
rés, les complications possibles
des traitements, l’organisation
des soins, la qualité de vie, l’as-
sistance médicale à la procréa-
tion, etc. Avec un manque impor-
tant, relevé par le Pr Jean-
François Delfraissy lui-même :
“Le rapport n’aborde pas la prise
en charge des patients dans les
‘pays du sud’ alors que les anti-
rétroviraux commencent à être
disponibles”, a-t-il écrit à cette
occasion. Et un autre, partiel seu-
lement car en fait “corrigé” à tra-
vers les différents chapitres
abordés (précarité, prison,
grossesse…) : les usagers de
drogues ne sont pas le thème
d’un “chapitre”.
Pour revenir aux résultats de
l’étude ART, le rapport conclut,
en effet, que la période optimale
pour débuter un traitement chez
un patient infecté par le virus
VIH se situe lorsque son taux de
lymphocytes T CD4 est en des-
sous de 350/mm3sans atteindre
200/mm3(ou 15 %.) Par ailleurs,
la décision individualisée chez un
patient donné de débuter un pre-
mier traitement antirétroviral doit
mettre en balance les bénéfices
escomptés (restauration immuni-
taire et réduction des morbidité
et mortalité induites par l’infec-
tion à VIH) et les risques encou-
rus (complications à long terme
des traitements…). En revanche,
il n’est pas recommandé de com-
mencer un traitement chez un
patient dont le nombre de lym-
phocytes T CD4 est supérieur à
350/mm3.
Quant à la valeur de la charge
virale plasmatique, elle doit être
prise en compte lorsqu’elle est
supérieure à 100 000 copies/ml si
le nombre des T CD4 est entre
200 et 350/mm3. Le but, comme
le souligne d’ailleurs Jean-Fran-
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w
Les principaux chiffres concernant l’hépatite C
•Dans le monde : 170 millions (3 %). Chaque année, on enre-
gistre dans le monde 180 000 nouveaux cas.
Aux États-Unis : 4 millions (1,8 %) ; en Europe : 9 millions (0,5-
2 %) ; en France : 500 000 à 600 000 (1 %)
En France, un tiers des patients sont des usagers de drogues ; 50
à 90 % des usagers de drogues sont séropositifs pour le VHC ;
plus de 25 % sont co-infectés par le VIH et le VHC ; 5 à 10 % sont
co-infectés VHC-VHB. Nouvelles contaminations annuelles en
France : environ 5 000 (70 % étant associées à l’usage de drogues).
• Les personnes qui courent le risque maximal d’infection par le
VHC sont les usagers qui se droguent par voie intraveineuse ou
intranasale, les personnes qui ont reçu des transfusions sanguines
avant 1992, le personnel de santé et les hémophiles. Les tatouages,
piercings, scarifications sont des facteurs de risque. Dans 20 à 30 %
des cas, on ne retrouve pas de facteur de risque.
• Chez 80 % des personnes infectées, il se développe une hépatite
C chronique. Dans 20 % des cas apparaît finalement une cirrhose
et dans 5 % des cas une insuffisance hépatique ou un cancer du
foie. L’insuffisance hépatique due à une hépatite chronique est la
cause la plus fréquente de la transplantation.
• Dans environ 80 % des cas, le génotype en cause est le 2 ou le 3
qui “répond” mieux après 24 semaines de traitement, avec une
probabilité quasi nulle de récidive à court et moyen termes.
• Les sujets infectés par un VHC de génotype 1 n’obtiennent une
réponse prolongée au traitement par interféron alpha pégylé et
ribavirine que dans 40 à 45 % des cas. Quarante-huit semaines
de traitement leur sont nécessaires. Deux cent mille personnes
auraient actuellement été dépistées en France, mais beaucoup
n’ont pas été traitées à ce jour, 8 000 à 10 000 patients sont trai-
tés par an, 50 000 jusqu’à présent.
Transplantations : 20 % des 700 à 800 transplantations
hépatiques annuelles ont pour origine l’hépatite C.

95
çois Delfraissy, est d’“inscrire les
traitements dans la durée” car, si
les effets secondaires sont trop
pesants pour le patient, il risque
de devenir presque à tous les
coups “dys-observant”. Et – c’est
un autre point important de ce
rapport –, un traitement au long
cours, correctement prescrit et
pris, n’entraîne pas les résistances
virologiques que l’on croyait il y
a quelques années. Enfin, le
patient (essentiellement celui qui
a peu de symptômes, a plus de
400 T CD4/mm3, mais souffre
d’effets secondaires) peut accé-
der à une “fenêtre thérapeutique”
raisonnée (à condition d’être
convenablement suivi), puis
reprendre son traitement. Reste à
démontrer que ce traitement n’a
pas perdu de son efficacité du fait
de cet arrêt... Cela débouche sur
la possibilité de mettre en place
de nouvelles stratégies thérapeu-
tiques.
Le Courrier : Que faut-il
attendre des inhibiteurs de
fusion, de la molécule T20
(Roche) notamment, dont on
a parlé à Barcelone ?
G.P. : Cette nouvelle molécule,
appelée enfuvirtide, qui a fait
déjà beaucoup de bruit cette
année, est le premier chef de
file d’une famille qui a déjà
d’autres “membres” en gesta-
tion (le T-12-49, par exemple).
Elle est, en effet, un inhibiteur
de la fusion entre le VIH et la
membrane cellulaire sur laquelle
il se fixe. Ces inhibiteurs de
fusion sont la première nouvelle
famille qui voit de jour depuis
l’avènement de la famille des
antiprotéases en 1996. Malheu-
reusement, toutes ces molé-
cules sont injectables, ce qui pré-
sente un inconvénient certain et
ne constitue en aucun cas la
panacée...
Le Courrier : Pourquoi per-
siste-t-on à dire que “le vaccin
n’est pas pour demain”, alors
qu’en Thaïlande 160 000
volontaires sont inclus dans
des essais de phase III d’un
candidat vaccin ?
G.P. : Il existe aussi des essais de
phase III (évaluation d’efficacité)
notamment en Ouganda et aux
États-Unis, et plus de 90 essais en
phases I et II (sur des volontaires
sains). Les stratégies vaccinales
sont nombreuses, mais pour le
moment aucune ne donne de pro-
messe sérieuse et leur efficacité
escomptée n’est que partielle.
L’essai thaïlandais, réalisé en par-
tenariat avec les États-Unis, vise à
apprécier la protection obtenue
par un vaccin mis au point par
Aventis-Pasteur, utilisant comme
vecteur un virus canarypox, sti-
mulant l’immunité cellulaire, et
un rappel par un autre vaccin
VaxGen, stimulant, pour sa part,
l’immunité humorale.
À Barcelone toujours, un sympo-
sium organisé par Christine
Katlama et Brigitte Autran au
nom de l’ORVACS (Objectif
Recherche Vaccin Sida, une fon-
dation privée qui doit beaucoup à
Mme de Bettancourt) s’est plus
attaché à la thématique du vaccin
thérapeutique que préventif,
Brigitte Autran présentant, pour
sa part, l’essai ANRS VACCI-
TER qui a obtenu une bonne tolé-
rance du canarypox chez les
patients VIH+ et une réponse
CD4 proliférative de 60 %
(29/48). Mais, encore une fois, un
consensus sur un modèle vacci-
nal ne s’est toujours pas fait jour.
Le Courrier : La conférence
de Barcelone a-t-elle apporté
du nouveau sur le plan de
l’efficacité des approches de
prévention et de réduction
des risques ?
G.P. : Des scoops dans ce do-
maine, certes non, mais beau-
coup d’expériences menées à tra-
vers le monde, des plus vastes,
initiées et conduites au niveau
gouvernemental, jusqu’aux plus
humbles, lancées au niveau d’un
village, d’un quartier. Oui, la pré-
vention et la réduction des risques
“marchent”, mais faut-il que l’on
communique encore à leur pro-
pos lors de grand’messes interna-
tionales pour en convaincre le
monde ? Pour ma part, j’ai lu un
poster madrilène qui m’a surpris,
car il remet en cause ce que l’on
disait sur les risques de contami-
nation par les rapports oro-géni-
taux non protégés. Dans cette
petite cohorte de 292 sujets hété-
rosexuels “VIH discordants”, au
sein desquels on avait isolé 135
séronégatifs ayant eu quelques
19 000 rapports oro-génitaux
entre 1990 et 2000 (les rapports
anaux et vaginaux étant proté-
gés), on n’a trouvé aucune
séroconversion. Ces pratiques
sexuelles n’entraîneraient donc
même pas une “faible probabilité
de contamination”, contrairement
à ce que l’on disait il y a quelques
temps encore.
Bien sûr, de telles recherches,
comme d’autres dans le domaine
de la prévention, ne peuvent don-
ner lieu de facto à des “prescrip-
tions” en termes de prévention
individuelle et encore moins col-
lective, car, en ce qui concerne du
moins les relations sexuelles
vaginales et anales, les charges
virales peuvent changer d’un rap-
port à l’autre, d’un individu à
l’autre, d’un instant à l’autre. On
connaît mal les échelles de conta-
mination au niveau individuel…
Hépatites C : de nou-
veaux outils au service
des malades
Le Courrier : Lors de cette
conférence internationale, vous
avez présenté un poster (le 20
juin 2001) cosigné par vous-
même, Pascal Gouëzel, Domi-
nique Salmon, Josiane Holstein,
Didier Sicard, Willy Rozen-
baum et Elisabeth Delarocque-
Astagneau sur les co-infections
HIV-HCV dans la plupart des
hôpitaux français (étude trisan-
nuelle). Quelles étaient les
caractéristiques des patients,
concernant leurs génotypes
viraux, l’importance de la co-
infection par les deux virus, de
leur consommation d’alcool,
leurs pathologies, leur accès
relatif au système de soins,
etc. ?
G.P. : Ce poster, réalisé sous
l’égide de l’Association des pro-
fesseurs de pathologie infectieuse
et tropicale (l’APPIT), de
l’Institut national de la veille
sanitaire (l’INVS) et de l’Assis-
tance publique-hôpitaux de Paris,
avait pour but de mieux cerner les
indications actuelles de la prise
en charge des co-infectés
VIH/VHC à commencer par la
biopsie hépatique, le profil des
patients, ceux qui accèdent aux
traitements, etc. Ainsi, 1 813 pa-
tients ont été inclus dans l’étude,
recrutés pour 71 % d’entre eux
dans des CHU et pour 29 % dans
des hôpitaux généraux (services
maladies infectieuses, immuno-
logie clinique, médecine interne) :
64 % des patients co-infectés
(soit 194 sur 305) avaient une
enzyme hépatique élevée (ALT),
36 % (soit 111 sur 305) normale,
58 % avaient le génotype 1 (soit
78 sur 135), 5 % le génotype 2
(7/135), 23 % le génotype 3
(31/135), 13 % le 4 (18/135) et
1% le 6 (1/135). Soixante-douze
pour cent consommaient moins
de 40 g d’alcool par jour, mais
8% plus de 80 g et 20 % de 40 à
80 g.
En fait, 28 % des patients séropo-
sitifs pour le VIH étaient co-
infectés par le VHC, 28 %
consommaient plus de 40 g par
jour d’alcool, 74 % avaient une
hépatite active ou une cirrhose,
9% une cirrhose ou un cancer.
49 % des patients co-infectés
n’avaient pas eu de biopsie du
foie, 46 % n’étaient pas en traite-
ment pour leur hépatite C. Les
patients co-infectés avec un
ALT normal ont deux fois
moins de biopsies hépatiques et
sont donc deux fois moins trai-
tés. Ceux qui consomment plus
de 40 g d’alcool par jour ont
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w

trois fois moins de “chances”
d’avoir une biopsie et donc
d’être traités. Comme on le voit
bien dans cette grosse enquête,
le fait d’être co-infecté, de
boire trop d’alcool, d’être usa-
ger de drogues par voie intra-
veineuse, etc. diminue donc
très clairement les “chances”
d’accès au traitement.
En dépit des améliorations
nettes apportées dans la prise
en charge de ces patients, il
reste donc beaucoup à faire
pour leur permettre de bénéfi-
cier des traitements, engager des
actions spécifiques contre les
consommations d’alcool et
faire valoir l’inanité du dogme
“transaminase normale = pas
de PBH” chez ces patients co-
infectés. La dernière conféren-
ce de consensus concernant la
prise en charge des hépatites C
est très claire sur ce point : “En
cas d’alcoolodépendance, le
traitement peut être proposé s’il
existe une prise en charge glo-
bale de celle-ci”. Comme pour
le sida dans le rapport Del-
fraissy, il y a donc de moins en
moins d’arguments formels à
opposer aujourd’hui à l’évalua-
tion histologique du foie (par
PBH ou bientôt à l’aide de mar-
queurs sanguins) et surtout à la
mise sous traitement. Reste à
traiter différemment le patient
qui boit ou se pique, mais non à
l’exclure du bénéfice des soins.
Le Courrier : Swaps vient de
publier un dossier sur l’hépa-
tite C : on y lit que de nou-
velles recommandations concer-
nant la PBH se sont fait jour. En
résumé : Quand s’en passer ?
combien de patients pour-
raient-ils “se l’économiser”,
puisqu’ils la redoutent, et selon
quels critères ?
G.P. : Tout allègement vers
moins d’investigation est a
priori un gain de chances pour
les malades et, s’il est possible
de disposer de bons critères
pour éviter aux patients “d’y
passer” avant de démarrer un
traitement, pourquoi s’en priver ?
D’autant que la PBH, qui reste
l’examen de référence et, il faut
le rappeler, qui a plusieurs
inconvénients : inconfort, mor-
bidité, mortalité (très faible,
bien heureusement), coût, faux
négatifs et inadaptation au
dépistage et au suivi. Ainsi, lors
de la dernière conférence de
consensus sur la prise en char-
ge de l’hépatite C, on a souli-
gné la possibilité de ne pas la
proposer lorsque l’indication
du traitement est indépendante
des lésions hépatiques (dans les
cas de génotypes 2 ou 3, en
l’absence de comorbidité),
pour une femme ayant un projet
de grossesse afin de diminuer
le risque de transmission de la
mère à l’enfant (même s’il est
faible), lorsque le patient pré-
sente des signes biologiques,
cliniques, échographiques évi-
dents de cirrhose. Ou encore,
évidemment, lorsque l’on ne
peut pas proposer de traitement
à court terme (en cas de cirrho-
se décompensée, lorsque les
transaminases sont normales
sans facteurs de comorbidité).
Quoi qu’il en soit, il est essen-
tiel de préparer le patient à sa
PBH (comme à un entretien
préopératoire), de la dédramati-
ser.
Le Courrier : Où en est-on
des alternatives possibles à
la PBH : imagerie médicale,
marqueurs sanguins directs
et indirects du VHC ? Quelle
est la validité du Fibrotest®?
G.P. : On recourt depuis plu-
sieurs années à des moyens
non invasifs de diagnostic de
la fibrose hépatique parmi les-
quels l’échodoppler et l’endo-
scopie, mais aussi des tests
sanguins, dont le plus populaire
est le Fibrotest®, mis au point
par l’équipe du Pr Thierry
Poynard de la Salpêtrière,
capable d’évaluer, sur une
simple prise de sang, le score
de fibrose nécessaire à la déci-
sion thérapeutique. Le Fibro-
test®permettrait ainsi “d’éco-
nomiser” 45 à 55 % des biop-
sies. Malheureusement, il n’est
pas exempt d’un certain nom-
bre d’erreurs possibles (je
vous engage à lire à ce propos
l’article de Paul Calès, dans le
N° 98 de Transcriptase). Il est
relativement cher (42,5 ) et
ne donne pas tous les rensei-
gnements que peut fournir une
PBH (sur la stéatose, la toxicité
médicamenteuse, l’alcool…).
On attend la mise sur le mar-
ché d’autres marqueurs san-
guins, directs et indirects…
Le Courrier : Les patients
usagers de drogues sont-ils
des “clients” moins com-
pliants que les autres ?
G.P. : La question porte en
elle le germe de la stigmatisa-
tion. C’est vrai qu’un patient
usager de drogues n’est pas, a
priori, le plus “compliant” des
malades, qu’il met parfois en
difficulté l’équipe de soins,
surtout lorsqu’elle n’est pas
formée, a tendance à dispa-
raître de la circulation de
temps en temps… Mais plus
ou moins que les autres
patients ? Et quand bien même ?
Nous sommes là pour soigner
des hommes et des femmes
qui ont besoin de soins appro-
priés, quels que soient leurs
comportements, leurs façons
d’être et de faire, leur orienta-
tion sexuelle ou leurs pra-
tiques addictives. Reste que la
question de la violence se
pose parfois. À nous de trou-
ver la façon de les accompa-
gner au plus près. Et puis, il
faut savoir que l’hépatite C
concerne en France, pour un
tiers des cas, les patients (ex
ou actif) usagers de drogues
et, dans l’avenir, 70 % des
contaminations concerneront
ces patients : soit entre 10 et
13 contaminations par jour.
Les études récentes ont mon-
tré que le nombre d’usagers de
drogues “mauvais répon-
deurs” au traitement (géno-
types 1 et 4) était en augmen-
tation, ils sont toujours plus
nombreux à présenter un “bon
génotype” (le 3), qui guérit
dans 80 % des cas. Un autre
problème vient souvent de ce
que… bien des médecins ne
savent pas que le fait de
prendre des antirétroviraux
peut diminuer la biodisponibi-
lité de la méthadone et que ces
patients peuvent alors se sentir
particulièrement mal, ce qui
majore encore les effets anxio-
gènes et dépressogènes du
traitement. C’est donc à nous
de nous adapter à ces patients
en cessant de croire qu’il faut
qu’ils soient impeccablement
stabilisés pour avoir droit de
bénéficier d’un traitement
efficace. Et qui peut les guérir.
96
Le Courrier des addictions (4), n° 3, juillet/août/septembre 2002
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w
Le sida en chiffres
Dans le monde, une nouvelle contamination toutes les six
secondes, un décès toutes les onze secondes !
•L’Afrique représente plus de 70 % des personnes infectées dans le
monde : 3 400 000 et 28 100 000 vivant avec le sida fin 2001.
•Europe de l’Ouest : 30 000 personnes infectées par le VIH en
2001 (560 000 vivant avec le sida fin 2001). Les trois pays le
plus touchés sont l’Espagne, la France et l’Italie.
•Amérique du Nord, respectivement 45 000 et 940 000.
•Amérique du Sud : 130 000 et 1 400 000.
•Afrique du Nord et Moyen-Orient : 80 000 et 440 000.
•Europe de l’Est et Asie centrale : 250 000 et 1 000 000.
•Asie de l’Est et Pacifique : 270 000 et 1 000 000.
•Asie du Sud-Est et du Sud : 800 000 et 6 100 000.
•Australie et Nouvelle-Zélande : 500 et 15 000 ONUSIDA.
1
/
4
100%