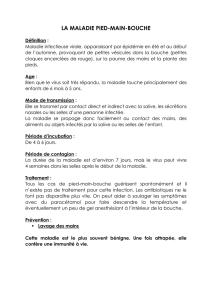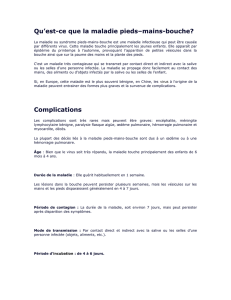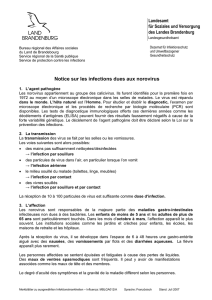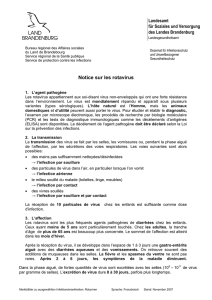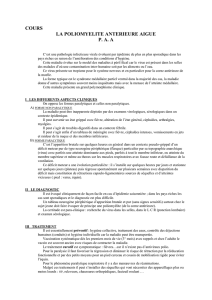La conception de l`enquête doit être décrite d`une manière globale

Protocole 1
PROTOCOLE D’ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE
Code de l’étude (RS2010-67)
DAVIA
Etude des facteurs de risque de survenue des diarrhées aiguës virales chez les sujets
adultes non-institutionnalisés et consultant un médecin généraliste
Etude cas-témoins, menée en médecine générale en France métropolitaine
Responsable de l’étude pour le
réseau Sentinelles :
Christophe Arena, MPH
UMR S 707 Inserm UPMC
Immeuble Castellani - BP 810
20192 AJACCIO Cédex 4
Comité scientifique
• Pr. Hanslik Thomas, UMR S 707 Inserm UPMC, Paris.
• Dr. Falchi Alessandra, UMR S 707 Inserm UPMC, Corte.
• Pr. Amoros Jean-Pierre, Université de Corse, Corte.
• Dr. Vaillant Véronique, Institut de Veille Sanitaire, St
Maurice.
• Dr. Balay Katia, Centre National de Référence des virus
entériques, Dijon.
• Dr. Alain Sophie, Hôpital Dupuytren, Limoges.
• Dr. Chikhi-Brachet Roxane, Agence Nationale de Recherche
sur le Sida, Paris.
• Dr. Arrighi Jean, Observatoire Régional de la Santé de Corse,
Ajaccio.
CONFIDENTIEL
Ce document contient des informations confidentielles et ne doit être utilisé que pour la conduite de
l’étude. Le synopsis ne doit pas être transmis à des personnes non concernées par cette étude, ni utilisé
dans un autre but, sans l’accord écrit préalable du réseau Sentinelles (Inserm UPMC UMR S 707)

Protocole 2
TABLE DES MATIERES
Glossaire ................................................................................................................................................................................. 3
1. Introduction ..................................................................................................................................................................... 4
2. Objectifs ............................................................................................................................................................................ 8
2.1 Objectif principal : ..................................................................................................................................................... 8
2.2 Objectifs secondaires : ............................................................................................................................................... 8
3. Plan expérimental et méthodologie ................................................................................................................................ 8
3.1 Type d’étude .............................................................................................................................................................. 8
3.2 Procédure d’inclusion dans l’étude ............................................................................................................................ 9
3.3 Sélection des médecins généralistes .......................................................................................................................... 9
3.4 Sélection des patients ............................................................................................................................................... 10
3.5 Nombre de sujets ..................................................................................................................................................... 11
4. Données recueillies ......................................................................................................................................................... 12
5. Mode et circulation des données ................................................................................................................................... 14
6. Considérations éthiques et légales ................................................................................................................................ 15
6.1 Cadre réglementaire de l’étude ................................................................................................................................ 15
6.2 Information des sujets et consentement éclairé ........................................................................................................ 15
6.3 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ........................................................................... 15
6.4 Comité de Protection de Personnes (CPP) ............................................................................................................... 15
6.5 Arrêt prématuré de l’étude ....................................................................................................................................... 16
6.6 Monitorage et contrôle des données......................................................................................................................... 16
6.7 Utilisation des résultats de l’étude ........................................................................................................................... 16
7. Financement ................................................................................................................................................................... 16
8. Calendrier ...................................................................................................................................................................... 17
9. Confidentialité ................................................................................................................................................................ 17
10. Références ...................................................................................................................................................................... 18

Protocole 3
Glossaire
Inserm
Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
UPMC
Université Pierre et Marie Curie
InVS
Institut de Veille Sanitaire
GEA
Gastroentérite Aiguë
DA
Diarrhée Aiguë
ARN
Acide RiboNucléique
ADN
Acide DésoxyriboNucléique
RS
Réseau Sentinelles
OR
Odds Ratio (rapport de côtes)
IC95%
Intervalle de Confiance à 95%
FDR
Facteur De Risque
INRA
Institut National de la Recherche Agronomique
MG
Médecin Généraliste
ADELF
Association D’Epidémiologies de Langue Française
CPP
Comité de Protection des Personnes
CNIL
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
CCTIRS
Comité Consultatif sur le Traitement de l’Information en Matière de Recherche dans le
domaine de la Santé

Protocole 4
1. Introduction
Une gastro-entérite est une infection inflammatoire caractérisée par l’émission brutale et fréquente de
selles liquides et abondantes (diarrhée). La diarrhée s’accompagne souvent de vomissements et de
poussées de fièvre, mais les symptômes varient en fonction des individus. Une étude menée aux Pays-
Bas de 1996 à 1999 [1] auprès de patients consultant un médecin généraliste pour une gastro-entérite,
définie comme « trois ou plus selles molles en 24 heures, ou bien diarrhée accompagnée de deux autres
symptômes gastro-intestinaux, ou encore vomissements accompagnés de deux autres symptômes
gastro-intestinaux », a montré que les patients présentaient presque tous des selles molles (98%), et
qu’une très faible partie d’entre eux présentaient uniquement des vomissements (1,4%).
Parmi les étiologies possibles des gastro-entérites aiguës (GEA), on retrouve des bactéries, des
parasites et des virus. La place relative de chacun de ces agents pathogènes varie selon l’âge des
patients, la période de l’année ou encore la région du globe. En période hivernale, les virus représentent
une part importante des étiologies de GEA, alors que les épidémies estivales sont causées
principalement par des bactéries. Une étude menée durant toute l’année 2007 en Autriche avec des
médecins Sentinelles [2] a mis en évidence deux pics annuels de GEA : un pic hivernal principal causé
par une infection virale (norovirus), et un pic estival résultant d’infections bactériennes dues
majoritairement à des Salmonelles.
Dès les années 1940, les virus ont été évoqués comme une cause importante de diarrhée aiguë (DA),
bien que l’étiologie restait inconnue chez de nombreux cas [3]. Mais il faudra attendre les années 1970
pour que soient identifiés au moyen de la microscopie électronique un virus comme cause de DA, le
virus de Norwalk (Norwalk-like virus) découvert dans la ville de Norwalk (Ohio, USA) en 1972 [4], le
rotavirus à Melbourne en 1973 [5] puis l'astrovirus [6] et l'adénovirus [7] en 1975. Puis de nombreux
autres virus ont été proposés comme agents responsables d'épisodes de DA : coronavirus [8],
picobirnavirus [9-11], pestivirus [12] et torovirus [13].
En France, une étude sur la diversité virologique a été menée avec les médecins Sentinelles, durant la
période hivernale 1997-1998 [14]. Elle a permis de retrouver au moins un virus chez près de 40% des
161 patients. Parmi les patients souffrant d’une DA, 19% étaient infectés par un calicivirus humain
(Norwalk-like virus ou Sapporo-like virus), 17% par un rotavirus A (aucun rotavirus C), 4% par un
astrovirus et 2,5% par un adénovirus 40/41. Des études menées en Allemagne [15] ou aux Pays-Bas
[1], sur de longues périodes (et non seulement sur une période hivernale), ont permis de détecter un
virus chez environ 15 et 18%, respectivement, des patients atteints d’une DA.
Les calicivirus sont de petits virus à ARN simple brin, non enveloppés, qui doivent leur nom aux
dépressions régulières en forme de calice observées sur leur surface, en microscopie électronique. Cette
famille de virus est extrêmement diversifiée et responsable de pathologies très variées chez l’animal.
Chez l’homme, ils sont à l’origine de GEA de gravité modérée. Ils sont classés sur la base de critères
génétiques en 5 genres : Norovirus, Sapovirus, Lagovirus, Vesivirus et Nabovirus. Un sixième genre
a été proposé, le genre Recovirus, après sa découverte chez un jeunemacaque vivant en captivité au
Centre Nationale de Recherche sur les Primates à Tulane (Nouvelle-Orléans) [16]. Les genres

Protocole 5
Norovirus et Sapovirus touchant les hommes se subdivisent chacun en 5 génogroupes puis en
génotypes. Parmi ces génogroupes, deux du genre Norovirus (III et V) et un du genre Sapovirus (III)
infectent uniquement l’animal. La diversité génétique des souches circulantes est importante, variant
d’une année à l’autre [17].
Les rotavirus sont de petits virus non enveloppés à ARN segmenté. Ils sont reconnaissables en
microscopie électronique à leur aspect en rayon de roue, d'où leur nom. Leur génome est constitué de
onze segments codant douze protéines. Sept groupes antigéniques ont été identifiés. La protéine
structurale VP6 de la couche intermédiaire de la capside détermine les sérogroupes, A à G. Trois
d'entre eux (A, B et C) infectent les humains, majoritairement le groupe A. Les protéines VP4 et VP7
de la couche externe de la capside portent les antigènes de type, permettant de définir les sérotypes P et
G. Parmi les rotavirus du groupe A, les génotypes G1 à G4 et G9 sont à l’origine de 90% des GEA.
Les astrovirus sont de petits virus à ARN simple brin, non enveloppés. Leur organisation génomique
particulière les classe dans une famille à part, le genre astrovirus, dont ils demeurent les seuls
représentants à ce jour. Leur nom reflète leur morphologie en étoile. Huit types antigéniques ont été
identifiés.
Les adénovirus entériques sont des virus à ADN double brin, non enveloppés. Ils sont reconnaissables
à leur forme icosaédrique hérissée de spicules ou « fibres » constituées de glycoprotéines qui portent la
spécificité du type. Parmi les nombreux sérotypes humains retrouvés, seuls les types 40 et 41 et plus
rarement les sérotypes 2, 3 et 31 sont responsables de GEA.
Moins fréquemment, les virus grippaux, comme les virus entériques, peuvent provoquer des troubles
gastro-intestinaux, tels que DA, vomissements ou encore douleurs abdominales [18-24]. On connaît
mal l'excrétion fécale de virus de la grippe saisonnière et pandémique. De rares précédentes études ont
rapporté la détection d'ARN de virus grippaux dans les selles d’enfants présentant une AD et un
syndrome grippal [18], de virus A/H1N1 2009 chez des patients séropositifs hospitalisés en raison de
complications de la GEA [20], et de virus grippaux chez des patients hospitalisés et non hospitalisés
présentant à la fois des symptômes gastro-intestinaux et respiratoires [19]. A notre connaissance aucune
donnée sur les adultes consultant en médecine générale et aucune donnée comparative avec des
contrôles n'ont été publiées.
Le mode de transmission de ces virus est essentiellement de type oro-fécal, direct par les mains, ou
indirect par les surfaces ou les objets, aliments ou eaux souillés. Si la transmission par les sécrétions
pharyngées n’a jamais été démontrée, la transmission par aérosols à partir des matières fécales, de
vomissements, ou de linges contaminés est possible. Elle est favorisée par l’abondance des particules
virales dans les selles en phase aiguë de la maladie, un taux d’attaque élevé, un taux de portage
prolongé dans les selles, jusqu’à près de 3 semaines, et une grande résistance des virus, qui gardent
notamment leur pouvoir infectieux sur les surfaces sèches et les mains [25]. Ainsi, plus de 15% d’une
charge virale déposée sur les doigts peut encore être transmise après 20 minutes [26]
Bien que les DA sont une importante cause de décès et de morbidité dans les pays en voie de
développement, leur impact dans les pays industrialisés reste non négligeable, notamment chez les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%