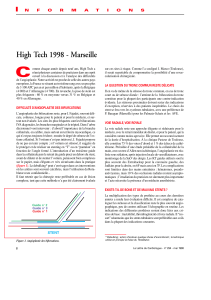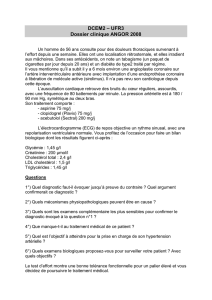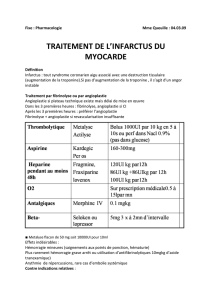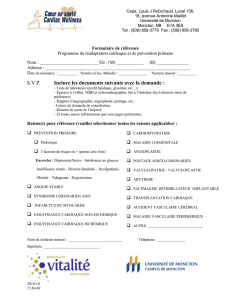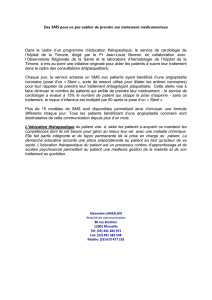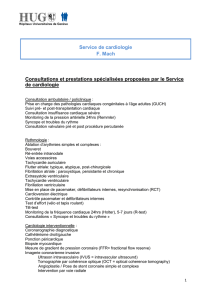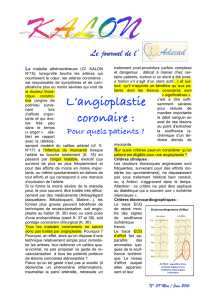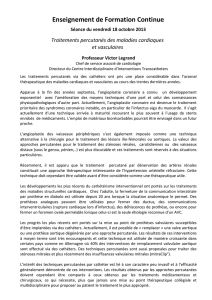Lire l'article complet

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. III - juin 1999 101
ÉDITORIAL
ourquoi chercher un nouveau mode de traitement de
la sténose carotide alors que l’on vient à peine de ter-
miner un cycle de 15 ans d’évaluation de la chirurgie
de ces sténoses et d’en démontrer l’efficacité ? Pourquoi, après 30
ans de débats entre les tenants d’une médecine “fondée sur les
preuves” prônant la nécessité de cette évaluation et ceux se fon-
dant sur leur expérience de l’efficacité de cette chirurgie (match
manifestement gagné par la ténacité des premiers), le même genre
de débat – pour le moins tendu – surgit-il entre les tenants de la
chirurgie et les promoteurs de l’angioplastie carotide ?
LA CHIRURGIE CAROTIDE EST EFFICACE,
ENTRE DES MAINS EXPERTES
Mille neuf cent quatre-vingt dix-huit aura vu la fin des deux études
ayant évalué la chirurgie carotide en cas de sténose symptoma-
tique, après un suivi de cinq à huit ans, avec toutes deux des résul-
tats très similaires, ce qui accroît encore la force de leurs conclu-
sions (1). Les sténoses les plus serrées (au-delà de 70 %)
bénéficient grandement de la chirurgie (endartérectomie) sans
plus aucun doute : le risque à deux ans d’une récidive homolaté-
rale à la sténose passe de 26 % dans le groupe médical à 9 % dans
le groupe chirurgie, soit une réduction relative du risque de 65 %
et un bénéfice de dix-sept infarctus cérébraux évités pour cent
patients traités. Pour les sténoses modérées ou peu serrées ainsi
que les sténoses légères, la chirurgie est contre-indiquée. En ce
qui concerne les sténoses mesurées entre 70 et 85 % selon la
méthode de mesure usuelle (soit entre 50 et 70 % selon la méthode
de mesure américaine), les derniers résultats montrent que cer-
taines décisions d’endartérectomie peuvent être délicates à
prendre chez le sujet âgé de plus de 80 ans, en cas de diabète,
d’accident rétinien, ou encore chez les femmes, car l’effet pré-
ventif dans pareils cas n’est pas évident.
Dans tous les cas, le geste chirurgical doit être intégré à une prise
en charge globale des facteurs de risque, avec traitement d’une
hypertension artérielle ou d’une hypercholestérolémie, arrêt d’une
intoxication tabagique, exercice physique régulier et contrôle du
poids, et être associé à un traitement antiplaquettaire et à un dépis-
tage de la maladie coronaire.
Les résultats de la chirurgie carotide, compte tenu d’un risque
opératoire faible, sont très satisfaisants. Quel intérêt y aurait il
donc à développer une technique concurrente comme l’angio-
plastie, jugée intuitivement risquée puisqu’elle laisse en place le
matériel athéromateux et expose théoriquement au risque
thrombo-embolique immédiat ?
L’ACTE CHIRURGICAL A UNE MORBIDITÉ,
MÊME RÉALISÉ PAR DES MAINS EXPERTES
Dans l’étude NASCET par exemple, le risque périopératoire
d’AVC et de décès était de 5,8 % (1). Il était de 7,5 % dans l’étude
européenne ECST. Ces résultats ont été obtenus dans les
meilleures conditions techniques et d’expertise neurologique
imposées par le protocole de ces études. Une revue systématique
de 50 études portant sur le risque périopératoire de 16 000 endar-
térectomies carotides a montré que le risque combiné de décès et
d’AVC variait selon les séries de 1,03 % à 35 % (2). Les études
qui ont fait appel à l’expertise d’un neurologue indépendant obte-
naient un risque d’AVC (7,7 %) trois fois supérieur à celui que
l’on retrouvait dans les études où il était évalué par le chirurgien
qui avait pratiqué l’intervention (2,3 %) (2). Un grand nombre
d’infarctus cérébraux dus à l’endartérectomie carotide furent donc
non diagnostiqués en l’absence d’évaluation neurologique. Le
Stroke Council de l’American Heart Association a recommandé
que le risque opératoire pour un chirurgien donné soit inférieur
à 6 %. Aucun audit externe, périodiquement réactualisé, ne garan-
tit habituellement au patient que son praticien répond réellement
à la performance opératoire requise.
L’ANGIOPLASTIE CAROTIDE EST FAISABLE,
MAIS PAS SANS RISQUE !
L’angioplastie avec stent est désormais un traitement à part entière
des sténoses des artères iliaques ou fémorales, coronaires ou
rénales, avec des bénéfices et des risques bien évalués et de mieux
en mieux maîtrisés, même si la resténose reste une éventualité
trop fréquente. L’angioplastie carotide a toujours paru trop ris-
quée jusqu’à ce que quelques pionniers l’introduisent, bénéficiant
des améliorations techniques et de l’apparition du stent (ou endo-
prothèse) posé en première intention (3, 4, 5). Au premier rang
des complications redoutées se trouve l’embolie cérébrale au
cours de la procédure, car l’angioplastie consiste en l’écrasement
de la sténose et donc sa fracture. Cette dernière expose le cœur
lipidique de la plaque, faisant redouter ses conséquences throm-
bogènes. Le stent améliore le résultat sur la perméabilité et la
Demain, l’angioplastie carotide
●
P. Amarenco*
* Service de neurologie, hôpital Lariboisière, Paris.
P

ÉDITORIAL
La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. III - juin 1999
102
sûreté du geste, et l’association à un traitement de six semaines
par aspirine + ticlopidine ou clopidogrel pourrait réduire consi-
dérablement les complications thrombotiques.
D’autres risques existent. Outre les complications au point de
ponction et l’allergie à l’iode, il y a le risque généré par le guide
ou le ballonnet, à l’origine d’occlusions de la carotide par vasos-
pasme, dissection artérielle, thrombose aiguë, ou simplement le
risque lié à la chute de la perfusion sanguine après gonflement
du ballonnet sur un hémisphère cérébral fragilisé par l’absence
de suppléance anastomotique. La dilatation peut être à l’origine
d’une bradycardie et d’une hypotension par stimulation du sinus
carotide (traitée par injection d’atropine), mais le risque théo-
rique de rupture artérielle semble infime. Parfois l’angioplastie
peut être techniquement difficile à réaliser, ou échouer en raison
de tortuosités ou de boucles artérielles, soit encore en raison d’une
sténose trop serrée que ne peut franchir le guide. Dans certains
cas également, le résultat anatomique est mauvais du fait d’une
sténose résiduelle trop importante. Le taux de succès dans les
études de faisabilité varie cependant de 90 à 100 %, et, au fil des
congrès, nous l’avons vu s’améliorer.
Comme le soulignent Gaux et coll. dans ce numéro de la Lettre
du Neurologue, il est difficile d’estimer actuellement la morbi-
dité globale de l’angioplastie à partir des données disponibles
dans la littérature, car celle-ci n’est pas homogène. En premier
lieu, il y a une hétérogénéité des techniques utilisées. Au début,
c’est à l’angioplastie simple que l’on recourait, puis à l’angio-
plastie avec stent autoexpansible. Ce matériel endoprothétique a
été perfectionné et des techniques de protection vis-à-vis des
embolies per-procédure peuvent désormais être utilisées. Les don-
nées de la littérature sont aussi inhomogènes en raison de l’ex-
posé des résultats, qui pouvait inclure une sténose carotide interne
à son origine et une autre sténose d’artère cérébrale comme celle
de l’artère vertébrale, ou encore mêler sténoses carotides symp-
tomatiques et asymptomatiques. En outre, les études de faisabi-
lité ont essentiellement porté, pour les plus sérieuses d’entre elles,
sur les contre-indications relatives de la chirurgie, comme une
bifurcation trop haute, un état cardiaque jugé trop sévère pour
supporter l’acte chirurgical, une sténose radique, une sténose trop
longue ou une occlusion controlatérale avec sténoses multiples
des artères cérébrales.Tout cela à l’évidence ne pouvait que nuire
à l’évaluation de la technique. Nombre de ces estimations du
risque pâtissaient aussi du manque d’évaluation indépendante
effectuée par des neurologues. Là encore, au fil du temps et des
congrès, nous avons vu ce risque diminuer lentement mais sûre-
ment. Rappelons-nous que la morbidité de la chirurgie carotide
était importante à ses débuts, dans les années 50-60, avec des
chiffres pouvant dépasser 20 %, et puis, la technique s’amélio-
rant, ce risque opératoire est devenu plus acceptable.
Les études avec audit neurologique indépendant conduites aux
États-Unis (Yadav et coll.) (6) et en Europe (étude CAVATAS) (7)
ont montré que ce risque pouvait être voisin du risque opératoire
chirurgical. Dans l’étude de Yadav et coll., sur une série consé-
cutive de 107 patients, le risque d’AVC et de décès toutes causes
confondues était de 7,9 %, et le risque d’infarctus majeur homo-
latéral ou de décès était de 1,6 % (6). Sur une série de 231 patients
consécutifs, la même équipe rapporte un risque d’infarctus céré-
bral mineur de 6,2 % et majeur de 0,7 %, à trente jours post-pro-
cédure (8). Les auteurs notent que seuls 14 % de leurs patients
auraient été éligibles pour une chirurgie carotide (insistant ainsi
sur la gravité et la complexité de leurs cas), et que, parmi ceux-
ci, le risque de la procédure était seulement de 2,7 %. Dans une
analyse multivariée, ils ont identifié l’âge élevé et les sténoses
longues et multiples comme étant les prédicteurs indépendants
de complications per- ou post-procédure (8). L’étude CAVATAS
est terminée mais n’est pas encore publiée. Des résultats ont
cependant étaient rapportés au mois de juin 1998 à l’European
Stroke Conference (7). Il s’agit de la première étude randomi-
sée ayant porté sur 504 patients (251 dans le groupe angioplas-
tie et 253 dans le groupe chirurgie). Le risque à trente jours d’in-
farctus cérébral invalidant ou de décès était de 6,4 % dans le
groupe angioplastie et de 6,3 % dans le groupe chirurgie. Il n’y
avait pas de différence, à sept jours, concernant l’incidence des
infarctus cérébraux homolatéraux à la sténose. Cette étude
souffre cependant de nombreuses critiques tenant aux critères
d’inclusion, à la non-consécutivité des patients inclus, à l’incer-
titude du degré de sténose qui était déterminé à partir de l’inter-
prétation, dans chaque centre, de données ultrasonographiques
ou angiographiques aussi imprécises que “ulcération” ou “throm-
bus mural”, sans qu’aucun essai de standardisation n’ait été réa-
lisé entre les centres. Les cas avec sténoses sévères ou avec sus-
picion d’ulcération et thrombus mural pouvaient être exclus et
opérés en dehors du protocole, biaisant ainsi l’essai CAVATAS
au détriment de l’endartérectomie.
Les données sont donc très insuffisantes pour affirmer que la chi-
rurgie et l’angioplastie sont deux techniques comparables en ce
qui concerne le risque opératoire. L’angioplastie carotide avec
stent reste une technique expérimentale pour l’ANAES, qui a
estimé, dans ses recommandations datant de 1997, qu’ “il n’y a
pas d’indication à l’angioplastie carotide dans les sténoses athé-
romateuses en dehors des essais thérapeutiques”. Elle ne peut don-
ner lieu à cotation dans le cadre de la nomenclature des actes médi-
caux (JO du 09/02/97). Des incertitudes persistent également quant
au risque à long terme de resténose. Il serait de 5 % pour l’angio-
plastie avec pose de stent (Yadav et coll.), soit un pourcentage
équivalent à ce que l’on peut attendre après endartérectomie (6).
ET SI L’ANGIOPLASTIE ÉTAIT AUSSI EFFICACE,
MOINS VULNÉRANTE ET MOINS CHÈRE ?
Certains avantages de l’angioplastie sur l’endartérectomie caro-
tide sont évidents et permettraient de l’envisager comme une
alternative, non pas forcément systématique mais très intéres-
sante, à la chirurgie. Elle prévient la cicatrice cervicale et ses
éventuelles complications douloureuses et/ou paresthésiantes,
gênantes ou invalidantes, liées à la section d’un tronc nerveux
(7,6 % des cas d’endartérectomie). Elle évite un hématome cer-
vical post-opératoire parfois volumineux (2 à 3 % des cas), et
surtout l’anesthésie générale ou loco-régionale. Elle permet
d’envisager à terme un acte ambulatoire et donc la réduction de
la durée d’hospitalisation et des coûts. Elle peut agir sur des sté-

La Lettre du Neurologue - n° 3 - vol. III - juin 1999 103
noses inaccessibles à la chirurgie (par exemple les sténoses trop
longues ou multiples siégeant sur les vaisseaux proximaux
comme l’artère carotide primitive), et pourquoi pas, dans le
futur, sur des sténoses de la terminaison carotide ou de l’artère
vertébrale ou sur certaines sténoses hémodynamiques du tronc
basilaire. Certains des avantages de l’angioplastie sont particu-
lièrement importants pour les patients les plus fragiles, à haut
risque opératoire, ou qui ont une contre-indication pour un acte
chirurgical majeur, comme une cardiopathie sévère. Elle per-
met ainsi de traiter des patients qui, autrement, ne le seraient
pas. Le confort opératoire de l’angioplastie est bien meilleur,
au point même que, paradoxalement, cela risque de trop bana-
liser le traitement de la sténose artérielle, l’acte chirurgical ayant
une valeur “pédagogique” certaine, souvent extrêmement impor-
tante, car il fait prendre conscience à certains patients de la gra-
vité potentielle de leur cas et de la nécessité d’un traitement pré-
ventif complémentaire au long cours. La cicatrice est parfois la
mémoire qu’a le patient de son accident ischémique cérébral
transitoire. Souvent d’ailleurs elle est exhibée avec un peu de
la fierté d’un “ancien combattant” !
Certaines indications de l’angioplastie paraissent déjà pouvoir
être discutées en première intention, comme le traitement des sté-
noses radiques ou des resténoses après chirurgie (9).
ÉVALUONS-LA !
Comme l’a souligné récemment un groupe d’experts de l’Ame-
rican Heart Association, ce n’est pas parce qu’une technique est
disponible qu’elle doit être utilisée avant d’avoir été évaluée, et
aucune angioplastie, à de très rares exceptions près, ne devrait
être faite en dehors d’essais randomisés approuvés par des comi-
tés d’éthique (10). De grandes études randomisées, comparant
l’angioplastie avec stent et la chirurgie des sténoses de l’origine
de l’artère carotide interne, tentent actuellement de se mettre en
place aux États-Unis et en Europe, car, outre la comparaison du
risque à trente jours de chacune des procédures, il est impératif
de comparer leur efficacité à long terme. À ce jour, nous n’avons
que très peu de données sur l’efficacité préventive à long terme
de l’angioplastie, alors que nous connaissons l’effet bénéfique de
la chirurgie.
Pour l’évaluer, seule une approche multidisciplinaire est possible.
La revue systématique de la littérature portant sur le risque de
l’endartérectomie carotide montre que beaucoup de complica-
tions neurologiques de la procédure ne sont pas reconnues par les
médecins qui l’ont pratiquée (2). De telles données montrent l’im-
portance d’une expertise clinique neurologique pour la détection
des événements indésirables en cas d’angioplastie carotide. L’an-
gioplastie se pratique sans anesthésie, mais demande un examen
neurologique fait par un neurologue avant, pendant et après la
procédure. Aucun système de monitoring peropératoire ne pourra
remplacer l’expertise clinique pour la détection précoce des évé-
nements indésirables. Le suivi à long terme doit être conduit par
un clinicien dont c’est la spécialité, car il fait partie d’une prise
en charge globale du risque artériel, du traitement des facteurs de
risque et de la meilleure stratégie antithrombotique.
NAISSANCE DE LA NEUROLOGIE VASCULAIRE
INTERVENTIONNELLE ?
L’émergence de cette nouvelle technique de traitement des sté-
noses des artères cérébrales doit être replacée dans le contexte des
nombreuses avancées majeures que le domaine de la neurologie
vasculaire a connues ces dernières années, et qui fondent l’émer-
gence et l’avenir de cette jeune spécialité en plein essor. De nou-
veaux champs immenses de recherche clinique, grâce aux progrès
des techniques endovasculaires, s’ouvrent aux neurologues inter-
ventionnels de demain, à la fois sur le plan biologique (biologie
de la paroi, biologie de l’athérosclérose, de l’hémostase et de la
resténose) et sur les plans technique et thérapeutique (évaluation
de l’angioplastie, mais aussi traitement thrombolytique intra-arté-
riel, traitement antithrombotique antiplaquettaire par voie orale et
par voie veineuse associé au geste d’angioplastie), perspective qui
devrait contribuer à stimuler encore le dynamisme, l’intérêt et l’en-
thousiasme qui animent la neurologie vasculaire.
Outre la maîtrise d’une excellente expertise clinique neurologique
et des techniques d’ultrasons des artères cérébrales, les neurologues
vasculaires de demain devront aussi, comme les cardiologues l’ont
fait en leur temps, ajouter à leur arsenal la neurologie interven-
tionnelle, pratiquée au sein d’équipes et de plateaux techniques
multidisciplinaires, dans un esprit de collaboration. La neurologie
vasculaire, en se structurant, doit être un exemple de spécialité d’or-
gane dans laquelle la prise en charge des patients est multidisci-
plinaire, à l’image des “stroke centers” américains. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Barnett H.J.M., Taylor W., Eliasziw M. et coll. for the North American
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. Benefit of carotid
endarterectomy in patients with symptomatic moderate or severe stenosis. N Engl
J Med 1998 ; 339 : 1415-25.
2. Rothwell P.W., Slattery J., Warlow C.P. A systematic review of the risks of stroke
and death due to endarterectomy for symptomatic carotid stenosis. Stroke
1996 ; 27 : 260-5.
3. Théron J.G., Payelle G.G., Coskun O. et coll. Carotid artery stenosis : treat-
ment with protected balloon angioplasty and stent placement. Radiology 1996 ;
201 : 627-36.
4. Hurst R.W. Carotid angioplasty. Radiology 1996 ; 201 : 613-6.
5. Brown M.M., Butler P., Gibbs J. et coll. Feasibility of percutaneous translumi-
nal angioplasty for carotid artery stenosis. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1990 ;
55 : 238-43.
6. Yadav J.S., Roubin G.S., Iyer S. et coll. Elective stenting of the extracranial
carotid arteries. Circulation 1997 ; 95 : 376-81.
7. Brown M.M. for the CAVATAS investigators. Results of the carotid and verte-
bral artery transluminal angioplasty study (CAVATAS). Cerebrovasc Dis 1998 ; 8
(suppl. 4) : 21.
8. Mathur A., Roubin G.S., Iyer S.S. et coll. Predictors of stroke complicating
carotid artery stenting. Circulation 1998 ; 97 : 1239-45.
9. Yadav J.S., Roubin G.S., King P. et coll. Angioplasty and stenting for resteno-
sis after carotid endarterectomy. Initial experience. Stroke 1996 ; 27 : 2075-9.
10. Bettmann M.A., Katzen B.T., Whisnant J. et coll. Carotid stenting and angio-
plasty. A statement for healthcare professionals from the councils on cardiovas-
cular radiology, stroke, cardio-thoracic and vascular surgery, epidemiology and
prevention, and clinical cardiology, American Heart Association. Circulation
1998 ; 97 : 121-3.
1
/
3
100%