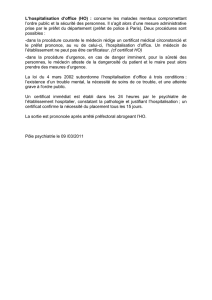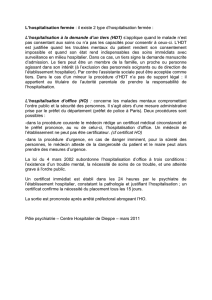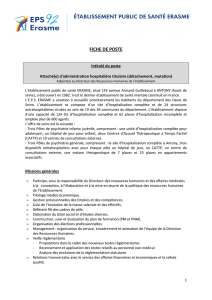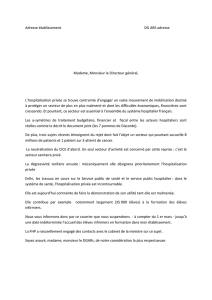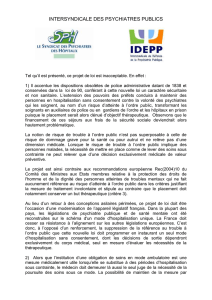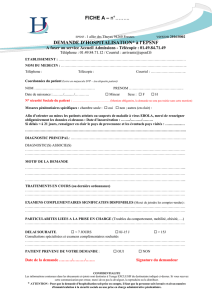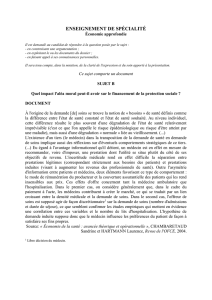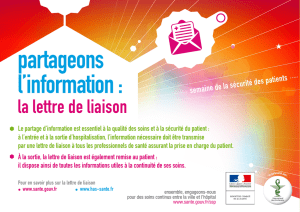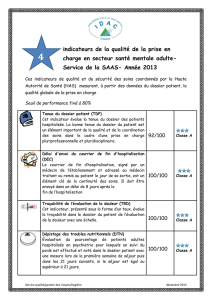M Même les patients hospitalisés sous contrainte ont des droits

Même les patients hospitalisés
sous contrainte ont des droits
Même lors d’hospitalisations
sans consentement en psy-
chiatrie, le patient a le droit d’être in-
formé dès son admission puis, à sa
demande, de sa situation juridique et
de ses droits », tient à rappeler Do-
minique Friard, infirmier en soins
psychiatriques à l’hôpital de La-
ragne. Les soignants sont dans
l’obligation de lui lire ses droits et
possibilités de recours. «Je lui ex-
plique qu’il a été hospitalisé parce
qu’une personne l’a demandé pour
lui et que cette personne n’est pas un
persécuteur. Cela permet aussi de lui
expliquer qu’il ne va pas rentrer chez
lui. D’une certaine manière, cela pré-
pare sa sortie. Mais certains soi-
gnants de psychiatrie craignent de lire
ses droits au patient. Ils ont peur qu’il
porte plainte. Ils se disent qu’il va de-
mander à quelqu’un de lui rendre jus-
tice. » Même paranoïaque, un pa-
tient qui porte plainte est un
patient qui bouge. Il s’inscrit dans
un itinéraire social.
«Mais cette loi sur l’hospitalisation
sans consentement ne parle pas de
soins, rappelle Dominique Friard.
Elle implique une obligation de
surveillance de la personne, et non
la nécessité de soins. » Il arrive tou-
tefois que le refus de soins par
le malade soit considéré par le
psychiatre comme une preuve de
sa maladie.
Marche à suivre
Cette loi de 1990, “l’hospitalisation
à la demande d’un tiers” (HDT),
remplace le “placement volontaire”
de la loi de 1838. De même, “l’hos-
pitalisation d’office” (HO) rem-
place l’ancien “placement d’office”.
Des étapes très précises sont pré-
vues par la loi pour ces deux types
de procédures.
1. Les étapes de l’hospitalisation
à la demande d’un tiers
«L’hospitalisation sur demande d’un
tiers ou HDT doit reposer sur un sys-
tème d’entraide familial et amical, ex-
plique Alexandra Véluire, juriste
(Ifross) à l’université Lyon-III. Tro i s
conditions sont nécessaires. Il faut que
cette personne soit atteinte de troubles
mentaux, que ces troubles mentaux
rendent impossible son consentement
aux soins, que son état réclame, en-
fin, des soins immédiats et assortis
d’une surveillance constante en mi-
lieu hospitalier. La décision du direc-
teur se fonde alors sur la demande
d’un tiers et deux certificats médi-
caux. Ce “tiers” peut être un membre
de la famille ou “une personne sus-
ceptible d’agir dans l’intérêt du ma-
lade”. Cette personne effectue une de-
mande d’hospitalisation manuscrite
et signée. Il faut également un premier
certificat médical signé par un prati-
cien n’exerçant pas dans l’hôpital où
serait hospitalisé le patient, ainsi
qu’un deuxième certificat médical
d’un praticien y exerçant. »
Le directeur de cet établissement,
qui doit vérifier qu’il n’existe pas
d’alliance entre ces deux méde-
cins, produit, 24 heures après
l’admission, un troisième certifi-
cat. Celui-ci confirme ou non
l’hospitalisation, laquelle sera
assortie d’un certificat de quin-
zaine, puis d’un certificat men-
suel quinze jour plus tard.
2. Les étapes de l’hospitalisation
d’office
«L’hospitalisation d’office peut inter-
venir après arrêt du préfet, en cas de
troubles mentaux qui perturbent
l’ordre public ou la sécurité des per-
sonnes », précise Alexandra Véluire.
Il s’agit donc d’une mesure de po-
lice, le trouble de l’ordre étant le
fondement de cette décision.
Il arrive toutefois que cette hospi-
talisation s’applique, par exemple,
à une personne qui s’enferme.
«Elle ne trouble pas l’ordre public,
convient la juriste. Dans ce cas, on
entend l’expression “sécurité des per-
sonnes” comme s’appliquant au pa-
tient lui-même. »
Dans tous les cas d’HO, le pré-
fet doit recueillir au préalable un
avis médical écrit, qui ne peut
émaner d’un psychiatre exer-
çant dans l’hôpital accueillant le
malade.
Une information sur cette hospi-
talisation est transmise au procu-
reur et à la Commission psychia-
trique sur l’ordre public. Comme
l’HDT, l’hospitalisation d’office
doit être assortie d’un certificat de
quinzaine, puis de certificats men-
suels quinze jours plus tard, à trois
mois et à six mois.
3. Les autres hospitalisations sans
consentement
Si le péril est imminent, on peut
se passer de cette procédure. Les
maires de communes et, à Paris,
les commissaires de police d’ar-
rondissements peuvent prendre
les mesures pour procéder à
l’hospitalisation. Ils préviennent
le préfet, qui dispose de
24 heures pour confirmer ou
non la mesure initialement prise.
A Paris, très concrètement, les
Avant l’entrée en vigueur de la loi de 1990*, aucun
texte ne précisait que les patients hospitalisés sous
contrainte en psychiatrie disposaient de droits. Les
quelques textes relatifs aux droits des malades ne leur
étaient pas applicables.
Psychiatrie
12 Professions Santé Infirmier Infirmière - No24 - mars 2001
«

commissaires de police appli-
quent cette procédure pour in-
terpeller des personnes et les
conduire à l’infirmerie psychia-
trique de la préfecture de police.
Elles y sont enfermées le temps
qu’un certificat médical soit
rédigé et que le préfet de police
prenne ensuite un arrêté d’HO.
Les autres cas d’hospitalisation
sans consentement concernent
les personnes ayant commis des
délits relevant de la justice, et
celles hospitalisées à l’hôpital gé-
néral, où l’on considère qu’une
hospitalisation sans consente-
ment en psychiatrie s’imposerait.
4. La fin de l’hospitalisation sans
consentement
«La fin d’une hospitalisation
d’office peut intervenir sur avis mé-
dical, précise Alexandra Véluire.
Le directeur de l’hôpital y procède
alors. Cette fin d’hospitalisation
d’office peut aussi intervenir par dé-
cision du tribunal de grande ins-
tance, ou après que la personne a
saisi ce tribunal. »
Une hospitalisation à la demande
d’un tiers peut se clore sur déci-
sion médicale, lors de la rédac-
tion des divers certificats insti tués
par la loi. Par ailleurs, le méde-
cin peut demander que la sortie
intervienne en dehors de ces
échéances. Théoriquement, la sor-
tie devrait intervenir également
dès qu’une de ces personnes a
requis la levée d’hospitalisation :
le curateur en la personne du
malade, le conjoint ou concubin,
les ascendants en l’absence de
conjoint, les descendants majeurs
en l’absence d’ascendants, la per-
sonne ayant signé la demande
d’admission, les Comités dépar-
tementaux de l’hospitalisation
psychiatrique (CDHP). La loi pré-
voit cependant que, si le médecin
de l’hôpital est en désaccord et es-
time que le patient pourrait com-
promettre l’ordre public ou la sé-
curité des personnes, il informe le
préfet de son avis sur la demande
de sortie. C’est ainsi qu’à l’occa-
sion d’un désaccord entre la fa-
mille et le médecin sur une HDT,
celle-ci peut alors être transformée
en HO par ce praticien. «Pour
l’HDT, dit enfin Alexandra Véluire,
l’hospitalisation peut cesser, comme
pour l’HO, à la suite de la saisine du
tribunal de grande instance du lieu
d’établissement. »
Des décisions hâtives
Mais on remarque de plus en plus
que l’indication d’hospitalisation
à la demande d’un tiers est posée
très tôt. Ces demandes émanent
en particulier des hôpitaux géné-
raux et de leurs services d’ur-
gences. L’application de la loi de
1990 subit une dérive : la per-
sonnalité du “tiers” dans l’hospi-
talisation à la demande d’un tiers.
Aux urgences, si le patient se
conduit de manière un peu diffé-
rente, il est vite “étiqueté” psy-
chotique suicidaire.
Or, celui qui accueille n’est pas
celui qui soignera. La tentation est
d’autant plus grande, pour le soi-
gnant ayant cette seule fonction
d’aiguillage, de ne traiter qu’une
urgence et non le patient. Ce
qui est préjudiciable pour le bon
suivi de ses soins psychiatriques
ultérieurs.
Marc Blin
Propos recueillis
lors de la conférence
“L’hospitalisation sans consentement”,
RSTI, Paris, novembre 2000.
* Loi du 27 juin 1990 “relative aux droits
et à la protection des personnes hospitali-
sées en raison de leurs troubles mentaux, et
à leurs conditions d’hospitalisation”. JO du
30 juin 1990.
13
Professions Santé Infirmier Infirmière - No24 - mars 2001
Égalité
des chances et handicap
A l’occasion de la Journée interna-
tionale des personnes handicapées
du 3 décembre 2000, l’OMS a pu-
blié un rapport sur la santé des per-
sonnes handicapées. L’OMS estime
à 7 à 10 % la proportion mondiale
des personnes ayant des incapacités
(d’ordre physique, intellectuel, sen-
soriel ou mental, avec un caractère
permanent ou temporaire), soit en-
viron 500 millions. Près de 80 % de
ces personnes vivent dans les pays
en développement dont 1 à 2 % seu-
lement bénéficient des services de
réadaptation nécessaires.
CNAM
et arrêt maladie
La CNAMTS rappelle que l’obliga-
tion, pour tout médecin, d’inscrire
le motif médical de la prescription
d’arrêt de travail est une obligation
nouvelle résultant d’une loi votée
àl’automne par le Parlement et
non d’une décision interne à l’as-
surance maladie. Le président de
la CNAMTS souhaite cependant
que les pouvoirs publics fassent
établir des références de bonne
pratique en matière de prescrip-
tion d’arrêt de travail, qui consti-
tueront le cadre de référence de
prescription pour les médecins
traitants et de contrôle pour les
médecins conseils.
Un site
pour la pneumologie
Le site de la Société de pneumolo-
gie de langue française (SPLF),
www.splf.org, offre désormais un
accès au grand public. Ce site pro-
pose une information qualifiée,
validée par les membres de la SPLF.
Il permet aussi une communica-
tion entre patients grâce à un fo-
rum et un projet à l’étude s’articu-
lera autour d’une communication
entre patients et médecins.
Brèves...
ERRATA
• Dans le numéro précédent, il faut lire :
téléphone : 01 46 99 18 99
pour l’AAPI (Association d’aide aux personnes
incontinentes).
• Dossier RSTI :
le compte rendu sur les soins palliatifs est issu
de la conférence organisée en collaboration
avec l’Institut UPSA de la douleur.
1
/
2
100%