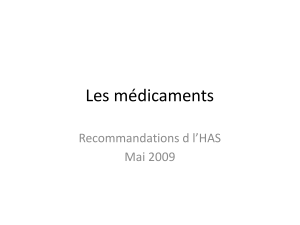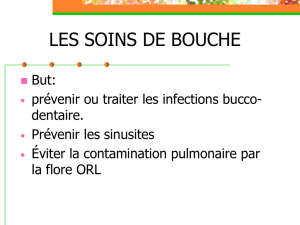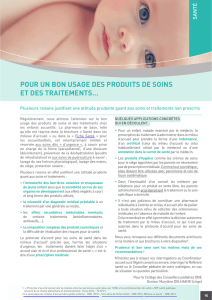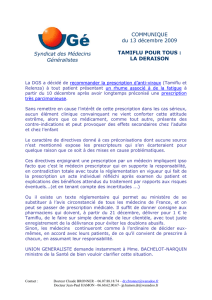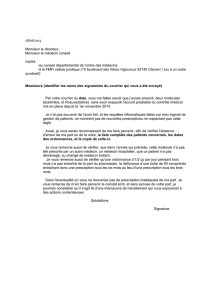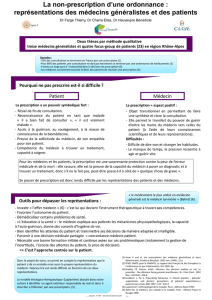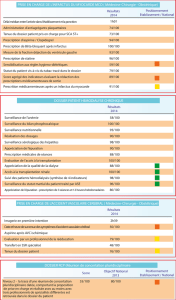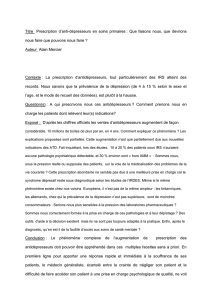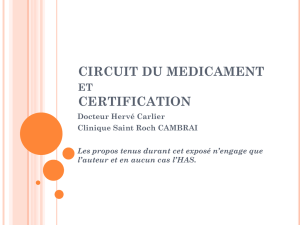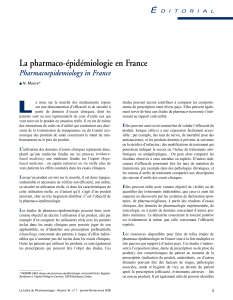L’ l e s m o t s ...

Les mots et les hommes
Les mots et les hommes
112
La Lettre du Psychiatre - Vol. IV - n° 3-4 - mai-juin-juillet-août 2008
L’
actualité s’y prête : la prescription des psychotropes
est à nouveau remise en question (1). L’inquiétude
ne porte pas tant sur leur efficacité intrinsèque, que
les cliniciens ont tant de fois heureusement observée, que sur
l’évaluation de cette dernière par les essais cliniques tels qu’ils
ont été préconisés ces dernières années.
Néanmoins, le fondement de la prescription des psychotropes se
résume-t-il à la connaissance des essais cliniques ? Sûrement pas.
Dans notre article, nous avons tenté de décortiquer les méca-
nismes et les savoirs à l’œuvre lors de la prescription des psycho-
tropes, afin d’individualiser certaines caractéristiques de celle-ci
et leurs interrelations. Résultante d’un système multifactoriel,
la prescription d’un psychotrope se révèle être le résultat d’une
combinatoire savante et complexe qui ne peut se concevoir sans
prendre en compte la dimension temporelle (le moment où elle
intervient) ni la relation soignante dans laquelle elle s’inscrit.
Nourrie d’une narration et d’une histoire thérapeutique déjà
en cours, la prescription est aussi un pari pour l’avenir, une
anticipation dans laquelle essaient de s’accorder les enjeux du
patient et ceux du médecin. Dans ce système multivarié, subti-
lement hiérarchisé et mis en tension par des désirs souvent
contradictoires, la prescription d’un psychotrope dépasse la
simple application des recommandations issues des résultats
des essais cliniques.
En dépit des progrès dans la standardisation de la clinique, et des
recommandations de prescription, la finesse d’une observation
clinique multivariée et la qualité de l’alliance thérapeutique
restent essentielles à la pertinence d’une prescription de psycho-
trope à un patient donné. Néanmoins, cette liberté idéale a un
prix, celui du travail continu du clinicien prescripteur. Inlassable
apprenti sémiologue, anthropologue des diversités du monde
contemporain, ce dernier devra aussi être exégète de la plainte,
adaptateur des classifications et des avancées scientifiques ainsi
que thérapeute soucieux des enjeux culturels en matière de
santé. Sa tâche est d’autant plus difficile qu’il doit rendre sa
démarche parfaitement intelligible pour le patient et pour les
autres thérapeutes, sans pour autant annuler la complexité qui la
sous-tend. Cet effort de clarté et d’explicitation est indispensable ;
sans lui, la prescription, devenue graphisme énigmatique, sera
fondée sur la croyance, d’autant plus dangereuse qu’elle prendra
l’apparence de la science ou de la psychologie.
Prescrire de façon adaptée un psychotrope est ainsi le résultat
d’un compromis. La prescription devra intégrer la singularité
de l’histoire d’un patient envisagé dans son contexte tout en
s’appuyant sur une sémiologie standardisée dessinant un patient
“moyenné”, “statistique”, comparable et transposable.
UN PATIENT SINGULIER
Le cœur de la pratique psychiatrique fondant la prescription
reste l’entretien et l’observation. Toutefois, sans grille préalable,
aucune organisation des données recueillies n’est possible. La
difficulté réside dans le fait qu’aucune grille clinique ne peut
prétendre à l’exhaustivité et qu’il convient, au sein de celles qui
sont possibles dans un contexte donné, de hiérarchiser les plus
pertinentes. Ainsi le contexte de la prescription aux urgences
diffère-t-il de celui d’un renouvellement d’ordonnance ou de celui
d’un échec thérapeutique. Chaque situation requiert une lecture
symptomatique et une hiérarchisation spécifiques. Toutefois, si
sophistiquée soit-elle, la démarche présidant à la prescription
doit rassembler un minimum classificatoire à la fois consensuel
parmi les pairs et intelligible pour le patient. Une prescription
fondée exclusivement sur l’intuition du clinicien ne pourrait
que lui appartenir et faire de cette dernière un simulacre ou une
supercherie puisque relevant uniquement de son injonction,
de sa subjectivité.
Une autre difficulté réside dans le fait que la clinique qui fonde
nos classifications, loin de sa fixité supposée indifférente au
temps, change d’une époque à l’autre. À côté de la clinique de
nos ouvrages de référence, basée sur les observations de nos
prédécesseurs, émerge celle de nos contemporains ou de nos
ordinateurs distinguant de nouvelles entités cliniques, auxquelles
il faut nous accoutumer. Les nouvelles approches cliniques,
fondées sur des présupposés nouveaux, n’ont pas pour finalité
d’annuler totalement les approches différentes. Elles témoignent
simplement du fait que nos patients sont nos contemporains
et qu’ils ajustent leurs manifestations aux modifications de la
phénoménologie sociétale. On citera comme entités cliniques
nouvelles la notion de handicap, celle de souffrance psycho-
sociale ou encore une métadimension telle que la cognition.
N’étant plus considérées, comme par le passé, comme la consé-
quence d’autres symptômes, le handicap, l’intégration sociale,
l’état neurocognitif (par exemple, les troubles de la mémoire de
travail) sont en passe de devenir des fragments séméiologiques
autonomes. Une prescription peut ainsi être justifiée par une
Prescription des psychotropes :
un carrefour entre science et conscience
Prescribing psychotropic drugs: a mix between science and ethics
B. Messan-Murphy*, P. Nuss**
* Service de psychiatrie, hôpital Saint-Jacques, Nantes.
** Service de psychiatrie, hôpital Saint-Antoine, Paris.
PSY mai-Juin 08.indd 112 20/08/08 15:46:18

Les mots et les hommes
113
Les mots et les hommes
La Lettre du Psychiatre - Vol. IV - n° 3-4 - mai-juin-juillet-août 2008
anxiété sociale isolée entraînant un handicap subjectif chez tel
patient, mais pas chez tel autre dont l’anxiété n’a pas de reten-
tissement social. La notion de handicap est ainsi devenue un
élément séméiologique à part entière. On observe de même
aujourd’hui des prescriptions fondées uniquement sur la plainte
subjective de fatigue. Ces “symptômes”, initialement considérés
comme résultant de l’intensité d’un trouble, sont devenus des
facteurs de gravité de ce dernier puis des éléments autonomes, à
un même niveau séméiologique. Ainsi la fatigue d’être soi, selon
la belle formule d’A. Ehrenberg, est-elle devenue aujourd’hui
un symptôme-plainte intrinsèque, au même titre que d’autres
plus classiques.
Les manifestations symptomatiques des troubles mentaux sont
des signaux qui témoignent d’une souffrance. Leur caractéristique
en psychiatrie est qu’elles s’adressent à un tiers. Elles ne se conten-
tent pas d’exister (comme le ferait la valeur d’une glycémie) : elles
comportent intrinsèquement dans leur expression la mention
d’un destinataire. Le premier destinataire est sans doute le patient
lui-même. Elles sont donc soumises, comme toute information,
aux lois qui régissent la communication dans notre monde et
particulièrement à celles associées à la consommation. Les
plaintes symptomatiques en tant qu’objets de communication
comportent et anticipent une série de présupposés, notam-
ment le droit d’être entendu, d’obtenir une réponse légitime. Il
existe ainsi, dans toute plainte, un destinataire, de même qu’une
représentation de la pensée de l’autre, de ce qu’il devrait faire,
notamment lorsqu’il s’agit d’un médecin. Toute plainte comporte
implicitement une anticipation de ce que son destinataire devrait
ou pourrait faire – et, particulièrement, prescrire.
On le voit, une grille d’analyse unique présidant universellement
à la prescription est donc improbable. Le clinicien doit trouver
un équilibre entre plusieurs modèles séméiologiques. Pour une
part, il considèrera les symptômes observés comme résultant
d’un désordre cérébral témoignant des contraintes intrinsèques
du dysfonctionnement de l’organe cerveau. Il tentera, dans le
cadre de cette approche, d’identifier les invariants biologiques
qui sous-tendent ces manifestations ainsi que les ruptures qu’ils
opèrent vis-à-vis du fonctionnement antérieur. Mais il devra
aussi, et concomitamment, inclure dans la symptomatologie
observée les modalités du vécu pathologique. Cela est impor-
tant car c’est à partir de cet éprouvé que le patient percevra sa
souffrance, demandera de l’aide et validera la pertinence de la
prescription. Lors d’une prescription de psychotrope, ces deux
niveaux d’analyse clinique complémentaires sont présents, et ce
à deux conditions. D’une part, la prescription d’un psychotrope
est indissociable d’une connaissance scientifique du cerveau.
Le psychotrope prescrit agira sur un système neurobiologique,
quelle que soit la représentation du symptôme ou de la souf-
france. Ignorer les règles fondamentales de psychopharmacologie
est un manquement à l’éthique, c’est pourquoi le prescripteur
ne pourra pas faire l’économie de l’apprentissage actualisé des
grands principes du fonctionnement biologique du cerveau.
D’autre part, l’engagement du patient dans le soin, notamment
dans la prise d’un psychotrope, présuppose l’existence d’un
désir de changement, une représentation de soi suffisamment
construite pour anticiper un avenir différent. De même, l’ab-
sence de modèle de représentation globale de la pensée et des
émotions humaines est incompatible avec la prescription d’un
psychotrope. On comprend donc que cette dernière possède dans
le même temps une base scientifique et psychothérapeutique.
On peut ainsi affirmer que la prescription d’un psychotrope est
partie intégrante d’une démarche psychothérapeutique parce
qu’elle présuppose un désir, un espoir et des représentations
psychologiques.
UN ÊTRE HUMAIN SOCIAL ET STATISTIQUE
La prescription d’un psychotrope à un patient se fonde aussi
sur d’autres considérations, sur une autre histoire que celle du
patient. Elle s’appuie en particulier sur la reconnaissance des
invariants symptomatiques décrits dans l’espèce humaine de
façon très diverse depuis l’Antiquité, regroupés initialement
sous le vocable “maladies de l’âme” et aujourd’hui répertoriés
dans le Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders
(DSM). Mais la prescription inclut aussi une autre histoire,
celle de la neuropsychobiologie, moins ancienne mais tout
aussi évolutive. Ces deux approches classificatoires et neuro-
biologiques, bien que revendiquées par la science, possèdent
comme elle des présupposés culturels fortement influencés
par les changements sociaux et techniques des époques où
elles ont vu le jour.
Par exemple, l’industrialisation et l’urbanisation ont entraîné
des changement tels que certains comportements associés à
des maladies comme la psychose sont apparus sous l’angle de la
pathologie mentale alors qu’ils étaient jusque-là absorbés, assi-
milés dans la vie sociale, à cause de leur rareté. Les psychotiques
jusqu’alors bergers, saisonniers ou assis près de l’âtre ont ainsi été
soudain mis sous les feux des projecteurs de cités moins absor-
bantes où, chacun devant travailler dans un emploi déterminé,
il n’était plus possible de s’intégrer au groupe. Les changements
sociétaux ont, entre autres choses, fait émerger dans les classi-
fications une pathologie jusqu’alors non décrite.
Toujours dans le même registre, une fonction non clinique
du DSM réside dans son rôle d’identification d’un barême de
remboursement et d’aide financière. Le modèle classificatoire
qui présidait à l’époque de ces acquis était le modèle psychana-
lytique. Sa nature et ses bases théoriques fondées sur la relation
transférentielle, donc sur un rapport de deux sujets singuliers
impliqués dans une relation exclusive et délibérée, ne pouvaient
pas convenir à cette approche classificatoire. Là encore, les
changements sociétaux dans lesquels le groupe social se mobi-
lisait pour soutenir ses différents membres ont conduit à des
modifications de perspective qui ont fondamentalement changé
les présupposés de la prescription.
Il en va de même de la connaissance du fonctionnement
biologique cérébral, issue autant du progrès des sciences et
des méthodes de mesure (particulièrement de l’imagerie) que
des représentations culturelles du comportement humain
(notamment le recours au comportement comme validateur
PSY mai-Juin 08.indd 113 20/08/08 15:46:18

Les mots et les hommes
Les mots et les hommes
114
La Lettre du Psychiatre - Vol. IV - n° 3-4 - mai-juin-juillet-août 2008
3
3
3
3
“La Lettre du Psychiatre assure
une Formation Médicale Continue
indispensable à votre exercice”
Claudie Damour-Terrasson
Directeur de la Publication
Pendant un an, recevez 6 numéros de La Lettre du Psychiatre, mais aussi des suppléments,
le point sur l’actualité et les congrès…
Béné ciez de comptes-rendus de congrès internationaux en temps réel envoyés sur votre e-mail
Accédez de façon eZgbVcZciZ et illimitée au numéro en cours de votre revue et à ses archives
– en accès exclusif et réservé – sur notre site Internet www.edimark.fr, mais aussi aux
archives sur 10 ans et aux numéros en cours des 20 autres publications du groupe, et ce pendant
toute la durée de votre abonnement
Béné ciez d’un copyright gracieux (usage personnel à but non lucratif) des articles, mais aussi des gures
(sous réserve du référencement de la revue) – articles à télécharger sur notre site Internet
Périodique de formation en langue française
Indexation dans la base PASCAL (INIST / CNRS)
La Lettre du Psychiatre béné cie d’un agrément
de l’Association de la Commission Paritaire
des Publications et Agences de Presse (CPPAP).
3337jaaZi^cYÉVWdccZbZci333|gZbea^gVjkZghd
3<V\cZoYjiZbehVous pouvez vous abonner directement sur notre site Internet :
333lll#ZY^bVg`#[g (rubrique “abonnez-vous”)
ABO-LPSY.indd 1 24/07/08 11:06:16
des pensées et des émotions), à partir desquelles la psychologie
expérimentale posait ses paradigmes expérimentaux. Le méca-
nisme d’action des psychotropes utilisés aujourd’hui repose sur
une représentation du fonctionnement biologique cérébral qui
date de l’époque où ils ont été identifiés. On cite l’importance
de neuromédiateurs tels que la noradrénaline, la dopamine,
la sérotonine, l’acétylcholine, l’histamine, le GABA. Pourtant,
les acquis récents ont montré qu’il existe de nombreux autres
acteurs de transmission de l’information cérébrale, comme les
peptides, les acides aminés, les gaz ainsi que des neuromodu-
lateurs comme les lipides. Ces données, dont on connaît l’im-
portance, ne sont habituellement pas prises en compte dans la
prescription des psychotropes. Heureusement, on commence à
s’intéresser à des molécules interagissant avec d’autres systèmes
plus récemment mis à jour.
L’apparition des psychotropes et leur remboursement ont néces-
sité la mise en place d’un consensus classificatoire à partir duquel
établir leur efficacité. Cette dernière a été évaluée non pas sur des
individus isolés, mais sur des populations de patients rassemblées
de façon suffisamment reproductible pour permettre des compa-
raisons. Afin de former des groupes homogènes de malades, il
a fallu dégager un consensus sur l’intensité symptomatique à
partir de laquelle on pouvait considérer que le groupe de patients
rassemblés appartenait au groupe malade (score minimal à une
échelle) mais il fallait aussi, comme l’indique le DSM, que les
patients présentent un handicap significatif. Cette notion est,
elle aussi, éminemment culturelle puisqu’elle correspond à une
représentation de la santé, dans un groupe social, à un moment
donné. Ainsi le DSM, puisqu’il servait à établir l’efficacité d’une
molécule sur un groupe de patients, a-t-il progressivement et
subrepticement été utilisé pour classifier les malades, et pour
résumer et justifier la prescription par le seul truchement des
essais randomisés en double aveugle. Une faiblesse de ces essais
est qu’ils recrutent des patients ne présentant que les symp-
tômes de la pathologie étudiée (absence de comorbidité) afin de
permettre d’obtenir un libellé clair et remboursable. Par ailleurs,
le modèle classificatoire du DSM, se définissant comme non
explicatif et uniquement descriptif, conduisait à une segmen-
tation de la séméiologie : plusieurs catégories diagnostiques
associées étaient nécessaire pour rendre compte de la clinique.
Ainsi chaque patient présentait-il presque systématiquement
une polypathologie mentale (comorbidité). Les essais cliniques
sélectionnant les patients sans comorbidité s’éloignaient donc
singulièrement de leur finalité : évaluer l’efficience des psycho-
tropes pour permettre leur prescription. Enfin, du fait même
de cette segmentation artificielle, on a vu progressivement les
psychotropes quitter leur statut de thérapeutique exclusive à
un trouble identifié et devenir des panacées, favorisant alors
les critiques et la contestation. Ces dernières s’adressent selon
nous davantage à la méthodologie des essais qu’aux molécules
elles-mêmes.
CONCLUSION
Ainsi, loin d’être un acte simple, presque mécanique, la pres-
cription d’un psychotrope est une décision complexe. Issue de
l’analyse fine d’une situation de souffrance, elle est fondée à la
fois sur la science, sur la culture et s’inscrit dans un rapport
singulier. Elle cristallise un moment au sein d’une trajectoire de
vie individuelle, d’un savoir médical sur les pathologies mentales
– particulièrement un état des neurosciences – tout en prenant
en compte les représentations de la santé d’un groupe social
dans une situation économique particulière. On imagine la diffi-
culté de la tâche lorsqu’il s’agit d’édicter des règles communes
de prescription (consensus), de donner une lisibilité (trans-
parence) et de continuer à penser aux traitements de demain
(prévention et recherche). Les règles de prescription doivent
donc être perçues non pas comme un aboutissement figé, issu
de vérités éternelles, mais comme un état temporaire résultant
d’une réflexion hybride. Il ne faut pas penser qu’il est impos-
sible d’édicter les règles, mais “simplement” concevoir que ces
dernières sont provisoires, successivement et nécessairement
remplacées en fonction des mouvements des savoirs. En cela,
elles sont en accord avec leur propos fondateur : participer au
maintien d’une dynamique, celle de la vie. ■
RéféRence bibliogRaphique
1. Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB et al. Initial severity and antidepres-
sant benefits: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Adminis-
tration. PLoS Med 2008;5(2):e45.
PSY mai-Juin 08.indd 114 20/08/08 15:46:20
1
/
3
100%