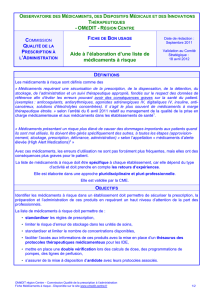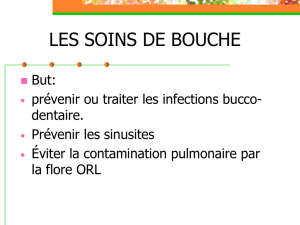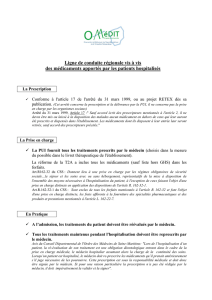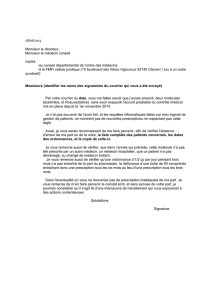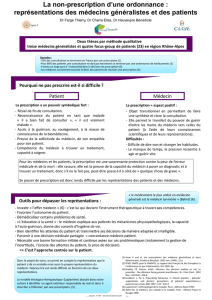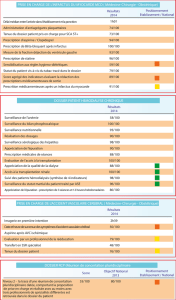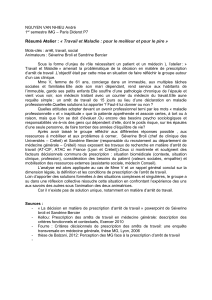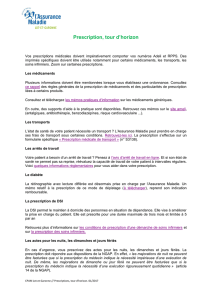L La pharmaco-épidémiologie en France É

La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 1 - janvier-février-mars 2005
3
ÉDITORIAL
L
a mise sur le marché des médicaments repose
sur une démonstration d’efficacité et de sécurité à
partir de données d’essais cliniques, dont les
patients sont ou non représentatifs de ceux d’entre eux qui
vont recevoir le produit en situation réelle. Il en est de même
des estimations de coûts ou d’utilité qui conduisent aux déci-
sions de la Commission de transparence ou du Comité éco-
nomique des produits de santé concernant le statut de rem-
boursement ou le prix du produit.
L’utilisation des données d’essais cliniques représente donc,
plutôt qu’une médecine fondée sur les preuves
(evidence-
based medicine)
,une médecine fondée sur l’espoir
(hope-
based medicine)
:on espère retrouver en vie réelle chez de
vrais patients les effets constatés dans les essais cliniques.
Lorsqu’un produit est mis sur le marché, il est donc logique,
souhaitable et nécessaire de vérifier son efficacité, son utilité,
sa sécurité en utilisation réelle, et donc les caractéristiques de
cette utilisation réelle, ce d’autant qu’il s’agit d’un produit
innovant, cher ou très largement distribué. C’est l’objectif de
la pharmaco-épidémiologie.
Les études de pharmaco-épidémiologie peuvent donc avoir
comme objectif de décrire l’utilisation d’un produit, afin par
exemple d’en comparer les utilisateurs réels avec les patients
inclus dans les essais cliniques pour pouvoir juger de son
applicabilité, ou d’identifier une prescription préférentielle
(chanelling)
concernant des patients à risque d’effets indési-
rables qui n’auraient pas été inclus dans les essais cliniques.
Outre les patients qui utilisent les produits, ce sont également
les prescripteurs qui peuvent être l’objet des études. Ces
études peuvent encore contribuer à comparer les comporte-
ments de prescription entre divers pays. Elles peuvent égale-
ment servir de base aux études de pharmaco-économie s’inté-
ressant au rapport coût-utilité.
Elles peuvent aussi avoir comme but de valider l’efficacité du
produit, lorsque celle-ci a une expression facilement acces-
sible : par exemple, des taux de survie, de mortalité pour des
anticancéreux, et les produits destinés à prévenir la survenue
ou la récidive d’infarctus ; des modifications de traitement qui
pourraient indiquer le succès ou l’échec de traitements anti-
biotiques ou antiépileptiques... On peut alors comparer les
résultats observés à ceux attendus ou espérés. D’autres indi-
cateurs d’efficacité pourraient être les taux de maintien de
traitements, par exemple dans des pathologies chroniques, et
les raisons d’arrêts de traitement comparées aux descriptions
des raisons d’arrêts des essais cliniques.
Elles peuvent enfin avoir comme objectif de vérifier ou de
quantifier des événements indésirables, que ceux-ci aient été
supectés ou découverts par les systèmes de déclaration spon-
tanée, de pharmacovigilance, à partir des résultats d’essais
cliniques, des données de pharmacologie expérimentale, de
toxicologie, ou à partir de données concernant d’autres pro-
duits similaires. La démarche concernant la toxicité putative
est évidemment la même que celle concernant l’efficacité
espérée.
Les ressources disponibles pour faire de telles études de
pharmaco-épidémiologie en France sont à la fois multiples et
très pauvres par rapport à d’autres pays. Ces études s’intéres-
sent à l’exposition (dose, durée de prescription ou de prise du
produit), aux caractéristiques du patient au moment de la
prescription (indication du produit, antécédents, ou d’autres
éléments pouvant être des facteurs de risque, pathologies
associées, mode et hygiène de vie), au devenir du patient
après la prescription (efficacité, événements adverses – liés
ou non au produit). Il est également utile de pouvoir identifier
La pharmaco-épidémiologie en France
Pharmacoepidemiology in France
●
N. Moore*
* INSERM U657, réseau de pharmaco-épidémiologie, université Victor Segalen-
Bordeaux II, hôpital Pellegrin-Carreire, 33076 Bordeaux Cedex.

4
La Lettre du Pharmacologue - Volume 19 - n° 1 - janvier-février-mars 2005
ÉDITORIAL
des sujets contrôles, soit non exposés dans une approche de
cohorte, soit n’ayant pas l’événement d’intérêt dans une
approche cas-témoins.
L’exposition médicamenteuse peut être abordée à partir de
sources diverses : les bases de données de l’assurance mala-
die, qui, toutefois, ne comprennent pas de données cliniques
et sont détruites au bout de deux ans. Les données de l’assu-
rance maladie ne contiennent pas les produits d’automédica-
tion et sont parfois imprécises quant au destinataire exact du
produit remboursé. En outre, elles ne sont pas d’un abord
facile, les procédures nécessaires pour y accéder pouvant
varier du plus simple au plus complexe, voire à l’impossible,
dépendant du but de l’étude, de l’interlocuteur et des objectifs
en cours de l’assurance maladie. Les données d’hospitalisa-
tion (PMSI) et les dossiers médicaux comprennent les événe-
ments, mais rarement les antécédents ou le mode de vie (ou
du moins pas de façon fiable le plus souvent), et encore moins
souvent des données fiables d’exposition médicamenteuse – il
est possible que la prescription informatisée puisse à terme
améliorer l’information sur les médicaments pris en cours
d’hospitalisation, au moins pour les produits dits T2A. Il est
possible de retrouver les médicaments prescrits en cours
d’hospitalisation en retournant aux pancartes et aux dossiers
infirmiers. Les données d’interrogatoire des dossiers médi-
caux ne sont en général d’aucune utilité pour la consomma-
tion médicamenteuse, ou, plutôt, sont dangereux, dans la
mesure où ils pourraient laisser croire à une précision ou à
une exactitude bien illusoires tant que les externes et internes
ne seront pas convaincus de l’utilité de savoir ce que prennent
les patients et formés à l’interrogatoire médicamenteux, un
exercice souvent plus subtil qu’il n’y paraît au premier abord.
Il est donc le plus souvent nécessaire de retourner au patient
et/ou au médecin traitant ou prescripteur pour avoir des infor-
mations fiables, sous réserve du libre choix multiple du(des)
médecin(s) par le patient et de la multiplicité des prescrip-
teurs. L’évolution vers un médecin référent qui serait informé
de l’ensemble de l’activité médicale autour d’un patient ne
peut être qu’un progrès pour nous, se rapprochant ainsi du
modèle anglais, et nous laissant espérer à terme la création
d’une base de données analogue à celle du GPRD anglais,
base de référence reconnue dans le monde entier, mais qui,
malheureusement, ne comporte que des patients anglais. Le
retour au patient peut se faire par l’intermédiaire de son
médecin traitant, ou par accès direct, orienté par une pres-
cription identifiable soit par la demande de remboursement,
soit par l’intermédiaire d’un pharmacien, soit encore à l’oc-
casion d’un événement critique ou d’une hospitalisation. Le
patient peut également être identifié et interrogé au hasard par
contact téléphonique en utilisant des techniques de sondage.
On peut donc envisager des études réalisées entièrement dans
des bases de données de remboursement, lorsqu’il s’agit uni-
quement de décrire des populations sur des critères simples
non cliniques, encore que l’on puisse parfois avoir des indica-
tions de données cliniques sur des informations indirectes : un
homme de 50 ans hospitalisé et sortant avec un anticoagulant,
une aspirine, une statine, un bêtabloquant, un IEC et un dérivé
nitré a plus de risques d’avoir fait un infarctus ou un syndrome
de menace qu’un homme de 35 ans qui sort de l’hôpital avec
des anticoagulants, des antalgiques, un plâtre et de la rééduca-
tion… Ou encore une femme de 75 ans qui prend du Vioxx®
(avec du Mopral®,bien sûr) ou du Chondrosulf®a plus de
risques d’avoir une indication d’arthrose que l’homme de
40 ans qui sort de chez son médecin avec un AINS (pas du
Vioxx®,ce serait hors AMM), un myorelaxant et un lombostat.
Le plus souvent, il faudra aller chercher tout ou partie de l’in-
formation auprès du patient ou de son médecin. Il faudra donc
en avertir ce dernier pour qu’il trouve le temps, parmi ses
tâches multiples (en particulier de médecin référent), de nous
renvoyer quelque information. Faut-il le payer, ou cela
devrait-il faire partie de son activité collective, pour laquelle
les pouvoirs publics lui seront éternellement reconnaissants
(comme pour tant d’autres choses) ?
Ces études de pharmaco-épidémiologie devraient pouvoir
être réalisées pour tout produit nouveau, innovant, et cher.
Encore faut-il en avoir les moyens, non pas tant financiers
(c’est un coût infime par rapport aux investissements promo-
tionnels des entreprises du médicament, et le prix par sujet
est ridicule par rapport à un essai clinique) qu’humains :
le nombre d’équipes en France intéressées par la pharmaco-
épidémiologie et susceptibles de faire (bien) ces études se
compte sur les doigts d’une main (ou des deux). Ces études
complémentaires des études d’autorisation de mise sur le mar-
ché doivent dès maintenant être prises en charge par les phar-
macologues formés à l’épidémiologie.
Encore un défi à relever... ■
1
/
2
100%