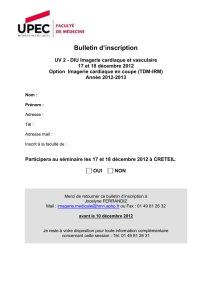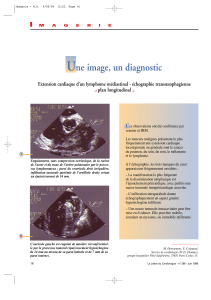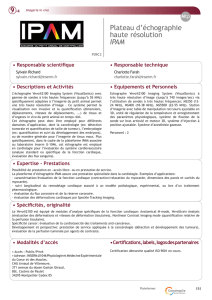L L’imagerie fonctionnelle pour la médecine personnalisée DOSSIER THÉMATIQUE

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 6 - juin 2012 | 315
DOSSIER THÉMATIQUE
La médecine personnalisée
L’imagerie fonctionnelle pour
la médecine personnalisée
Functional imaging for personalized medicine
N. Lassau*
* Irciv, institut Gustave-Roussy ; IR4M,
UMR8081, université Paris-Sud-XI,
Villejuif.
L
a recherche de biomarqueurs prédictifs de
la réponse clinique est indispensable pour le
développement de la médecine personnalisée
en cancérologie et devient un enjeu majeur (1).
Des tests compagnons diagnostiques ont vu le
jour dans le côlon, le sein et le mélanome avec les
mutations de KRAS, de BRCA et de BRAF, respecti-
vement. En imagerie, l’objectif est de sélectionner la
bonne molécule pour le bon patient (2) en effectuant
2 mesures, avant et juste après le début du traite-
ment. Cette recherche de biomarqueurs en imagerie
est encore en phase de validation et nécessite avant
tout, comme première étape, de démontrer une
corrélation avec le devenir clinique dans des études
multicentriques.
Jusqu’à présent, la réponse tumorale objective
évaluée par l’imagerie sur 2 examens successifs est
l’un des éléments qui guident la décision de pour-
suivre ou d’arrêter les traitements. Pour les essais de
phase I et II, cette réponse tumorale est le principal
paramètre d’évaluation.
Les thérapeutiques ciblées ont mis en défaut le
critère de diminution de la taille comme seul para-
mètre à évaluer. En effet, des patients considérés
comme non répondeurs aux thérapeutiques sur
ce seul critère ont une survie équivalente à celle
des répondeurs. De nouvelles méthodes d’imagerie
fonctionnelle, basées sur l’évaluation initiale et
les modifications de l’angiogenèse tumorale
sous traitement, sont maintenant indispensables
pour estimer correctement la réponse tumorale.
Ces techniques pourraient être un atout majeur
pour le développement de la médecine personna-
lisée en permettant de distinguer très tôt les bons
et les mauvais répondeurs avant l’apparition des
critères morphologiques traditionnels.
Rappel des critères
internationaux
La réponse tumorale est actuellement défi nie en
général par la diminution de la taille d’une lésion
observée sur 2 examens d’imagerie successifs
(espacés de 2 à 3 mois), qu’il s’agisse d’évaluer
un traitement dont l’effi cacité est connue ou d’un
essai clinique concernant un nouveau traitement.
Les critères classiques de l’OMS (Organisation
mondiale de la santé), les RECIST (Response
Evaluation Criteria In Solid Tumors) ou les critères
d’approximation volumique ont l’avantage d’être
fi ables et reproductibles. Mais la corrélation entre
survie globale et réponse tumorale n’est pas toujours
prouvée (3). Actuellement, les critères RECIST sont
reconnus au niveau international dans les essais de
phase I et II pour les tumeurs solides de l’adulte. En
pratique courante, ils doivent toujours être corrélés
à l’amélioration clinique, à la diminution des symp-
tômes, à la normalisation d’un marqueur et à l’amé-
lioration de la qualité de vie (4).
Les critères de l’OMS sont déterminés (5) pour une
lésion donnée en calculant sa surface (produit des
2 plus grandes dimensions perpendiculaires dans un
même plan). Quand il y a plusieurs cibles, on réalise la
somme des surfaces des différentes lésions. On évalue
la réponse au traitement par l’évolution de ces mêmes
surfaces. Si une réponse complète correspond bien à
100 % de régression tumorale, les valeurs défi nissant
la réponse partielle (au moins 50 % de régression) ou
la progression (au moins 25 % de progression) sont
totalement arbitraires, et la validité clinique de ces
mesures n’est jamais isolée. On parle de maladie
stable dans la fourchette intermédiaire : progression
inférieure à 25 %, régression inférieure à 50 %.

316 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 6 - juin 2012
Points forts
»La DCE-US a été implémentée dans les guidelines européens avec un niveau de preuve 1.B (Oxford).
»
La DCE-US a été standardisée : injection en bolus et quantification à partir des données linéaires brutes
sur 3 minutes.
»
La mesure à 1 mois du paramètre AUC (volume sanguin) est prédictive de la réponse aux traitements
anti-angiogéniques dans différents types de tumeurs (RCC, HCC, côlon, mélanome).
Mots-clés
Imagerie fonctionnelle
Volume vasculaire
Quantifi cation
DCE-US
Traitements anti-
angiogéniques
Highlights
»
DCE-US has been imple-
mented in european guidelines
with a level1.B evidence.
»
DCE-US has been standar-
dized: bolus injection and
quanti fi cation based on rough
linear data over 3minutes.
»
One month AUC (blood
volume) predicts response
to antiangiogenic agents in
several tumors (RCC, HCC,
colorectal cancer, melanoma).
Keywords
DCE-US
Functional imaging
Antiangiogenic agents
Avec l’arrivée de l’imagerie en coupes, qui permet
de détecter un nombre plus important de lésions,
les imprécisions des critères de l’OMS ont été majo-
rées, et des travaux canadiens, nord-américains et
européens ont proposé l’utilisation de mesures unidi-
mensionnelles mises à jour en 2009 (6, 7). On mesure
toujours la somme des plus grands diamètres des
lésions, mais on se limite à 2 lésions par organe (au
lieu de 5) et à 5 lésions par patient (au lieu de 10). Pour
l’évaluation en tomodensitométrie (TDM), la taille
minimale des lésions mesurables est de 10 mm si
l’épaisseur des coupes est égale ou inférieure à 5 mm ;
si les coupes sont plus épaisses, la taille minimale
est le double de l’épaisseur. Cette nouvelle version
apporte également des précisions concernant l’évalua-
tion ganglionnaire : une adénopathie peut être prise
pour cible si le petit axe ganglionnaire mesure plus de
15 mm. Des précisions ont été apportées quant aux
critères de réponse afi n de pallier les inconvénients
qui ont été décrits dans la littérature. La progres-
sion tumorale qui correspond à une augmentation
de la taille de 20 % de la somme des mesures est
affi née afi n de tenir compte du risque d’erreur lors
de la mesure : il faut que cette augmentation soit
également supérieure ou égale à 5 mm. Concernant
la confi rmation de la réponse exigée par la première
version dans un délai de 1 mois, cela ne sera néces-
saire que pour les essais thérapeutiques où le critère
de réponse est le critère principal. Dans les autres
cas (critère principal : survie globale ou survie sans
progression), il n’y a plus lieu de confi rmer la réponse.
Actuellement, on utilise les critères de l’OMS,
l’approximation volumique pour les lymphomes
et les tumeurs solides pédiatriques, et les RECIST
pour la majorité des tumeurs solides de l’adulte.
Les contraintes techniques sont nombreuses : tech-
niques identiques, fenêtrage convenable en TDM,
temps d’injection identique. Compte tenu de la
variabilité des mesures, qu’elles soient prises ou non
par le même observateur, il est recommandé lors
de l’examen de contrôle de disposer de l’examen
antérieur afi n de reprendre les mesures sur l’examen
initial, et ce, dans les mêmes conditions : on ne
compare pas un examen d’échographie ou d’IRM
(imagerie par résonance magnétique) avec un examen
tomodensitométrique et on ne compare pas une
séquence sans injection avec une séquence injectée.
Techniques adaptées
pour la médecine personnalisée
Avec les nouvelles thérapeutiques ciblées, le compor-
tement tumoral a remis en question ces critères en
raison du peu d’effet sur la taille tumorale de ces
traitements alors que la survie était très rapidement
améliorée chez les patients évalués comme non
répondeurs selon les RECIST. Les patients évalués
comme répondeurs (régression lésionnelle de plus
de 30 %) avaient le même taux de survie à 6 mois
que les patients évalués comme non répondeurs
(régression inférieure à 30 % ou progression infé-
rieure à 20 %) [8]. La diminution du volume tumoral
n’est plus le seul paramètre d’évaluation. La nécrose
tumorale doit être mesurée pour ne pas sous-évaluer
une bonne réponse et interrompre des thérapeu-
tiques effi caces. L’analyse des modifi cations de la
vascularisation tumorale est le second nouveau
paramètre à prendre en compte.
Les premières études se sont donc intéressées aux
modifi cations post-thérapeutiques des tumeurs stro-
males gastro-intestinales (GIST) en associant taille
tumorale et densité en unité Hounsfi eld (UH) [9]
afi n d’apprécier la nécrose tumorale. L’arrivée de
l’imatinib, qui cible les récepteurs c-KIT et PDGFR
(Platelet-Derived Growth Factor Receptor), a fonda-
mentalement changé le pronostic de ces patients
avec un taux de réponse objective de l’ordre de 80 %.
Ce traitement induit d’importantes modifi cations
du parenchyme tumoral, avec une diminution de
la vascularisation et l’apparition de nécrose, sans
modifi cation du volume tumoral. La pertinence des
critères de l’OMS et des RECIST, basés sur la taille
de la tumeur pour l’évaluation de la réponse à ce
traitement a donc été mise en défaut. Les modalités
d’imagerie associant des critères morphologiques
et fonctionnels doivent maintenant être préférées
pour évaluer la réponse à ce type de traitement.
Qu’il s’agisse de lésions primitives laissées en place
ou d’une dissémination métastatique hépatique ou
péritonéale, une réponse au traitement est typique-
ment une diminution de la densité lésionnelle des
lésions de 15 % en UH mesurée au temps portal
de l’injection par rapport à la densité avant traite-
ment, associée ou non à une diminution de la taille
(critère RECIST) de 10 %. L’absence de réponse est

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 6 - juin 2012 | 317
DOSSIER THÉMATIQUE
défi nie par une augmentation de la taille supérieure
à 20 %, par l’absence de diminution de la densité
tumorale ou par l’apparition d’une nouvelle lésion.
Ces méthodes ont également été testées chez les
patients atteints de cancer du rein métastatique et
traités par antiangiogéniques (10, 11).
Le nombre croissant de patients atteints de cancer
traités avec de nouvelles thérapies antiangio-
géniques, associé à des enjeux éthiques et écono-
miques, propulse l’imagerie fonctionnelle au
tout premier plan dans la prise en charge de ces
patients (12). Il est donc de mieux en mieux reconnu
que les règles morphologiques internationales (OMS
ou RECIST) défi nissant les méthodes de mesure des
tumeurs solides et les critères de réponse ne sont pas
adaptés pour ces nouvelles thérapies (13). Plusieurs
techniques − comme le scanner de perfusion,
la DCE-MRI (Dynamic Contrast Enhanced-Magnetic
Resonance Imaging) ou l’échographie de contraste
− sont maintenant proposées. Caractériser la
néo vascularisation d’une tumeur peut se faire en
étudiant différents paramètres dynamiques après
injection d’un agent de contraste. L’évaluation du
fl ux sanguin perfusant la tumeur, du volume sanguin
tumoral correspondant au taux de vaisseaux par
rapport au volume tumoral ou de la diffusion de
l’agent de contraste dans l’interstitium sont des
indicateurs pertinents calculés à partir de l’acqui-
sition de la courbe de prise de contraste au cours
du temps sur plusieurs minutes avec une résolution
temporelle très variable d’une technique à l’autre.
Le fl ux sanguin, le volume sanguin tissulaire et le
temps de transit moyen peuvent être calculés à partir
de l’IRM fonctionnelle, du scanner de perfusion et de
l’échographie dynamique de contraste ; en revanche,
la perméabilité capillaire et le volume interstitiel ne
peuvent l’être qu’avec les 2 premières techniques.
Ces techniques d’imagerie fonctionnelle ne sont
actuellement pas validées dans la version 1.1 des
RECIST. Il est essentiel de souligner que la standar-
disation des techniques est un obstacle majeur à la
comparaison des résultats d’une machine à l’autre.
La DCE-MRI a été utilisée dans différents types de
tumeurs depuis le début des années 2000 (14),
mais uniquement dans des études monocentriques
étudiant plusieurs paramètres, et proposée comme
biomarqueur (15) : une diminution du coeffi cient
de perméabilité vasculaire permettrait de prédire
la réponse au bévacizumab 15 jours après le début
du traitement. L’IRM de diffusion est également très
prometteuse et a été proposée comme biomar-
queur lors de la conférence de consensus du NCI
en 2008 (16) : une augmentation du coeffi cient de
diffusion apparent (correspondant au mouvement
brownien des molécules d’eau) serait observée chez
les patients répondeurs, en particulier dans le cancer
du sein, le sarcome, le cancer primitif du foie et
les tumeurs cérébrales. Cette technique permet-
trait d’évaluer la réponse tôt et d’estimer la survie,
mais également de recommander la dose optimale
biologique.
La DCE-US (Dynamic Contrast-Enhanced UltraSono-
graphy) a montré initialement son potentiel pour
prédire précocement la réponse dans les GIST et le
cancer du rein (17, 18).
Une quantifi cation objective paramétrique a été mise
au point pour que cette technique soit reconnue,
validée et incluse de façon systématique dans les
essais thérapeutiques. Le rehaussement obtenu à
partir des données brutes après injection de produit
de contraste permet d’observer clairement la prise
de contraste avec une acquisition de la courbe de
perfusion tumorale (19).
Ce type de quantifi cation est actuellement utilisé
chez l’animal, et ce très tôt, dès les premières
minutes pour l’évaluation de l’efficacité des
nouvelles thérapies, mais également dans plusieurs
essais thérapeutiques chez l’homme dès les premiers
jours du traitement (20). Après modélisation des
courbes de perfusion, il est possible de calculer
différents paramètres tels que l’intensité maxi-
male du pic, le temps de transit moyen, le coeffi -
cient de la courbe du wash-in, l’aire sous la courbe
(AUC). Il est important de rappeler que les agents
de contraste utilisés en ultrasons ont la particularité
d’être uniquement intravasculaires, ce qui simplifi e
la modélisation des courbes comparativement à
la DCE-MRI avec de plus une relation linéaire aux
concentrations utilisées. Mais, en contrepartie,
il n’est pas possible de calculer le coeffi cient de
perméabilité. Plusieurs études (21) ont montré
que l’AUC (correspondant au volume vasculaire)
est un paramètre toujours signifi cativement corrélé
à la réponse RECIST. L’étude de carcinomes hépato-
cellulaires (CHC) traités par bévacizumab montre
que ce paramètre est également signifi cativement
corrélé à la survie globale (p = 0,002). Une étude
multicentrique (19 centres) soutenue par l’Institut
national du cancer (INCa) [STIC 2006 DCE-US] a
diffusé cette technique afi n de déterminer le para-
mètre le plus robuste mais également le timing le
plus adéquat pour confi rmer ou infi rmer l’effi ca-
cité des traitements antiangiogéniques. Cinq cent
trente-neuf patients métastatiques (rein, côlon,
sein, GIST, mélanomes) ou porteurs de carcinomes
hépatocellulaires ont été inclus et traités majori-

318 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 6 - juin 2012
L’imagerie fonctionnelle pour la médecine personnalisée
DOSSIER THÉMATIQUE
La médecine personnalisée
tairement par bévacizumab, sorafénib, sunitinib et
imatinib ; l’intérêt de l’AUC comme biomarqueur
a été confi rmé. Des recommandations (22) euro-
péennes publiées récemment ont proposé cette
technique pour le suivi des patients (niveau 1.B selon
les recommandations d’Oxford).
Enfi n, l’imagerie moléculaire pourrait jouer un rôle
primordial pour caractériser l’hétérogénéité tumorale
et proposer des biomarqueurs plus spécifi ques (23).
Le ciblage moléculaire (24) a fait ses premiers pas
avec les intégrines αvβ3 dès 1998 en IRM puis en
PET-CT (Positron Emission Tomography-Computed
Tomography). Les études récentes avec les micro-
bulles ciblées (25) ciblant les intégrines, VEGFR-2
(Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2) [26]
et l’endogline sont très prometteuses (27) avec une
forte dynamique concrétisée par la première phase I
dans le cancer de la prostate, commencée en 2011.
Conclusion
Les nouvelles techniques d’imagerie très promet-
teuses vont jouer un rôle essentiel dans le dévelop-
pement de la médecine personnalisée. Le coeffi cient
de perméabilité vasculaire pour la DCE-MRI, le
coefficient de diffusion apparent pour l’IRM de
diffusion et l’AUC pour la DCE-US sont des para-
mètres qui semblent pertinents pour cette indi-
cation. Cependant, la validation de ces potentiels
biomarqueurs nécessite la mise en place d’études
multicentriques ; celles-ci sont encore insuffi santes
à ce jour. ■
1. La Thangue NB, Kerr DJ. Predictive biomarkers: a paradigm
shift towards personalized cancer medicine. Nat Rev Clin
Oncol 2011;8(10):587-96.
2. Kelloff GJ, Sigman CC. Cancer biomarkers: selecting the
right drug for the right patient. Nat Rev Drug Discov 2012;
11(3):201-14.
3. Laplanche A. [Tumor response in comparative trials]. Bull
Cancer 1991;78(8):687-92.
4. Ollivier L, Leclère J, Thiesse P, Di Stefano D, Vincent C.
[Measurement of tumour response to cancer treatment:
morphologic imaging role]. Bull Cancer 2007;94(2):171-7.
5. WHO. Handbook for reporting results of cancer treat-
ment. Geneva: Offset publication, 1979.
6. Therasse P, Arbuck SG, Eisenhauer EA et al. New guide-
lines to evaluate the response to treatment in solid tumors.
European Organization for Research and Treatment of
Cancer, National Cancer Institute of the United States,
National Cancer Institute of Canada. J Natl Cancer Inst
2000;92(3):205-16.
7. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J et al. New response
evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline
(version 1.1). Eur J Cancer 2009;45(2):228-47.
8. Verweij J, van Oosterom A, Blay JY et al. Imatinib mesylate
(STI-571 Glivec, Gleevec) is an active agent for gastrointes-
tinal stromal tumours, but does not yield responses in other
soft-tissue sarcomas that are unselected for a molecular
target. Results from an EORTC Soft Tissue and Bone
Sarcoma Group phase II study. Eur J Cancer 2003;39(14):
2006-11.
9. Choi H, Charnsangavej C, Faria SC et al. Correlation of
computed tomography and positron emission tomography
in patients with metastatic gastrointestinal stromal tumor
treated at a single institution with imatinib mesylate:
proposal of new computed tomography response criteria.
J Clin Oncol 2007;25(13):1753-9.
10. Hittinger M, Staehler M, Schramm N et al. Course of
size and density of metastatic renal cell carcinoma lesions
in the early follow-up of molecular targeted therapy. Urol
Oncol 2011. [Epub ahead of print]
11. Nathan PD, Vinayan A, Stott D, Juttla J, Goh V. CT
response assessment combining reduction in both size and
arterial phase density correlates with time to progression
in metastatic renal cancer patients treated with targeted
therapies. Cancer Biol Ther 2010;9(1):15-9.
12. Weissleder R, Pittet MJ. Imaging in the area of molecular
oncology. Nature 2008;452(7187):580-9.
13. Neves AA, Brindle KM. Assessing responses to cancer
therapy using molecular imaging. Biochim Biophys Acta
2006;1766(2):242-61.
14. Li SP, Padhani AR, Makris A. Dynamic contrast-enhanced
magnetic resonance imaging and blood oxygenation level-
dependent magnetic resonance imaging for the assessment
of changes in tumor biology with treatment. J Natl Cancer
Inst Monogr 2011;43:103-7.
15. Pedrosa I, Alsop DC, Rofsky NM. Magnetic resonance
imaging as a biomarker in renal cell carcinoma. Cancer 2009;
115(10 Suppl):2334-45.
16. Padhani AR, Liu G, Koh DM et al. Diffusion-weighted
magnetic resonance imaging as a cancer biomarker:
consensus and recommendations. Neoplasia 2009;
11(2):102-25.
Références bibliographiques
Chers abonnés, chers lecteurs,
L’équipe Edimark vous souhaite un très bel été
d’évasion et de réflexion,
et vous donne rendez-vous dès la rentrée
pour vous accompagner dans votre pratique !

318 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXI - n° 6 - juin 2012
DOSSIER THÉMATIQUE
La médecine personnalisée L’imagerie fonctionnelle pour la médecine personnalisée
17. Lassau N, Koscielny S, Albiges L et al. Metastatic
renal cell carcinoma treated with sunitinib: early evalua-
tion of treatment response using dynamic contrast-
enhanced ultrasonography. Clin Cancer Res 2010;16(4):
1216-25.
18. Lassau N, Chami L, Koscielny S et al. Quantitative func-
tional imaging by Dynamic Contrast Enhanced Ultrasono-
graphy (DCE-US) in GIST patients treated with masatinib.
Invest New Drugs 2012;30(2):765-71.
19. Cosgrove D, Lassau N. Imaging of perfusion using ultra-
sound. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2010;37(Suppl. 1):S65-85.
20. Lassau N, Koscielny S, Chami L et al. Advanced hepato-
cellular carcinoma: early evaluation of response to beva-
cizumab therapy at dynamic contrast-enhanced US with
quantification − preliminary results. Radiology 2011;
258(1):291-300.
21. Lassau N, Chami L, Chebil M et al. Dynamic contrast-
enhanced ultrasonography (DCE-US) and anti-angiogenic
treatments. Discov Med 2011;11(56):18-24.
22. Piscaglia F, Nolsøe C, Dietrich CF et al. The EFSUMB
Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of
Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): update 2011 on non-
hepatic applications. Ultraschall Med 2012;33(1):33-59.
23. Gerlinger M, Rowan AJ, Horswell S et al. Intratumor
hetero geneity and branched evolution revealed by multire-
gion sequencing. N Engl J Med 2012;366(10):883-92.
24. Arteaga C, Baselga J. Impact of genomics on persona-
lized cancer medecine. Clin Cancer Res 2012;18(3):612-8.
25. Deshpande N, Ren Y, Foygel K, Rosenberg J, Willmann
JK. Tumor angiogenic marker expression levels during tumor
growth: longitudinal assessment with molecularly targeted
microbubbles and US imaging. Radiology 2011;258(3):804-11.
26. Pysz MA, Foygel K, Rosenberg J et al. Antiangiogenic
cancer therapy: monitoring with molecular US and a
clinically translatable contrast agent (BR55). Radiology
2010;256(2):519-27.
27. Kiessling F, Gaetjens J, Palmowski M. Application of
molecular ultrasound for imaging integrin expression.
Theranostics 2011;1:127-34.
Références bibliographiques (suite de la p. 318)
1
/
5
100%