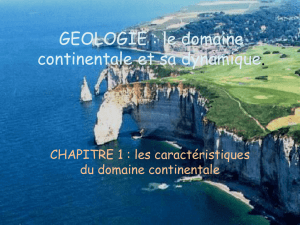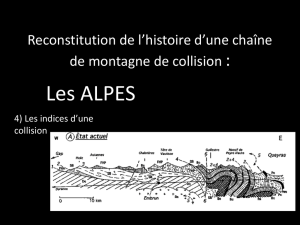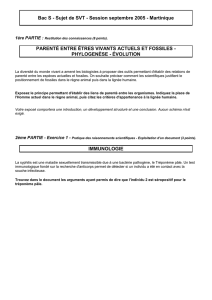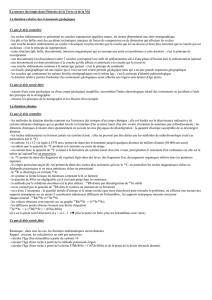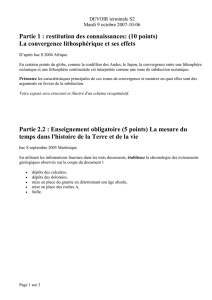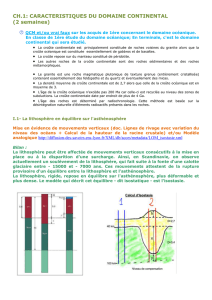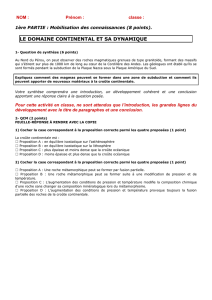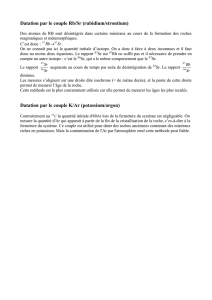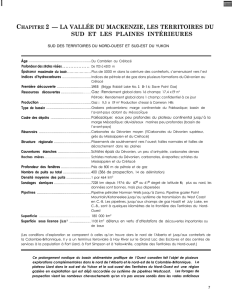16_TS_1B1_exercice

http://lewebpedagogique.com/bouchaud 16_TS_1B1_exercice.docx
1
Exercices sur le thème :
5 page 161.
T=ln(a+1)/λ
T= ln (1,0644)/1,42.10-11
T= 4,39 Ga soit 4,4 Ga
Age proposé proche de celui de la Terre, mais plus ancien que celui des plus vieilles roches continentales.
6 page 161.
Contact anormal entre le Silurien et le Crétacé plus récent. La nappe est constituée du Silurien et du
Dévonien. La zone de contact est sub-horizontale.
Cela provoque un épaississement de la CC au niveau de la chaîne pyrénéenne.
7 page 162
Le développement des notions suivantes est attendu :
!- Principales caractéristiques de la croûte continentale : Composition, densité, épaisseur, altitude moyenne, âge.!
- Mise en relation de certaines caractéristiques crustales et différences d’altitude moyenne entre océans et
continents : densité et épaisseur expliquent l’altitude moyenne des continents en lien avec le modèle d’équilibre
isostatique.
8 page 162
Soulèvement crustal à l’emplacement des anciennes calottes glaciaires ou des calottes glaciaires actuelles
(localiser). Le soulèvement vertical continue de se produire alors que les calottes ont fondu. La perte de masse
est compensée par une remontée de la lithosphère.
Des zones d’enfoncement crustal sont localisées à la périphérie des zones de soulèvement. Dans le cadre du
modèle de l’isostasie, le mouvement vers le bas pourrait être interprété comme résultant d’une surcharge. Celle-
ci correspond à un transfert de charge: la fonte des calottes glaciaires nord-américaines et scandinaves transfère
de l’eau au domaine océanique.
9 page 162.
Gneiss = roches métamorphiques. Présence de plis dans les roches : déformations souples en profondeur
(ductile). De mêmes : lits clairs et foncés, donc orientation préférentielle des minéraux. Les deux arguments
reflètent une hausse de pression et de température (lié à l’épaississement crustal).
y"="0,0644x"+"0,6988"
0,6985"
0,699"
0,6995"
0,7"
0,7005"
0,701"
0,7015"
0,702"
0,7025"
0" 0,02" 0,04" 0,06"
87Sr/86Sr'
87Rb/86Sr'
Droite'de'régression'
87Sr/86Sr"
Linéaire"(87Sr/86Sr)"
77
THÈME 3 – EXERCICES
1
EXERCICES DU THÈME 3
Les corrigés des exercices des rubriques « Évaluer ses
connaissances» et « S'entraîner avec un exercice
guidé » se trouvent à la fin du manuel (p. 366).
Chapitre 1 [pp. 161-162 du manuel]
LA DATATION D’UNE MÉTÉORITE
(Utiliser des modes de représentation graphique)
Réponses attendues :
1. La datation par radiochronologie est fondée sur la décroissance
radioactive naturelle de certains éléments chimiques contenus
dans les minéraux des roches magmatiques. Le 87Rb est un isotope
instable du Rb : il se désintègre en 87Sr. Ainsi, la quantité de 87Rb
contenu dans un minéral diminue au cours du temps, alors que
celle de 87Sr augmente anticorrélativement, en suivant une loi
exponentielle liée au temps. La détermination de la quantité de
87Rb et de 87Sr dans plusieurs minéraux d’une roche permet alors
de calculer un âge pour celle-ci.
2.
3. La pente de la droite isochrone est de 0,0647. On peut alors
calculer l’âge de la météorite :
T = Ln (pente +1) / Ð = 4 422 857 333 années.
Il est « raisonnable » d’arrondir la valeur obtenue (la représentation
graphique montre que tous les points ne sont pas strictement ali-
gnés sur la droite isochrone, il y a donc des erreurs de mesure, de
plus il y a une imprécision dans la détermination de la pente), et
de proposer un âge de 4,4 Ga.
4. L’âge de cette météorite est très proche de celui proposé pour
la Terre à partir de la datation d’autres météorites (4,56 Ga). Il est
plus élevé que l’âge des plus anciennes roches de la croûte conti-
nentale (4,02 Ga).
LA NAPPE DE GAVARNIE
(Mettre en relation des informations avec ses connaissances)
Réponses attendues :
1.
2. On observe sur la photo une disposition relative anormale des
couches sédimentaires, puisque des formations du Mésozoïque
sont surmontées par des formations du Paléozoïque. Cette dispo-
sition peut être interprétée comme résultant d’un déplacement.
L’énoncé précise que l’ampleur de ce déplacement est estimée
à environ 10 km. Ces caractéristiques suggèrent que la nappe de
Gavarnie est une nappe de charriage.
3.
4. L’empilement de la nappe de Gavarnie sur le socle surmonté par
les calcaires du Crétacé contribue à épaissir la croûte continentale
au niveau des Pyrénées.
CROÛTE OCÉANIQUE ET CROÛTE CONTINENTALE
(Effectuer une synthèse des connaissances)
Réponse attendue :
Le développement des notions suivantes est attendu :
– Principales caractéristiques de la croûte continentale : Composition,
densité, épaisseur, altitude moyenne, âge.
– Mise en relation de certaines caractéristiques crustales et dif-
férences d’altitude moyenne entre océans et continents : densité
et épaisseur expliquent l’altitude moyenne des continents en lien
avec le modèle d’équilibre isostatique.
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
87Sr/86Sr
87Rb/86Sr
0,7025
0,7015
0,7005
0,6985
0,6995
0,7020
0,7010
0,6990
0,7000
y = 0,0647x + 0,6988
Schistes
Calcaires blancs
Calcaire
Schistes noirs
Socle granitique
Dévonien moyen
PALÉOZOÏQUE
MÉSOZOÏQUE
PALÉOZOÏQUE
Dévonien
Crétacé
Silurien
Cambrien
Schistes
Calcaires blancs
Calcaire
Schistes noirs
Socle granitique
Dévonien moyen
Nappe de
charriage
Contact
anormal
Dévonien
Crétacé
Silurien
Cambrien
(…)
© Éditions Belin 2012
1
/
1
100%