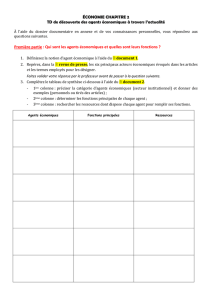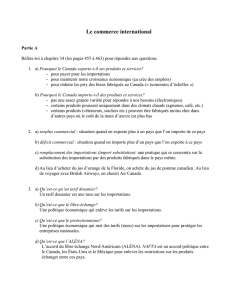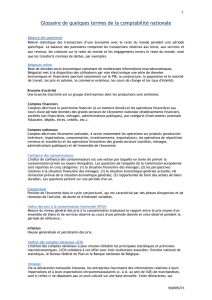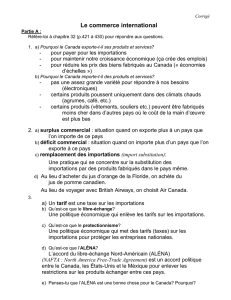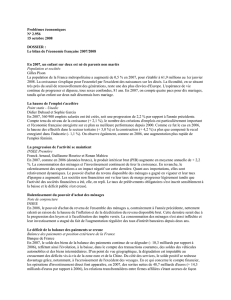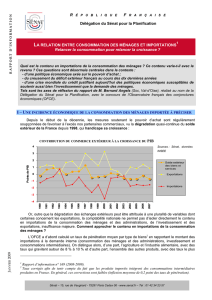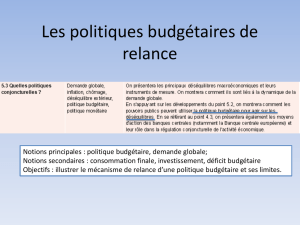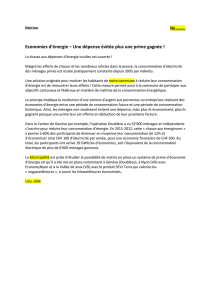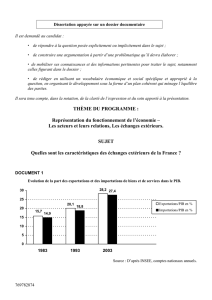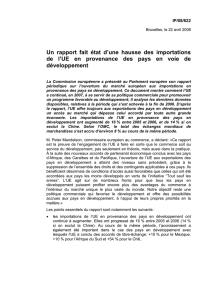RAPPORT D´INFORMATION N° 169 SÉNAT

N° 169
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 2009
RAPPORT D´INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la Planification (1) sur la relation
macroéconomique entre la consommation des ménages et les importations,
Par M. Bernard ANGELS,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; MM. Pierre André, Bernard Angels, Mme Evelyne
Didier, M. Joseph Kergueris, vice-présidents ; M. Yvon Collin, Mme Sylvie Goy-Chavent, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier,
M. Gérard Bailly, Mme Bernadette Bourzai, MM. Jean-Luc Fichet, Philippe Leroy, Jean-Jacques Lozach, Jean-François Mayet,
Philippe Paul


- 3 -
SOMMAIRE
Pages
INTRODUCTION ......................................................................................................................... 5
I. UNE QUESTION IMPORTANTE : QUELLE EST LA RELATION
ENTRE CONSOMMATION ET IMPORTATIONS ?........................................................... 7
A. CONTRAINTE EXTÉRIEURE ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE......................................... 7
1. Un déficit extérieur pénalisant la croissance…....................................................................... 8
2. …dans une économie de plus en plus ouverte.......................................................................... 11
B. PRÉCISIONS SUR LE CONTENU EN IMPORTATIONS DE LA CONSOMMATION............ 12
1. Du taux de pénétration macroéconomique à la mesure des importations par produit ............. 13
a) Vue générale....................................................................................................................... 13
b) Un contenu différencié ....................................................................................................... 14
2. Une mesure nécessitant des corrections liées au contenu en exportations françaises
des importations ..................................................................................................................... 15
3. Un impact économique de la consommation des ménages importée
difficile à évaluer dans sa globalité ........................................................................................ 16
a) La perception d’un contenu en importations relativement limité......................................... 16
b) Une activité nationale induite par les importations non négligeable.................................... 19
II. UNE PROPENSION À CONSOMMER DES PRODUITS IMPORTÉS QUI
AUGMENTE AVEC LE REVENU ......................................................................................... 22
A. UNE PROPENSION À CONSOMMER DES BIENS IMPORTÉS PLUS FORTE POUR
LES MÉNAGES AISÉS............................................................................................................. 22
1. Des choix de consommation différenciés selon le revenu… ..................................................... 22
2. … se traduisent par une propension à consommer des produits importés globalement
croissante avec le revenu........................................................................................................ 23
B. UNE PROPENSION À CONSOMMER DES PRODUITS IMPORTÉS PLUS FORTE
À LA MARGE........................................................................................................................... 25
III. UNE RELANCE ÉCONOMIQUE QUI DOIT ÊTRE PENSÉE
EN CONSÉQUENCE............................................................................................................... 27
A. UN MARCHÉ NATIONAL RELATIVEMENT OUVERT ET CONCURRENTIEL
POUR LE MARCHÉ DES BIENS ............................................................................................. 27
1. L’incidence des prix d’importations sur les prix de consommation dénote un degré
de concurrence relativement élevé .......................................................................................... 27
2. Des perspectives d’ouverture et de concurrence encore accrues............................................. 31
B. QUELLE RELANCE, À QUEL ÉCHELON ? ............................................................................ 32
1. Nécessité et perspective d’une relance concertée .................................................................... 32
a) Le bien fondé d’une relance concertée de la demande…..................................................... 32
b) … au niveau mondial.......................................................................................................... 34
c) … au niveau européen ........................................................................................................ 35
2. La pertinence d’une coordination des politiques économiques
dans l’Union Européenne et particulièrement dans la zone euro ............................................ 37
a) L’importance du commerce intra-zone................................................................................ 38
b) Les vertus d’un « policy mix » dans la zone euro au soutien de la demande ....................... 39

- 4 -
3. Quelle déclinaison nationale d’une politique budgétaire expansive ? ..................................... 41
a) Une relance française à court terme qui préfère l’investissement
à la consommation … ......................................................................................................... 42
b) … malgré le contexte d’un choc de demande...................................................................... 45
EXAMEN EN DÉLÉGATION...................................................................................................... 51
ANNEXE : ÉTUDE DE L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES CONJONCTURES
ÉCONOMIQUES (OFCE) ............................................................................................................ 59

- 5 -
INTRODUCTION
Depuis le début des années 2000 et jusqu’à la propagation de la
crise financière actuelle, les mesures aboutissant à une distribution de
pouvoir d’achat ont été régulièrement soupçonnées de favoriser l’activité
des pays exportateurs au détriment de la production nationale, sur fond
d’augmentation du déficit extérieur de la France.
De fait, toute réflexion sur les politiques de soutien à la
consommation des ménages doit, à côté d’autres considérations (la croissance,
l’emploi, le pouvoir d’achat…), intégrer la contrainte extérieure, c’est-à-dire
l’obligation pour un pays d’équilibrer à terme ses échanges extérieurs1. En
particulier, relancer la consommation lorsque la production intérieure ne peut
la satisfaire aboutit nécessairement au creusement du déficit extérieur, sans
gains significatifs en termes de croissance.
Ce débat rejoint la question, plus générale, de l’autonomie des
politiques économiques, en particulier des politiques de relance pour lutter
contre le chômage, dans le cadre d’une économie ouverte. Beaucoup auront
encore en mémoire les obstacles auxquels la relance française de 1981 s’est
heurtée, exemple de politique économique expansionniste butant sur la
contrainte extérieure2.
Aujourd’hui, dans le cadre de la monnaie unique, l’impact sur
l’inflation et la monnaie d’une relance contracyclique de la consommation
nationale se trouve, certes, « dilué » entre les 15 pays de la zone euro3.
Toutefois, les problèmes de déficit extérieur, et de déficit public
de la France, si la politique budgétaire devait être mise à contribution, se
posent avec une acuité persistante, et même renouvelée dans le contexte de
la crise actuelle.
1 Cette obligation présente un caractère sinon théorique, du moins différé - voire incertain - si
l’on considère, par exemple, l’économie américaine dont le creusement ces dernières années du
double déficit (extérieur et budgétaire) a été permis par la suprématie du dollar, ou encore la
situation de la France au sein de l’Union européenne, dont le double déficit n’est pas sanctionné
par une hausse des taux d’intérêt ou une baisse du cours de l’euro, notre devise étant commune à
l’ensemble de la zone.
2 La création d’emplois publics et la revalorisation des salaires et des prestations sociales
avaient alors favorisé la croissance mais, dans un environnement international peu porteur, le
niveau des importations avait fortement augmenté, se découplant de celui des exportations. Le
déficit commercial et le déficit budgétaire se sont rapidement creusés si bien que, dès 1982, a
succédé une politique de rigueur, non seulement pour combler ces déficits, mais encore pour
lutter contre l’inflation et raffermir le franc, qui subissait alors des attaques.
3 Avec la disparition des monnaies nationales, l’euro a entraîné celle des désalignements des
changes entre les devises concernées ; en outre, idéalement, la zone euro fait de l’équilibre
extérieur une question qui ne se pose plus au niveau national. Qui se préoccupe, pour les Etats-
Unis du déficit extérieur du Maine ou de l’Arizona ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
1
/
100
100%