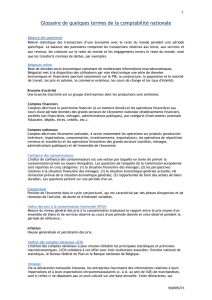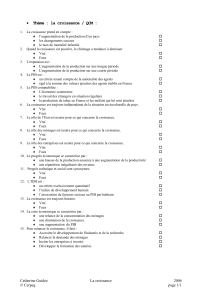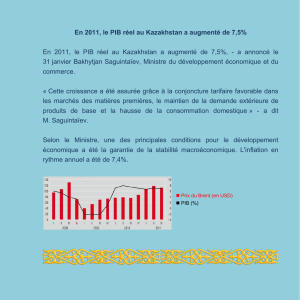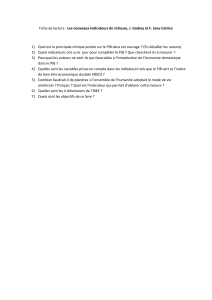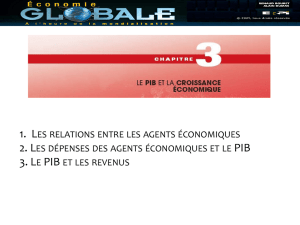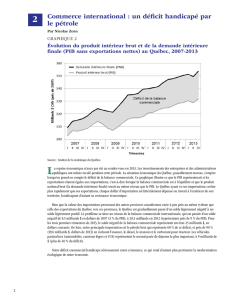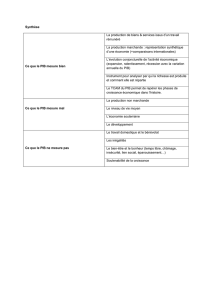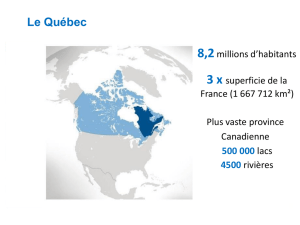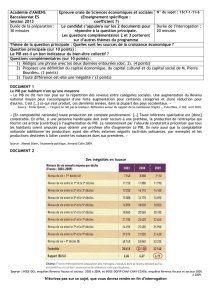tes_ses_1b_les_4piliers_de_lactivite

1
Les quatre piliers de l'activité
Louis MAURIN | Alternatives Economiques, Hors-série n° 053 - juillet 2002
A quoi sert le PIB français ?
Vingt ans de croissance
La consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses de l'Etat et le
commerce extérieur alimentent la croissance de la production.
Le socle de la croissance économique est constitué de la consommation des ménages. En
France, avec 717 milliards d'euros, elle représente plus de la moitié (54%) du PIB, lequel
atteint 1 336 milliards d'euros (1). Contrairement à ce que pourraient laisser croire les
commentaires des enquêtes mensuelles de conjoncture, la consommation est un élément plutôt
stable. Les ventes de parapluies s'accroissent quand il pleut, mais la grande masse des
dépenses (les loyers, les charges liées au logement, à l'automobile, etc.) se reproduisent assez
régulièrement.

2
La fameuse confiance des ménages (D1)
Les pics de récession ou de reprise sont nettement moins marqués pour la consommation que
pour l'investissement. Ainsi, au plus fort de la récession du début des années 90, quand
l'investissement perdait plus de 6%, la consommation ne fléchissait que de 0,6%. Attention
tout de même: une petite variation des dépenses des ménages peut avoir des effets importants
sur la croissance, par un effet de masse (la consommation représente 2,7 fois
l'investissement).
Contrairement à des discours répandus, ces dépenses de consommation sont peu liées à l'état
d'esprit du moment. La fameuse "confiance", si souvent invoquée par les gouvernements, peut
provoquer des effets de relance durant quelques mois ou, quand elle se transforme en
défiance, alimenter une épargne de précaution temporaire. A moyen terme pourtant, c'est le
niveau de vie qui détermine le niveau des dépenses. La relative stabilité de la consommation
s'explique en partie par la rigidité à la baisse des salaires: une rigidité appréciable pour les
intéressés, mais qui évite aussi que les ralentissements soient plus accentués. La répartition
plus structurelle entre épargne et consommation dépend de facteurs de fond que l'on décrypte
mal: rendements et produits de l'épargne, incitations fiscales, position dans le cycle de vie,
évolution des systèmes de retraite, etc.
Les aléas de l'investissement (D2)
Le deuxième pilier de la croissance, qui en fait son dynamisme, est l'investissement des
entreprises. Avec 267 milliards d'euros, on est bien loin de la consommation: il représente
"seulement" un cinquième du PIB. Pour partie, cette différence est artificielle, car on
comptabilise mal l'investissement immatériel (*). Ainsi, par exemple, formation initiale et
formation continue façonnent pour de longues années le niveau et les structures de la
compétence de la main-d’œuvre. Au total, les dépenses d'éducation représentent 7% du PIB et
n'apparaissent pas comme un investissement, alors qu'elles en ont les caractéristiques.
Les dépenses à long terme des entreprises forment la variabilité du PIB: de 1998 à 2000, elles
ont progressé à un rythme supérieur à 6%. Au cours de cette période, l'investissement
explique à lui seul 40% de la croissance totale. Sa source première est la demande
qu'anticipent à moyen terme les entreprises. Pour acheter une machine, il faut avoir de bonnes
perspectives de ventes. Mais il faut aussi que ce soit rentable, c'est-à-dire que les rendements
réels escomptés (inflation déduite) dépassent le coût des emprunts à réaliser ou la rentabilité
des placements financiers. La montée des taux d'intérêt peut rendre les placements financiers
plus attractifs que l'investissement dans la production.
Derrière la rentabilité de l'investissement, se cache la question du partage du profit. Si les
entrepreneurs estiment que la part qu'ils vont récupérer est trop faible, ils auront peu intérêt à
investir et à prendre des risques. Avec des conséquences négatives à long terme sur le
potentiel de fond de l'économie et sur ses capacités d'innovation et d'adaptation. A l'inverse, si
la part des profits est trop élevée, non seulement les travailleurs sont spoliés du fruit de leur
labeur, mais, comme l'avait souligné Keynes, il y a un risque important d'une déprime de la
demande, avec répercussion sur l'investissement. L'équilibre résulte toujours d'un rapport de
force entre patrons et salariés, arbitré par la collectivité qui, via la fiscalité, peut prendre aux
uns et redonner aux autres.
L'ouverture de l'économie (D4)

3
Le troisième pilier de la croissance est constitué de nos échanges avec le reste du monde.
C'est dans ce domaine que la situation a le plus évolué. En vingt ans, de 1980 à 2000, le degré
d'ouverture de notre économie (mesuré par la moyenne des importations et des exportations
rapportée au PIB) est passé de 16% à 28%. Cet indicateur montre le degré d'insertion de la
France dans l'économie européenne et mondiale. Aujourd'hui, le niveau des exportations (près
de 400 milliards d'euros) dépasse de loin celui des investissements. En 2000, la progression
des ventes françaises à l'étranger (+ 43,5 milliards d'euros) a dépassé la hausse totale du PIB
(+ 40,2 milliards d'euros).
L'évolution des importations et des exportations dépend des facteurs structurels:
compétitivité, savoir-faire, réseaux commerciaux, ressources naturelles, etc. Mais le
commerce extérieur varie aussi de façon plus conjoncturelle, en fonction de l'évolution de
l'économie mondiale. Ainsi, alors qu'elles avaient progressé de près de 13% en 2000, les
exportations ont stagné en 2001 et même régressé au premier trimestre de cette année.
Les dépenses publiques (D3)
Enfin, les dépenses publiques forment le quatrième pilier, que la comptabilité nationale
nomme "dépenses de consommation des administrations publiques". Il s'agit de la valeur des
services non marchands produits par les administrations, moins les paiements partiels
effectués par les ménages. Depuis 1980, cette part a légèrement progressé, de 22% à 25% du
PIB, puis elle est revenue à 23%. On est loin d'une collectivisation de l'économie.
Sur longue période, ces dépenses jouent une fonction régulatrice : la volonté des
gouvernements d'amortir les chocs d'un côté, et surtout la continuité des services publics, font
que le niveau de dépenses est relativement indépendant de l'activité économique. Les revenus
ainsi distribués évitent une dégradation supérieure. Ce fut net en 1993, où ces dépenses se
sont accrues de 4,6%, alors que le PIB reculait de près de 1%. Plus près de nous, en 1998, la
vigueur de la croissance a permis d'enregistrer une stagnation des dépenses de consommation
de la collectivité sans restriction majeure des services publics.
Ces quatre piliers de la croissance sont liés entre eux. On l'a vu, les besoins de consommation
se répercutent sur l'investissement à moyen terme. Celui-ci détermine notamment la
compétitivité des entreprises vis-à-vis de leurs consœurs étrangères, et donc le niveau des
exportations. Les dépenses de la collectivité, outre leur action sur les structures de l'économie,
peuvent aussi maintenir l'activité du pays.
L'art d'une bonne politique économique
Tout l'art d'une bonne politique économique consiste à maintenir un savant équilibre pour
arriver à un niveau d'ensemble de la croissance qui soit élevé et constant (voir page 26).
Depuis le milieu des années 70, aucun gouvernement n'a trouvé la recette miracle pour faire
tenir l'équilibre plus de quatre années. La première difficulté est de savoir à quel moment et à
quel degré il faut intervenir pour réguler les cycles. Parfois, la chance est de la partie. Qu’elle
soit ou non favorable, la baisse des impôts de 2000 est arrivée à point nommé pour soutenir la
croissance en 2001, alors qu'elle avait été décidée en plein boom économique. La seconde
difficulté est que, face à un choc de grande ampleur, l'intégration des économies européennes
rend assez vain tout effort de relance dans un seul pays, car il se traduit rapidement par une
hausse des importations

4
Faut-il croire les prévisions ?
Entre Madame Soleil et des chercheurs sérieux, on trouve de tout dans le monde de la
prévision économique. Il est rare qu'un institut annonce avant tout le monde ce qui serait
intéressant, à savoir un retournement de conjoncture. Pour une raison simple: prévoir consiste
la plupart du temps à prolonger les tendances du moment. En outre, les événements politiques
nationaux et internationaux échappent, par définition, aux experts. De la guerre du Golfe aux
attentats du 11 septembre, ces événements ont des répercussions importantes. L'une des
grandes variables qu'ils ne maîtrisent pas, qui fluctue fortement et se répercute nettement sur
l'activité économique, est le cours du baril de pétrole.
Dans l'ensemble, les prévisionnistes demeurent assez conformistes: face à la concurrence, les
instituts préfèrent ne pas prendre le risque de se trouver en décalage avec le reste de la
profession (1). Plus que les données affichées, c'est l'exercice lui-même qui importe: la façon
dont les experts économiques décrivent les enchaînements en cours et les facteurs en jeu.
(1) "L'art de la conjoncture ou comment se tromper intelligemment", Alternatives
Economiques n° 138, juin 1996.
* Investissements immatériels : dépenses de recherche-développement, formation
professionnelle, à caractère commercial, logiciels.
En savoir plus :
Le ministère de l'Economie, direction de la prévision:
www.minefi.gouv.fr/minefi/publique/macroeconomie/index.htm
L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE): www.ofce.sciences-po.fr
Le Bureau d'informations et de prévisions économiques (Bipe): www.bipe.fr
Le Centre d'observation économique (COE, Chambre de commerce de Paris):
www.coe.ccip.fr/03/macroeco.htm
Le Crédit lyonnais: http://finance.creditlyonnais.fr/default.asp
La Société générale: http://groupe.socgen.com/ecofr
(1) L'exemple français est utilisé comme illustration, il est représentatif de la situation des
pays industrialisés en général.
1
/
4
100%