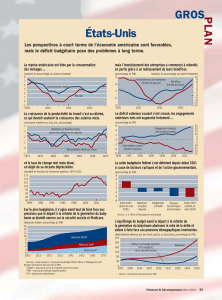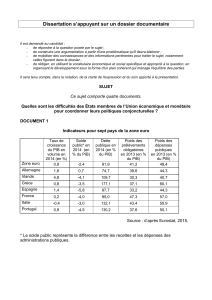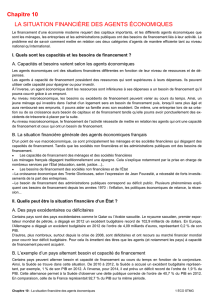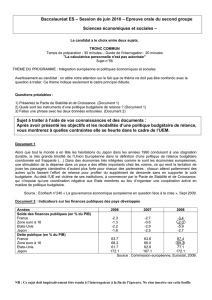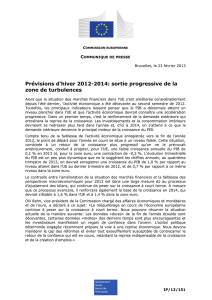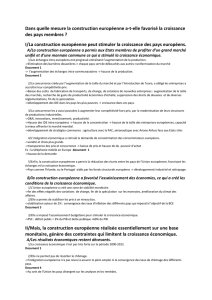N° 66 S É N A T

N° 66
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2002
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur les perspectives
macroéconomiques à moyen terme (2002-2007),
Par M. Joël BOURDIN,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; Mme Évelyne Didier, MM. Serge
Lepeltier, Marcel Lesbros, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Pierre André, Yvon Collin, secrétaires ; MM.
Gérard Bailly, Joseph Kergueris, Patrick Lassourd, Michel Pelchat, Daniel Percheron, Roger Rinchet, Gérard Roujas,
Bruno Sido.
Prévisions et projections économiques.

- 2 -
SOMMAIRE Pages
PRÉSENTATION : À PROPOS DE LA PROJECTION MACROÉCONOMIQUE
EXPOSÉE DANS LE PRÉSENT RAPPORT.............................................................................................. 8
PREMIÈRE PARTIE : LES PERSPECTIVES DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE ET DES FINANCES PUBLIQUES À L’HORIZON 2007............... 10
CHAPITRE I : LA FRANCE DANS SON ENVIRONNEMENT EUROPÉEN .............................. 12
I. UNE HYPOTHÈSE DE REPRISE DE LA CROISSANCE EN 2003............................................. 12
A. UNE CROISSANCE ATONE EN 2002...................................................................................................... 13
B. LES CONDITIONS D’UNE REPRISE EN 2003...................................................................................... 14
1. Scénario de reprise en 2003 ....................................................................................................................... 15
2. En Europe, une combinaison des politiques économiques peu expansionniste............................. 16
II. DIVERGENCES ET CONVERGENCES EN EUROPE................................................................... 19
A. DES ÉCARTS DE CROISSANCE ET D’INFLATION PERSISTENT EN EUROPE.................... 19
B. UNE POLITIQUE MONÉTAIRE TROP RESTRICTIVE ?................................................................... 21
CHAPITRE II : PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES À MOYEN TERME................... 24
I. UN SCÉNARIO DE REPRISE MODÉRÉE DE LA CONSOMMATION ET DE
L’INVESTISSEMENT.................................................................................................................................. 24
A. UNE CONSOMMATION RELATIVEMENT DYNAMIQUE............................................................. 24
a) La consommation serait bien orientée................................................................................................. 25
b) La consommation est soutenue par la progression du revenu des ménages….......................... 25
c) … ainsi que par une baisse modérée du taux d’épargne des ménages ........................................ 27
B. UNE REPRISE DE L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF À PARTIR DE 2004............................. 28
C. LES AUTRES COMPOSANTES DE LA DEMANDE INTÉRIEURE PÈSENT SUR LA
CROISSANCE................................................................................................................................................... 29
II. LA CROISSANCE, LES PRIX ET L’EMPLOI................................................................................... 32
A. UNE CROISSANCE AU RYTHME DE LA CROISSANCE POTENTIELLE................................. 32
1. Résultats de la projection............................................................................................................................ 32
2. Une croissance potentielle française comparable à celle des partenaires européens
de la France.................................................................................................................................................... 33
B. UN RYTHME DE CROISSANCE INSUFFISANT POUR RÉSORBER LE CHÔMAGE............ 34
C. UN SCÉNARIO DE CROISSANCE NON INFLATIONNISTE......................................................... 36

- 3 -
III. UNE CROISSANCE PLUS SOUTENUE PEUT ÊTRE ATTEINTE À DE
STRICTES CONDITIONS .......................................................................................................................... 37
A. UN SCÉNARIO QUI SUPPOSE UNE PROGRESSION PLUS VIGOUREUSE DE LA
DEMANDE INTÉRIEURE MAIS AUSSI UNE BAISSE DU CHÔMAGE STRUCTUREL....... 37
1. Une croissance du PIB de 3 % par an suppose une progression plus dynamique de la
consommation et de l’investissement ....................................................................................................... 37
2. La croissance serait équilibrée grâce à une baisse du taux de chômage structurel.................... 39
B. CRÉATIONS D’EMPLOIS ET BAISSE DE L’ÉPARGNE ALIMENTERAIENT LE
DYNAMISME DE LA DEMANDE INTÉRIEURE................................................................................ 44
1. Hausse des revenus et baisse du taux d’épargne des ménages.......................................................... 44
2. Un scénario d’endettement des entreprises ............................................................................................ 45
IV. LES CONSÉQUENCES D’UNE REPRISE RETARDÉE DE L’INVESTISSEMENT.......................................... 46
A. UNE HYPOTHÈSE DE REPRISE RETARDÉE DE L’INVESTISSEMENT….............................. 46
B. … DONT LES CONSÉQUENCES SERAIENT DOMMAGEABLES POUR
L’ÉCONOMIE................................................................................................................................................... 47
CHAPITRE III : LES TENDANCES DES FINANCES PUBLIQUES .............................................. 50
I. UN ÉQUILIBRAGE DES FINANCES PUBLIQUES QUI N’EST PAS ATTEINT À
L’ÉCHÉANCE 2007 ...................................................................................................................................... 50
A. MALGRÉ DES HYPOTHÈSES FAVORABLES…................................................................................. 51
1. Deux scénarios où la croissance est plus ou moins soutenue mais, au moins, égale à
la croissance potentielle.............................................................................................................................. 51
2. Des orientations strictes de « politique budgétaire ».......................................................................... 51
B. …L’ÉQUILIBRE DES COMPTES PUBLICS N’EST PAS ATTEINT EN 2007............................. 53
1. Une réduction inégale du déficit public................................................................................................... 53
a) Un déficit public de 1,8 point du PIB en 2007 dans le scénario de croissance
potentielle ................................................................................................................................................... 53
b) Un quasi-retour à l’équilibre dans le scénario de croissance à 3 %............................................ 54
2. Une trajectoire de retour à l’équilibre qui n’offre que peu de marges de manœuvre
pour des réductions supplémentaires de prélèvements obligatoires................................................ 55
C. LES ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RETRAITES ...................................................................... 58
D. DES RÉSULTATS DANS LA LIGNE DE LA PROGRAMMATION DES FINANCES
PUBLIQUES DU GOUVERNEMENT....................................................................................................... 61
1. Les hypothèses de la programmation des finances publiques à l’horizon 2006,
présentée à l’appui du projet de loi de finances pour 2003............................................................... 61
a) Deux scénarios de croissance, tous deux supérieurs à la croissance potentielle...................... 61
b) Des engagements presque identiques.................................................................................................. 61
2. Des résultats contrastés............................................................................................................................... 62
a) Le scénario de croissance à 2,5 %........................................................................................................ 62
b) Le scénario de croissance à 3 %........................................................................................................... 64
3. Les différences entre les résultats des projections de la Délégation et celles du gouvernement............... 66
II. DE L’IMPORTANCE D’UNE BONNE GESTION DES DÉPENSES PUBLIQUES ....................... 67
A. L’HÉRITAGE DE LA LÉGISLATURE PRÉCÉDENTE....................................................................... 71
1. Un contexte économique très favorable................................................................................................... 71
2. Des résultats très insuffisants..................................................................................................................... 74

- 4 -
a) La réduction du besoin de financement public a largement reposé sur une
composante conjoncturelle toujours réversible et pas assez sur un effort
d’assainissement structurel.................................................................................................................... 74
b) Les performances de la France ont été moins favorables que celle des partenaires
européens.................................................................................................................................................... 75
(1) Une réduction du besoin de financement moins élevée en France..................................................... 76
(2) Un impact de la croissance de second ordre........................................................................................ 77
(3) Une amélioration moins nette de la capacité de financement primaire en France............................ 79
B. UNE ILLUSTRATION DES ENJEUX DE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES
PUBLIQUES À PARTIR D’UN EXERCICE DE VARIANTES ......................................................... 84
1. L’impact d’une croissance plus lente....................................................................................................... 84
a) De quelques problèmes techniques ...................................................................................................... 84
b) Une illustration à partir du modèle Quest de la Commission européenne................................. 85
2. Quelques illustrations des conséquences d’une progression plus rapide des dépenses
publiques........................................................................................................................................................... 86
a) Les effets d’une augmentation plus rapide des dépenses de santé............................................... 87
b) Les effets d’une augmentation plus rapide des salaires publics................................................... 89
DEUXIÈME PARTIE : REFONDER LA COORDINATION BUDGÉTAIRE
EN EUROPE...................................................................................................................................................... 92
CHAPITRE IV : DES POLITIQUES BUDGÉTAIRES NATIONALES NÉCESSAIRES ET,
SOUS CERTAINES CONDITIONS, EFFICACES ................................................................................... 96
I. LA RÉALISATION DE L’UEM ACCENTUE LA NÉCESSITÉ DE POUVOIR
MOBILISER LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES NATIONALES ........................................... 96
A. L’EUROPÉANISATION DES POLITIQUES MONÉTAIRE ET DU CHANGE FACE
À UNE EUROPE DONT L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RESTE
INCOMPLÈTE.................................................................................................................................................. 97
1. L’adoption de l’euro a été naturellement accompagnée d’une européanisation des
politiques monétaires et de change.......................................................................................................... 97
2. Une intégration économique et sociale incomplète.............................................................................. 97
a) Des particularismes économiques nationaux subsistent................................................................. 97
b) Une intégration budgétaire européenne presque inexistante.........................................................100
B. LE HIATUS ENTRE LE MODÈLE DE ZONE MONÉTAIRE OPTIMALE ET L’UEM..............101
1. L’UEM ne présente pas les caractéristiques d’une zone monétaire optimale...............................101
2. Un hiatus qui ne doit pas inquiéter au-delà du raisonnable..............................................................102
II. LES ARGUMENTS OPPOSÉS AUX POLITIQUES BUDGÉTAIRES MÉRITENT
ATTENTION…...............................................................................................................................................103
A. L’ÉCOLE DU PUBLIC CHOICE OU LA DÉFIANCE ENVERS LES DÉCIDEURS
POLITIQUES.....................................................................................................................................................104
B. LES ANALYSES NÉOCLASSIQUES OU LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE REFUSÉE.............104
1. L’effet d’éviction............................................................................................................................................104
2. Les anticipations............................................................................................................................................105
C. LES PRAGMATIQUES OU LES DIFFICULTÉS DU PILOTAGE BUDGÉTAIRE......................106
D. UNE SÉRIE D’ARGUMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION..............................................107

- 5 -
III. … MAIS LA RÉPUDIATION DE L’INSTRUMENT BUDGÉTAIRE SERAIT
UNE ERREUR .................................................................................................................................................107
A. LES RÉSULTATS DES TRAVAUX EMPIRIQUES METTENT L’ACCENT SUR LA
CONTRIBUTION DES POLITIQUES BUDGÉTAIRES À LA STABILISATION
ÉCONOMIQUE À COURT TERME. .........................................................................................................108
1. Les résultats des simulations réalisées à partir de différents modèles............................................108
a) L’inégale efficacité des stabilisateurs automatiques nationaux....................................................108
b) Une illustration à partir des simulations réalisées avec le modèle de la
Commission européenne.........................................................................................................................110
2. Les résultats d’une variante associée à la projection de l’économie française à
l’horizon 2007................................................................................................................................................113
B. L’APPORT DE L’EURO.................................................................................................................................115
CHAPITRE V : LA COORDINATION ET LA SURVEILLANCE DES POLITIQUES
ÉCONOMIQUES : UNE AMBITION APPAUVRIE, UNE NORME AMBIGUË, UNE
SURVEILLANCE INADAPTÉE.....................................................................................................................116
I. LA COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES, UNE AMBITION
APPAUVRIE....................................................................................................................................................116
A. L’ARTICLE 99 DU TRAITÉ POSE LE PRINCIPE D’UNE COORDINATION DES
POLITIQUES ÉCONOMIQUES, DES ETATS…...................................................................................116
B. … QUE LE RÈGLEMENT N° 1466/97 DU 7 JUILLET 1997, PREMIER PILIER DU
PACTE DE STABILITÉ ET DE CROISSANCE, N’A APPROFONDI QUE POUR
LES POLITIQUES BUDGÉTAIRES ..........................................................................................................117
II. LES AMBIGUÏTÉS ET LES CONTRADICTIONS DE LA NORME DE RETOUR
À UNE POSITION BUDGÉTAIRE DE MOYEN TERME D’ÉQUILIBRE, VOIRE
D’EXCÉDENT.................................................................................................................................................118
A. LES PROGRAMMES DE STABILITÉ DOIVENT COMPORTER UNE TRAJECTOIRE
PERMETTANT, À MOYEN TERME, D’ACCÉDER À UNE POSITION BUDGÉTAIRE
PROCHE DE L’ÉQUILIBRE, VOIRE EXCÉDENTAIRE. ..................................................................119
B. UNE RÈGLE CONTRADICTOIRE AVEC LES AUTRES PILIERS DU PACTE..........................119
1. Une règle contradictoire avec les autres piliers du pacte ..................................................................119
2. Des contradictions que les Codes de conduite successifs n’ont pas réduites mais ont,
au contraire, accentuées..............................................................................................................................120
a) Le Code de conduite d’octobre 1998...................................................................................................121
b) La révision du Code de conduite..........................................................................................................122
III. UNE SURVEILLANCE INADAPTÉE..................................................................................................126
A. UN MODÈLE MIXTE DE SURVEILLANCE QUI FONCTIONNE MAL.......................................127
B. DANS SON JUGEMENT SUR LES PROGRAMMES DE STABILITÉ, LE CONSEIL
DISPOSE D’UNE LARGE MARGE D’APPRÉCIATION…...............................................................129
C. …ET LES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DES PROGRAMMES SONT SANS
COHÉRENCE AVEC UNE APPLICATION STRICTE DE LA RÈGLE DE RETOUR À
L’ÉQUILIBRE...................................................................................................................................................129
IV. DANS LES FAITS, LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES ETATS SONT
RAREMENT RESPECTÉS.........................................................................................................................130
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
1
/
204
100%