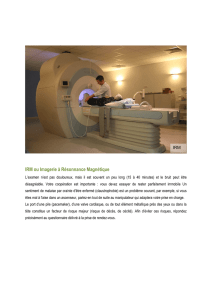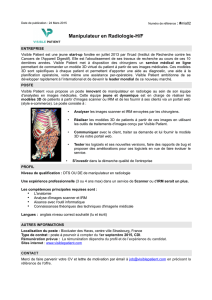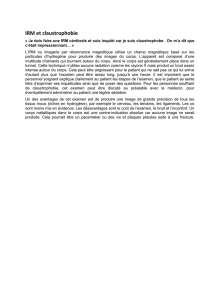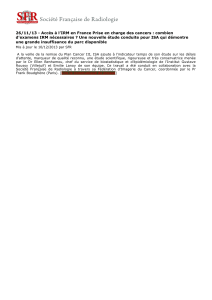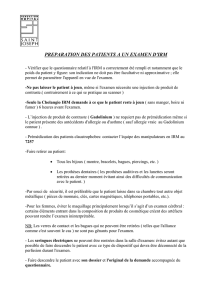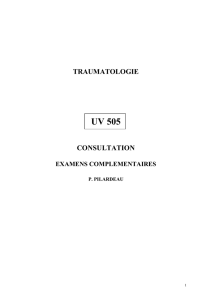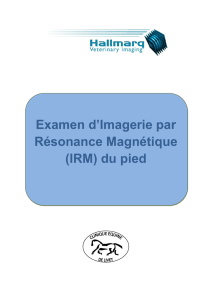Générer un fichier PDF

Imagerie Ostéo-articulaire
Publié le 19/04/2010, mis à jour le 13/08/2010 par
SFR
Romain BAZELI
(1),
Vincent BALBI
(2)
(1)
Service de Radiologie, Hôpital Bichat, Paris
(2)
Service d
’
Imagerie Musculosquelettique, CHRU Lille
Session genou
Notohamiprodjo (Erlangen, Allemagne) a comparé une séquence 3D (3D
-
TSE) sur le genou aux
acquisitions classiques dans les 3 plans (2D
-
TSE) sur une IRM 3T. Outre un léger gain de temps en
faveur de la séquence 3D (10 :48 min contre 12 :20 min pour les 3 séquences), les auteurs ont aussi
montré un rapport signal sur bruit et un rapport contraste sur bruit meilleur pour la séquence 3D. Ceci
semblait être particulièrement intéressant pour l
’
étude du cartilage dans les régions où les effets de
volume partiel gênent habituellement l
’
interprétation (trochlée fémorale, partie postérieure des
condyles).
Dans 3 travaux, Shmidt et Scheurecker (Vienne et Linz, Autriche) ont étudié l
’
intérêt de l
’
IRM dans des
pathologies habituellement dédiées au scanner : l
’
instabilité fémoro
-
patellaire tout d
’
abord, avec des
acquisitions successives réalisées à des niveaux différents de flexion, mais aussi des mesures de
torsion fémorale (avec des acquisitions sur les hanches, les genoux et les chevilles). Néanmoins, les
auteurs n
’
ont pas confronté les mesures de l
’
IRM au scanner et les protocoles d
’
acquisition semblaient
assez longs. De plus, le principal intérêt de l
’
IRM par rapport au scanner semblait être l
’
absence
d
’
irradiation. Les applications de ces séquences semblent donc limitées à l
’
heure actuelle.
Session coude et poignet
Canella (Lille, France) a montré l
’
intérêt de la tomosynthèse dans la détection d
’
érosions osseuses chez
des patients avec une polyarthrite rhumatoïde. L
’
utilisation de la tomosynthèse permettait de détecter
environ 20 % d
’
érosions supplémentaires comparativement aux radiographies avec une irradiation
moindre par rapport au scanner. Dans le même registre, Damasio (Rome, Italie) a démontré que la
présence d
’
un œdème osseux en IRM chez des patients ayant une arthrite juvénile idiopathique était
prédictive de la survenue d
’
érosions.
Pour Kasprian (Vienne, Autriche), la tractographie dans le syndrome du tunnel du nerf ulnaire était
possible, et les patients avaient une baisse de fraction d
’
anisotropie au niveau des nerfs. Néanmoins, le
nerf présentait des anomalies de signal et de forme dans 15 cas sur 16, l
’
intérêt diagnostique et surtout
pronostique de ces séquences reste donc à démontrer.
Session Rachis
On retiendra de cette session de nombreuses études sur les séquences T2 mapping (pour les facettes
articulaires, pour le disque intervertébral, dans les études sur les hernies de Schmorl, dans les douleurs
lombaires). Cette technique semble prometteuse, permet d
’
apprécier le contenu en eau du disque et la
préservation des fibres collagènes.
Session
«
hanche, cheville et pied
»
X.J. Yang (Shanghai) a démontré sur un modèle animal (chien) la faisabilité de la quantification de la
perfusion osseuse au scanner, pouvant être utile dans le diagnostic de l
’
ostéonécrose.
M. Tengvar (Stockholm) a étudié en IRM les caractéristiques des lésions traumatiques musculaires des
ischio
-
jambiers chez des danseuses par rapport aux cas classiques (chez des sprinteurs) montrant la
différence de la topographie lésionnelle, ce qui pourrait avoir un impact thérapeutique.
La supériorité des séquences 3D pour le diagnostic des lésions de la cheville a fait l
’
objet de deux
travaux. Hao (Chine) avait trouvé une sensibilité plus élevée de la détection des lésions ostéo
-
chondrales du talus par une séquence SFPGR alors que Notohamiprodjo (Chine) montrait une meilleure
sensibilité des séquences 3D T1
-
SE dans le diagnostic des lésions ligamentaires.
Antoine Feydy (Paris) avait étudié l
’
apport de l
’
IRM et de l
’
échographie doppler dans l
’
évaluation de la
talalgie chez des patients SPA. Il a montré que les anomalies vues à l
’
échographie n
’
avaient aucune
spécificité (par rapport au groupe contrôle). A l
’
IRM seul l
’
œdème osseux était spécifique mais peu
sensible.
Session
«
tumeurs
»
Kasprian (Vienne) a montré l
’
intérêt de la tractographie IRM pour l
’
étude du rapport des nerfs
périphériques avec des tumeurs des parties molles et son éventuel intérêt dans le bilan préopératoire.
Becce (Paris, Lausanne) a étudié les caractéristiques des lésions
«
ostéome ostéoide
-
like
»
au scanner
et a apporté des points permettant de suspecter ce diagnostic avant le traitement par radiofréquence.
Dans le cadre des myélomes
-
multiples, l
’
IRM corps entier attire de plus en plus l
’
attention. Fetchner
(Danemark) a montré la supériorité de l
’
IRM corps entier (par rapport à l
’
IRM standard du rachis) dans
l
’
évaluation pronostique chez des patients avec gammapathies monoclonales asymptomatiques.
Weckbach (Danemark) s
’
était intéressé au temps nécessaire pour la réalisation d
’
une IRM corps entier
dans la pratique courante en proposant une nouvelle mode d
’
acquisition deux fois plus rapide (grâce au
mouvement continu de la table).
Session
« épaule et membre supérieur »
De cette séance on retient notamment le travail de Timpert (Munich) sur l
’
étude du mouvement du
tendon du long biceps au niveau de la poulie en IRM dynamique.

1
/
2
100%