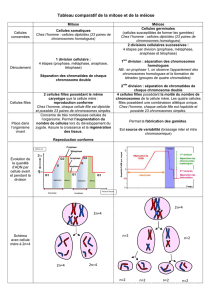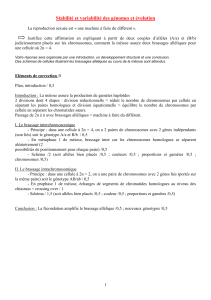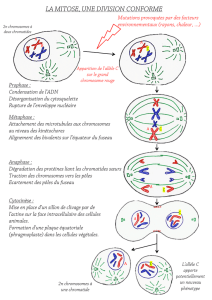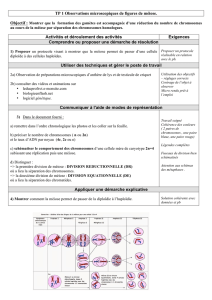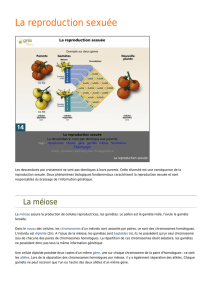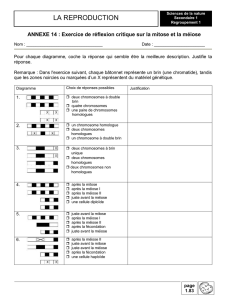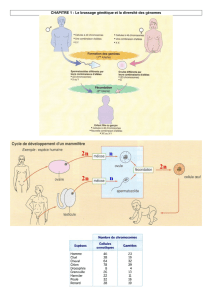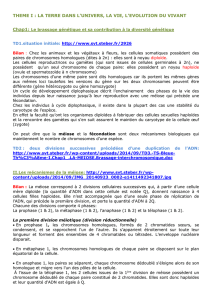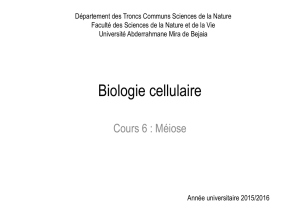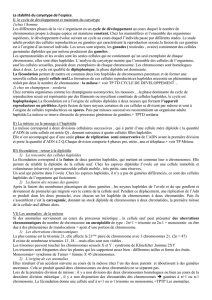La méiose

1
LA MEIOSE
I/ Généralités.
La méiose : est la production de cellules haploïdes (gamètes) à partir de cellules diploïdes afin de
rendre possible une reproduction sexuée donnant fruit à une cellule diploïde contenant le
mélange des deux génomes.
1) Cycle chez les animaux.
2) Cycles chez les mycètes et les algues.
3) Chez les végétaux.
Certaines de ces cellules, par méiose, vont donner naissance à des spores, haploïdes, qui peuvent
se diviser par mitose pour donner naissance à un gamétophyte.
C’est ce qu’on appelle une alternance de générations.
Les cellules haploïdes sont formées dans
les gonades, où se situent les cellules
germinales.
La fécondation est la recombinaison des
deux génomes parentaux et forme une
cellule diploïde 2n.
Le zygote est la seule cellule diploïde.
Il est issu de la réunion de deux cellules
haploïdes, et va tout de suite se diviser
via une méiose pour donner naissance à
deux cellules haploïdes.
Chez les végétaux et certaines algues, le
zygote et les cellules haploïdes sont capables,
chacun, de former un organisme
pluricellulaire.
Le zygote va se diviser pour donner un
organisme formé de cellules diploïdes.

2
II/ Processus méiotique.
Elle est constituée de deux phases successives : la méiose I (division réductionnelle) et la méiose II
(division équationnelle).
1) La méiose I.
Chromatide : long brin d’ADN condensé.
a) La prophase I :
Réplication des chromosomes homologues (2X 1c).
Appariement des chromosomes homologues (2X 2c).
Recombinaison génétique durant l’appariement (échange
d’ADN des chromosomes proches).
Division réductionnelle (2n).
Séparation des chromosomes homologues en deux lots
(1n : 1X 2c).
Nouvelle combinaison génétique.
Appariement des chromosomes homologues.
Recombinaison génétique
Elle est composée de cinq stades consécutifs :
- Leptotène
Grossissement du noyau.
Apparition des chromosomes.
Nucléoles visibles.
- Zygotène
Condensation : télomères ancrés à la lamina.
Assemblage du complexe synaptonémal (attache des
2 chromosomes homologues).
Formation des bivalents.
- Pachytène
Chromosomes courts et épais.
Complexe synaptonémal formé.
Enjambements chromosomique (recombinaison).
- Diplotène
Désintégration du complexe synaptonémal.
Chiasmas (lieu de recombinaison) visibles.
Décondensation et transcription des X qui
s’écartent.

3
- Diacinèse
Condensation des chromosomes.
Migration des chiasmas vers les extrémités des X.
Formation du fuseau de division.
Disparition des nucléoles.
Les bivalents d’écartent (asynapsis).
b) La métaphase I :
Transition métaphase / anaphase :
- Migration des chiasmas vers les extrémités des chromosomes.
- Un crossing over par paire minimum est effectué.
- Sans recombinaison, la méiose n’a pas lieu.
- Migration des homologues depuis le centromère vers les pôles.
La séparation des homologues entraine une réduction de ploïdie (2n : 2X 2c 1n : 1X 2c).
Mitose ≠ méiose : les MT s’attachent au kinétochores de chaque chromatide sœur ≠ les MT
s’attachent au kinétochore de chaque chromosome homologue.
c) L’anaphase I :
d) La télophase I :
La protéine MamI entraine la fusion des kinétochores
des chromatides sœurs : un seul kinétochore par X.
Les kinétochores des chromosomes homologues sont
attachés aux pôles opposés du fuseau.
Les chromosomes homologues sont toujours liés l’un à
l’autre par les chiasmas.
Initiée par une dissolution simultanée des chiasmas.
La répartition des chromosomes homologues vers un des pôles
se fait au hasard.
La protéine MamI protège la cohésine par un clivage des
séparases : les chromatides restent liées.
Obtention de deux cellules filles 1n : 1X 2c.
Les chromatides sœurs ne sont plus identiques due à la
recombinaison en phase de transition.
Très courte apparition de l’enveloppe nucléaire.

4
2) La méiose.
La prophase II : pas de décondensation chromosomique et formation du nouveau fuseau de division.
La métaphase II : chromatides sœurs liées par le kinétochore à un jeu de microtubule.
L’anaphase II : la disparition de MamI permet la séparation des chromatides vers les pôles.
La télophase II : obtention de 4 cellules haploïde à combinaison génétique unique.
Mitose
Méiose
Une seule division
Deux divisions successives sans synthèse d’ADN
Echange de fragment d’ADN pendant la
prophase
Séparation uniquement des chromatides sœurs
Séparation des chromosomes homologues en
méiose I provoquant une réduction de ploïdie
Production de deux cellules diploïdes
identiques entre elles avec la cellule mère
Production de quatre cellules haploïde à
combinaison génétique unique
Se produit dans toutes les cellules somatiques
Apparait uniquement dans les cellules
germinales des gonades
Responsable de la croissance de l’organisme et
de la réparation des tissus
Destinée exclusivement à la synthèse de
gamète
3) La diversité génétique de la reproduction sexuée.
Répartition au hasard des homologues maternels et paternels entre les cellules filles durant la
méiose I.
Les échanges génétiques permettent de combiner dans un même chromosome l’ADN hérité des
deux parents.
La nature aléatoire de la fécondation qui met en jeu deux gamètes parmi les nombreuses
combinaisons possibles.
Les mutations nucléotidiques.
La reproduction sexuée :
- Implique un mélange de deux génomes.
- Donne naissance à des génomes uniques.
- Mélange des génomes obtenu par fusion des cellules haploïdes.
- Nécessite donc une réduction de la ploïdie.
La reproduction asexuée donne naissance à des clones génétiquement semblables.
1
/
4
100%