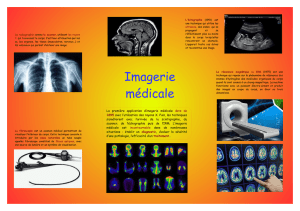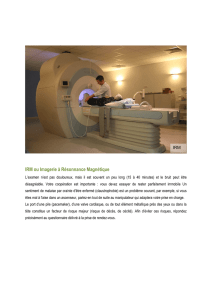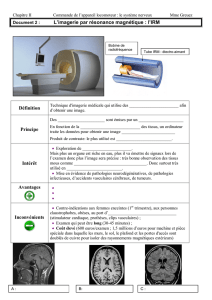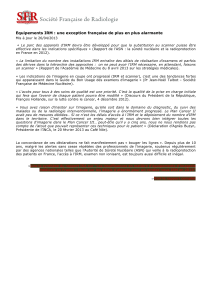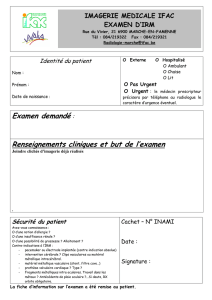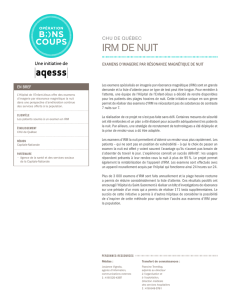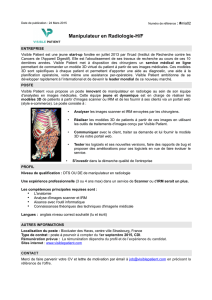Applications cliniques

Applications cliniques
Mis à jour le 13/12/2013
Les boursiers de la SFR – GUERBET au RSNA 2012 ont pu faire le point sur un certain nombre de sujets
qui leur sont apparus comme nouveaux, pertinents ou synthétiques. Ce rapport n'est nullement un
reporting exhaustif des présentations scientifiques ou pédagogiques ; mission totalement impossible
compte tenu du nombre inimaginable de session et de hétérogénéité de celles
-
ci.
Ce travail s'est fait dans une ambiance conviviale et fort peu protocolaire, mais la qualité du rapport
produit par les boursiers atteste de leur sérieux et confirme que la bourse SFR
-
GUERBET est un lieu
d
’
échange d
’
expérience et de parcours propice à la vitalité de notre discipline.
IMAGERIE CARDIAQUE ET VASCULAIRE
1 - En IRM Cardiaque plusieurs études se sont intéressées à
l’imagerie avancée de l’inflammation et de la fibrose.
Constatant les limites du T2 STIR qui ne dépasse pas 30 à 40 % de
sensibilité pour la détection de l’œdème myocardique, l’équipe française
de J. Potet a évalué les performances d’une séquence en diffusion EPI à
faible b (b = 50) : les résultats sur 13 patients examinés pour
myocardite sont prometteurs avec une sensibilité de 100 % et une très
bonne corrélation morphologique aux séquences de rehaussement
tardif.
Notons aussi le retour des USPIO pour détecter l’inflammation
myocardique, avec cependant des images trop bruitées et un protocole
trop complexe (acquisitions à H0 et à H24) pour véritablement
convaincre.
Pour la fibrose, l’accent a été mis sur le T1 mapping : une diminution du
T1 est détectable précocement dans les fibroses myocardiques (CMH
surtout). Ainsi, 5 % de fibrose suffisent à induire une baisse du T1 alors
que 15 à 20 % sont nécessaires pour qu’apparaisse un rehaussement
tardif.
Enfin, une présentation impressionnante démontrait la faisabilité d’une
acquisition ciné 3D volumique en seulement deux apnées : les images
sont moins résolues que les ciné-standards, mais permettent un calcul
efficace de la fraction d’éjection et la détection des
hypokinésies/akinésies.
2 - En scanner cardiaque , peu de nouveautés techniques
frappantes, mais de nombreuses présentations consacrées aux résultats
de grandes études épidémiologiques. Un mot d’ordre à retenir : l’arrivée
prévisible du coroscanner aux urgences pour la gestion des douleurs
thoraciques atypiques. ROMICAT II confirme sur 1 000 patients que
dans les SCA ST- et TN-, le coroscanner réalisé à l’admission diminue
drastiquement la durée de passage aux urgences et le taux
d’hospitalisation. ACRIN PA4005 (1400 patients) et CATER (101 patients)
retrouvent les mêmes résultats. Une question reste cependant en
suspens : dans ces douleurs thoraciques atypiques, faut-il se contenter
d’un coroscanner ou aller vers un protocole « triple rule-out » ? Pas de
réponses définitives, ces grandes études ne testant que le coroscanner
pur, mais certains experts recommanderaient plutôt la deuxième option
chez les patients de plus de 60 ans, afin de ne pas méconnaître les
classiques diagnostics différentiels. Reste aussi le problème des
ressources : comment adapter ce protocole en France, avec la pénurie
en équipements et en radiologues que nous connaissons ?
3- En imagerie vasculaire diagnostique, le scanner double énergie
était clairement la vedette du congrès : il permet de sensibiliser les
examens grâce aux reconstructions monochromatiques (diminution des
keV augmentant le contraste de l’Iode) et aux images Iode-spécifiques
(cartographie de la prise de contraste). Des études ont confirmé ces
bénéfices dans le diagnostic des endofuites. Plusieurs auteurs ont mis à
profit ces avantages pour réduire la dose de produit de contraste
utilisée, une équipe française descendant jusqu’à 13,5 g pour les
angioscanners aortiques et 18,9 g pour les angioscanners des membres
inférieurs. Ceci pourrait devenir une technique de référence chez les
patients insuffisants rénaux modérés à sévères.
A la lumière de ces avancées, plusieurs équipes redécouvrent les
bienfaits de la diminution des kV en angioscanographie : avec des
acquisitions à 100 kV voire 80 kV, le contraste de l’iode est augmenté et
l’irradiation nettement diminuée. Les algorithmes de reconstructions
itératives permettent de travailler efficacement à ces bas kV en limitant
le bruit induit.
Réunion de travail quotidienne des boursiers
RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE PERIPHERIQUE
La radiologie interventionnelle périphérique, vasculaire ou non, a occupé
Une étude a montré que la détection du CHC au scanner était
équivalente à celle de l’IRM avec injection de Primovist. Le scanner est
même supérieur à l’IRM en cas d’incapacité pour le patient de maintenir
l’apnée, pour les nodules localisés en périphérie et en cas de cirrhose
sévère.
Deux études se sont concentrées sur le scanner pour le diagnostic de
CHC. La première montre que la dose de produit de contraste optimale
pour visualiser le caractère hypervasculaire des CHC est comprise entre
567 et 647 mgI/kg. La seconde retrouve que l’utilisation du software
vContrast (Philips) permet d’augmenter le CNR et la densité des CHC
après injection, sans majoration du bruit et des artéfacts. Sous réserve
de futures études, cette méthode pourrait permettre de diminuer la dose
de PCI à injecter.
Concernant la phase hépatobiliaire, à la fois son optimisation, ses
performances diagnostiques et son caractère prédictif ont été
présentés :
- L’augmentation de l’angle de bascule à 30° pour sa réalisation permet
une meilleure performance diagnostique et un meilleur contraste pour le
diagnostic de lésion hypointense sur la phase hépatobiliaire, suspecte de
CHC.
- Dans une étude avec comme gold standard les foies explantés, seul 69
% de CHC sont visibles en IRM avec injection de Primovist avant la
transplantation.
- Une autre étude retrouve qu’environ 90 % des CHC apparaissent
hypointenses sur la phase hépatobiliaire. Les 10 % qui sont iso ou
hyperintenses sur la phase hépatobiliaire sont de plus petite taille, de
grade plus faible et ont une survie sans récidive après chirurgie plus
longue que les CHC hypointense sur la phase hépatobiliaire. L’aspect du
CHC à la phase hépatobiliaire semble donc être un facteur prédictif de
récidive après chirurgie.
Plusieurs études ont regardé l’évolution des nodules au cours du temps
et les possibilités de différencier nodules dysplasiques et CHC :
- Les nodules hypovasculaires qui apparaissent hyperintenses sur la
phase hépatobiliaire évoluent rarement (< 1 % des cas) vers des
nodules hypervasculaires et des CHC. Cependant, parmi ces nodules,
ceux qui mesurent plus de 10 mm ou qui présentent une augmentation
de taille, doivent être surveillés car sont plus à risque de devenir un
CHC.
- La moitié des CHC hypervasculaires apparaissent hypointenses sur la
phase hépatobiliaire sur une IRM réalisée 6 mois avant de devenir
hypervasculaires. Un nodule hypointense à la phase hépatobiliaire
même s’il n’est pas hypervasculaire est donc à haut risque de CHC.
- Une étude a cherché à voir si l’on pouvait différencier les nodules
dysplasiques, les CHC de bas grade et les CHC de haut grade. Le signal
T2 des nodules dysplasiques est inférieur à celui des CHC de bas grade,
lui même inférieur à celui des CHC de haut grade. A la phase
hépatobiliaire, les CHC de haut grade sont plus hypointenses que les
CHC de bas grade et les nodules dysplasiques. Les CHC, quelque soit
leur grade, présentent un rehaussement plus rapide que les nodules
dysplasiques. Pour différencier CHC de haut et de bas grade, le signe le
plus sensible est l’hypointensité à la phase hépatobiliaire alors que le
signe le plus spécifique est l’hypersignal T2.
Une seule étude s’est intéressée à l’IRM de diffusion et a regardé ses
performances isolément pour le diagnostic de CHC. Ils ont comparé
deux séquences de diffusion avec gradient monopolaire ou bipolaire. Les
qualités des deux séquences sont équivalentes. Malgré un meilleur
rapport signal sur bruit pour la séquence avec gradient monopolaire,
aucune différence n’est retrouvée pour la détection du CHC entre les
deux séquences. Les performances de l’IRM de diffusion sont nettement
inférieures à celles précédemment publiées mais cette étude a regardé
l’IRM de diffusion de manière isolée et confirme l’insuffisance de l’IRM de
diffusion seule pour le diagnostic de CHC.
Enfin, une étude s’est intéressée au suivi après traitement et a étudié
l’intérêt de l’échographie de contraste pour prédire la réponse et la
survenue d’effets secondaires aux traitements des CHC par sorafénib.
L’aire sous la courbe de rehaussement à J7 est prédictive de la survie
globale et de la survie sans récidive, celle à J14 de la réponse. La
diminution de l’aire sous la courbe dans le parenchyme hépatique entre
J0 et J7 est elle prédictive de la survenue d’effets secondaires majeurs.
IMAGERIE URO-NEPHROLOGIQUE
Richard Barr et Jean-Michel Correas rapportent leur expérience sur la
détection des cancers prostatiques en élastographie ultrasonore
shearwave (SWE) sur 161 patients. En utilisant un seuil de 35Kpa, cette
technique, peu invasive, permet de diagnostiquer (diagnostic par
patient) les nodules malins avec une sensibilité de 86,2 %, une
spécificité de 69,9 %, une valeur prédictive positive de 61,7 % et
prédictive négative de 90 %. Du fait de sa haute VPN les patients à PSA
élevée et SWE normale pourraient ne pas avoir de biopsie, diminuant

une partie importante du RSNA cette année avec des sessions dédiées
pluriquotidiennes à type de cours ou de présentations scientifiques. La
radiologie nord-américaine a également pris conscience de la place
primordiale qu’elle occupe dans la prise en charge du patient :
« Radiologists will no longer be valued for just interpreting images »
1- L’aorte , organe phare de la spécialité vasculaire, a été représentée
comme il se doit. Nous avons eu le plaisir de découvrir les progrès des
stents grafts toujours plus flexibles, plus angulés avec un choix de taille
grandissant permettant un traitement adapté, personnalisé à chaque
patient. Les progrès ont aussi porté sur la surveillance des patients
traités avec une meilleure détection et prise en charge des
complications. Des études portant notamment sur la mesure du volume
des endofuites de type 2, donnent des résultats intéressants pour juger
de la nécessité d’un retraitement.
2- Les veines n’ont pas été oubliées avec une journée dédiée à la
maladie thromboembolique et à la présentation de l’efficacité des
techniques de thrombolyse avec notamment de nouveaux dispositifs
intraveineux introduits par voie percutanée assurant une thrombolyse
mixte : chimique et mécanique « automatiques ».
3- Le versant oncologique a également été riche avec de multiples
topos sur les méthodes d’ablation de type thermoablation ou
cryothérapie mais aussi avec de plus en plus de séries sur
l’électroporation. L’exposition technique montrait de nombreux dispositifs
d’aide à la navigation pour faciliter la mise en place d’aiguille
principalement sous échographie avec la possibilité de s’entraîner sur
fantôme.
4- Enfin nous avons découvert des perspectives révolutionnaires grâce
à L
’
imagerie interventionnelle moléculaire! Aujourd’hui, nous
savons diagnostiquer les anomalies vasculaires et les traiter mais
bientôt nous pourrons les prévoir. Nos cathéters ne permettront plus
seulement d’avoir une luminographie vasculaire, ils analyseront
l’environnement périvasculaire. Nous pouvons déjà étudier
morphologiquement la paroi vasculaire avec la tomographie par
cohérence optique. Demain, grâce à la fluorescence infrarouge, nous
mesurerons l’inflammation de l’environnement périplaque et ainsi nous
détecterons les plaques à risque…
Les perspectives de la spécialité apparaissent énormes mais le contexte
de crise actuelle nous pousse à quelques réserves. Il est très intéressant
de voir que nos confrères outre-atlantique sont également sensibles à
cette problématique comme le montre certaines citations exposées au
congrès :
« The future of radiology is bright but the future for radiologists is far
less uncertain »
IMAGERIE THORACIQUE
Les principales nouveautés présentées au RSNA 2012 dans le domaine
de la pathologie thoracique concernaient la quantification des maladies
des voies aériennes chroniques telles que l'asthme et la BPCO. La
tomodensitométrie reste l'outil de choix dans ce domaine, puisqu'elle
reste la seule modalité d'imagerie capable d'imager avec une résolution
spatiale suffisante les parois et les lumières bronchiques. Elle permet
également de quantifier la densité du parenchyme pulmonaire, comme
marqueur quantitatif d'emphysème (en inspiration) ou d'air trapping (en
expiration). S. Gupta a ainsi présenté une méthode de phénotypage de
l'asthme à l'aide de ces approches combinées en tomodensitométrie.
Dans le domaine de la BPCO, il a été montré que la classification des
patients sur la base des seules données fonctionnelles fournies par la
spirométrie laisse environ 12 % de patients inclassés. Chez ces patients,
des modifications ont été démontrées versus patients témoins, en
particulier une augmentation de l'épaisseur de leur paroi bronchique sur
la bronche RB1. Kazerooni et al ont montré une méthode originale de
quantification permettant de différencier l'air trapping de l'emphysème à
partir de TDM acquises en inspiration et expiration chez les patients
BPCO. A partir de la mesure de la variation de densité voxel par voxel
des volumes pulmonaires, les voxels étant matchés entre l'inspiration et
l'expiration par une méthode de recalage élastique, le choix de seuils de
variation permet de discriminer ces deux conditions. Les données de
l'expiration ne concernent pas seulement le parenchyme pulmonaire.
Ainsi, l'équipe de Boiselle et al ont montré que le collapsus de la trachée
et des bronches souches en cours d'expiration chez les BPCO est un
marqueur de la sévérité de la maladie.
Des avancées ont été aussi présentées dans la quantification en
imagerie thoracique fonctionnelle. L'IRM est dans ce domaine l'outil de
choix de par son caractère non irradiant, permettant la réalisation
d'acquisitions temporelles continues. Toutefois l'IRM pose problème par
la faible densité en proton du parenchyme pulmonaire, et les artéfacts
de susceptibilité magnétique du fait de la présence de nombreuses
interfaces. En IRM, l'inhalation d'hélium polarisé avait ouvert la voie à ce
type d'imagerie fonctionnelle in vivo chez l'homme. D'autres gaz rares
ont également été utilisés, tels que le Xénon ou le Krypton. Ce type de
technique est cependant grevé par leur coût prohibitif, nécessitant entre
2 000 et 3 000 euros de gaz par patient. Pour pallier à cette limite, une
méthode novatrice a été présentée, basée sur l'utilisation de gaz fluoré
peu coûteux et la détection de la résonance du 19Fluor. Une étude de
faisabilité a montré des résultats prometteurs dans la quantification de
l'air trapping sur des populations de patients témoins, asthmatiques et
BPCO.
Une autre approche en cours de développement et d'évaluation est
basée sur l'extraction des fréquences cardiaques et respiratoires sur des
acquisitions IRM acquises en respiration libre, ce qui permet d'obtenir,
après décomposition de l'espace de Fourier, des images représentatives
de la ventilation ou de la perfusion. Lederlin et al ont montré l'évaluation
de la qualité et de la reproductibilité de la lecture des données issues de
ce type de technique d'imagerie. Ces évaluations sont satisfaisantes
pour les régions postérieures sur des imageries acquises dans le plan
coronal, mais médiocres pour les régions antérieures. Une solution
possible pourrait être de compléter les acquisitions par des séquences
réalisées dans le plan sagittal, ou bien d'adapter les paramètres des
séquences. Outre l'aspect fonctionnel, l'utilisation de l'IRM, pour
l'analyse classique du parenchyme a été rapportée avec la réalisation de
séquences en T1 utilisant des temps d'écho ultracourt permet d'imager
les atteintes de l'interstitium. Les résultats sont satisfaisants mais encore
en dessous des performances des TDM notamment pour la détection des
micronodules.
Dans le domaine des pathologies interstitielles, des résultats ont été
présentés sur des études visant à quantifier les différentes atteintes, en
particulier le verre dépoli, l'emphysème, les bronchectasies de traction,
les atélectasies et le rayon de miel. Les résultats sont mitigés, puisque
ainsi le nombre de biopsie négative en situation de détection.
NEUROR
ADIOLOGIE
Trois thématiques parmi les dizaines présentées ont particulièrement
retenu notre attention.
1-
A
ccident vasculaire cérébral (AVC) ischémique
De nombreuses communications font part des résultats prometteurs de
la thrombectomie mécanique dans le traitement des AVC ischémiques à
la phase aigüe. Le développement récent des « stentrievers » (mot-
valise pour « stent retrievers », c’est-à-dire des stents non-largables
désignés pour « emprisonner » le caillot afin de l’extraire par voie
endovasculaire) permettrait selon les séries présentées (Kallenberg K.
et col.) d’obtenir une recanalisation jusque dans plus de 80 % des cas et
uneévolutioncliniquefavorable(mRS≤2)jusquedans50%descas.
Ces résultats sont très encourageants. Néanmoins, aucune des études
présentées n’était randomisée.
2-
S
egmentation
Une large place a été donnée aux techniques de segmentation pour le
suivi longitudinal de pathologies neurologiques. Ainsi, une équipe
suédoise (M. Warntjes et col.) a présenté un algorithme de segmentation
rapide (10s) des anomalies de signal en T2 de la substance blanche
(SyMRI Diagnostics [SyntheticMR AB, Suède]). Cet algorithme permet
de segmenter à la fois la substance blanche, la substance grise, le LCR
et par différence de ces 3 volumes avec le volume cérébral total, les
lésions de la substance blanche. Cette méthode apparaît, selon les
auteurs, rapide et reproductible.
Un outil de segmentation élaboré initialement pour la SEP (Lesion
Segmentation Toolbox [LST]) a également été évalué par une équipe
américaine pour la segmentation des lésions de la substance blanche
liée à une atteinte microvasculaire chez les patients diabétiques, avec
des résultats encourageants.
Enfin, une équipe a évalué l’intérêt d’un algorithme de segmentation
pour quantifier le volume ventriculaire avant et après drainage dans
l’hydrocéphalie à pression normale sur des séquences MPRAGE à 1,5T
en utilisant l’algorithme Bridge Burner implémenté sur Firevoxel. Les
patients présentant une bonne réponse au drainage ventriculaire ont,
selon cette étude, une réduction du volume ventriculaire 3 fois plus
importante que les non-répondeurs.
3-
I
RM 7T
Enfin, les applications cliniques de l’IRM à haut champ (7T) ont été mises
à l’honneur par plusieurs communications et posters. Une étude pilote a
été présentée sur la détection des dépôts ferriques, marqueurs indirects
de l’activité des plaques de SEP, sur les séquences FLAIR et SWI à 7T.
L’IRM à haut champ apporte, selon cette étude, une exploration non-
invasive avec de fortes résolutions spatiale et en contraste de ces
dépôts ferriques. Ceux-ci seraient, par ailleurs, plus nombreux dans les
formes rémittentes-progressives que dans les formes secondairement
progressives de la SEP.
Enfin, une équipe japonaise (Kudo K. et col.) a fait une mise au point, à
travers un poster richement illustré, des apports de l’IRM à haut champ
dans de nombreuses pathologies du système nerveux central, de par le
fort rapport contraste/bruit qu’elle apporte et de sa forte résolution en
contraste. Les performances de l’IRM 7T ont été présentées, notamment
dans la visualisation des vaisseaux de petits calibres (200 μm) comme
les artères lenticulo-striées ou les vaisseaux prolifératifs de la maladie
de Moya-Moya.
Mickaël Ohana et Gaël Dournes en compagnie de G.Bisset, président du
RSNA 2012
IMAGERIE PEDIATRIQUE ET ANTENATALE
Au RSNA cette année, la radiologie pédiatrique a été représentée de
manière très variée, beaucoup de poster, de cours, cas cliniques et de
sessions scientifiques, sur des sujets très différents. Il existait une salle
dédiée à la « communauté pédiatrique» où les posters papiers et
électroniques étaient consultables et présentés par les auteurs à
certaines heures.
1- L’
IRM f
œtale abdominale et thoracique a été abordée dans
plusieurs sessions scientifiques. Plusieurs communications ont décrit la
faisabilité de l’IRM fœtale dans les malformations abdominales et les
pathologies du tube digestif, concluant qu’il s’agit d’un examen
permettant d’apporter des éléments supplémentaires à l’échographie
anténatale (contraste meilleur, plus grand champ de vu), et permettant
d’optimiser les modalités d’accouchement et de prise en charge
néonatale, notamment chirurgicale. Ces données n’étaient pas très
innovantes pour la pratique de l’imagerie fœtale en France.
Des sujets plus innovants ont été abordés. L’équipe de C. Much
(Hamburg – Allemagne) a évalué en imagerie de diffusion l’effet de
l’administration de corticoïdes sur la maturation pulmonaire de fœtus de
moutons, à 1,5 T. Leurs résultats montrent que dans le groupe ayant
reçu de la cortisone, il existait une augmentation significative de l’ADC
entre l’IRM baseline (J0) et l’IRM de suivi à J5. L’ADC était le même dans
les deux groupes à J0. L’ADC n’était pas corrélé à l’âge gestationnel, ce
qui exclut une influence par la maturation fœtale physiologique. Ainsi
l’imagerie de diffusion pourrait être une technique non-invasive pour
monitorer in vivo la maturation pulmonaire induite par l’administration
de corticoïdes. Toujours concernant l’IRM fœtale pulmonaire, M. Mills
(Salt Lake City) explique dans son poster scientifique qu’il existe une
association entre les ratio d’intensité (poumons/rate, foie, muscles) et
l’âge gestationnel, permettant une évaluation non-invasive de la
maturité pulmonaire, mais non encore utilisable en routine clinique.
H. Werner (Rio de Janeiro – Brésil) a présenté de belles images 3D de
fœtoscopie virtuelle et bronchoscopie virtuelle. Les images 3D du
placenta dans deux grossesses gémellaires compliquées de STT au

ces approches, basées sur du contourage manuel et/ou semi
automatique, coûteuses en temps d'extraction des données, n'apportent
pas de bénéfice par rapport à une méthode de quantification qualitative
visuelle.
Une nouvelle maladie a été présentée, liée à l'inhalation de produits
chimiques présents dans des humidificateurs stérilisants. Les
caractéristiques de cette maladie sont sa survenue au printemps, chez
des femmes jeunes en période de péripartum. L'atteinte
tomodensitométrique consiste en des micronodules centrolobulaires
diffus et extensifs, parfois compliqués de pneumomédiastin.
Dans le domaine de la cancérologie, de nombreuses études ont présenté
les caractéristiques des nodules permettant de prédire leur malignité ou
leur bénignité. L'IRM s'érige également comme un outil utile à
l'évaluation diagnostique, pronostique, ou bien de prédire à l'aide des
séquences de perfusion ou de diffusion la réponse aux traitements. Par
exemple, l'étude du rehaussement permet de suivre la bonne réponse
au traitement sur les cicatrices de radiofréquences de nodules
pulmonaires.
Soirée entre les boursiers et les président et secrétaire de la SFR
IMAGERIE DIGESTIVE
1- La séance scientifique dédiée à la stéatose hépatique était,
sans grande nouveauté, principalement axée sur le calcul de la stéatose
hépatique en IRM qui a été comparé aux résultats de la biopsie (Idilman
and al) et de la spectroscopie (Yakir and al). Cette technique a montré
des résultats équivalents en terme de sensibilité et de spécificité
comparativement aux techniques existantes à condition que le signal soit
corrigé le T2* et l'effet T1 soit minimisé en diminuant l'angle de bascule.
La présence de fibrose diminue toutefois les performances des
techniques de détection de la stéatose.
Mais l'élément le plus intéressant de cette session reste la série de
Benjamin Pully menée sur la souris avec l'utilisation du MPO gadolinium
permettant de distinguer la stéatose et la NASH. La NASH est en effet
caractérisée par une inflammation locale et le MPO gadolinium va
rehausser ces zones inflammatoires, les plages de stéatose quant à elles
n'étant pas rehaussées. Cette série apparaît prometteuse et nécessite
maintenant une étude de validation chez l'homme.
2- Le produit de contraste hépatospécifique IRM (Gd EOB DTPA
– Primovist® ou Eovist® suivant le pays) est toujours d'actualité. C.
Sirlin a fait une mise au point exhaustive sur ses avantages et limites.
La littérature commence à être fournie pour affirmer son rôle : détection
des métastases, caractérisation des tumeurs hépatocytaires bénignes,
détection et caractérisation des CHC et notamment des early CHC dont
le diagnostic est souvent très difficile avec un gadolinium standard. (Les
études rapportant spécifiquement l'utilisation du Gd EOB DTPA pour le
diagnostic du CHC sont rapportées ci-dessous dans le chapitre "CHC").
La qualité de la phase artérielle dégradée du fait de la faible quantité de
produit injecté, reste toutefois une limite de ce produit. Enfin B. Viglianti
et al. ont rapporté une moins bonne tolérance (dyspnée à l'injection de
ce produit comparativement au Gd DOBTA (Mltihance®). Les possibilités
cliniques maintenant confirmées de ce nouveau produit de contraste font
à nouveau regretter qu'il ne soit pas disponible en France alors qu'il l'est
dans tous les autres pays européens.
3- Cette année encore l'accent a été mis sur le
S
canner àdouble
énergie pour améliorer la détection des CHC hypervasculaire. Adnan
Wajid Ali and al retrouvent dans leur série rétrospective de 50 patients,
12 nodules (17 %) non visualisé sur le scanner triphasique classique. La
limite actuelle de ces séries reste toutefois l'absence de confrontation à
l'IRM ou au foie explanté pour connaître leurs performances réelles.
L'une des principales critiques faite également au scanner à double
énergie était la dose importante délivrée au patient. Parallèlement
plusieurs posters électroniques et communication orale ont donc porté
sur la réduction de dose. Cette réduction de dose est en effet possible
grâce aux reconstructions itératives proposées par les différents
constructeurs (Safire, Veo, Asir...). Zih-Cen Lin and al dans leur série de
50 patients montrent d'ailleurs une réduction de dose de 41 % sans
perte d'information.
4- Cancer du rectum
Les deux grands sujets abordés dans la session sur le cancer du rectum
ont été l’évaluation de la réponse au traitement et le staging
ganglionnaire.
Concernant le staging ganglionnaire, une étude, avec corrélation précise
imagerie-anapath, a confirmé l’insuffisance de l’IRM pour le staging
ganglionnaire, notamment pour les ganglions de moins de 3 mm, qui
peuvent être atteints.
Deux études ont montré l’intérêt de l’IRM dynamique dans le bilan
d’extension et l’évaluation après radio-chimiothérapie dans le cancer du
rectum. La première a regardé l’intérêt dans la caractérisation
ganglionnaire : 3 types de courbe de rehaussement ont été définis,
selon l’évolution après une prise de contraste initiale : type A = prise de
contraste persistante, B = prise de contraste en plateau, C = lavage. Un
troisième trimestre permettent de visionner des films de simulation 3D,
et d’aider à guider la voie d’abord optimale de la fœtoscopie pour
réaliser un traitement par laser. La bronchoscopie virtuelle, réalisable
chez 5 fœtus présentant des tumeurs cervicales (lymphangiome ou
tératome), pourrait également être un outil intéressant, en particulier
pour étudier le retentissement d’une tumeur cervicale sur les voies
aériennes supérieures. Enfin M. Thomason (Detroit) a identifié en IRM
fonctionnelle chez le fœtus humain des réseaux de connexion neuronale
similaires à ceux observés en postnatal (brainnexus.com).
2- Une session entière a été consacrée à L’imageriecardiaque anté-
et postnatale. B. Schoennagel (Hamburg – Allemagne) a évalué une
technique d’IRM anténatale cardiovasculaire chez des moutons, en
synchronisant au rythme cardiaque fœtal par un capteur écho-doppler.
Les résultats sont concluants, permettant des mesures de la FEVG et des
vitesses du flux sanguin dans l’aorte. La même équipe a démontré par la
même technique, qu’il n’existait pas de différence significative entre les
mesures de pic de vitesses dans l’aorte fœtale descendante mesurées
en IRM et en écho-doppler. De nouvelles techniques d’IRM ont été
évaluées (Perfusion de premier passage, IRM 4D) chez des patients
opérés d’une transposition des gros vaisseaux ou d’une tétralogie de
Fallot. A. Popescu (Chicago) a comparé 3 techniques d’imagerie des
coronaires chez 54 enfants (IRM T2 SSFP, IRM 3D IR FLASH, scanner
cardiaque synchronisé, rétrospectif, après injection de produit de
contraste). Les résultats montrent bien qu’aucune technique IRM ne peut
concurrencer le scanner cardiaque. Cependant la séquence IRM IR
FLASH permet une bonne visualisation de l’origine et de la partie
proximale des artères coronaires, notamment entre 0 et 1 an, ce qui est
le plus informatif en imagerie cardiaque pédiatrique. F. Secchi (Milan –
Italie) a démontré que l’évaluation par IRM cardiaque est efficace, pour
l’évaluation de la fonction cardiaque dans le suivi après implantation
percutanée de valve pulmonaire (Melody®). L’équipe de R.
Krishnamurthy (Houston - Texas) a présenté les résultats d’une étude
évaluant l’efficacité de l’angioscanner et de l’angioIRM pour la recherche
de récidive de sténose de veine pulmonaire après chirurgie de
correction de retour veineux anormal pulmonaire total. Cette même
équipe a aussi démontré que l’angioscanner est équivalent au
cathétérisme pour évaluer l’anatomie des artères pulmonaires et des
collatérales aorto-pulmonaires (MAPCAs : Major Aorto Pulmonary
Collateral Arteries) chez les enfants avec atrésie pulmonaire et CIV.
R. Paul Guillerman (Houston) a clôturé une session sur l’imagerie
cardiothoracique pédiatrique par un cours très intéressant sur les
pathologies pulmonaires diffuses pédiatriques, en abordant de nouvelles
classifications.
IMAGERIE GYNECOLOGIQUE
Peu d’avancées majeures en imagerie du pelvis féminin, mais trois
grands thèmes ont pu être dégagés au cours de ce congrès RSNA 2012 :
1-
I
magerie des cancers pelviens de la femme
Comme attendu, l’imagerie de diffusion était à l’honneur en cancérologie
pelvienne, avec de très nombreuses communications didactiques et
scientifiques, notamment dans le staging initial, le diagnostic des
récidives après traitement mais également comme élément pronostique
de la réponse thérapeutique.
L’équipe de Härma et al (Kuopio, Finlande) a démontré la valeur ajoutée
de l’IRM de diffusion « corps entier » à 3T comparativement au TDM
dans le staging des cancers ovariens, tandis qu’une équipe chinoise (Li
et al, Pékin) rapportait des performances similaires au TEP scan dans le
diagnostic des récidives des néoplasies ovariennes sur une population
de 30 patientes. Le duo diffusion/perfusion est également à la mode,
avec une étude rapportant des performances accrues dans la distinction
lésions borderline de l’ovaire vs carcinomes.
La valeur prédictive de l’IRM de diffusion a également été étudiée dans
les néoplasies du col utérin relevant d’un traitement par radio-
chimiothérapie concomitante. (Liu et al, Tianjiu, Chine).
Les séquences T2 3D sont également à la mode dans le staging des
cancers du col, avec 2 études (1,5 et 3T) mettant en exergue des
performances au moins aussi bonnes qu’avec les séquences T2
conventionnelles ; aucune mention toutefois du temps gagné ou perdu…
Pour autant, le scanner n’est pas mort, comme en témoigne le travail
intéressant de Liu et al (Tianju, Chine) portant sur un score TDM
prédictif avant prise en charge des carcinoses péritonéales compliquant
là encore les cancers de l’ovaire.
2- Urgences abdominopelviennes et grossesse
L’échographie reste bien évidemment l’examen de première intention
dans la majorité des centres, mais la place de l’IRM devient de plus en
plus importante, notamment aux Etats-Unis, qui connaissent certes
moins que d’autres les problèmes de disponibilité d’appareils ! Les
applications, à base se séquences de type « single shot », sont larges et
couvre aussi bien la pathologie biliaire que l’appendicite, les maladies
inflammatoires chroniques ou la lithiase urinaire. Mais là encore, le
scanner rend encore service…Une étude de l’équipe d’Indiana a montré
que le scanner très basse dose « conventionnel » (hors double énergie)
conservait d’excellentes performances diagnostiques.
Autre sujet d’importance, les anomalies d’insertion placentaire, où la
place de l’IRM devient prépondérante dans les cas échographiques
difficiles. L’équipe de Lariboisière a montré que le défect d’interface
utéroplacentaire et les hyposignaux T2 intraplacentaires en bande
étaient les 2 signes les plus fiables pour ce diagnostic.
3- Endométriose
Beaucoup de revues iconographiques sur les localisations typiques et
atypiques, à 1,5 ou 3T, et 2 communications intéressantes :
- l’apport de la coloscopie virtuelle dans l’atteinte digestive de
l’endométriose profonde en comparaison à l’IRM (Jeong et al, Corée du
Sud), où les disparités de calibre focales du rectosigmoïde semblent être
le signe majeur ; malheureusement les IRM étaient réalisées sans
balisage vaginal et/ou rectal.
- les séquences uro-IRM T2 2D dans la détection de l’envahissement
urétéral (souvent asymptomatique), rapides et simples à réaliser (Roy
et al, Strasbourg).
IMAGERIE OSTEOARTICULAIRE
Encore une fois cette année l’imagerie ostéo-articulaire représentait une
part importante des présentations scientifiques et pédagogiques avec
plus de 300 sujets traités.
Parmi les différentes thématiques abordées, l’échographie, qui connaît
un regain d'intérêt au Etats-Unis, était particulièrement présente,
reprenant de très nombreux concepts déjà développés dans la
littérature européenne comme l’intérêt des manœuvres dynamiques, ou

pourcentage de voxel présentant un rehaussement persistant supérieur
à 26 % est en faveur d’un ganglion néoplasique, alors que la présence
d’un lavage est plutôt en faveur d’un ganglion bénin. Cette méthode de
discrimination présente une meilleure spécificité que les critères de
taille.
La deuxième étude a regardé quelle est la meilleure séquence à utiliser
pour réaliser une volumétrie tumorale sur les examens pré et post
radiochimiothérapie afin d’évaluer la réponse tumorale et différencier les
patients répondeurs des patients non répondeurs. L’IRM dynamique est
plus performante que l’IRM pondérée en T2 et l’IRM pondérée en
diffusion, avec une AUROC de 0,8 (vs 0,4). Il persiste cependant des
faux négatifs et cette méthode d’évaluation est chronophage.
Concernant l’évaluation après radiochimiothérapie, une équipe italienne
a montré que l’ADC après traitement et que la variation de l’ADC
permettaient de différencier les patients répondeurs des patients non
répondeurs avec des AUROC de 0,8 et des sensibilités et des spécificités
optimales évaluées à 86 et 67 % pour l’ADC après traitement et à 81 et
67 % pour la variation du coefficient ADC. Dans une seconde étude, ils
ont comparé les performances de l’IRM de diffusion à celle du PET-CT.
L’ADC post-traitement des répondeurs est supérieur à celui des non
répondeurs et le SUVmax des répondeurs est inférieurs à celui des non
répondeurs. L’association des 2 techniques permet d’avoir une valeur
prédictive positive de réponse de 97 %, supérieure à celle de chaque
technique isolée.
Une méta-analyse a confirmé les performances similaires du PET de
l’IRM de diffusion pour évaluer la réponse aux traitements néoadjuvants.
Il note également une sensibilité plus basse dans le cadre des
adénocarcinomes mucineux, pour lesquels il déconseille l’utilisation de
ces méthodes d’imagerie fonctionnelle.
Enfin, une étude intéressante s’est attachée à trouver un moyen de
différencier réaction desmoplastique et infiltration tumorale. Différents
modèles d’infiltration de la graisse périrectale ont été définis : infiltration
nodulaire, qui elle, est par définition tumorale, infiltration réticulaire et
infiltration linéaire. La présence d’une infiltration réticulaire est associée
à une infiltration tumorale. En revanche la présence d’une infiltration
linéaire est associée à une infiltration tumorale uniquement quand cette
infiltration va jusqu’au fascia para recti. Ces critères devront être
étudiés dans de futures études mais semblent être intéressants.
5- Carcinome hépatocellulaire
Les critères LI-RADS ont été présentés : ils permettent de caractériser
un nodule sur foie de cirrhose et de définir sa probabilité de CHC selon
sa classe. La classification est la suivante : LI-RADS 1 = définitivement
bénin, LI-RADS 2 = probablement bénin, LI-RADS 3 = intermédiaire, LI-
RADS 4 = probablement un CHC et LI-RADS 5 = définitivement un CHC.
La démarche diagnostique est présentée dans l’organigramme suivant :
A noter que ces critères ne prennent pas en compte les données de
l’imagerie fonctionnelle et notamment l’IRM de diffusion.
Les différents critères diagnostiques de CHC (Barcelone, AASLD, LI-
RADS et OPTN) ainsi que des nouveaux critères utilisant la phase
hépatobiliaire après injection de Primovist ont ensuite été étudiés.
Les critères OPTN (critères américains de TH) et les critères LI-RADS
présentent des sensibilités et spécificités similaires pour le diagnostic de
CHC, avec une spécificité élevée pour la classe 5. Les autres signes
diagnostiques comme la présence d’une restriction de la diffusion, d’un
signal intermédiaire en T2 ou la présence de fer, sont très spécifiques et
peuvent être utilisés dans les cas difficiles où les critères classiques sont
insuffisants.
Comparativement aux critères de Barcelone et aux critères de l’AASLD,
les critères «Primovist» (prise de contraste au TA, comportement
variable au TP et hyposignal à la phase hépatobiliaire) sont plus
sensibles mais moins spécifiques pour le diagnostic de CHC.
Une étude a comparé les performances de l’échographie de contraste,
du scanner et de l’IRM avec injection de gadolinium BOPTA pour la
détection du CHC. Les performances des 3 techniques sont similaires
mais on retrouve plus de nodules typiques en IRM.
son utilité pour l’exploration de la pathologie nerveuse.
En imagerie en coupe, de nombreuses nouveautés techniques
concernaient la réduction des artefacts métalliques. En TDM, l’équipe de
Vardhanabhuti montre que le nouveau modèle de reconstruction
itérative MBIR (model based iterative reconstruction) permet une
diminution des artefacts plus importante que les techniques classiques
ASIR de reconstruction basé sur une modélisation du bruit tout en
diminuant encore la dose.
En IRM l’équipe de Yoon a comparé les séquences SEMAC (slice
encoding for metal artefact) à des séquences FSE classiques sur rachis
opéré en IRM 3T. Il montre une diminution significative de la taille des
artefacts et une amélioration de la visualisation du sac dural.
L’élastographie par onde de cisaillement très présente dans l’ensemble
des disciplines (sein, ORL, prostate…) est toujours en retrait dans le
domaine de l’imagerie musculosquelettique. Une seule étude était
présentée concernant la reproductibilité des mesures de dureté
tendineuse sur différents tendons. Elle montre des résultats décevants
avec une importante variabilité des mesures à la fois entre les différents
tendons et entre les côtés droit et gauche.
En interventionnel, on citera 2 études françaises, cocorico !! Le Dr Potet
montre sur 75 patients l’intérêt du guidage par CT fluoroscopie des
cimentoplasties pour diminuer l’incidence des embolies pulmonaires et le
Dr Huwart, sur 52 patients l’intérêt des vissages percutanée sous
guidage mixte (fluoroscopique et scanner) des fractures du toit de
l’acétabulum peu ou non déplacées.
Petit résumé « en vrac » et par région des nouveautés :
-
H
anche : Kogler montre une très nette amélioration de la sensibilité
de l’arthro-IRM de hanche (87 vs 21 %) pour la détection des lésions
cartilagineuses dans les conflits fémoro-acétabulaires en utilisant un
système de traction mécanique du membre inferieur pour distendre
l’articulation.
- Pied : L’équipe de Mariluis propose l’utilisation d’une manoeuvre de
Mulder IRM déjà décrite en échographie dynamique et consistant en un
stripping de l’avant pied pour améliorer la détection des névromes de
Morton.
- Genou/poignet : utilisation du scanner 4D dynamique sur le poignet
dans le diagnostic des instabilités du carpe ou dans le genou (Equipe de
Thawait) pour la détection des anomalies de la mobilité patellaire.
- Epaule : l’équipe de Barile montre sur 70 patients que l’injection de
PRP intra-tendineuse guidée par l’échographie et localisée dans la zone
de rupture entraîne dans 60 % des cas une diminution des douleurs et
une amélioration de la mobilité de l’épaule conjointement à la
modification des images IRM.
- Coude : Chhabra montre l’intérêt du tenseur de diffusion pour le
diagnostic des neuropathies ulnaires, montrant qu’en cas de pathologie
nerveuse avérée au coude, il existe une différence significative de FA
conjointement à la modification du signal du nerf.
Pour finir, on citera une étude amusante de Muda qui a consisté à
comparer la lecture d’une IRM de genou pour la recherche des lésions
arthrosiques sur les consoles de post traitement habituelles et sur iPad
2/iPhone 5. Elle montre une équivalence des supports pour la détection
des lésions…
Les boursiers prennent le bus du soir

1
/
5
100%