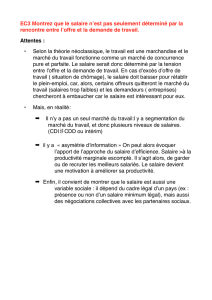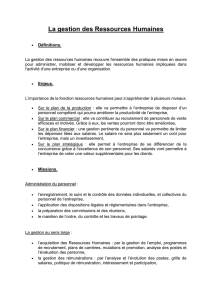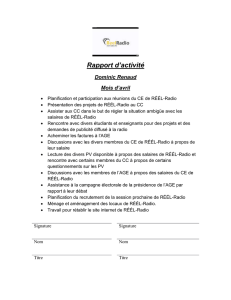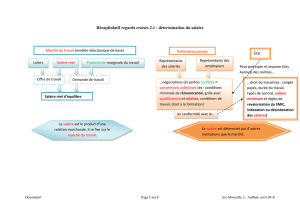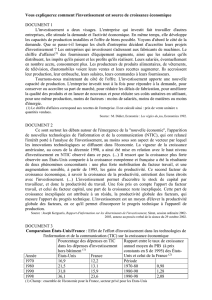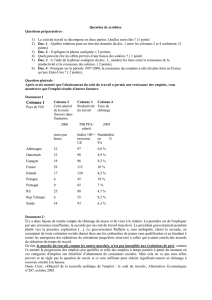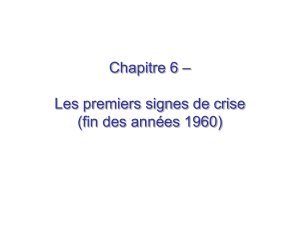SÉNAT RAPPORT N° 298

N°
298
SÉNAT
SECONDE
SESSION
ORDINAIRE
DE
1969-1970
Annexe
au
procès-verbal
de
la
séance
du
22
juin
1970
.
RAPPORT
FAIT
au
nom
de
la
Commission
des
Affaires
économiques
et
du
Plan
(
1
)
sur
le
projet
de
loi
,
ADOPTÉ
PAR
L'
ASSEMBLÉE
NATIONALE
,
portant
approbation
d'
un
rapport
sur
les
principales
options
qui
commandent
la
préparation
du
VI
"
Plan
,
Par
M.
JEAN
FILIPPI
,
Sénateur
.
(
1
)
Cette
commission
est
composée
de
:
MM
.
Jean
Bertaud
,
président
;
Paul
Mistral
,
Etienne
Restat
,
Joseph
Yvon
,
Marc
Pauzet
,
vice-présidents
;
René
Blondelle
,
Auguste
Pinton
,
Joseph
Beaujannot
,
Jean-Marie
Bouloux
,
secrétaires
;
Louis
André
,
Octave
Bajeux
,
André
Barroux
,
Aimé
Bergeal
,
Auguste
Billiemaz
,
Georges
Bonnet
,
Amédée
Bouquerel
,
Robert
Bouvard
,
Marcel
Bregegere
,
Pierre
Brousse
,
Raymond
Brun
,
Fernand
Chatelain
,
Michel
Chauty
,
Albert
Chavanac
,
Jean
Colin
,
Francisque
Collomb
,
Maurice
Coutrot
,
Georges
Dardel
,
Léon
David
,
Roger
Deblock
,
Roger
Delagnes
,
Henri
Desseigne
,
Hector
Dubois
,
Emile
Durieux
,
François
Duval
,
Jean
Errecart
,
Jean
Filippi
,
Marcel
Gargar
,
Victor
Golvan
,
Léon-Jean
Grégory
,
Paul
Guillaumot
,
Roger
du
Halgouet
,
Yves
Hamon
,
Alfred
Isautier
,
René
Jager
,
Eugène
Jamain
,
Maxime
Javelly
,
Lucien
Junillon
,
Michel
Kauffmann
,
Maurice
Lalloy
,
Robert
Laucournet
,
Robert
Laurens
,
Charles
Laurent-Thouverey
,
Marcel
Legros
,
Jean
Natali
,
Gaston
Pams
,
Guy
Pascaud
,
François
Patenôtre
,
Paul
Pelleray
,
Albert
Pen
,
Lucien
Perdereau
,
André
Picard
,
Jules Pinsard
,
Henri
Prêtre
,
Maurice
Sambron
,
Guy
Schmaus
,
Raoul
Vadepied
,
Amédée
Valeau
,
Jacques
Verneuil
,
Joseph
Voyant
,
Charles
Zwickert
.
Voir
les
numéros
:
Assemblée
Nationale
(
4
*
législ
.)
:
1184
,
1257
,
1203
,
1231
,
1236
et
in-8°
253
.
Sénat
:
297
(
1969-1970
).
Plan
.

—
3
—
SOMMAIRE
Introduction
:
Pages
.
I.
—
De
quelques
évidences
méconnues
5
II
.
—
Une
société
de
frustration
7
PREMIÈRE
PARTIE
.
—
Une
nouvelle
conception
de
la
planification
:
y
a
-
t
-
il
encore
un
;
Plan
?'
1
"
Comment
s'
exécuta
le
V
"
Plan
10
2°
Ce
que
devrait
être
le
VIe
Plan
12
3°
L'
excuse
européenne
13
4°
La
nécessité
d'
une
planification
européenne
14
DEUXIÈME
PARTIE
.
—
La
stratégie
de
la
croissance
.
I.
—
Une
condition
essentielle
:
le
progrès
des
connaissances
18
II
.
—
Les
fonctions
productives
:
A.
—
Agriculture
,
commerce
et
tourisme
19
1°
Les
problèmes
agricoles
19
2°
Le
commerce
22
3°
Le
tourisme
24
B.
—
La
politique
industrielle
24
1°
Les
hommes
26
2°
Les
investissements
27
3°
Le
progrès
technique
30
III
.
—
Le
taux
de
croissance
:
A.
—
La
croissance
à
6;5
%
32
B.
—
Le
respect
des
équilibres
36
IV
.
—
Les
obstacles
à
la
croissance
38
TROISIÈME
PARTIE
.
—
La
répartition
des
fruits
de
la
croissance
.
I.
—
Le
point
de
vue
du
Gouvernement
sur
le
,
partage
des
revenus
44
1°
La
répartition
entre
consommation
et
investissements
...
44
2°
Revenus
directs
et
revenus
indirects
44
3°
Les
équipements
collectifs
45
4°
Le
logement
46

—
4
—
Pages
.
n
.
—
La
constatation
de
certaines
évidences
et
les
«
recommanda
tions
»
de
la
Commission
:
1°
La
pression
fiscale
et
parafiscale
46
2°
Le
logement
49
3°
Les
équipements
collectifs
49
4°
L'
emploi
et la
durée
du
travail
51
5°
Les
transferts
sociaux
52
6°
Les
dépenses
de
solidarité
54
QUATRIÈME
PARTIE
.
—
L'
aménagement
du
territoire
et
la
politique
régionale
.
A.
—
Les
principes
généraux
d'
action
:
1°
Le
développement
urbain
58
2°
L'
industrialisation
des
régions
insuffisamment
dévelop
pées
59
3°
La
rénovation
rurale
60
4°
La
politique
de
l'
environnement
et
de
la
protection
de
la
nature
61
5°
Les
infrastructures
de
transport
62
B.
—
Les
actions
nouvelles
65
Conclusion
69
Amendement
72
ANNEXES
ANNEXE
I.
—
Les
auditions
de
la
commission
77
ANNEXE
II
.
—
Les
travaux
de
la
commission
99
ANNEXE
III
.
—
Analyse
de
l'
avis
du
Conseil
économique
...
101
ANNEXE
IV
.
—
Principales
modifications
apportées
par
le
Gouvernement
. .
.
107
ANNEXE
V.
—
Le
débat
à
l'
Assemblée
Nationale
111
ANNEXE
VI
.
—
La
lettre
rectificative
du
Gouvernement
121
ANNEXE
VII
.
—
Documents
chiffrés
125
ANNEXE
VIII
.
—
L'
exécution
du
Ve
Plan
135
ANNEXE
IX
.
—
La
politique
industrielle
,
thème
majeur
du
VI
E
Plan
141
ANNEXE
X.
—
Le
marché
financier
145
ANNEXE
XI
.
—
Le
mémorandum
de
la
Communauté
économique
européenne
.
149

—
5
—
INTRODUCTION
(
1
)
Un
plan
ne
peut
être
isolé
ni
dans
sa
conception
,
ni
dans
son
exécution
,
du
contexte
économique
et
social
de
son
époque
.
Or
,
depuis
la
fin
de
la
seconde
guerre
mondiale
,
la
France
,
le
monde
occidental
et
l'
ensemble
des
pays
industrialisés
ont
connu
une
croissance
rapide
et
continue
;
le
niveau
de
vie
a
doublé
et
,
en
ces
vingt-cinq
ans
,
on
a
construit
autant
de
logements
que
pendant
les
soixante-dix
années
précédentes
.
Ce
phénomène
,
nouveau
dans
l'
histoire
économique
du
monde
,
n'
a
pas
toujours
été
compris
ni
maîtrisé
.
Il
paraît
donc
nécessaire
à
votre
rapporteur
de
tenter
de
l'
analyser
et
de
décrire
sommaire
ment
le
type
de
société
auquel
ces
progrès
ont
donné
naissance
.
I.
—
DE
QUELQUES
ÉVIDENCES
MÉCONNUES
1
.
Le
rythme
de
la
croissance
économique
n'
est
pas
dû
aux
régimes
politiques
,
et
nous
n'
en
voulons
pour
preuve
que
le
fait
que
l'
Allemagne
de
l'
Est
a
augmenté
son
activité
de
façon
aussi
spectaculaire
que
l'
Allemagne
de
l'
Ouest
;
il
est
fils
du
développe
ment
et
de
la
diffusion
des
connaissances
,
des
progrès
de
production
et
de
productivité
qui
en
découlent
,
d'
améliorations
aussi
dans
l'
organisation
du
travail
et
dans
celle
du
«
management
».
Mais
la
continuité
de
cette
croissance
,
la
disparition
des
crises
cycliques
qui
ont
si
durement
marqué
le
xix
e
siècle
et
le
début
du
nôtre
doivent
être
également
notées
;
celles-ci
sont
dues
au
fait
que
l'
État
dispose
d'
armes
nouvelles
.
L'
importance
des
dépenses
publiques
—
les
charges
fiscales
et
parafiscales
représentent
en
France
,
et
le
chiffre
est
analogue
dans
les
pays
occidentaux
,
40
%
du
produit
intérieur
brut
(
contre
13,5
%
en
1912
)
—
donne
une
grande
efficacité
à
la
politique
budgétaire
conjoncturelle
.
Une
politique
du
crédit
rendue
plus
rigoureuse
par
l'
encadrement
des
encours
bancaires
et
le
système
des
réserves
obligatoires
,
s'
ajoutant
au
maniement
traditionnel
du
taux
d'
escompte
,
vient
étayer
l'
action
des
finances
publiques
.
(
1
)
Par
souci
de
rendre
ce
rapport
aussi
concis
que
possible
,
nous
avons
renvoyé
en
Annexes
un
certain
nombre
d'
éléments
,
qui
en
illustrent
les
principales
parties
.

—
8
—
Par
d
autres
méthodes
,
certains
pays
de
l'
Est
arrivât
<
A
résultats
du
même
ordre
;
voici
donc
un
monde
où
nous
ni
plus
comme
maladie
de
la
croissance
économique
que
des
p
S
de
moindre
développement
ou
,
au
pire
,
de
«
mini-récession
comme
celle
que
connaissent
actuellement
les
Etats
-
Unis
Le
rythme
d'
expansion
est
différent
selon
les
années
et
selon
les
pays
et
le
Japon
est
en
tête
des
nations
industrielles
avec
une
moyenne
de
10
à
12
%
;
il
est
différent
aussi
selon
les
secteurs
économiques
,
mais
si
l'
agriculture
s'
essouffle
,
c'
est
en
vertu
d'
un
*
vente
arithmétique
qui
s'
impose
en
raison
de
la
faible
élasticité
de
la
consommation
de
ses
produits
.
Sur
le
plan
national
,
seule
la
démographie
lui
permet
de
se
développer
et
ses
débouchés
exté
rieurs
eux-mêmes
manquent
d'
élasticité
.
Elle
ne
peut
donc
avoir
le
même
potentiel
de
croissance
que
l'
industrie
ou
les
services
.
Le
progrès
et
le
développement
économiques
impliquent
donc
sans
ambiguïté
que
la
part
de
l'
industrie
et
celle
des
services
dans
la
P.
I.
B.
grandissent
,
tandis
que
celle de
l'
agriculture
décroît
.
2
.
L'
expansion
continue
a
pour
corollaire
,
il
est
juste
de
le
constater
,
une
hausse
généralement
modérée
mais
permanente
des
prix
.
Ce
phénomène
d'
inflation
rampante
est
mondial
(
1
),
et
l'
objectif
d'
un
Gouvernement
est
de
limiter
la
cadence
de
la
hausse
des
prix
,
tout
en
accélérant
celle
du
développement
de
la
produc
tion
.
Si
nous
retenons
,
à
titre
d'
exemple
,
la
période
1948-1966
,
qui
nous
fournit
les
statistiques
les
plus
utilisables
,
«
la
lanterne
rouge
»
revient
à
l'
Angleterre
,
dont
les
prix
ont
augmenté
de
94
%
et
la
production
industrielle
de
82
%
seulement
,
suivie
par
la
France
,
avec
une
hausse
des
prix
de
177
%
contre
190
%
pour
la
production
industrielle
;
mais
le
prix
d'
excellence
revient
au
Japon
,
pays
où
les
prix
ont
augmenté
de
144
%
et
où
la
production
industrielle
s'
est
accrue
de
814
%
.
Certes
,
dans
cette
comparaison
,
il
faut
tenir
compte
de
la
période
de
reconstruction
,
au
lendemain
de
la
guerre
,
et
nous
ne
voulons
pas
tirer
de
ces
chiffres
la
conclusion
qu'
il
faut
favoriser
l'
inflation
inflation
pour
assurer
le
développement
économique
;
contentons
-
nous
de
dire
que
la
formule
utilisée
par
la
V
e
République
,
après
la
IV
*,
de
«
l'
expansion
dans
la
stabilité
»
nous
paraît
mythe
.
,
u
cf
Annexe
VII
>
c
p
.
130
)
:
observation
relative
à
la
dépréciation
monétaire
dans
les
grands
pays
industriels
.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
1
/
140
100%