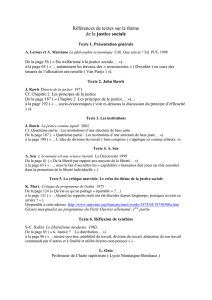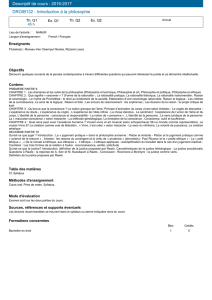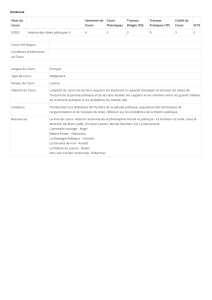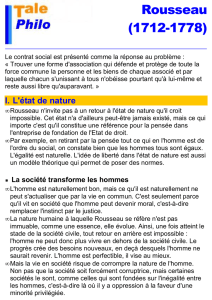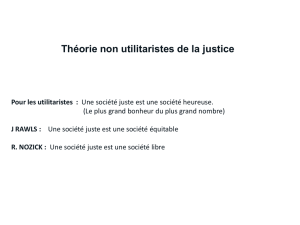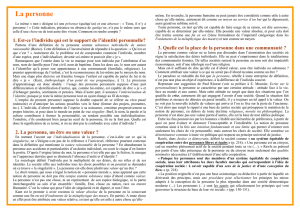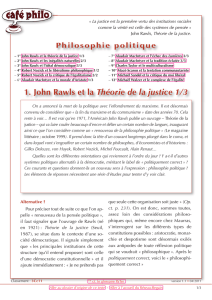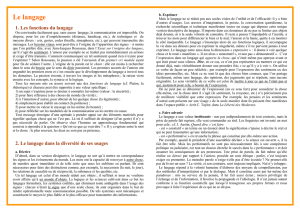Damien Clerget

° • •
UNE RELECTURE DE LA MODERNITÉ POLITIQUE
Damien Clerget
«QSPQPTEF-F1SJODJQFEµPCMJHBUJPOEF#SVOP#FSOBSEJ1BSJT7SJO&)&44
Les sociétés démocratiques portent en elles le principe de leur
dissolution. Ce jugement de Tocqueville n’a pas valeur de prophétie,
mais il prend la mesure d’un risque persistant. Nos sociétés sauront-
elles éviter que leur tendance naturelle à l’individualisme ne tourne un
jour en suicide programmé ? Comment prévenir la lente dissolution
du social sous la poussée des égoïsmes ? Bruno Bernardi partage
tout à la fois l’inquiétude de Tocqueville et son désir de chercher des
solutions ailleurs que dans un pur et simple retour à l’Ancien. C’est
dans la modernité elle-même qu’il convient de trouver, s’il y en a,
les ressources pour échapper aux dangers de sa maturité. Une telle
ambition ne se nourrit pas seulement de la conviction que tout regressus
serait impossible. Plus radicalement, elle se fonde sur le constat que
la modernité politique, dans l’élaboration philosophique qu’elle s’est
donnée d’elle-même, n’a pas eu d’autre préoccupation que celle-là.
Loin d’avoir ignoré le problème, les penseurs de la modernité n’ont
eu en effet de cesse d’y revenir et de s’y confronter. Mieux encore : ce
problème pourrait être assumé comme le noyau conceptuel autour
duquel toute la modernité gravite.
µIZQPUIoTFEF3PVTTFBV
Bruno Bernardi tire ici profit d’un petit texte très suggestif, issu de
la sixième des Lettres écrites de la montagne, où Rousseau s’efforce de
clarifier la position qu’il tient dans le champ de la philosophie politique :
« Qu’est-ce qui fait que l’État est un ? C’est l’union de ses membres.
Et d’où naît l’union de ses membres ? De l’obligation qui les lie. Tout
%BNJFO$MFSHFUFTUQSPGFTTFVSBHSnHnEFQIJMPTPQIJFBVMZDnF%FTDBSUFT5PVST

est d’accord jusqu’ici. Mais quel est le fondement de cette obligation ?
Voilà où les auteurs se divisent ». Le principe d’obligation serait donc
le fil d’Ariane qu’il conviendrait de suivre afin de saisir correctement
la thématique commune de la modernité politique, ainsi que la
source de ses divergences. Si tout ordre politique doit être conçu sous
l’horizon d’une liberté des volontés individuelles, comment penser
l’obligation qui doit assujettir ces volontés à un ordre commun ? « Les
présuppositions retenues, écrit Bernardi, ne laissent que deux voies pour
fonder l’obligation : soit l’assujettissement à une volonté supérieure,
soit la convention de volontés se liant les unes aux autres. Le principe
commun qui les unit se trouve donc, d’un autre point de vue, la source
de l’opposition des diverses pensées politiques ». C’est donc à éprouver
l’hypothèse de Rousseau dans un projet de clarification conceptuelle de
la modernité que s’efforce l’auteur.
Sans nous prononcer encore sur le succès de l’entreprise, reconnaissons
tout ce qui en fait déjà l’originalité. Transformer un point d’ombre de
la modernité (la difficulté de penser l’obligation) en vecteur interne de
sa cohérence, est une proposition qui ne manque pas de charme. Le
principe d’obligation ne serait donc plus l’écueil où la modernité vient
achopper. Il serait littéralement le foyer où la modernité se constitue :
« Si l’obligation est bien le problème de la modernité, ce n’est donc
pas comme un problème qui se pose à elle, comme la marque de son
inconsistance, mais comme le problème qu’elle se pose elle-même et qui
lui donne consistance » (p. ). C’est qu’il y a en effet bien des manières
de concevoir la modernité politique, selon qu’on privilégie l’émergence
du principe de Souveraineté, l’autonomisation de l’ordre politique
par rapport à l’ordre religieux, la reconnaissance à l’individu de droits
subjectifs, la distinction de la société civile d’avec la société politique...
Quoi de commun entre ces différents aspects ? Il semble bien difficile
de qualifier de moderne tout à la fois l’affirmation d’un pouvoir d’État
émancipé des lois et la limitation de ce pouvoir au profit d’individus
libres. L’interprétation libérale de la modernité est naturellement
conduite à négliger intentionnellement cette autre forme institutionnelle
de la modernité politique que constitue la théorie de la Souveraineté.
L’apparente contradiction se dissipe rapidement, dès qu’on choisit
d’intégrer ces deux aspects au problème du fondement de l’obligation
: la théorie contractualiste s’efforce de fonder l’obligation passive sur
l’obligation active (« je suis obligé parce que je me suis d’abord obligé »),
tandis que la théorie de la Souveraineté tâche au contraire de fonder
l’obligation active sur l’obligation passive (« je m’oblige parce que j’y suis
obligé »). Dans les deux cas, comme on voit, l’obligation est posée.

6OFSFMFDUVSFEFMBNPEFSOJUnQPMJUJRVF
µnDVFJMEFMBNPEFSOJUnTµPCMJHFSPVpUSFPCMJHn
Et avec l’obligation, c’est la volonté qui fait aussi son entrée en
politique : « L’obligation devant être entendue comme ce par quoi une
volonté est liée, une seconde présupposition serait également commune
à la modernité politique : la représentation de l’individu comme
volonté » (p. ). En dépit du fait que le privilège du Souverain semble
faire peu de cas des volontés individuelles, il n’en repose pas moins déjà
sur un pouvoir d’obliger qui admet en principe la liberté des sujets. La
singularité du pouvoir d’État c’est la manière radicalement neuve de
penser l’obéissance en terme d’obligation. C’est chez Bodin, auquel est
consacrée la première étude de l’ouvrage, que se perçoit l’émergence
de cette nouvelle façon de voir. Elle prend l’allure d’une thèse par
laquelle le souverain se trouve justifié au nom même de la volonté libre
des sujets. Seule, en effet, une volonté est à même d’obliger une autre
volonté. Il n’y aura donc d’obligation qu’à l’intérieur d’un rapport de
volonté à volonté.
On constate que la grille de lecture proposée par Rousseau et
revendiquée par l’auteur se révèle particulièrement féconde. Elle
permet notamment de restituer des continuités, là où on serait tenté
de ne voir que rupture et changement d’horizon. Car c’est bien dans
la comparaison avec Bodin qu’il faut encore penser le jusnaturalisme et
ses difficultés. Ici, le problème de l’obligation revêt l’allure particulière
d’un conflit des facultés : alors que pour Grotius l’obligation naturelle
est d’abord obligation envers soi-même dans l’obéissance à la raison,
Pufendorf n’admet au contraire qu’une soumission de la volonté au
pouvoir contraignant de la volonté. « Le jusnaturalisme semble ainsi
pris dans un étau : soit il fonde l’obligation naturelle sur la raison et
se trouve former un concept de l’obligation morale dont il a le plus
grand mal à tirer l’obligation politique, soit il pense l’obligation comme
sujétion d’une volonté à une autre et vide de contenu moral la relation
d’obligation ». La théorie du droit naturel sanctionne l’échec de toute
tentative entreprise en vue de donner à l’obligation politique une
origine naturelle.
Tout ce cheminement – faut-il s’en étonner ? – prépare l’apothéose
de la théorie rousseauiste. C’est à l’auteur du Contrat social que
revient en effet le mérite d’avoir pensé une manière d’être obligé qui
préserve intacte la possibilité de s’obliger soi-même. Bruno Bernardi
appuie son interprétation sur une lecture minutieuse qui force
l’adhésion.

%VQSPCMoNFhMBTPMVUJPOEF3PVTTFBVh3PVTTFBV
Il n’en demeure pas moins que la perspective qui conduit à ce triomphe
de la pensée rousseauiste rendait assuré un tel dénouement. Après tout,
l’impressionnant parcours argumentatif qui vise à valider l’hypothèse de
Rousseau empreinte des voies et passe par des jalons qui présupposaient
déjà une certaine forme d’adhésion. Comment justifier en effet le
choix des auteurs que cette étude a retenus ? On y trouve Bodin, mais
pas Machiavel ; on y trouve Grotius et Pufendorf, mais ni Hobbes ni
Locke ; Barbeyrac et Burlamaqui, mais pas Montesquieu. En somme,
on y trouve les protagonistes que Rousseau lui-même s’était donné
ou aurait pu se donner. En lecteur scrupuleux de Rousseau, Bernardi
s’est efforcé d’identifier précisément tous ceux à qui Rousseau faisait
implicitement référence. Ainsi a-t-il été conduit, dans la logique des
travaux entrepris par R. Dérathé, à identifier les sources de la pensée
rousseauiste, celles à partir desquelles cette pensée se déploie et se
justifie. Dans la lignée des auteurs dont se revendique Rousseau lui-
même cohabitent Sidney, Althusius, Locke, Montesquieu, l’abbé de
Saint-Pierre. Aucun de ceux-là ne figurent dans l’enquête. C’est que
Bernardi a préféré voir dans ce catalogue hétéroclite un repoussoir
commun : « aucun n’est à proprement parler un théoricien du droit
naturel ». C’est donc contre le droit naturel et en faveur du droit positif
que, à l’intérieur de la tradition contractualiste, Rousseau semble avoir
choisi ses alliés. Cette interprétation est tout à fait convaincante, et elle
conduit naturellement à faire une place importante à ceux que Rousseau
nomme les « jurisconsultes ».
Ce choix de respecter une classification « rousseauiste » des auteurs n’en
conduit pas moins à un certain parti pris. En respectant scrupuleusement
cette sélection, Bernardi n’a pas eu de peine à montrer que la modernité
politique se pliait effectivement au jugement de Rousseau. Mais c’est au
prix d’une minimisation excessive des différences qui séparent la pensée
de Rousseau de celle de Locke, ou de Montesquieu. Sur l’essentiel, écrit
Bernardi, ces penseurs se rejoignent : la convention, et la convention
seule, est le fondement de l’obligation. Or, justement, il n’est pas du tout
certain que cette thèse constitue une « prémisse » essentielle de la pensée
politique de Locke. Non que Locke n’ait effectivement soutenu cela...
mais on peut douter que la théorie de la convention (comme le problème
du fondement de l’obligation) constitue une aussi bonne voie d’accès
à la philosophie lockienne qu’à la philosophie de Rousseau. Bernardi
admet humblement que la différence entre les deux auteurs est sans
doute plus importante qu’il ne veut bien le dire ; mais, écrit-il, « notre

6OFSFMFDUVSFEFMBNPEFSOJUnQPMJUJRVF
but étant ici seulement de dresser l’arbre généalogique de la modernité
politique selon Rousseau, il ne saurait être question d’aller plus avant
dans l’examen de la relation de Rousseau à Locke ». La justification est
curieuse, car elle revient à assumer ouvertement la partialité du point
de vue sur la modernité au nom d’une fidélité maintenue à la pensée
de Rousseau.
Il serait sans doute légitime de se demander en quel sens cette généalogie
fonde l’hypothèse de Rousseau : lui donne-t-elle raison, comme le
prétend l’auteur ? Ou n’en rend-elle pas plutôt raison ? N’est-ce pas
parce qu’il s’est montré fin connaisseur de la tradition jusnaturaliste, et
qu’il a su porter remède à ses impasses théoriques que Rousseau a été
conduit à placer le problème du fondement de l’obligation au cœur
même du projet moderne ? Ce soupçon n’ôte rien à l’intérêt de l’ouvrage.
Bruno Bernardi s’est livré à une enquête passionnante et rigoureusement
attentive au détail des textes. Il a su sortir de l’ombre, avec une grande
pénétration, des auteurs rarement lus et rarement compris. Du point
de vue de la compréhension de Rousseau lui-même, sa contribution est
significative. Mais il n’est pas certain qu’elle suffise à renouveler notre
approche de la modernité politique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%