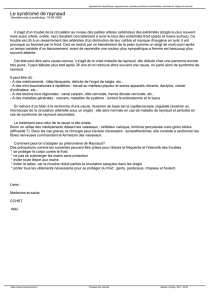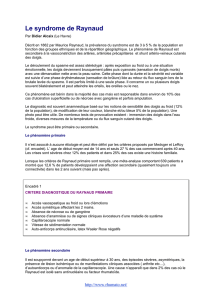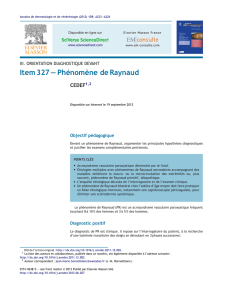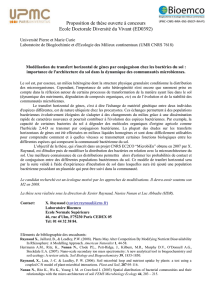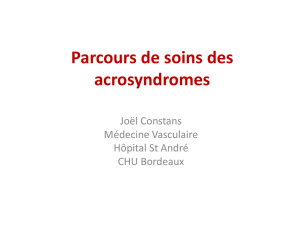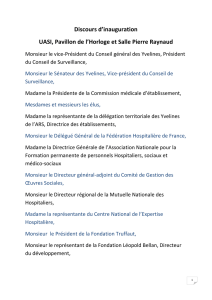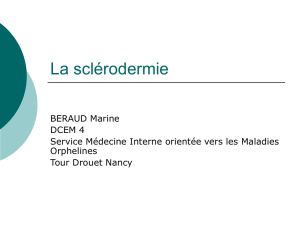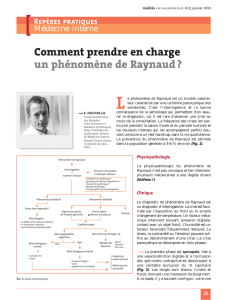Le phénomène

4815
Le phénomène
de Raynaud...
toujours
présent
Pierre Sintes*
Toujours diagnostiqué à l’in-
terrogatoire, un phénomène
de Raynaud mérite un examen
clinique complet qui sera suivi,
dans tous les cas, d’une capil-
laroscopie, surtout s’il s’agit
d’un Raynaud bilatéral et symé-
trique. La capillaroscopie orien-
tera la suite des explorations
complémentaires à la recherche
d’une cause générale et notam-
ment d’une collagénose. En
revanche, en cas de forme uni-
latérale, l’écho-doppler est
indispensable pour éliminer une
lésion artérielle emboligène. Il
pourra être complété par un
EMG en cas de paresthésies
systématisées. Au total, un exa-
men clinique bien conduit et un
bilan paraclinique simplifié éli-
minent, dans la majorité des
cas, une forme secondaire. Si
les règles hygiéno-diététiques
sont toujours préconisées, les
médicaments sont, en revanche,
réservés aux formes sévères mais
avec un résultat inconstant.
Décrit en 1862 par Maurice Raynaud
l’acrosyndrome qui porte son nom
garde tout son intérêt à l’aube du XXIe
siècle du fait de sa grande fréquence et
de la multiplicité des étiologies pos-
sibles. En effet, il peut être le témoin
d’une simple hypersensibilité au froid,
le plus souvent familiale, ou bien au
contraire s’associer à d’autres symp-
tômes dans le cadre d’une maladie sys-
témique au pronostic sévère. Son dia-
gnostic reste toujours clinique et le plus
souvent une capillaroscopie est néces-
saire pour orienter les autres examens
complémentaires à la recherche d’une
cause dans les phénomènes de Raynaud
secondaires. De plus, sa physiopatholo-
gie garde encore une part de mystère.
Epidémiologie
En France, le phénomène de Raynaud a
une prévalence de l’ordre de 4 %, avec
des variations selon les régions et le sexe.
Il touche surtout la femme, chez laquelle
la fréquence varie de 3 à 6 %.
On distingue les formes primitives des
formes secondaires. Le phénomène de
Raynaud idiopathique ou “maladie de
Raynaud” est le plus répandu dans la
population générale. Il s’agit d’un trou-
ble fonctionnel, parfois gênant, mais
d’évolution toujours bénigne. En revan-
che, les Raynaud secondaires s’intègrent
dans des affections loco-régionales ou
générales, ces dernières étant le plus sou-
vent des collagénoses au pronostic sévè-
re et au premier rang desquelles figure la
sclérodermie généralisée. Dans une
consultation hospitalière spécialisée, au
recrutement biaisé, les Raynaud secon-
daires sont les plus fréquents, mais cela
ne semble pas être le reflet de la réalité
dans la population générale.
Diagnostic clinique
Le diagnostic d’un phénomène de
Raynaud se fait toujours à l’interroga-
toire. Parfois, les patients sont exami-
nés au moment de la crise vasomotrice
et le diagnostic est alors évident. Plus
souvent, le patient se plaint d’avoir les
“doigts morts” à l’exposition au froid
durant dix à vingt minutes. A cette
phase syncopale peuvent succéder une
phase cyanique puis une phase hyper-
hémique plus ou moins douloureuses.
En réalité, la simple notion de décolo-
ration des doigts survenant de façon
paroxystique au froid ou lors d’une
émotion doit faire évoquer le diagnostic
de phénomène de Raynaud. En dehors
des crises, les doigts ont en général une
coloration normale. Il est parfois utile
de recourir à des photographies pour
aider les patients à décrire leur trouble
vasomoteur.
Il s’agit d’un acrosyndrome paroxys-
tique à différencier des autres acrosyn-
dromes vasculaires permanents telle
l’acrocyanose, fréquemment répandue
chez les jeunes femmes, qui ont, dans
ce cas, les mains rouges, moites et
froides en permanence, avec au
moment de l’exposition au froid une
majoration des symptômes, voire un
Raynaud sur un ou plusieurs doigts.
A l’issue de cet interrogatoire, le dia-
gnostic de Raynaud est porté et l’en-
quête étiologique doit commencer dès
l’examen clinique.
Bilan orienté d’un phénomène
de Raynaud
La multiplicité des causes possibles et
la gravité de certaines d’entre elles
imposent un bilan étiologique mini-
mum. Celui-ci sera orienté en fonction
de certains critères comme le sexe,
l’âge, la profession du patient, la date
d’apparition des premières crises et sur-
tout l’uni- ou la bilatéralité du phéno-
mène de Raynaud. C’est donc dès
* G.R.A.C.I.A., Hôpital Broussais, Paris.
Angio fév. 98 22/04/04 12:19 Page 4815

4816
Act. Méd. Int. - Angiologie (14) n° 240, Février 1998
l’interrogatoire et au cours de l’examen
clinique que la recherche étiologique
débute ; les examens complémentaires,
comme la capillaroscopie ou l’écho-
doppler, ne sont que le prolongement
de la clinique.
Raynaud bilatéral
Les principales causes sont le phéno-
mène de Raynaud idiopathique (ou
maladie de Raynaud) et les collagé-
noses, au premier rang desquelles figure
la sclérodermie généralisée.
- L’interrogatoire recherchera en priori-
té des arthralgies diffuses, des myal-
gies, des troubles digestifs et notam-
ment un pyrosis. Une dyspnée d’effort
évoquera une fibrose alvéolaire débu-
tante. Un syndrome de Gougerot-
Sjögren sera suspecté devant une séche-
resse buccale et oculaire.
Il faudra également s’enquérir des trai-
tements suivis et en particulier recher-
cher la prise de bêtabloquants, même en
collyre, pouvant être à l’origine de
l’acrosyndrome ou de la majoration
d’un Raynaud préexistant.
- L’examen clinique apportera une
attention toute particulière à l’aspect
des doigts et de la peau : doigts boudi-
nés, infiltrés, sclérodactylie, cicatrices
de nécrose pulpaire, présence de télan-
giectasies en pleine peau ou mégacapil-
laires visibles à l’œil nu au rebord
unguéal.
A l’issue de cet examen clinique, la
démarche étiologique est déjà bien
avancée et certains examens complé-
mentaires doivent être envisagés en
fonction de la cause recherchée.
Cependant, un examen doit toujours
être pratiqué en cas de phénomène de
Raynaud bilatéral : il s’agit de la capil-
laroscopie au lit unguéal des doigts.
- La capillaroscopie est l’examen com-
plémentaire à réaliser systématique-
ment car elle est rarement normale dans
les formes secondaires. Véritable pro-
longement de l’examen clinique dans le
cadre d’une consultation angiologique,
il s’agit d’un examen simple, non inva-
sif, fiable et peu coûteux.
La capillaroscopie visualise les capil-
laires au lit unguéal et permet de les
quantifier et d’étudier leurs anomalies
morphologiques (dystrophies mineures
et mégacapillaires). On recherche éga-
lement les anomalies des espaces péri-
capillaires (œdème, hémorragies) et de
l’écoulement sanguin (sludge). A partir
de ces différents critères, il est possible
de distinguer un Raynaud idiopathique
d’une microangiopathie organique (1).
De plus, la présence de mégacapillaires
est spécifique d’une sclérodermie
généralisée ou d’un syndrome de Sharp
ou encore d’une dermatomyosite.
L’aspect capillaroscopique peut aussi
être le témoin d’une microangiopathie
organique non spécifique faisant alors
suspecter un lupus systémique, un syn-
drome de Gougerot-Sjögren, une PAN
ou une polyarthrite.
La capillaroscopie permet donc de
poursuivre et d’orienter la recherche
étiologique.
Ainsi, devant une capillaroscopie nor-
male et une clinique évocatrice d’un
Raynaud idiopathique, il n’est pas
nécessaire de pousser plus loin les
investigations. En revanche, une capil-
laroscopie anormale doit faire pratiquer
un bilan biologique minimum (2) com-
prenant : NFS, plaquettes, cryoglobuli-
némie, facteurs antinucléaires. Si une
sclérodermie généralisée est suspectée,
la recherche de localisations viscérales
s’impose : radio pulmonaire et des
mains recherchant respectivement une
fibrose alvéolaire et une calcinose
sous-cutanée. Un syndrome sec sera
éliminé par un test de Shirmer et une
biopsie des glandes salivaires acces-
soires. Le bilan immunologique (3) est
complété avec le dosage des autoanti-
corps anticentromères, anti-Scl 70 et
antinucléolaires.
Raynaud unilatéral
Il témoigne le plus souvent d’une cause
loco-régionale soit vasculaire soit neu-
rologique. La capillaroscopie est dans
ce cas peu contributive, et les examens
complémentaires à privilégier sont
donc l’écho-doppler et l’électromyo-
gramme.
- L’examen clinique recherche l’aboli-
tion d’un pouls, un souffle artériel. Il
doit être complété par les manœuvres
dynamiques à la recherche d’un syndro-
me de la traversée thoraco-brachiale. Le
test d’Allen (5) est une manœuvre
clinique très contributive en cas d’oc-
clusion artérielle.
La recherche d’une compression ner-
veuse est systématique au niveau du
canal carpien, du coude et du défilé
cervico-thoracique.
- L’écho-doppler explore tout l’axe
artériel, depuis la sous-clavière jus-
qu’aux flux pulpaires, à la recherche
d’une lésion artérielle source d’embo-
lies distales (sténose ou anévrysme) ou
d’une obstruction artérielle. Chez un
travailleur manuel utilisant des engins
vibrants (6) ou chez certains sportifs
(karaté, badminton, volley) (7), il faut
éliminer un anévrysme cubital dû aux
traumatismes répétés de la paume de la
main. Il faut également pratiquer un
doppler dynamique avec manœuvres
d’abduction-rétropulsion des bras,
manœuvres d’Adson et de Wright, dont
la positivité est en faveur d’un syndrome
de la traversée throraco-brachiale. En
fonction des résultats de cet écho-dop-
pler, une artériographie sera pratiquée
en prévision d’une intervention chirur-
gicale (résection d’un anévrysme ou
traitement d’une pince costo-claviculai-
re).
- L’EMG est indiqué en cas de paresthé-
sies du membre supérieur, celles-ci
pouvant siéger dans le territoire du
médian, du cubital ou du radial et
témoignant alors d’une compression
Angio fév. 98 22/04/04 12:19 Page 4816

4817
localisée. Elles peuvent s’associer à un
phénomène de Raynaud, mais celui-ci
est toujours incomplet et limité à
quelques doigts.
Au terme de l’examen clinique et du
bilan paraclinique, il est possible de
distinguer :
- les véritables phénomènes de
Raynaud, répartis en forme idiopa-
thique et formes secondaires ;
- les phénomènes de Raynaud majorés
par un processus pathologique intercur-
rent (médicamenteux, hématologique) ;
- les associations fortuites entre un
Raynaud ancien et une pathologie géné-
rale ne modifiant pas le trouble vaso-
moteur.
Traitement
En cas de Raynaud secondaire, le traite-
ment est bien sûr celui de la cause mais,
même lorsque cela est possible, le
trouble vasomoteur peut persister
ensuite.
Dans tous les cas, la prise en charge
thérapeutique reposera sur des conseils
hygiéno-diététiques : protection contre
le froid, arrêt du tabac. Il faut avertir
ces patients que certains médicaments
leur sont contre-indiqués (dérivés de
l’ergot de seigle, bêtabloquants, sympa-
thomimétiques). De même, il faut être
très prudent en cas de chirurgie podolo-
gique, car il y a un risque de complica-
tions postopératoires (algies, retard de
cicatrisation, algoneurodystrophies).
Le recours à un traitement médicamen-
teux est proposé en cas de gêne fonc-
tionnelle importante ayant une répercus-
sion sur les activités professionnelles ou
quotidiennes du patient. Mais ce traite-
ment est souvent décevant.
En cas de Raynaud idiopathique, il faut
avant tout rassurer le patient et lui
expliquer le caractère bénin de sa mala-
die et l’absence de complication à long
terme.
Les vaso-actifs sont bien tolérés mais
leur effet reste le plus souvent modéré
et parfois transitoire. Ils méritent
cependant d’être essayés en première
intention.
Les sympatholytiques, et en particulier
la prazosine, qui est un inhibiteur des
récepteurs alpha-1 post-synaptiques,
peuvent être employés, mais avec pru-
dence en raison de leur risque d’hypo-
tension orthostatique.
Les inhibiteurs calciques (8) sont les
plus efficaces pour diminuer la fré-
quence et l’intensité des crises.
Cependant, leurs effets secondaires
sont nombreux et gênants (flush du
visage, céphalées, œdèmes des
membres inférieurs, hypotension). De
plus, ils sont contre-indiqués en cas de
BAV et doivent être prescrits chez les
jeunes femmes sous couvert d’une
contraception. Ils doivent donc être
réservés aux formes sévères.
La trinitrine par voie percutanée donne
des résultats satisfaisants mais sa tolé-
rance générale est souvent médiocre.
Conclusion
De diagnostic clinique, le phénomène
de Raynaud nécessite toujours un bilan
étiologique minimum. Celui-ci com-
prend un examen clinique complet et
presque toujours une capillaroscopie,
qui permettra d’orienter les autres exa-
mens complémentaires. En cas de
Raynaud bilatéral et symétrique, une
capillaroscopie et un bilan biologique
minimum sont nécessaires car il peut
s’agir d’une collagénose (sclérodermie
généralisée), même si le Raynaud idio-
pathique est le plus fréquent. Une
forme unilatérale et incomplète évoque
plutôt une cause artérielle loco-régionale
nécessitant la pratique d’un écho-
doppler à la recherche d’une obstruc-
tion artérielle ou d’un anévrysme.
En dehors d’un traitement étiologique
peu fréquent, les mesures thérapeu-
tiques reposent sur une protection
rigoureuse contre le froid et la prescrip-
tion d’un vaso-actif ou d’un inhibiteur
calcique en cas de gêne fonctionnelle
importante.
Bibliographie
1- Vayssairat M., Priollet P. : Atlas pratique
de capillaroscopie. Ed. de la Revue de
Médecine, Paris, 1983.
2- Priollet P., Yeni P., Vayssairat M., Segond
P., Tallou F., Housset E. : Bilan étiologique
minimum des phénomènes de Raynaud. Cent
deux cas. Presse Méd., 1985, 14 : 1999-2003.
3- Kallenberg C.G.M., Pastoor G.W., Wouda
A.A. : Antinuclear antibodies in patients with
Raynaud’s phenomenon : clinical significan-
ce of anticentromere antibodies. Ann. Rheum.
Dis., 1982, 41 : 382-387.
4- Le Quentrec P., Lefebvre M.L. : Double-
blind placebo-controlled trial of Buflomedil in
the treatment of Raynaud’s phenomenon : six
month follow-up. Angiology, 1991, 42 (4) :
289-95.
5- Pistorius M.A., Faucal (de) P., Planchon
B., Grolleau J.Y. : Intérêt du test d’Allen dans
la recherche d’une artériopathie distale au
cours du phénomène de Raynaud. Etude pros-
pective sur une série continue de 576
patients. J. Mal. Vasc., 1994, 19 : 17-21.
6- Spencer-Green G., Morgan G.J., Brown L.,
Fitzgerald O. : Hypothenar hammer syndro-
me : an occupational cause of Raynaud’s phe-
nomenon. J. Rheumatol., 1987, 14 : 1048-
1051.
7- Vayssairat M., Priollet P., Capron L.,
Hagege A., Housset E. : Does Karate injure
blood vessels of the hand. Lancet, 1984, 11 :
529.
8- Rhedda A., Mc Causs J., William A.R., Ford
P.M. : A double blind placebo controlled cross
over randomized trial of diltiazem in
Raynaud’s phenomenon. J. Rheumatol., 1985,
12 : 724-727.
Angio fév. 98 22/04/04 12:19 Page 4817
1
/
3
100%