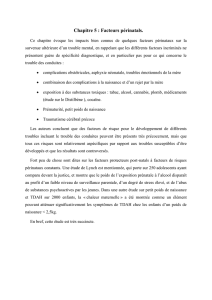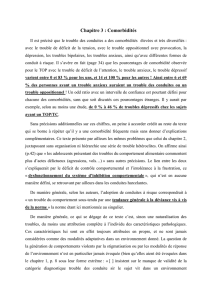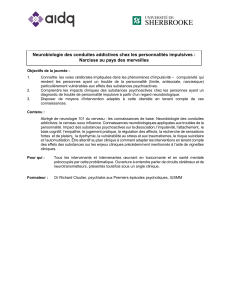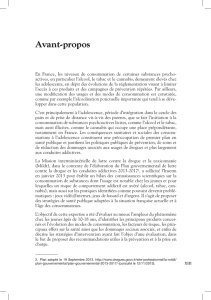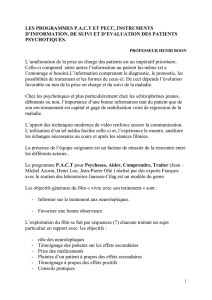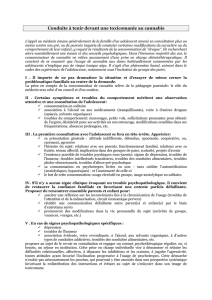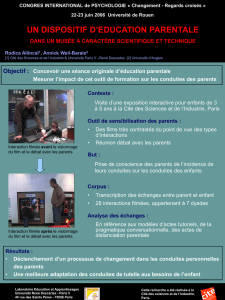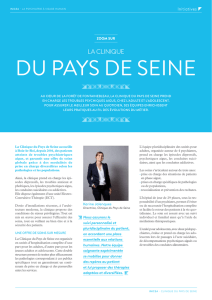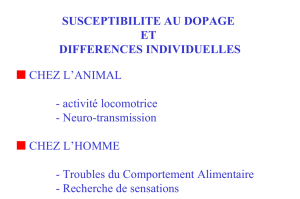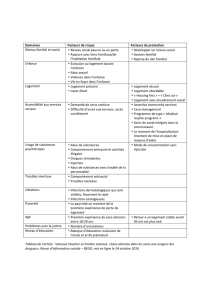Lire l'article complet

30
Le Courrier des addictions (5), n° 1, janvier/février/mars 2003
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
Camille,19 ans, a été hospitalisée à plusieurs
reprises depuis l’âge de 17 ans, tantôt pour
état dépressif atypique, tantôt pour troubles
des conduites. Une prise en charge en hôpital
de jour a finalement été proposée il y a un an,
des éléments délirants étant apparus au sein de
la problématique dépressive. Comme de nom-
breux sujets à cet âge, Camille ne conçoit pas
d’exister sans risquer sa vie. Si elle revendique
sa consommation de substances, ses tentatives
de suicide ou ses fugues, elle les attribue, dans
le même temps, au divorce de ses parents lors-
qu’elle avait 12 ans. Lors des entretiens indi-
viduels, Camille se présente tantôt comme
étant très déprimée, tantôt en affichant une
désinvolture qui accompagne le plus souvent
un discours lucide et plein d’humour, parfois
teinté de séduction. Cette juxtaposition
d’affects et de symptômes, apparemment
contradictoires, met à jour une économie qui
est à la fois dépressive et antidépressive.
Cette brève introduction peut représenter un
exemple témoignant des difficultés concep-
tuelles que comporte l’étude de l’association
entre troubles distincts, ceux-ci pouvant parti-
ciper de causes différentes ou au contraire
d’un déterminisme réciproque, d’interrelations
causales assez étroites. Les troubles que cible
cette étude ainsi que leurs différents liens ont
déjà fait l’objet d’une littérature abondante,
mais les travaux abordant simultanément ces
quatre variables à l’adolescence sont relative-
ment rares. Certains travaux consacrés aux
formes de comorbidité liées à l’utilisation de
substances révèlent pourtant que les troubles
anxieux, les troubles de l’humeur et les
troubles psychotiques comptent précisément
parmi les plus fréquemment associés aux
conduites d’usage, d’abus ou de dépendance
(22). Si un nombre considérable de travaux a
par ailleurs été consacré au problème des
interrelations complexes qu’entretiennent les
conduites d’abus ou de dépendance et les
autres troubles, la nature exacte – sans doute
multifactorielle – de celles-ci demeure mal
élucidée. Certaines données peuvent toutefois
être avancées.
Les études épidémiologiques menées auprès
de patients présentant des troubles psycho-
tiques ou des troubles de l’humeur font appa-
raître une prévalence de l’abus de substances
de deux à cinq fois supérieure à celle retrouvée
en population générale. Par ailleurs, la plupart
des études récentes ont montré l’absence de
liens linéaires entre les troubles psychopatho-
logiques et le type de substance consommée :
l’alcool et le cannabis sont les produits les
plus utilisés par les patients, quels que soient
les troubles associés (12, 17, 20).
La plupart des données dont nous disposons
font clairement apparaître la nécessité de la
prise en compte de la comorbidité dépression-
addictions à l’adolescence, dans la mesure où
elle est susceptible d’aggraver la sévérité des
troubles, d’accroître le risque de tentative de
suicide, d’entraîner une résistance accrue aux
traitements et une durée d’évolution plus
longue (9, 14, 16). Qu’elles soient primaires ou
secondaires, l’anxiété et la dépression peuvent
être considérées comme aggravant ou mainte-
nant l’abus ou la dépendance au toxique (5).
La nature des relations entre conduites addic-
tives et troubles psychotiques demeure dif-
ficile à apprécier. Les données récentes révè-
lent que l’abus et la dépendance à l’alcool ou
au cannabis peuvent favoriser l’apparition ou
le maintien d’une symptomatologie positive
(hallucinations, idées délirantes, etc.) et modi-
fier de façon considérable l’évolution et le
pronostic des troubles (3, 10, 15). Si l’on ne
relève pas de rapport de causalité directe entre
conduites d’abus ou de dépendance et patho-
logies psychotiques, l’étude de la chronologie
de l’addiction, par rapport à l’apparition des
premiers signes de la pathologie, montre que
l’abus ou la dépendance au cannabis précè-
dent ou coïncident généralement avec la sur-
venue du trouble, alors que l’abus ou la
dépendance à l’alcool semblent succéder
aux premiers symptômes plus souvent
qu’ils ne les précèdent (1, 19). Plusieurs
études prospectives ont par ailleurs montré
que la survenue de rechutes psychotiques
était significativement plus précoce et plus
sévère chez les patients présentant des
troubles associés à l’utilisation de substances
psychoactives (11, 12, 15).
L’une des principales données issues de
Anxiété, dépression, conduites
de dépendance et troubles psychotiques
à l’adolescence
J.-P. Moutte*, J. Doron**
Cette étude, fondée sur une population de 18 adolescents accueillis
dans un hôpital de jour, tente d’évaluer l’intensité et la nature des liens
qui peuvent exister entre l’anxiété, la dépression, les conduites de
dépendance et les troubles psychotiques. Les conduites symptomatiques
et les modes de fonctionnement psychique sous-jacents ont été respecti-
vement évalués à l’aide de méthodes standardisées et du Rorschach.
Les principaux résultats révèlent qu’une majorité de sujets présente au
moins deux troubles distincts. L’utilisation de substances psychoactives
apparaît comme un facteur aggravant des troubles psychotiques et des
troubles de l’humeur : les sujets qui présentent des conduites d’abus
et/ou de dépendance sont en effet significativement plus déprimés et
nécessitent des hospitalisations plus fréquentes que les autres sujets.
L’analyse des modalités narcissiques témoigne du fait que la plupart de
ces sujets présentent un fonctionnement psychique relevant de registres
psychotiques plus ou moins profondément désorganisés.
* Psychologue clinicien, hôpital de jour du
Parc, 347, boulevard du Président-Wilson,
33200 Bordeaux.
** Professeur de psychologie clinique et patho-
logique, université Victor-Segalen, Bordeaux 2,
département de psychologie, Bât H, 3 ter, place
de la Victoire, 33076 Bordeaux Cedex.

31
l’examen transversal des formes de comorbi-
dité entre anxiété, dépression et psychose
indique que la plupart des troubles psycho-
tiques sont susceptibles de comporter une
symptomatologie anxieuse et/ou dépressive,
en particulier à l’adolescence. Certains tra-
vaux ont ainsi mis en lumière une plus grande
sévérité de la symptomatologie anxio-dépres-
sive lors des premières décompensations psy-
chotiques (6), en soulignant notamment la fré-
quence des raptus anxieux. Si les patterns de
comorbidité entre psychose, dépression et
anxiété à l’adolescence peuvent recouvrir des
tableaux cliniques relativement hétérogènes,
on notera que l’anxiété et la dépression ont
toujours un retentissement important sur
l’évolution des troubles psychotiques et sur
l’insertion sociale et familiale des patients.
Cette étude poursuit deux types d’objectifs.
Il s’agit tout d’abord de mesurer la préva-
lence ponctuelle de la comorbidité entre
anxiété, dépression et conduites de dépen-
dance au sein d’un groupe d’adolescents et
de jeunes adultes accueillis en hôpital de
jour pour troubles psychotiques. Nous
tâcherons, par là même, d’analyser les rela-
tions quantitatives qu’entretiennent ces
variables entre elles. Nous tenterons égale-
ment d’apporter une réponse à la question
de l’inscription de cette comorbidité – en
termes de place et de fonction – dans la
problématique d’adolescents présentant des
troubles psychopathologiques graves.
Méthodologie
Sujets
La population de cette étude est constituée de
dix-huit adolescents âgés de 16 à 21 ans qui
présentent des troubles psychotiques non
déficitaires. Ces quinze garçons et trois filles
suivent tous une scolarité dans le cadre de
l’hôpital de jour, les classes fréquentées allant
de la cinquième à la terminale.
Procédure
Les dix-huit adolescents ont été répartis en
deux groupes selon qu’ils avaient ou non
recours à l’utilisation de substances psycho-
actives. Les questionnaires I et J de la Mini
international neuro-psychiatric interview
(MINI 4,4) (13) ont été utilisés afin de distin-
guer les situations d’usage, d’abus et de dépen-
dance à une ou plusieurs substances au cours de
l’année écoulée (critères CIM-10).
Les sujets de chaque groupe ont ensuite pris
part à un entretien de recherche au cours duquel
Grille d’investigation des modalités narcissiques
(Monika Boekholt, 1992)
Axe 1 : Coloration affective de la représentation de soi (ou d’objet)
+Élation : toute marque de grandeur, puissance enviable, beauté, noblesse. Valorisation
explicite de l’objet, de soi ou de la relation.
- Dévalorisation explicite, dysphorie, fragilité, menace, interrelation présentée comme négative.
= Neutralité, constat, dénomination simple, pas de tonalité affective exprimée.
±Mouvements simultanés d’attraction/répulsion, de dénigrement/réparation, descriptions
dysphoriques complaisantes, ambivalence explicite, etc.
Axe 2 : Procédés
• Échelle i : Représentation idéale de soi ou d’objet
i1. Simple valorisation, dévalorisation, non justifiées, constat.
i2. Parure, art, fleurs, décor, danse, fête, musique, feu d’artifice, attributs féminins, objets creux, etc.
i30. Attributs virils, objets et signes de puissance, objets à moteur, constructions érigées, agres-
sivité socialisée, feu, bestiaire puissant/impuissant, formulation additive ou privative.
i31. Béance, vide, trou, vacuité interne sans représentation sexuelle associée.
i32. Altération, déformation corporelle.
i33. Décomposition, désagrégation, pourriture, ruines, objets en déséquilibre, en morceaux.
i4. Monde asexué, naïf, puéril, petit, mignon, amusant, jouet, pureté, monde virginal, anges, etc.
i5. Grandiose, toute puissance magique, convoitée ou redoutable, versus valorisation ou menace,
êtres maléfiques, monstres, etc. Neutralité absolue. Bisexualité. Survalorisation excessive en
fonction du stimulus.
i6. Idéalisation du négatif, dévitalisation, statue, momie, marionnette, pétrification d’un
contenu précédemment animé, contenu minéral.
i7. Agressivité destructrice, attributs destructifs, projection agressive, volcan, bombardement,
écrasement.
• Échelle R : Retrait et centration sur soi
R1. Découpes inhabituelles, valorisation de l’imaginaire, désintérêt, images floues, centrations
autistiques.
R2. Centration sur le corps et/ou le sexe, symbolisme transparent mais pas de réponse directe,
déplacement par biais culturel, scientifique, animal, insistance sur la verticalité de la symétrie.
R3. Réponses corporelles anatomiques et sexuelles directes, sang.
R4. “Narcissisme primaire” : expression symbolique, éléments primitifs, éléments marins,
animaux marins, géographie aquatique vague.
R41. Fantasmes de retour au sein maternel crûment exprimés ; thèmes obstétricaux directs ; fœtus.
R5. Fantaisie orale : réponses alimentaires, scènes de dévoration, nutrition, becs, bouches,
dents, gueules, mâchoires, hyène, ogre.
R6. Régression au niveau du mode de pensée, brusques dénivellations perceptives.
R7. Vigilance, caractère persécutif, interprétatif, guetter, scruter (intentionnalité sous-jacente).
• Échelle S : Dimension spéculaire et dédoublement
S1. Miroirs, reflets par rapport à l’axe de la planche.
S2. Réponses unilatérales : dédoublement de percepts habituellement unitaires.
S3. Insistance sur la symétrie et sur la duplication des images ; oscillation unité/dualité dans la
même phrase ou à l’enquête ; confusion singulier/pluriel.
S4. Réponses bilatérales, accent mis sur la posture plus que sur la relation.
S5. Jumeaux, siamois, personnages collés, soudés, semblables, interchangeables par rapport
à l’axe de la planche.
S6. “Dissociation symétrique” : réponses symétriques contradictoires.
• Échelle L : Enveloppes corporelles, tactiles et chromesthésiques
L0. Thématique d’étayage : porter, soutenir, bercer, s’appuyer sur, contenir…
L1. Peaux, vêtements, tissus, voiles, masques ; thématiques d’enveloppement, recouvrir, cacher.
L2. Fragilité de l’enveloppe : transparences, déchirures, membranes, libellules, discontinuité,
effraction.
L. Qualité tactile : matière, épaisseur, consistance, doux, velu, compact, rugueux, sec, etc.
L4. Qualité visuelle : sensorialité, couleur, luminosité ; contraste blanc-noir, couleurs dégradées.
L5. Superpositions de percepts mal délimités, “contaminations”.
L6. Perceptions auditives et olfactives.
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r

32
Le Courrier des addictions (5), n° 1, janvier/février/mars 2003
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
étaient utilisés différents instruments standardi-
sés, à savoir :
1. L’inventaire d’anxiété de Beck (BAI) afin
d’évaluer l’intensité de l’anxiété (7).
2. Le questionnaire CES-D (Center for
Epidemiologic Studies-Depression scale) afin
d’apprécier la sévérité de la symptomatologie
dépressive (8).
3. Un questionnaire standardisé visant au
recueil des données biographiques et thérapeu-
tiques (âge, niveau scolaire, antécédents fami-
liaux, prise d’un traitement, nombre d’hospita-
lisations au cours de l’année, etc.).
Nous avons également tenté de cerner le mode
de fonctionnement psychique de chaque sujet à
partir du Rorschach. Les protocoles ont été
cotés à l’aide d’une grille d’analyse mise au
point par M. Boekholt (2), grille qui permet une
approche différentielle des aménagements
dépressifs relevant de registres distincts (névro-
tique, pervers, limite, psychotique) tout en four-
nissant des éléments comparatifs objectivables
dans le cadre d’une recherche intergroupes.
Nous ne détaillerons pas ici le mode de cotation
si ce n’est pour préciser que celle-ci s’effectue
sur deux axes : l’un est relatif à l’expression
d’affect telle qu’elle est explicitée par la verba-
lisation et les réactions comportementales lors
de la passation, de l’enquête et de l’épreuve des
choix ; l’autre a trait aux procédés d’investis-
sement narcissiques et ne prend en compte que
les réponses présentes dans le protocole.
Des contraintes institutionnelles ne nous ayant
pas permis de proposer la passation du
Rorschach à tous les sujets, nous avons propo-
sé celle-ci à dix d’entre eux, soit cinq sujets tirés
au hasard dans chaque groupe.
Le diagnostic principal (critères CIM-10)
auquel nous nous référons pour chaque sujet a
été établi par trois psychiatres expérimentés
exerçant dans l’institution. La chronologie
d’apparition des conduites d’abus et/ou de
dépendance par rapport aux prodromes de la
maladie a également été prise en compte. Nous
avons considéré, à partir des éléments recueillis
au cours de l’entretien, que l’apparition était
concomitante si les deux types de troubles
avaient débuté au cours de la même année, que
l’un avait précédé l’autre si l’intervalle d’appa-
rition était supérieur à un an.
Résultats
Étude descriptive
Les dix-huit sujets constituant notre popula-
tion ont été répartis en deux groupes, l’un
composé de neuf adolescents ayant recours à
l’utilisation de substances psychoactives
(groupe A), l’autre de neuf adolescents ne
présentant pas de telles conduites (groupe B).
L’âge moyen est légèrement plus élevé au sein
du groupe A (18,5 ± 1,3) qu’au sein du
groupe B (17,6 ± 1,5). Comme le montre le
Groupe A Groupe B Total
(n = 9) (n = 9) (n = 18)
Catégories diagnostiques
(CIM-10)
• Schizophrénie 11,1 % 11,1 % 11,1 %
• Troubles délirants persistants 0 % 11,1 % 5,5 %
• Troubles schizo-affectifs 33,3 % 22,2 % 27,7 %
• Troubles psychotiques aigus 22,2 % 11,1 % 16,6 %
• Troubles de l’humeur :
– épisode maniaque 11,1 % 0 % 5,5 %
– trouble bipolaire 11,1 % 0 % 5,5 %
– trouble dépressif récurrent 11,1 % 11,1 % 11,1 %
• Troubles envahissants
du développement 0 % 33,3 % 16,6 %
Prise d’un traitement
médicamenteux 88,8 % 33,3 % 61,1 %
Âge moyen de début des troubles 16,8 ans 13,3 ans 15 ans
Nombre d’hospitalisations
au cours de l’année
• 1 hospitalisation 22,2 % 0 % 11,1 %
• 2 hospitalisations ou plus 33,3 % 0 % 16,6 %
Antécédents familiaux
• Troubles psychiatriques 44,4 % 33,3 % 38,8 %
• Utilisation régulière de substances 33,3 % 11,1 % 22,2 %
Tableau I. Comparaison des principales caractéristiques diagnostiques et thérapeutiques
des deux groupes étudiés.
Normes Groupe A Groupe B
Rentre 20 et 30 mn 18 mn 15 mn
Tentre 20 et 30 mn 21 mn 9 mn
G20 à 30 % 63 % 72 %
D60 à 70 % 27 % 22 %
Dd 5 à 10 % 2 % 4 %
F % 60 à 65 % 58 % 60 %
F + % 70 à 80 % 66 % 66 %
+ % 70 à 90 % 70 % 66 %
K 3,5 1,5 1
C55 2,5
H % 10 à 20 % 18 % 18 %
A % 40 à 45 % 42 % 48 %
Ban 5 à 7 4 3
IA Significatif si > 12 % 13 % 8 %
Tableau II. Principales caractéristiques des protocoles de Rorschach (moyennes et pour-
centages).

33
tableau I, les sujets qui recourent à l’utilisa-
tion de substances présentent des troubles
d’apparition plus tardive et sont accueillis
dans l’institution depuis moins longtemps
(10 mois en moyenne) que les sujets qui n’uti-
lisent pas de substance (24 mois en moyenne).
La première constatation concerne la pré-
sence concomitante, chez une majorité de
sujets, de manifestations anxieuses et/ou
dépressives. Douze sujets présentent des
manifestations dépressives (CES - D > 17 ou
23) relativement intenses (m = 22 ± 9,7). Ces
manifestations ne diffèrent pas significative-
ment en fonction du diagnostic principal, ce
qui est sans doute dû au petit nombre de sujets
dans chaque groupe. Dix sujets présentent des
manifestations anxieuses (BAI > 15) ; celles-
ci sont relativement peu intenses (m = 16,8 ±
9,5). Nous n’avons trouvé de différence signi-
ficative ni entre les deux groupes de sujets, ni
entre les diverses catégories diagnostiques.
Les sujets répondant aux critères de dépen-
dance à une ou plusieurs substances au cours
de l’année écoulée sont au nombre de huit.
Cinq d’entre eux (62,5 %) répondent aux cri-
tères d’abus et/ou de dépendance à deux types
de substances, qui sont dans tous les cas
l’alcool et les dérivés du cannabis. Les autres
sujets répondent aux critères de dépendance à
une seule substance, qui est pour les uns le
cannabis, pour l’autre l’alcool. Par ailleurs,
trois de ces sujets consomment ou ont
consommé d’autres types de substances (ecs-
tasy, cocaïne) sans que l’on puisse parler
d’abus ou de dépendance au cours de l’année.
L’âge moyen de début des conduites d’utilisa-
tion de substances est de 16,7 ans (± 1,3).
Cinq sujets ont présenté ce type de conduites
avant l’apparition des premiers symptômes
psychotiques ou thymiques patents. Les deux
types de symptômes sont apparus de
manière concomitante chez trois sujets, et un
seul a développé des conduites de dépen-
dance plus d’un an après l’apparition d’une
symptomatologie psychotique.
Si les données obtenues doivent être nuan-
cées, compte tenu du faible effectif sur
lequel elles portent, elles mettent néan-
moins en lumière le retentissement que
cette comorbidité peut avoir sur le plan cli-
nique : les huit sujets qui présentent des
conduites de dépendance à une ou plusieurs
substances psychoactives sont significati-
vement plus déprimés (t = 4,14 p < 0,004)
et hospitalisés plus fréquemment (t = 4,21
p < 0,003) que les autres sujets.
Étude psychodynamique
• Caractéristiques générales
Les protocoles de Rorschach des adoles-
cents présentant des conduites d’abus et/ou
de dépendance se caractérisent par une ver-
balisation relativement riche pouvant com-
porter des bizarreries ou des éléments déli-
rants. À l’inverse, les protocoles des ado-
lescents n’utilisant pas de substance ren-
dent compte d’un investissement de la pas-
sation moins important et témoignent
d’une certaine pauvreté associative. La plu-
part des protocoles révèlent des oscillations
parfois importantes entre les a-résonnances
qu’assure le gel pulsionnel, l’activité de
représentation subissant des attaques des-
tructrices (disparition de la kinesthésie au
profit de formes banales, figées, répéti-
tives) et les émergences brutales de proces-
sus primaires. Ces épreuves témoignent
dans leur ensemble d’un rapport au réel
assez ténu, bien que les protocoles des
sujets du groupe A révèlent un ancrage
dans la réalité extérieure et des capacités
d’adaptation qui semblent connotées moins
négativement que ceux des sujets du groupe
B. Le TRI – extratensif chez une grande
majorité de sujets – met en évidence la
massivité des affects et le caractère discon-
tinu des possibilités de contenance pulsion-
nelle. Les mécanismes de défense auxquels
recourent la plupart des sujets sont, dans
l’un et l’autre groupe, le clivage, le déni,
l’idéalisation et la projection.
Les dix adolescents auxquels nous avons
proposé la passation du Rorschach sem-
blent tous confrontés à un processus psy-
chotique. On notera toutefois que les pro-
fils généraux qui peuvent être établis pour
chaque groupe diffèrent sensiblement l’un
de l’autre (tableau II).
• Analyse des modalités d’investissement
narcissiques
Cette analyse repose principalement sur les
dimensions qualitative et quantitative des
modalités narcissiques dans les protocoles.
La dimension temporelle (enchaînement
réponse par réponse, planche par planche) ne
sera pas abordée ici.
Le premier constat que l’on peut faire concer-
nant la coloration affective de la représenta-
tion de soi et d’objet tient au fait que la plupart
des réponses sont exprimées de façon neutre :
les réactions comportementales sont assez
rares et peuvent être connotées tant positive-
ment que négativement. Pris dans leur globa-
lité, les mouvements dysphoriques, anxieux
ou de dévalorisation apparaissent au sein des
deux groupes plus fréquemment que les
marques d’élation, de plaisir ou de valorisation
(tableau III, axe 1). Au sein du groupe A, les
mouvements de dévalorisation ont trait tantôt à
la représentation d’objet, tantôt à la représenta-
tion de soi, tandis que les mouvements de valo-
risation sont principalement dirigés sur la
représentation de soi. Dans l’autre groupe, les
mouvements de dévalorisation portent sur les
représentations d’objet et de relation lorsque
les mouvements de valorisation portent le plus
souvent sur la représentation de soi.
Sur le plan quantitatif, les procédés d’investis-
sement auxquels recourent massivement tous
ces adolescents ont trait à la représentation
idéale de soi (tableau III,axe 2). Les réponses
porteuses de cette thématique renvoient essen-
tiellement aux items i2, i5, i6 et i7, le recours
aux trois derniers mettant en lumière l’activité
des polarités létales du narcissisme négatif. Les
items de l’échelle R – R4, R5 et R7 principa-
lement – sont quant à eux retrouvés dans des
proportions comparables dans la plupart des
Groupe A Groupe B
Axe 1
– Valorisation explicite, élation 8,1 % 5,2 %
– Dévalorisation explicite, dysphorie 15 % 9 %
– Neutralité, dénomination simple 72,2 % 83,1 %
– Ambivalence explicite 4,7 % 2,7 %
Axe 2
– Échelle i : représentation idéale de soi 55,2 % 61 %
– Échelle R : retrait et centration sur soi 16,4 % 15,8 %
– Échelle S : dimension spéculaire, dédoublement 14,1 % 11,2 %
– Échelle L : enveloppes corporelles et
chromesthésiques 14,3 % 12 %
Tableau III. Dimension quantitative de l’analyse des modalités narcissiques au
Rorschach.
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r

34
Le Courrier des addictions (5), n° 1, janvier/février/mars 2003
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
D
o
s
s
i
e
r
protocoles. Les mouvements de retrait qui pré-
sident à l’utilisation de ces items semblent,
dans l’un et l’autre groupe, dictés par un
important désinvestissement objectal. Les
items de l’échelle S qu’emploient la plupart
des sujets, à savoir les items S4 et S6, renvoient
aux mouvements scissionnels qui sont la
marque de défenses psychotiques. L’emploi
des items de l’échelle L recouvre là aussi cer-
taines similitudes entre les deux groupes de
sujets. Une majorité d’entre eux recourt en
effet aux items L2, L4 et L5. La thématique et
l’éprouvé subjectif perceptibles au travers de
ce type de réponses sont généralement conno-
tés négativement et renvoient à des relations
d’objet recherchées ou redoutées mais
toujours empreintes de dysphorie.
On retiendra donc, à l’issue de cette approche
différentielle, que les éléments dépressifs que
présentent une majorité de sujets relèvent
effectivement de registres dissociatifs.
Discussion
Nous n’évoquerons pas ici les hypothèses
psychopharmacologiques et génétiques
concernant la fréquence élevée de la comorbi-
dité entre troubles psychopathologiques.
Celles-ci ont fait l’objet d’études aussi nom-
breuses qu’attentives qui pourront être retrou-
vées ailleurs.
L’analyse statistique de l’association entre les
différentes variables étudiées montre que la
dépression est corrélée avec l’anxiété (r = 0,69
p < 0,01), ce qui est cohérent avec la plupart
des données dont nous disposons (5, 9).
L’anxiété est, quant à elle, corrélée, dans une
moindre mesure et de façon négative, avec la
durée de la prise en charge. Cette dernière
donnée souligne l’importance d’une prise en
charge durable, qui permette aux sujets l’inté-
gration progressive de capacités à utiliser le
cadre institutionnel comme système contenant
et pare-excitant. Les troubles liés à l’utilisation
de substances apparaissent comme étant prin-
cipalement liés à la dépression. Ceux-ci sont
toutefois significativement plus importants
lorsque la dépression est présente conjointe-
ment avec l’anxiété (t = 2,92 p < 0,05). Le fait
que la dépression, l’anxiété et les conduites
addictives apparaissent, sur le plan statistique,
comme des variables explicatives les unes des
autres indique la possibilité d’une tentative
d’automédication des angoisses psychotiques
et/ou de l’humeur dépressive. La massivité du
recours à l’alcool et au cannabis va d’ailleurs
dans le sens de cette hypothèse, les effets
anxiolytiques et subeuphoriques de ces deux
types de substances étant bien connus. Si ces
trois variables entretiennent des relations,
celles-ci semblent toutefois difficilement
réductibles à une relation linéaire de causalité,
de nombreuses autres variables (l’intensité de
la symptomatologie psychotique, l’utilisation
ponctuelle d’autres substances, etc.) pouvant
jouer un rôle déterminant dans l’apparition ou
le maintien de ces manifestations comorbides.
Le fait que l’alcool et les dérivés du cannabis
soient les substances les plus fréquemment
utilisées tend à confirmer l’importance, dans
le choix du produit, du coût et de la disponibi-
lité de celui-ci dans l’environnement du sujet.
L’ hypothèse selon laquelle le choix des sub-
stances utilisées par les patients psychotiques
serait lié à une appétence préférentielle pour
les psychostimulants – appétence probable-
ment sous-tendue par une tentative d’auto-
médication de la symptomatologie négative –
n’est pas confirmée ici. La place importante
qu’occupent le cannabis et l’alcool dans les
conduites addictives auxquelles nous sommes
confrontés semble en outre témoigner de la
non-pertinence de la dichotomie entre drogues
“douces” et “dures” ou entre substances licites
et illicites lorsque l’on aborde la question de
leur utilisation par des sujets présentant des
troubles psychopathologiques.
On constate que les conduites de dépendance
précèdent le plus souvent l’apparition des
troubles psychotiques ou thymiques. Cette
chronologie tend à confirmer une série
d’hypothèses que nous rappellerons briève-
ment. Selon la première de ces hypothèses, les
substances psychoactives joueraient le rôle de
facteur précipitant de la première décompen-
sation psychotique ou thymique chez des
sujets pouvant présenter des failles identitaires
sous-jacentes. Selon la deuxième hypothèse,
non exclusive de la précédente, l’utilisation
régulière de substances modifierait la présen-
tation clinique de la symptomatologie débu-
tante, au point d’entraîner parfois des erre-
ments diagnostiques.
Nous appuyant sur l’ensemble des données
qualitatives, nous tâcherons maintenant de
livrer une lecture processuelle (considérant
un processus psychopathologique où sur-
viennent divers éléments symptomatiques)
plutôt que catégorielle (considérant la psy-
chose et les manifestations qui lui sont asso-
ciées comme des pathologies distinctes) des
phénomènes comorbides qui constituent
l’objet de ce travail.
L’ e xamen des protocoles de Rorschach
témoigne du fait que les sujets que nous avons
rencontrés présentent tous un fonctionnement
psychique relevant de registres psychotiques
plus ou moins profondément organisés. Il
apparaît également que les procédés d’inves-
tissement narcissiques mis en jeu, s’ils sont
sensiblement les mêmes dans les deux
groupes, le sont toutefois en proportion
variable selon que les sujets font partie de l’un
ou l’autre groupe. Ces différences quant à la
nature et au degré des mouvements d’investis-
sement et de désinvestissement indiquent la
possibilité de dénis, de clivages et de projec-
tions plus limités, moins radicalement coupés
de la réalité chez les sujets du groupe A que
chez ceux du groupe B. Il semble que les pre-
miers disposent ainsi de ressources plus
importantes que les seconds pour tenter de
répondre aux difficultés qu’ils rencontrent.
Ces différences peuvent être liées, en partie du
moins, au fait que les sujets du groupe A pré-
sentent des troubles d’apparition plus récente
que les autres sujets. Il se peut que ces diffé-
rences tiennent aussi aux contradictions, inhé-
rentes à la psychopathologie de l’adolescence,
entre des modes d’organisation psychotique
mobilisables et d’autres qui, bien qu’apparem-
ment semblables, sont déjà fixés.
Les protocoles de Rorschach des deux
groupes de sujets sont majoritairement por-
teurs des indices classiques de l’inhibition
dépressive : restriction du nombre de répon-
ses, pauvreté kinesthésique, sensibilité spéci-
fique au noir et/ou au blanc, etc. Au-delà de
ces critères, ces protocoles sont révélateurs de
la difficulté qu’ont certains sujets à associer
l’affect de souffrance et une ou des représen-
tations de perte. Sur ce dernier point, les
modalités diffèrent parfois au sein d’un même
groupe, car elles portent, soit la marque du
lien maintenu à l’objet soit celle de son anéan-
tissement. L’articulation entre dépression et
organisation psychotique semble donc varier
selon que la menace de désorganisation
identitaire est circonscrite ou envahissante
et selon que dominent les aspects fusionnels
ou scissionnels.
Les fonctions que peuvent revêtir les
conduites de dépendance d’un point de vue
psychique leur confèrent, comme l’ont souli-
gné certains auteurs (4, 18), un caractère de
solution aspécifique. Celles-ci peuvent en
effet être utilisées par les patients afin de sup-
porter les angoisses et les affects dépressifs ou
d’abandon – réels ou fantasmatiques – qu’ils
éprouvent, pour tenter de déplacer leur dépen-
dance aux objets parentaux, pour tenir les
 6
6
1
/
6
100%