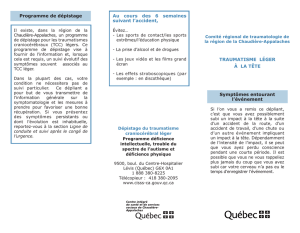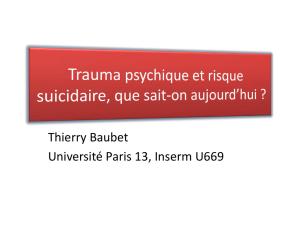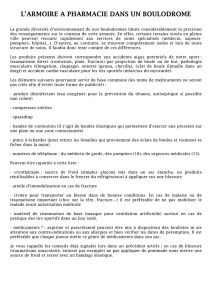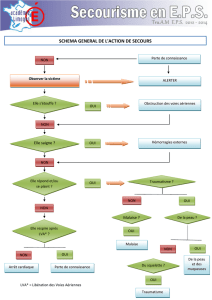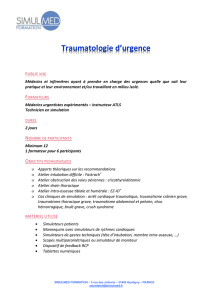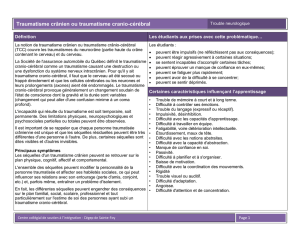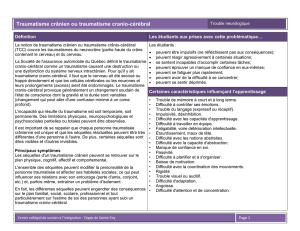Le traumatisme psychique de guerre

19/04/17
– 1 – / 5
LE T R A U M A T I S M E P S Y C H I Q U E D E G U E R R E
INTRODUCTION
Le mot traumasme apparent aujourd’hui au langage courant : c’est un choc émoonnel intense. Mais à y regarder de plus près, il s’agit de
tout autre chose que du traumasme psychique.
En fait la connaissance du traumasme, du mécanisme déterminant le traumasme est restreinte à un cercle de psychiatrie de guerre.
L’intérêt à gagner le champ civil : les accidents traumaques par exemple sont considérés comme des traumasmes psychiques.
Pourtant, la prise en compte par les médecins du traumasme se situe au début du 20e avec la première guerre mondiale même si dès les
guerres napoléoniennes, les chirurgiens Larrey, Percy ou Desgenees ont appelé « vent du boulet » les états de stupeur aigue déterminés par la
seule frayeur d’avoir sen les projecles les frôler sans avoir été blessé.
Au cours de la guerre de Sécession, le neurophysiologiste Weir Mitchell s’étonnait d’avoir vu des soldats robustes se comportaient comme des
femmelees ou de compter par milliers des cas de nostalgie. Des hôpitaux spécialisés sont conçus pour accueillir ces blessés psychiques.
C’est la confrontaon à la mort de masse observé durant les deux guerres mondiales que le phénomène apparaît avec la plus grande acuité. Ce
que l’on appelle aussi le premier vingème siècle qui se caractérise par la violence nouvelle dans les modalités de combat.
Si les données chirées sont connues, de tels chires ne gurent que d’une représentaon assez faible, même si on change l’échelle.
Exemple dans le cas français : 900 combaants meurent chaque jour entre 1914 et 1918, 1300 côté allemand.
Dans le cas du conit en Afghanistan : 80 en dix ans.
Au sein de nos sociétés qui sont déshabituées à la mort, à l’idée de la mort même à la guerre, de tels chires nécessitent une représentaon.
Cee approche quantave ne ent pas compte de l’aspect du champ de bataille, le combat s’inscrit dans les chairs de ceux qui ont la charge de
combare.
Si on dispose de données chirées quand au nombre de tués, aucune probabilité des blessés psychiques n’a été mise en place.
Dans le cas de la première guerre mondiale, seuls les États-Unis ont évalué leur nombre de blessés : 69 400 blessés psychiques sur 2 millions
d’hommes engagés entre avril 1917 et novembre 1918.
Dans tous les cas, aucun chire ne donne la mesure des traumasmes observés lors de l’après guerre : l’état post-traumaque se caractérisant
par la confrontaon, par des réminiscences.
L’Allemagne ne reconnaît pas les traumasmes psychiques. Ces derniers sont reconnus comme une honte → négaon du traumasme
psychique. L’idéologie nazie a considéré cela comme une tare et une aeinte à la pureté de la race. Ce fut également fort mal considéré en
URSS.
D’un consensus à la fracture dans les modalités à penser le traumasme du milieu des années 50 jusqu’à l’inscripon dans le DSN au diagnosc
du PTSD, on examinera le processus d’inclinaison du discours médical dans le sens d’une négaon jusqu’à une reconnaissance du traumasme
psychique.
I. Représentations et appellations
A. Du « Shell Shock » à l’exhaustion
Le terme « Shell Shock » a été retenu par le discours médical pour désigner les aeintes d’ordre nerveux et/ou psychique provoquées sur
l’organisme humain par les déagraons d’obus. On ne trouve pas d’équivalent dans le cas français mais, on trouve une multude de
dénominaons pour dénir les exposions aux déagraons d’obus.
On rencontre les appellaons de commoon cérébrale, de congeson cérébrale, d’accidents nerveux, de commoons médullaires, de choc
émoonnel, d’obusite, de choc commoonnel ou d’éclopés psychiques. Mais le plus souvent les psychiatres français s’accordent sur le terme de
commoon.
La diversité des troubles engendrés est due aux traumasmes des chocs d’obus déterminant des aeintes fonconnelles mais aussi des aeintes
sans lésion. Dans le cas français, à côté des troubles mentaux tels que la confusion mentale, les psychoses hystériques, l’amnésie, le délire,
l’exposion à ces déagraons d’obus déterminent des troubles dits nerveux :
- aeinte de l’ouïe
- de la vue (cécité)
- de la parole (musme)
- des tremblements
- de l’astasie (diculté à tenir la posion debout)
- de l’abasie (diculté ou perte plus ou moins complète de la faculté de marcher)
- paraplégie
- paralysie
- crises convulsives
- plicatures → les plicaturés sont des soldats que l’on a retrouvé en posion fœtale et qui ne parviennent plus à se redresser : incapacité
à se tenir en posion vercale

– 2 – / 5
Dans le cas britannique, pour cet ensemble, ils n’ont retenu que le terme « Shell Shock » évoqué pour la première fois en 1915.
Ce sont des aeintes sans lésion. Les troubles nerveux sont en fait une inscripon dans le corps de la terreur.
Le terme « Shell Shock » est déni par l’explosion d’un gros obus avec ou sans blessure physique. Ce type de traumasme se rencontrait si
fréquemment que les médecins ont cru que les soldats étaient des simulateurs : ère du soupçon.
On ne comprend pas le traumasme ; c’est la mort et la vision de corps mulés qui déterminent le traumasme psychique. Une violence
nouvelle s’inscrit dans le rapport à la mort tolérée par le combaant jusqu’à son point de rupture. C’est dans ce sens que le poète Wilfried
Owen a écrit les vers suivants : (mental cases) « ceux-ci sont des hommes dont les morts ont violé les âmes ».
Ce sont également essenellement les anglo-saxons qui arent le regard sur le rôle de la précarité de l’existence en parculier sur des
bouleversements induits dans les rythmes de vie : sommeil, alimentaon → remise en cause des défenses psychologiques. Dans le cas
français, la plupart des psychiatres ont négligé ces facteurs au prot de la prédisposion et du caractère d’hérédité mis en avant.
Durant la seconde guerre mondiale, dans le cas américain (voire anglo-saxon), ils ont d’abord ulisé le terme « Blast Concussion » : commoon
cérébrale.
Les psychiatres ont convenu en avril 1943 de l’appellaon « Combat Exhauson » évoquant l’épuisement au combat comme diagnosc de tous
les troubles psychiques de guerre. Le mot a été retenu parce qu’il semblait s’accommoder aux symptômes observés ; il ne relevait que d’un état
de fague provisoire qui était rapidement pris en charge et soigné, mais ne relevait pas du monde psychiatrique. Même le monde militaire l’a
accepté sauf certains qui ont vu la une certaine permissivité → re-au-anc.
Chaque homme avait son point de rupture et donc le terme « Combat Exhauson » s’inscrit comme une réacon normale à une situaon
anormale.
Dans le discours médical américain et dans les travaux écrits par Roy Grinker et John Spiegel, ils insistent sur les épuisements physiques et
psychiques prolongés. Ce sont ces mêmes auteurs qui introduisent pour la première fois le mot stress en 1945. Beaucoup de troubles
d’apparion diérée, lors du retour, ont été relevés au point qu’ils jusent à l’appellaon réacon diérée au combat ou « Dileate Combat
Reacon ».
C’est en 1943 lors de la campagne d’Italie, qu’émerge le syndrome du vieux sergent qui illustre le point de rupture décrit précédemment ; il
concerne les sous-ociers qui sont vieux de par leur présence sur le champ de bataille. Ils deviennent sujet à l’anxiété quand les pertes de leurs
unités augmentent et quand ils se rendent compte qu’ils sont les seuls survivants. Ils ne parviennent plus à se concentrer sur leur mission et
lorsqu’ils sont renvoyés à l’arrière, ils culpabilisent → dépression profonde.
Dans le cas français, on est frappé par la connuité des mots retenus :
- psychonévrose de guerre : type clinique telles que la confusion mentale, l’hystérie, la persévéraon
- aenon portée sur les facteurs constuonnels : hérédité, facteur déclenchant…
B. Du stress au PTSD
De quelle manière est-on passé du stress au PTSD ?
Le mot stress apparaît dans le discours médical en 1945 mais c’est Hans Selye, neurophysiologiste canadien d’origine autrichienne, qui a retenu
le mot stress appelé inialement syndrome général d’adaptaon pour désigner la réacon biophysiologique d’alarme et de défense de
l’organisme face à une agression. Il désigne à la fois l’agression et la défense.
Le mot stress ne connaît pas d’équivalent dans la langue française, sa traducon est la pression d’une usure quodienne de la vie.
Stress of Life (1956) a connu dans le monde anglo-saxon une très large diusion. Pour Selye, le stress est une réacon adaptave avec une
décharge d’adrénaline et de corsone qui mobilise les eecteurs physiologiques et musculaires donnant à l’organisme un statut de défense.
Si le stress est prolongé, on parle de stress dépassé → fuite panique, sidéré, agité, acon automaque. Ce concept de stress s’est érigé en
doctrine peu à peu devenant la réacon de l’individu à toute sollicitaon courante de la vie.
Il disngue :
- un dis-stress (réponse aux agressions)
- un eu-stress (réponse aux événements heureux)
Les travaux de Selye ont un impact encore considérable. Le traumasme psychique n’est plus désormais perçu comme du stress puisque tout est
stress.
C’est le stress qui amène la fracture entre les modalités anglo-saxonnes et francophones.
DSM III : diagnosc and stascal manual of mental disorders → Post-Traumac Stress Disorder.
Cee inscripon vient d’un collège américain. Ils ont posé ce diagnosc de PTSD qui se traduit par un état de stress post-traumaque qui a
contribué à modier les modalités de la prise en charge et les modalités cliniques.
L’impact ici de la guerre du Vietnam est matricielle : l’expérience américaine du traumasme pendant la guerre et au retour.

– 3 – / 5
Ce manuel a été élaboré par une « Task Force on Nomenclature and stascs » placé sous la direcon de Robert L. Spitzer qui a reçu la mission
d’élaborer un nouveau manuel qui about 6 ans après à une classicaon qui se voulait plus scienque et athéorique. Le maître mot du DSM
est disorder (trouble ou désordre) qui permeait d’aborder l’ensemble du champ de la pathologie mentale.
Il décline des états de stress post-traumaque sous leurs formes aigue ou diéré :
- forme aigue : durée de l’état de stress dépassant la journée jusqu’à 4 semaines après l’événement. En France, cet état de stress ne
dépasse pas 1h après l’événement traumaque. Ici, il n’y a pas de disncon entre stress et traumasme et le recourt au stress
traumaque → confusion des deux noons du côté anglo-saxon.
- forme chronique : symptômes en rapport avec acvité NV excessive (toujours sur le qui-vive) réacon de peur exagérée, diculté de
sommeil, les symptômes le caractérisant sont des états de stress aggravés par la mise en situaon lui rappelant la situaon dans
laquelle le stress a été subi.
Ce mode de pensée a eu du mal à s’imposer excepté en Grande-Bretagne.
Dans le cadre nosographique du DSM III, les névroses (Freud) sont inclues dans 5 classes de diagnosc :
- troubles aecfs
- troubles anxieux
- troubles somatoformes
- troubles dissociafs
- troubles psycho-sexuels
Pour l’essenel des psychiatres militaires, ces médecins fondent leur concepon sur les écrits de Freud (lecture Freudienne). Ici l’apport de
Freud est fondamental dans la compréhension du traumasme psychique, en parculier à parr de deux textes de Freud qui sont
« Considéraons actuelles sur la guerre et sur la mort » en 1915 et « Au delà du principe de plaisir » en 1920. Aucun des médecins français n’y
fait référence avant 1970.
Les points posifs vont empêcher la déformaon de la membrane. En cas de stress, la membrane va se déformer.
Il y a eracon lorsqu’il y a rencontre avec le réel de la mort → image à caractère traumaque.
Après l’événement : la paroi est déformée mais l’image traumaque demeure et le paent y est soumis de manière récurrente.
Le traumasme dans les pays anglo-saxons est du au stress et la mort n’est qu’un facteur stressogène.
Cee fracture se matérialise au début des années 2000 par la créaon de la revue du « Stress et du traumasme » par Dr François Lebigot
s’opposant aux concepons anglo-saxonnes largement diusées. Exemple : les blessés d’Irak sont soignés, mais ils ne s’intéressent pas à la mort.
Le stress n’est qu’un moyen de défense face à une menace, il disparaît quand le facteur stressogène disparaît.
Les concepons anglo-saxonnes se sont imposées avec en 1992 leur inscripon dans la classicaon internaonale des maladies mentales (ce
qui marque l’hégémonie de la pensée américaine du traumasme).
II. Les lieux de prise en charge
La fréquence des troubles nerveux dans les premières semaines de la guerre a nécessité la mise en place de structures spécialisées. La créaon
de ces centres de neuropsychiatrie dans la zone des combats et les centres de neurologie et de psychiatrie à l’arrière relève de l’iniave
propre des médecins.
A. Près du champ de bataille
Dans la zone des combats, on trouve des centres neuropsychiatriques d’armée à parr de février 1915.

– 4 – / 5
Dans les centres neuropsychiatriques, l’un des objecfs consistait à éviter les exclusions hâves et injusées.
L’établissement d’un diagnosc, le traitement, le triage et l’évacuaon des soldats étaient les foncons de ces centres. Dès les premiers mois de
la guerre, les médecins ont insisté sur la précocité de la prise en charge d’abord parce qu’elle permeait le mainen du paent dans
l’atmosphère du combat (les médecins meent en avant l’importance du milieu dans lequel le malade est soigné, pour eux, il apparaît important
d’éviter une rupture avec le groupe primaire que sont les camarades), en outre, près du front, la percepon du médecin est diérente parce
qu’il est plus proche du monde du soldat, il partage sa peur, il est plus apte à le comprendre. Les condions d’écoute sont meilleures. C’est
pourquoi ils insistent sur la relave bénignité des troubles observés ce qui explique la faible durée d’hospitalisaon dans ces centres (1 à 2
semaines).
Ce qu’ils appellent le degré de curabilité apparaît étroitement lié à la fraicheur du traumasme ; plus le paent est pris en charge tôt plus le
paent a des chances de guérir vite alors que lorsque les complicaons s’installent les réponses thérapeuques deviennent plus compliquées à
mere en œuvre. Il s’agit de récupérer les hommes pour les renvoyer au combat.
B. À l’arrière
Dans les territoires, il y a des centres neurologique et psychiatriques dès octobre 1915.
Dans le cas des centres régionaux, l’évacuaon du combaant marque une rupture avec le milieu et l’oblige à se réadapter après la guérison.
Les dicultés apparaissent aussi plus grandes au médecin et les guérisons sont plus lentes à se dessiner (on parle de semaines voire de mois
pour la durée du traitement).
Ces centres étaient pourvus d’espaces verts procurant un repos au grand air pour les malades. L’un des grands principes de cee formaon
reposait aussi sur l’isolement forcé des paents : box fermé, fenêtre avec grillage, escalier avec barrière an-suicide…
La dernière étape dans la chaine d’évacuaon est la mise du paent à l’asile. Cee décision qui ne dépend plus de l’administraon militaire mais
du civil entraîne une lourde responsabilité car la décision est souvent irréversible.
Pour la deuxième guerre mondiale, les lieux de prise en charge pour les modalités de concepon reprennent celles de 14-18. L’organisaon
s’appuie sur le principe de précocité de pris en charge.
Après la WW2, les auteurs anglo-saxons marquent la persistance des séquelles psychiques bien après la guerre notamment avec l’étude de Brill
et Beebe en 1949 portant sur 1500 cas de névrose de guerre et qui montre que seulement 10% de ces vétérans ne présentaient plus aucun
symptôme. La moié de ces vétérans présentaient des séquelles mineures mais au moins 1/3 avaient besoin d’un traitement psychiatrique.
C’est la première étude dite épidémiologique de suivi. Ils insistent sur les états de stress post-trauma.
Parmi les symptômes les plus relevés :
- irritabilité
- anxiété
- migraine
- insomnie
- cauchemars
- dépression
- diculté de concentraon
- troubles gastro-intesnaux
- troubles cardio-vasculaires
- alcoolisme (violence inigée à soi même)
- douleurs neuromusculaires
III. Contenu des réponses thérapeutiques
Dans l’ensemble, le contenu des réponses thérapeuques présente une grande uniformité qu’il soit praqué à l’avant ou à l’arrière dans le cas
de la première guerre mondiale. Il n’apparaît pas non plus de spécicité marquée en foncon de la nature du traumasme.
Deux formes de réponses peuvent être dégagées : douce ou brutale.
A. Les méthodes douces ou raisonnée
Il s’agit d’une réponse thérapeuque basée sur l’hydrothérapie → prise de bain qui neoie les soldats du lien avec la guerre, avec la mort. Cela
présente également l’avantage de calmer l’excitaon, l’anxiété. L’hydrothérapie pouvait se substuer à des méthodes coercives : l’emploi de
l’eau froide pour démasquer les simulateurs notamment.
Le sommeil et le repos apparennent à ces méthodes douces. Cela permet de rompre avec le rythme du champ de bataille.
L’alimentaon parcipe également à ce type de méthode : elle permet un retour à la normalité. Il en va de même pour la rééducaon par la
gymnasque avec des mouvements très simples.

– 5 – / 5
L’hypnose a été employée dans les centres régionaux : rééducaon par la suggeson → sommeil profond, le médecin aide à recouvrir à leurs
facultés perdues.
B. Les méthodes brutales
Les méthodes brutales sont composées de l’électrothérapie. L’électricité s’inscrit dans la connuité des thérapies de la n du 19e.
Exemple : Roussi et Lhermie et leur séance d’électrisaon. Ces séances se feront sans témoin à part les aides qui mainendront les malades
nus. Le traitement se fait en posion debout et couchée. Le courant ulisé est un courant faradique → bobine liée à un l n, et tampon
humidié appliqué sur les zones. Le courant est faible au début puis il est augmenté, les tampons sont d’abord xés au niveau des zones
intéressées puis à des zones sensibles comme les lèvres ou la plante des pieds. Il s’agit avant tout de provoquer ici une sorte de déclenchement.
Ces séances peuvent durer plusieurs heures jusqu’à ce que les médecins puissent « avoir » le malade.
Dans le cas de la seconde guerre mondiale, on retrouve un peu de l’électrothérapie mais surtout l’hypnose et la narco-analyse (avec injecon
de barbiturique) avec repos, réentrainement, thérapie de groupe…
La narco-analyse se praque sous Pentothal, elle doit permere d’obtenir l’abréacon. La narco-analyse a été élaborée dès 1940 et codiée
ensuite par ses aspects d’abréacons et psychothérapiques. On retrouve les mêmes méthodes dans le cas français et le même type de
traitement.
L’abréacon est l’extériorisaon de la séquence émoonnelle du paent après lui avoir injecter du barbiturique. Soit le paent le dit lui même,
soit le médecin lui fait dire. Ensuite, il est repris par le médecin pour des séances de psychothérapies.
Le LSD est aussi employé pour parvenir à l’abréacon.
CONCLUSION
Il y a une certaine connuité dans la violence du champ de bataille, de nombreuses situaons, des rencontres avec le réel de la mort. Une
connuité que l’on retrouve dans le discours médical quant à la dénion du traumasme psychique. À une nuance près : l’inscripon dans les
corps de la sourance et des expériences dites traumaques. L’inscripon apparaît beaucoup moins importante lors de la WW2. Au point qu’il
est possible d’évoquer une sommaon.
Mere en place une thérapeuque d’urgence pose les fondements des modalités de prise en charge en insistant sur la précocité → psychiatrie
d’urgence. Le mainent d’un contact avec le milieu s’est avéré essenel dans la guérison du paent. L’expérience des évacuaons retarde les
soins.
L’organisaon matérielle de la prise en charge semble poser dès la grande guerre et subit peu de modicaons lors de la seconde. En revanche,
dans le contenu des réponses thérapeuques, on peut les qualier de moins brutales, plus humaines et une aenon est plus portée sur les
états post-traumaques, sur les séquelles post-psychiques par le biais d’études épidémiologiques. Cee mise en place d’enquête sur un moyen
ou long terme xe le rapport. Ces modalités de suivie sont encore valables aujourd’hui. Cela permet d’armer que les psychiatres ont prix en
compte de manière progressive les sourances et les blessures de guerre.
On passe d’une ère du soupçon voire de négaon à une certaine reconnaissance du traumasme psychique → ère de la vicmisaon
aujourd’hui (reconnaissance + indemnisaon).
Lien ule :
hp://www.geopsy.com/cours_psycho/le_trauma_psychique.pdf
hp://tsovorp.org/histoire/Themes/neurologieGuerreSynthese.pdf
Un arcle de Lebigot sur le traumasme psychique issu de la revu « Stress et Trauma » super +++++ :
hp://www.traumapsy.com/IMG/pdf/S_T2009-201-204_Lebigot-2.pdf
Livre : Les traumasmes psychiques de guerre de Louis Crocq
1
/
5
100%