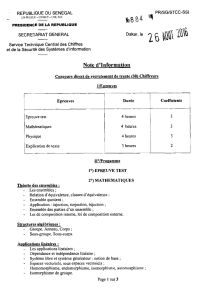Algèbre approfondie

Algèbre approfondie
Notes de cours
Master 2 Mathématiques 2013-2014
Julien Bichon
Département de Mathématiques
Université Blaise Pascal

Les pages qui suivent constituent les notes de cours “Algèbre approfondie” du Master 2
Mathématiques. Bien sûr, il est probable que des coquilles ou erreurs se sont glissées dans
ce document, merci de me les signaler !
Voici quelques références utiles.
•D. Dummit, R. Foote, Abstract algebra. Third edition, John Wiley & Sons, 2004.
•D. Guin, Algèbre (tome 1), Belin, 1997.
•D. Perrin, Cours d’algèbre, Ellipses, 1996.
•J. P. Serre, Représentations linéaires des groupes fini, Hermann, Paris, 1978.
•P. Tauvel, Mathématiques générales pour l’agrégation, Masson, Paris, 1997.
1

Table des matières
I Modules 4
A Définitions....................................... 4
B Sous-modules ..................................... 7
C Modulesquotients .................................. 10
II Modules libres 12
A Définitionetexemples ................................ 12
B Le théorème de la base incomplète . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
C Rangd’unmodulelibre ............................... 14
D Moduledetorsion................................... 17
III Algèbres 19
A Definitions....................................... 19
B L’algèbred’unmonoïde ............................... 21
C Algèbresdepolynômes................................ 22
IV Arithmétique dans les anneaux factoriels 26
A Anneauxnoethériens................................. 26
B Divisibilité....................................... 28
C Anneauxfactoriels .................................. 29
D Anneauxeuclidiens.................................. 33
E LethéorèmedeGauss ................................ 34
F Critères d’irréductibilité des polynômes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
G Polynômes cyclotomiques et applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
G.1 Généralités .................................. 39
G.2 Le théorème de Wedderburn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
G.3 Version faible du théorème de la progression arithmétique . . . . . . . 42
V Matrices à coefficients dans un anneau commutatif 44
A Matrices ........................................ 44
B Centre et idéaux d’une algèbre de matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
C Déterminant...................................... 46
D Application aux endomorphismes d’un module libre . . . . . . . . . . . . . . 48
E Application : les entiers algébriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
F Opération sur les lignes et colonnes d’une matrice . . . . . . . . . . . . . . . . 51
G Applications aux groupes linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
VI Modules de type fini sur un anneau principal 57
A Les théorèmes de structures : énoncé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
B Le théorème de la base adaptée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
C Structure des modules de type fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
D Application à la réduction des endomorphismes d’un espace vectoriel . . . . 64
D.1 Forme canonique de Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
D.2 Facteurs invariants et forme canonique rationnelle . . . . . . . . . . . . 68
2

VIIReprésentations linéaires des groupes finis 72
A Introduction ...................................... 72
B Définitions....................................... 72
C Constructions et exemples de représentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
C.1 Représentations de dimension un . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
C.2 Représentations de permutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
C.3 Somme directe de représentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
C.4 Représentationduale............................. 78
D Enoncé des théorèmes principaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
E Représentations unitaires, complète réductibilité des représentations . . . . . 80
F LelemmedeSchur .................................. 81
G Invariantsetmoyenne ................................ 81
H Relations d’orthogonalité et applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
I Structure de l’algèbre du groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
J Caractères ....................................... 87
K Application : le théorème “pq” de Burnside . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
L Exercices : exemples de représentations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
VIIIGroupes projectifs linéaires 96
A Généralités....................................... 96
B Simplicité de PSL2(K)................................ 97
C Opération sur l’espace projectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
D Critère de simplicité d’Iwasawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
D.1 Vocabulaire .................................. 101
D.2 Enoncé..................................... 102
D.3 Démonstration ................................ 102
IX le théorème des zéros de Hilbert 104
A Rappel : le théorème de Bezout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
B Ensembles algébriques affines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
C Version faible du théorème des zéros de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
C.1 Enoncé..................................... 105
C.2 Démonstration ................................ 105
C.3 Une autre démonstration (cas non dénombrable) . . . . . . . . . . . . . 107
D Le théorème des zéros de Hilbert : version générale et conséquence . . . . . . 107
A Appendice : le corps des fractions d’un anneau intègre 109
B Appendice : une autre preuve du théorème de la base adaptée 111
3

I Modules
Rappel : un anneau est un triplet (A,+,·)où Aest un ensemble non vide et
+:A×A−→ A,·:A×A−→ A
sont des lois (internes) sur Asatisfaisant aux axiomes qui suivent.
1. (A,+) est un groupe abélien. Le neutre est alors noté 0Aou 0, et le symétrique d’un élément a∈A
est noté −a.
2. (A,·)est un monoïde, c’est-à-dire que la loi ·est associative et possède un élément neutre, noté
1Aou 1.
3. On a ∀a,b,c∈A:a·(b+c) = a·b+a·c, et (b+c)·a=b·a+c·a.
Dans ce chapitre on va étudier les modules sur un anneau. Cela permet
−→de généraliser des résultats d’algèbre linéaire (les modules sur les corps étant les espaces
vectoriels),
−→ d’obtenir des résultats structurels sur les anneaux (de la même manière, on obtient des
résultats sur les groupes en les faisant opérer sur des ensembles).
Dans la suite Aest un anneau.
A Définitions
Définition A.1. Un A-module (à gauche) est un triplet (M,+, .)où (M,+) est un groupe abélien
et . : A×M−→ M est une loi externe
A×M−→ M
(a,x)7−→ a.x
vérifiant les axiomes suivants (∀a,b∈A, ∀x,y∈M) :
1. a.(x+y) = a.x+a.y,
2. (a+b).x=a.x+b.y,
3. (ab).x=a.(b.x),
4. 1.x=x.
Exemples A.2. 1. Aest un A-module, la loi externe étant la multiplication de A.
2. Pour n∈N∗,Anest un A-module, dont le groupe abélien sous-jacent est le groupe
abélien produit Anet la loi externe est donnée par
a.(x1, . . . , xn) = (ax1, . . . , axn)
3. Si Aest un corps, un A-module est exactement un A-espace vectoriel.
4
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
1
/
113
100%
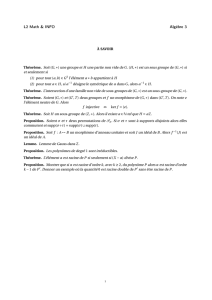
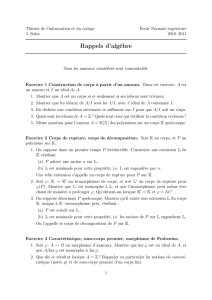
![14 C[X, Y ]/(X 2 + Y 2 − 1) principal - Agreg](http://s1.studylibfr.com/store/data/003770161_1-f3ec298fcc6df231437153404bd18909-300x300.png)

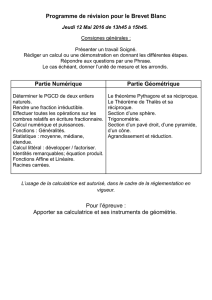


![L`anneau Z[i] et le théorème des deux carrés](http://s1.studylibfr.com/store/data/001182405_1-c5de184ddbb980fbc51248e036ae00d6-300x300.png)