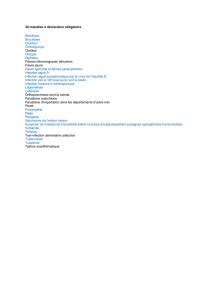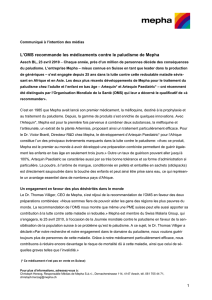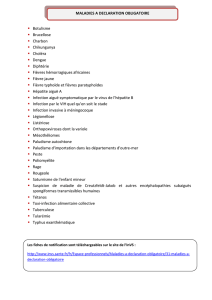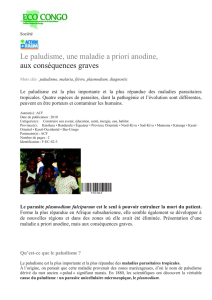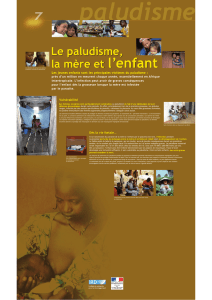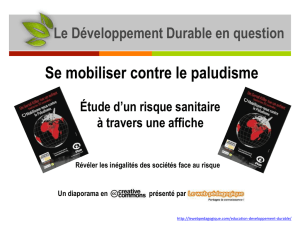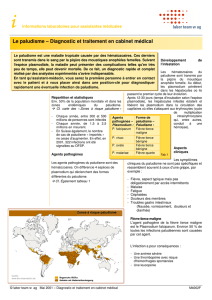Lire l'article complet

Professions Santé Infirmier Infirmière N° 55 • mai 2004
Actua l ité Sa nté
9
S
elon l’OMS, plus de deux mil-
l i o n s
de personnes décè-
dent chaque année du
paludisme, appelé parfois malaria,
dont plus d’un million, soit la moi-
tié, sont des enfants de moins de
5ans. Sur les 40 % de la popula-
tion potentiellement à risque, plus
de 400 millions de nouveaux cas
se déclarent chaque année. Si plus
de 90 % de l’Afrique est infestée,
l’Asie et l’Amérique latine n’en sont
pas exemptes. Maladie endémique
sur ces trois continents, le palu-
disme est fortement exporté, au
point que plus de 8 0 0 0 cas ont
été dénombrés en France en 2001,
causant 20 décès. Plus de 90 %
des paludismes importés provien-
nent d’Afrique, touchant 1 à 2 %
des voyageurs. Plus rarement, sont
atteints les personnes résidant à
proximité des aéroports ou les per-
sonnels y travaillant.
Cause et diagnostic
Le vecteur est un moustique : l’ano-
phèle femelle, qui infecte l’homme
en le piquant et le contamine,
après avoir piqué une personne
déjà infectée, avec le principal res-
ponsable du paludisme et le plus
mortel : le Plasmodium falciparum,
ou, à un degré moindre, avec le
Plasmodium vivax, le P l a s m o d i u m
ovale ou le Plasmodium malariae.
L’homme est le seul réservoir de ces
parasites, qui migrent alors dans la
circulation et se divisent rapidement
au sein du foie, au cœur de l’hépa-
tocyte. Les nouveaux parasites, libé-
rés dans le sang, pénètrent alors
dans les globules rouges, qu’ils
infectent. Aucune contamination
interhumaine n’est possible, excepté
par voie transplacentaire.
Du fait de la multiplicité des signes
pouvant révéler la maladie, toute
fièvre survenant chez une personne
o r i ginaire ou revenant d’une zone
infestée peut et doit, sauf preuve
du contraire, signifier un paludisme.
Après une incubation de 7 jours, le
premier accès palustre se mani-
feste par un syndrome grippal : une
fièvre évoluant de manière conti-
nue ou, au contraire, par poussées
accompagnées d’asthénie, de myal-
gies,
de courbatures, de céphalées.
Parallèlement, comme pour la grippe,
quelques nausées et vomissements
sont possibles, de même que
quelques troubles du transit. Un
gros foie peut être perçu à l’exa-
men, ainsi qu’une grosse rate, d’ap-
parition souvent plus tardive.
Première ma l adie infe ctieuse dans le monde et la plus
m e u rtr i è r e , le paludisme touche de manière endémique les
p o p u l a t ions des zo n e s tro p i ca l es, mais aussi, occa s i o n n e l-
l e m e nt, les voya g e u r s revena n t des régions to u c h é e s .
Paludisme
Une éradication encore lointaine
Lorsque, après cette primo-invasion,
les globules rouges laissent échap-
per dans le sang les parasites qui se
sont multipliés, les frissons devien-
nent intenses, avec tremblements
et sueurs froides. Puis survient une
fièvre élevée, supérieure en
moyenne à 40 °C, une rémission
complète pouvant durer quelques
heures avant la réapparition de tous
les signes. C’est cette rythmicité qui
est alors pathognomonique, selon
un rythme tierce ou fièvre tierce sur
48 heures et quarte sur 72heures.
À chaque décharge parasitaire cor-
respond un accès. Lors de l’accès, le
prélèvement par goutte épaisse
signe le diagnostic.
Complications
En l’absence de traitement adapté
peut survenir l’accès pernicieux
entraînant une anoxie cérébrale. De
même, une méningite, des convul-
sions, une anémie, un syndrome
h é m o r r a g ique sont à craindre. Les
troubles sont plus graves, voire
mor-
Infos
...
Protection
Les moustiquaires
imprégnées
d’insecticide offrent
une bonne protection
contre le paludisme.
Si elles sont
correctement utilisées
et associées à
un traitement précoce
au niveau de
la communauté,
la transmission
du paludisme pourra
reculer de 60 % et
le taux global de
mortalité chez
les enfants en bas âge
diminuer d’environ
un cinquième.
Source : Unicef
Goutte épaisse et frottis mince
✓
Principe
Sur une goutte épaisse, à l’inverse du frottis mince, les parasites sont
concentrés au maximum sur la plus petite surface possible.
✓
Technique
Le prélèvement se fait au bout du doigt, au vaccinostyle, à partir d’une
grosse goutte de sang. Placée sur une lame, celle-ci est défibrinée à l’aide
du vaccinostyle pendant une minute, mise à sécher pendant 24 heures,
recouverte d’eau distillée pour deshémoglobiniser et colorée par Diff-Quick
ou Giemsa.
Pour accélérer l’examen, on peut pratiquer une cytocentrifugation après
hémolyse : le résultat est alors disponible en 1 heure.
✓
Résultats
Les hématies ayant disparu, grâce à l’hémolyse, les parasites apparais-
sent plus aisément. La goutte épaisse permet aussi le diagnostic de filarioses
à microfilaires sanguines. Si la goutte épaisse est l’examen le plus connu
pour le diagnostic d’urgence du paludisme, le frottis mince donne de
meilleurs résultats, et plus rapidement. Ainsi, il est possible de déterminer
le type de Plasmodium : P. falciparum, P. malariae, P. ovale, P.vivax. La
parasitémie calculée supérieure à 3 % est considérée comme dangereuse
(il s’agit du nombre de parasites pour 100 leucocytes).
En cas de doute sur un accès palustre et de frottis négatif, il faut refaire ce
dernier et commencer un traitement sans en attendre les résultats. En ce qui
concerne le frottis mince, il faut signaler au laboratoire la prise éventuelle
d’antimalariques susceptibles d’altérer les formes parasitaires typiques.
>>
Actualités 22/06/04 16:17 Page 9

tels, chez le jeune enfant, la femme
enceinte et les personnes immuno-
déprimées. Les atteintes cardiaques,
hépatiques, spléniques sont surtout le
fait de réinfestations multiples chez
des patients séjournant sans protection
dans les zones endémiques.
Traitement
Il faut rappeler que cette maladie
parasitaire est la plus répandue dans
le monde et la seconde parmi les plus
m e u rtrières dans les pays en dévelop-
pement. Selon Médecins du monde*,
elle est actuellement en pleine recru-
descence, et sévit dans plus de
10 0 pays représentant au total 40 %
de la population mondiale.
Pour les voyageurs se rendant dans
les zones infestées, le meilleur traite-
ment demeure prophylactique. Il
n’existe pas de vaccin contre le palu-
disme, et aucun n’est en vue, selon
les chercheurs, avant une quinzaine
d’années.
D’abord, il s’agit donc de se protéger
contre les moustiques : physique-
ment, grâce au port de vêtements
amples, à manches longues à la tom-
bée du jour, à l’utilisation de mousti-
quaires autour des lits des jeunes
enfants notamment. Chimiquement,
les répulsifs doivent être largement
utilisés sur soi, répandus dans l’atmo-
sphère de la pièce, jusque sur les
moustiquaires.
La prophylaxie individuelle médica-
menteuse est différente selon la per-
sonne et son lieu de destination (voir
e n c a d r é ) . Selon la personne, il faut
toujours tenir compte du passé médi-
cal, du présent (grossesse, par
exemple), des traitements en cours,
de l’état immunitaire.
Il peut ainsi être souhaitable de
tester la tolérance des médications
avant le départ pour prévenir tout
incident sur place. Habituellement,
le traitement sera commencé un
peu avant le départ, poursuivi pen-
dant tout le voyage et une à quatre
semaines après le retour : une,
pour atovaquone + proguanil seu-
lement, mais quatre pour toutes
les autres spécialités. Il existe en
effet des formes retard de déclen-
chement du paludisme.
Si le voyage comprend des périodes
où l’on risque de se trouver loin de
tout centre hospitalier, il faut se munir
d’un traitement de réserve à prendre
en cas de doute. Ce traitement de
réserve sera prescrit avant le départ et
comprendra soit de la quinine, soit de
la méfloquine, soit de l’halofantrine
( l ’ ECG est indispensable pour dia-
gnostiquer les risques de troubles du
rythme cardiaque induits).
Toujours selon Médecins du monde,
les antipaludéens classiques ne sont
plus efficaces dans nombre de pays
où ils sont néanmoins utilisés comme
protocole national. Le nombre de cas
est ainsi quatre fois plus élevé que
dans les années 70, en raison de
l’augmentation de la résistance des
parasites du paludisme aux traite-
ments. Et, depuis 2000, on assiste
même à des flambées épidémiques
au Burundi, dans le sud du Soudan et
en Éthiopie. Ce phénomène avait
p o u r tant disparu. Pour soigner les
patients atteints, les dérivés d’artémi-
sine semblent offrir de réels avan-
tages par rapport au traitement anti-
paludique classique, car ils sont plus
efficaces contre le parasite et agissent
plus rapidement, sans trop d’effets
indésirables. Mais leur coût est un
frein pour les pays pauvres.
JB
*www.msf.fr et www.accessmed-msf.org
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 55 • mai 2004
Actua l ité Sa nt é
1 0
Prophylaxie selon la destination
Type de pays Chloroquinorésistance Prophylaxie
Type I 0 Chloroquine
Type II + Chloroquine, proguanil
Type III +++ Méfloquine ou
atovaquone chloroquine
ou doxycycline
Savez-vous que le premier décès
dans le monde dû à un véhicule
motorisé a eu lieu le 17 a o û t
1896, à Londres ? La victime s’ap-
pelait Bridget Driscoll, elle avait
44 ans, et a été renversée par une
voiture en traversant l’esplanade
du Palais. Le véhicule roulait “pro-
bablement” à 12 km/h au lieu
des 6,4 km/h qu’il n’était pas
sensé dépasser.
Aujourd’hui, selon l’OMS, chaque
j o u r, il y a 140 0 0 0 blessés sur
les routes du monde. Près de
30 0 0 personnes meurent et
1 5 000 environ resteront handi-
capées à vie. Si les tendances
actuelles se confirment, on assis-
tera, d’ici 2020, à une augmenta-
tion de 60% du nombre des per-
sonnes tuées ou handicapées
suite à un accident de la route.
Paradoxalement, les pays les plus
motorisés, qui, compte tenu de
leur expérience ancienne, ont
engagé des programmes de
sécurité routière, enregistrent les
taux de mortalité les plus bas
(taux annuels inférieurs à
6 , 0 p o u r 10 0 000 habitants).Le s
hommes ont une probabilité
presque trois fois plus grande que
les femmes de mourir d’un acci-
dent de la route, et plus de 50 %
de la mortalité concernent les
personnes âgées de 15 à 44 ans.
Les piétons, les cyclistes et les
motocyclistes courent un risque
plus grand par kilomètre par-
couru. Compte tenu du manque
d’infrastructures adéquates, de
mesures éducatives, etc., les habi-
tants les plus vulnérables sont les
piétons des pays à faibles revenus
ou à revenus intermédiaires. Ces
pays ont d’ailleurs une part dis-
p r o p o r tionnée, par rapport au
nombre de véhicules motorisés,
dans la charge mondiale crois-
sante de morbidité due aux acci-
dents de la route.
Source OMS à propos de
la Journée mondiale de la santé
du 7 avril 2004.
En bref ...
L’accident de la route
n’est pas une fatalité
Infos
...
Afrique et
paludisme
Le coût de prise
en charge des
hospitalisations des
cas graves (en
moyenne 30 à 50 %
des admissions
dans les hôpitaux en
Afrique) serait de
12 milliards de
dollars par an.
La maladie a
des répercussions
sévères sur
le développement
des populations.
La fièvre empêche
l’enfant d’aller à
l’école et l’adulte
d’aller au travail
notamment celui des
champs qui est vital
pour ces populations.
La journée mondiale
du paludisme a eu
lieu le 25 avril.
>>
Actualités 22/06/04 16:17 Page 10
1
/
2
100%