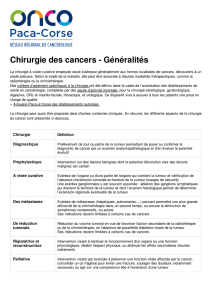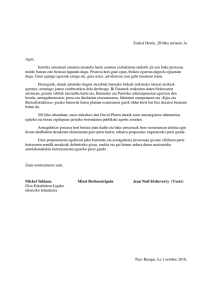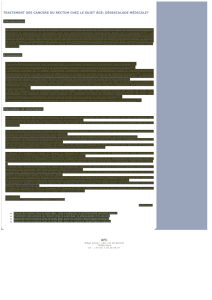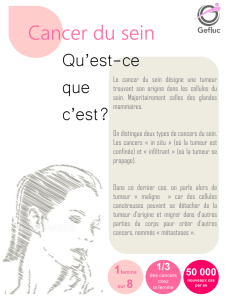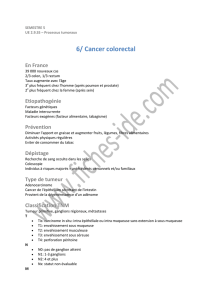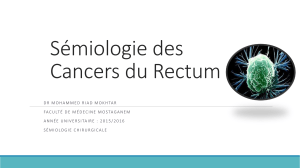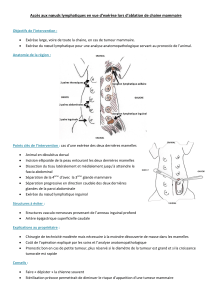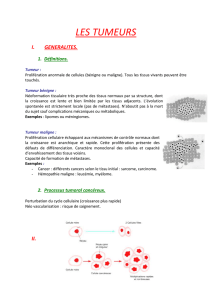Traitement chirurgical par voie transanale des polypes malins du rectum Critères morphologiques

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001
Points forts
Points forts
Points forts
●
C. Denet*
Traitement chirurgical par voie transanale
des polypes malins du rectum
e traitement par voie transanale des
polypes malins du rectum est une
alternative possible au traitement de réfé-
rence des cancers du rectum, qui associe
une exérèse du rectum et de ses relais gan-
glionnaires (mésorectum et axe mésenté-
rique inférieur). L’exérèse transanale
(ETA) a comme avantage d’être moins
mutilante qu’une exérèse radicale (ER) et
moins morbide, tant pour les complications
postopératoires que pour les séquelles
fonctionnelles digestives, sexuelles et uri-
naires. En revanche, si le cancer est inva-
sif, ce traitement, purement local, mécon-
naît la possibilité d’un envahissement
ganglionnaire (EG). L’indication d’une
ETA est donc fondée sur un faisceau de cri-
tères cliniques, morphologiques et histo-
logiques précis.
AVANT LE TRAITEMENT
CHIRURGICAL
Il faut réunir l’ensemble des critères de
sélection, en sachant que le bien-fondé du
choix thérapeutique n’est parfois acquis
qu’à la lecture histologique de la totalité
de la pièce d’exérèse.
Critères cliniques
et endoscopiques
Au toucher rectal, une tumeur fixée ou
occupant plus du tiers de la circonférence
du rectum n’est a priori pas accessible à
une ETA. La palpation d’une adénopathie
suspecte nécessite une confirmation mor-
phologique avant de contre-indiquer une
ETA. L’endoscopie permet d’apprécier la
taille et l’aspect macroscopique de la
tumeur. Classiquement, la taille du cancer
ne doit pas excéder 3 cm : ce critère est de
plus en plus controversé et ne semble
influencer ni le risque d’EG (1),ni le risque
de récidive locale (2) ; une tumeur de plus
de 3 cm ne contre-indique pas a priori une
ETA.
Critères morphologiques
L’écho-endoscopie (EE) évalue correcte-
ment l’envahissement pariétal dans 67 à
93 % des cas ; ces résultats semblent moins
précis si la tumeur est localisée dans le bas
rectum (4). Elle est aussi moins perfor-
mante dans la détection des métastases
ganglionnaires (MG) (62 à 88 % des cas)
pour deux raisons :
– la possibilité de micro-métastases au sein
d’un ganglion ;
– la taille et le nombre de ganglions enva-
his dans les tumeurs T1 ou T2, inférieurs
à ceux observés dans les tumeurs plus
avancées.
Si l’un des critères retenus pour le dia-
gnostic de MG est un diamètre d’au
moins 5 mm, le diagnostic est correct
dans 89 % des cas avec une spécificité de
94 % mais une sensibilité faible de 38 %,
puisque, dans environ 20 % des cas, la
MG est inférieure à 4 mm (4, 5). Si le cri-
tère de taille est fixé à 3 mm (5) pour les
tumeurs T1 et T2, l’EG est surestimé
(sensibilité 75 %, spécificité 49 %). Cer-
taines équipes proposent, afin d’amélio-
rer les performances de l’EE, de réaliser
des biopsies des ganglions suspects sous
EE (5, 6). Le scanner et l’imagerie par
résonance magnétique nucléaire sont
moins performants que l’EE pour les can-
cers dits “superficiels” (tant pour le degré
d’envahissement pariétal que pour la
détection de MG) (4).
Critères histologiques
Avant l’intervention, les biopsies peren-
doscopiques permettent d’exclure des can-
cers invasifs sans permettre de poser for-
mellement le diagnostic de cancer
superficiel. L’intérêt de la chirurgie trans-
anale est alors de proposer une exérèse
complète de la lésion et de déterminer si
* Institut mutualiste Montsouris, département
médico-chirurgical de pathologie digestive, Paris.
◆Une tumeur de plus de 3 cm, ulcérée,
n’est pas une contre-indication formelle à
une résection locale.
◆L’écho-endoscopie est l’examen pré-
opératoire qui évalue le mieux l’envahis-
sement pariétal.
◆L’exérèse transanale isolée peut être
proposée pour des cancers au plus T1 ; la
profondeur de l’envahissement de la sous-
muqueuse restant un critère décisionnel
essentiel.
◆Pour une tumeur T1 bien différenciée,
la survie à 5 ans après traitement local
varie de 90 à 100 %.
Points forts
Points forts
Points forts
L
Dossier thématique
96
CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:22 Page 96

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001
un traitement plus mutilant est nécessaire
ou non. La présence d’un cancer invasif
peu différencié ou indifférencié sur la
biopsie préopératoire est une indication
pour de nombreux auteurs à une ER.
L’ INTERVENTION
Techniques
d’exérèse chirurgicale
Une préparation colique et une antibio-
prophylaxie sont recommandées pour ce
type de chirurgie. Les ETA se font sous
anesthésie générale ou loco-régionale. Le
malade est installé en fonction de la loca-
lisation de la tumeur : position de la taille
pour les lésions postérieures ou latérales,
en procubitus ventral pour les lésions
antérieures.
La section muqueuse est réalisée à au
moins 1 cm des berges de la lésion.
L’exérèse emporte toute la paroi rectale
et si possible la graisse périrectale. Pour
les lésions antérieures du rectum sous-
douglassien, l’exérèse est plus limitée, de
façon à éviter les fistules recto-vaginales
chez la femme ou recto-urétrales chez
l’homme. Le risque pour les lésions anté-
rieures du rectum sus-douglassien est une
perforation rectale en péritoine libre.
ETA classique
La technique du parachute est indiquée
pour les tumeurs situées à moins de 10 cm
de la ligne pectinée. Après dilatation anale,
l’exposition de la tumeur se fait habituel-
lement avec deux valves vaginales étroites.
Des fils sont placés sur le pourtour de la
tumeur, au moins à un centimètre des
berges. La traction de ces fils donne un
aspect de parachute, d’où l’appellation de
la technique. Cette manœuvre permet une
bonne exposition de la zone à sectionner
et garantit une marge de sécurité de 1 cm
entre les berges de la tumeur et la zone de
section. Les berges peuvent être refermées
par des points séparés de fil résorbable. De
principe, ou en cas de traction excessive,
la plaie peut être laissée ouverte, la cica-
trisation se faisant par réépithalisation.
L’alternative à cette technique est la tech-
nique du lambeau tracteur, lambeau débuté
au-dessus de la ligne pectinée et qui per-
met l’exérèse de la lésion en l’abaissant
progressivement hors de l’anus.
Microchirurgie endoscopique (ME)
Cette technique, peu développée en France,
est particulièrement adaptée pour les
tumeurs du moyen et du haut rectum (2). Le
matériel utilisé comprend un rectoscope,
muni d’un système d’insufflation permet-
tant de distendre le rectum, et par lequel
peuvent être introduits plusieurs instru-
ments chirurgicaux. L’exérèse est réalisée
selon les mêmes principes qu’une ETA clas-
sique : section à 1 cm des berges de la
tumeur et exérèse de la totalité de la paroi
rectale. Les berges sont rapprochées par un
surjet de fil résorbable.
Résultats de l’ETA
pour les polypes malins
du rectum
Complications postopératoires
La mortalité postopératoire après ETA est
quasiment nulle (2, 7, 8). La morbidité
après ETA est faible et globalement infé-
rieure à 5 % (8,9). Elle est d’environ 20 %
après ME (9, 10). Aucune séquelle sur la
fonction intestinale n’a été décrite après
ETA.
Analyse histologique
L’objectif de l’étude histologique est
double : confirmer le caractère complet de
l’exérèse et déterminer les caractéristiques
de la tumeur augmentant le risque d’EG.
En cas de carcinome in situ, le risque
d’EG est nul, et l’ETA, si l’exérèse est
complète, reste le traitement de choix. Si
le cancer est invasif, le risque d’EG aug-
mente proportionnellement au degré d’in-
filtration pariétale :T1 (envahissement de
la sous-muqueuse) 3 à 17 % d’EG, T2
(envahissement de la musculeuse) 15 à
30 %, T3 (envahissement de la sous-
séreuse) 50 à 65 % (1, 3, 5, 11, 12).
D’autres facteurs histologiques augmen-
tent la fréquence des métastases gan-
glionnaires : le caractère peu différenciée,
voire indifférencié, de la tumeur, (1, 8, 11,
13), la présence d’un envahissement vas-
culaire ou lymphatique (1, 8, 11, 13),la
présence d’un contingent colloïde
muqueux (13). Ce dernier critère est
actuellement débattu : plusieurs études
ont montré qu’il n’influençait ni le risque
d’EG (1), ni celui de récidive locale (8,
9). Le risque d’EG pour une tumeur T1
bien différenciée sans envahissement
vasculaire ou lymphatique est évalué par
Blumberg et al. (1) à 7 %. Ce risque est
nul dans l’étude de Brodsky et al. pour
les tumeurs T1 sans envahissement lym-
phatique, mais l’effectif des malades est
faible, puisque inférieur à 20 (1). Des
études japonaises ont proposé, comme
autre critère corrélé au risque d’EG, le
degré d’infiltration de la tumeur dans la
sous-muqueuse (SM) : sm1 (1/3 superfi-
ciel de la SM), sm2 (1/3 moyen de la
SM), sm3 (1/3 profond de la SM) : le
risque d’EG est plus faible pour les
tumeurs sm1 et sm2 que pour les tumeurs
sm3 (11).
Sur la pièce d’exérèse après ETA, les cri-
tères habituellement requis sont (a) un car-
cinome invasif ne dépassant pas la SM, (b)
un carcinome bien différencié ; (c) des
marges latérales et profondes saines ; (d)
l’absence d’envahissement vasculaire ou
lymphatique ; (e) selon les auteurs, l’ab-
sence de contingent colloïde muqueux (7,
9, 14, 15). Si l’un de ces critères n’est pas
respecté, une ER ou, si elle n’est pas envi-
sageable, une radiochimiothérapie doit être
proposée au malade (7, 9, 14, 15).
Résultats carcinologiques
Les résultats de l’ETA dans la littérature
sont d’interprétation difficile parce que (a)
les critères de sélection ne sont pas tou-
jours précisés ou varient d’une étude à
l’autre, (b) les populations de malades sont
hétérogènes dans une même série, (c) cer-
taines études incluent des cancers de stade
et de différenciation différents ; (d) la
majorité des études sont rétrospectives ; (e)
dans une même série, les traitements sont
parfois différents, tant par la technique uti-
lisée (ETA, exérèse par voie transsacrée,
destruction par fulguration ou électrocoa-
gulation…) que par leur caractère curatif
ou palliatif ; (f) le suivi des malades est
souvent inférieur à 5 ans.
Après ETA pour un cancer T1 bien diffé-
rencié, le taux de récidive locale varie de
0 à 13 % et la survie à 5 ans de 90 à 100 %
Dossier thématique
97
CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:22 Page 97

Le Courrier de colo-proctologie (II) - n° 3 - septembre 2001
(3, 5, 8, 14). Une étude randomisée com-
parant l’ETA par ME et une ER pour des
cancers T1 bien ou moyennement diffé-
renciés n’a montré aucune différence
significative en termes de récidive locale
et de survie à 5 ans entre les deux groupes.
Mais les effectifs de ces deux groupes sont
faibles (26 malades pour le groupe ER,
24 pour le groupe ME), et le suivi dans les
deux groupes est inférieur à 4 ans. Néan-
moins, Garcia-Aguilar et al. (7)rapportent
un taux de récidive à 54 mois de 18 % pour
des cancers classés T1 traités par ETM et
répondant aux critères histologiques
requis, ce qui ne correspond pas aux résul-
tats attendus après ER. Certains proposent
même un traitement adjuvant après ETA
pour des cancers classés T1 (7, 15).
Surveillance
Une surveillance postopératoire régu-
lière, comprenant au minimum un exa-
men physique, une rectoscopie et une
écho-endoscopie, est indispensable. Le
choix d’une ETA doit être remis en ques-
tion si cette surveillance ne peut être
assurée.
CONCLUSION
Actuellement, en cas de cancer invasif, aucun
critère clinique, morphologique ou histolo-
gique ne permet d’éliminer formellement un
EG associé ; par conséquent, une ETA
expose le malade à un risque de récidive le
plus souvent accessible à une chirurgie de
rattrapage, mais dont les résultats sur le plan
carcinologique semblent inférieurs à ceux
d’une ER de première intention (16).
D’après les résultats publiés dans la littéra-
ture, l’ETA peut être proposée pour les can-
cers T1, idéalement sm1 ou sm2, bien dif-
férenciés, sans envahissement lymphatique
ou vasculaire, avec des marges de section
saine ; mais ce traitement, en l’état actuel de
nos connaissances, ne peut être considéré
comme le traitement de référence. Pour les
autres cancers T1 ne répondant pas à ces cri-
tères, et a fortiori pour les cancers T2, l’ETA
ne peut être considérée comme un traitement
curatif, et une ER doit être proposée au
malade. En cas de refus par le malade, ou si
l’état général du malade ne permet pas une
ER, l’ETA doit être complétée par un trai-
tement adjuvant. ■
Mots clés. Cancer du rectum – Chirurgie trans-
anale – Polype malin.
RÉFÉRENCES
1. Brodsky JT, Richard GK, Cohen AM, Minsky BD.
Variables correlated with the risk of lymph node
metastasis in early rectal cancer. Cancer 1992 ; 69
(2) : 322-6.
2. Benoist S, Taffinder N, Gould S et al. Transanal
endoscopic microsurgery : a forgotten minimally
invasive technique. Gastroenterol Clin Biol 2001 ;
25 (4) : 369-74.
3. Lasser P, Goharin A. Local treatment of rectal
cancer. Ann Chir 2000 ; 125(3) : 213-21.
4.Heriot AG, Grundy A, Kumar D. Preoperative sta-
ging of rectal carcinoma. Br J Surg 1999 ; 86 (1) :
17-28.
5. Akasu T, Kondo H, Moriya Y et al. Endorectal
ultrasonography and treatment of early stage rectal
cancer. World J Surg 2000 ; 24(9) : 1061-8.
6. Milsom JW, Czyrko C, Hull TL et al. Preoperative
biopsy of pararectal lymph nodes in rectal cancer
using endoluminal ultrasonography. Dis Colon
Rectum 1994 ; 37 (4) : 364-8.
7. Garcia-Aguilar J, Mellgren A, Sirivongs P et al.
Local excision of rectal cancer without adjuvant the-
rapy : a word of caution. Ann Surg 2000 ; 231 (3) :
345-51.
8. Bleday R, Breen E, Jessup JM et al. Prospective
evaluation of local excision for small rectal cancers.
Dis Colon Rectum 1997 ; 40 (4) : 388-92.
9.Benoist S, Panis Y, Martella L et al. Local excision
of rectal cancer for cure : should we always regard
rigid pathologic criteria ? Hepatogastroenterology
1998 ; 45 (23) : 1546-51.
10. Winde G, Nottberg H, Keller R et al. Surgical
cure for early rectal carcinomas (T1). Transanal
endoscopic microsurgery vs anterior resection. Dis
Colon Rectum 1996 ; 39 (9) : 969-76.
11.Nivatvongs S. Surgical management of early colo-
rectal cancer. World J Surg 2000 ; 24 (9) : 1052-5.
12. Graham RA, Garnsey L, Jessup JM. Local exci-
sion of rectal carcinoma. Am J Surg 1990 ; 160 (3) :
306-12.
13. Goldstein NS, Hart J. Histologic features asso-
ciated with lymph node metastasis in stage T1 and
superficial T2 rectal adenocarcinomas in abdomino-
perineal resection specimens. Identifying a subset of
patients for whom treatment with adjuvant therapy or
completion abdominoperineal resection should be
considered after local excision. Am J Clin Pathol
1999 ; 111 (1) : 51-8.
14.Banerjee AK, Jehle EC, Shorthouse AJ, Buess G.
Local excision of rectal tumours. Br J Surg 1995 ; 82
(9) : 1165-73.
15. Lamont JP, McCarty TM, Digan RD et al.
Should locally excised T1 rectal cancer receive adju-
vant chemoradiation ? Am J Surg 2000 ; 180(6) :
402-5 ; discussion 405-6.
16. Baron PL, Enker WE, Zakowski MF, Urmacher
C. Immediate vs salvage resection after local treat-
ment for early rectal cancer. Dis Colon Rectum
1995 ; 38 (2) : 177-81.
Dossier thématique
98
CP septembre MAQ.ok 31/10/01 09:22 Page 98
1
/
3
100%