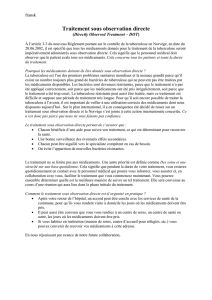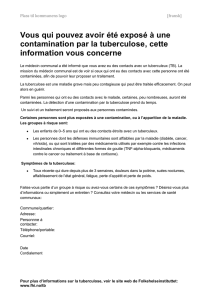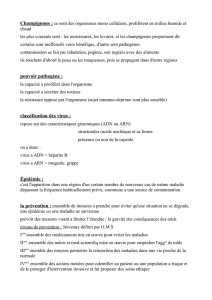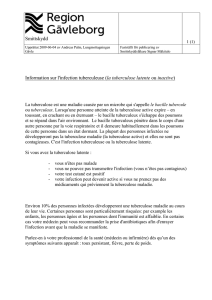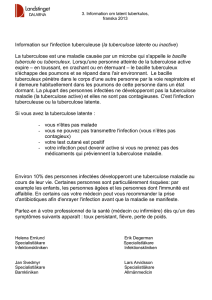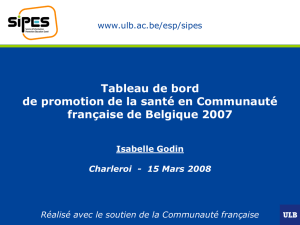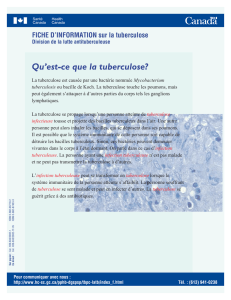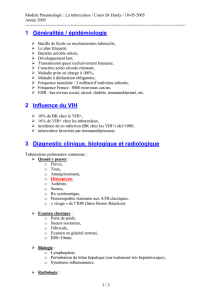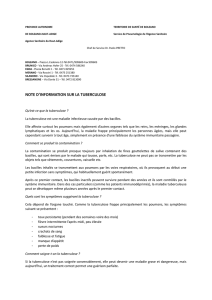Tuberculose et VIH : duo meurtrier

16
Transversal n° 38 septembre-octobre dossier
dossier par Victoire N’Sondé
Tuberculose et VIH :
duo meurtrier
hépatites virales (ANRS) basée à Abidjan (Côte d’Ivoire). Or
le risque de contracter la tuberculose s’accroît chez les per-
sonnes séropositives immunodéprimées. C’est pourquoi cette
maladie infectieuse est l’une des plus courantes chez ces der-
nières. Ainsi, en Afrique, elle est la maladie opportuniste la
plus répandue. Elle peut s’accompagner de récidives, ce qui
complique la donne, comme l’explique le DrAnglaret : « Une
fois guérie, la tuberculose a tendance à récidiver davantage
chez les personnes infectées par le VIH ; cela est très pro-
bablement dépendant de l’immunodépression. Des études
qui avaient pour objet de caractériser les souches de bacilles
responsables des récidives ont en effet mis en évidence le
fait que pour la tuberculose elles pouvaient être provoquées
par des souches responsables des contaminations précé-
dentes – le bacille n’avait pas été complètement éradiqué
malgré la guérison – ou par de nouvelles infections. »
Une tuberculose atypique difficile à diagnostiquer. Contrairement
à une idée très répandue, la tuberculose ne touche pas exclusi-
vement le système respiratoire, même si dans plus de trois quarts
des cas, le bacille se loge effectivement au niveau des poumons.
Ainsi, chez les personnes vivant avec le VIH et contaminées par
le BK, les localisations extrapulmonaires sont plus fréquentes.
On peut retrouver le bacille dans les ganglions, au niveau de la
plèvre (enveloppe des poumons), voire, pour des formes parti-
culièrement sévères, disséminé dans tous les organes. Il existe
également des formes mixtes qui combinent des localisations
pulmonaires et extrapulmonaires.
Chez les personnes séronégatives, les tuberculoses pulmonaires
sont aisément décelées par radiographie. Si cette dernière
montre une anomalie, les crachats du sujet sont analysés au
microscope afin de repérer la présence du bacille. Chez les per-
sonnes séropositives, même dans le cas de tuberculose pulmo-
naire, les signes sont moins typiques. « La tuberculose creuse
des cavernes au niveau des poumons chez les personnes infec-
tées par le bacille quand le système immunitaire fonctionne,
décrit le PrBrigitte Autran, du laboratoire d’immunologie cellu-
laire et tissulaire de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris). Ces
cavernes traduisent la défense du système immunitaire. Chez
les personnes séropositives, en l’absence de lymphocytes CD4,
le système immunitaire est incapable de faire ce travail. Il n’y
PLUS D’INFORMATIONS
OMS en ligne
www.who.int/tb/en/
pour la tuberculose
et www.who.int/tb/hiv/en/
pour la coïnfection TB/VIH
Comment la bactérie et le virus accentuent-ils
mutuellement leurs effets dévastateurs ? Quelles
sont les recommandations thérapeutiques
principales à suivre sur le terrain ?
Face à l’urgence du phénomène, notamment
pour les pays en développement, tour d’horizon
des recherches et des solutions actuelles.
La tuberculose et l’infection au VIH : deux pandémies mon-
diales intimement liées et particulièrement ravageuses dans les
régions du monde où la situation sanitaire est la plus critique.
Les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont
sans équivoque : 14 millions de personnes vivent avec une
coïnfection tuberculose/VIH. Cette dernière est responsable
d’environ 200 000 décès chaque année. L’Afrique est de loin le
continent qui paie le plus lourd tribut. Les perspectives y sont
d’autant plus alarmantes que, comme en Asie, l’incidence de la
tuberculose progresse alors qu’elle baisse partout ailleurs. Si, au
niveau mondial, les pays situés au sud du Sahara recensent le
plus grand nombre de cas de tuberculose, six pays asiatiques
concentrent la moitié des nouvelles incidences : Bangladesh,
Chine, Inde, Indonésie, Pakistan et Philippines.
Les personnes séropositives en première ligne. Un tiers de la
population mondiale est porteuse de la bactérie responsable de
la tuberculose, le bacille de Koch (BK), mais la maladie ne se
déclare que si ce bacille devient actif. « Il n’existe cependant
pas de tests biologiques réellement performants permettant
de dire que quelqu’un est porteur ou non du bacille de
Koch », prévient le DrXavier Anglaret, de l’université française
Victor-Segalen Bordeaux 2, coordinateur scientifique d’une
équipe de l’Agence nationale de recherches sur le sida et les

active en cours d’évolution a été écarté. Plusieurs essais rando-
misés ont mis en évidence l’efficacité de ce protocole, qui dimi-
nuerait d’un facteur 2 le risque de tuberculose. «Pour autant, il
n’est pas du tout appliqué en Afrique, témoigne Xavier Anglaret.
La prophylaxie antituberculeuse est regardée avec perplexité.
D’une part, si le bénéfice à court terme a été prouvé, il n’en est
pas de même pour celui potentiel à 5 ans ou 10 ans. Et cela
génère la peur que le risque de réinfection persiste dans les
zones de forte endémie. Cette prophylaxie ne serait alors qu’un
coup d’épée dans l’eau… D’autre part, avec ce protocole, on a
recours à un traitement antituberculeux incomplet, puisque
basé sur une seule molécule [lire p. 19]. Ce qui entraîne la
peur panique des résistances. Il faut être sûr que la personne ne
couve pas une tuberculose active. Il est possible de gérer ce
risque de manière individuelle, mais pas globalement, en terme
de programme. » Ce qui ne saurait empêcher le chercheur et
son équipe de s’intéresser tout particulièrement à cette problé-
matique. « Nous souhaiterions remettre cette prophylaxie en
perspective en la couplant à un traitement précoce avec les
ARV. » Pour cela, ils préparent un essai randomisé baptisé
Temprano (ANRS 12136), qui sera mené chez des personnes
ne présentant pas de critères cliniques de mise en route immé-
diate d’un traitement antirétroviral. Temprano comparera l’effi-
cacité de la stratégie actuelle de l’OMS à deux autres interven-
tions non recommandées par l’agence onusienne : recourir à six
mois de prophylaxie par isoniazide avant la mise sous ARV ou au
contraire débuter ces derniers plus précocement.
Des spécificités liées au cotraitement. En prévention d’une
rechute de tuberculose, le moment le plus opportun pour prescrire
les ARV fait débat. On comprendra facilement que la question
se pose de manière encore plus criante dans le cas de figure où
a donc pas de lésions caractéristiques au niveau des poumons.
Et en l’absence de ces cavernes, les patients crachent moins de
BK. » On risque donc plus de passer à côté du diagnostic de
tuberculose, d’autant plus qu’il n’existe pas de symptômes carac-
téristiques de la coïnfection BK/VIH. « Comme une fois sur deux
on ne voit rien au microscope chez les personnes infectées
par le VIH, complète Xavier Anglaret, l’examen de choix est la
mise en culture du prélèvement. Vous récupérez ainsi une
grande partie de ce que vous n’avez pas vu au microscope. »
Problème : dans les pays en développement, peu de labora-
toires sont en mesure de réaliser cette analyse. « La culture
demande des moyens un peu sophistiqués, témoigne le méde-
cin. À Abidjan, par exemple, il existe des laboratoires qui font
cela très bien, mais ils sont en nombre insuffisant par rapport
à la demande. En Afrique, la plupart des laboratoires n’ont
pas accès à ces techniques. Ils pratiquent des examens directs
au microscope et se retrouvent dans une situation délicate
quand ces derniers sont négatifs. »
Lutter conjointement. Pour Xavier Anglaret, comme pour l’en-
semble de ses pairs, une des solutions à ce casse-tête est de
coupler, sur le terrain, les luttes contre le VIH et la tuberculose.
«Il faut commencer par organiser l’accès au dépistage du VIH
dans les centres antituberculeux. Cette mesure est efficace
pour deux raisons. Concernant les personnes séropositives au
VIH et dont les crachats sont négatifs pour le BK, on pourra se
dire qu’il y a plus de risque qu’elles aient quand même la
tuberculose. Par ailleurs, avec les antirétroviraux, on pourra
organiser une prise en charge des séropositifs, qu’ils soient
atteints ou non par la tuberculose. » Une volonté qui se heurte
à l’insuffisance d’accès aux antirétroviraux (ARV), notamment en
Afrique où cette situation accentue encore davantage le risque
pour les personnes séropositives de contracter la tuberculose.
«Comme l’accès aux ARV est plus difficile en Afrique, les gens
commencent leur traitement à un stade d’immunodépression
plus avancé. Ils restent donc plus longtemps dans le risque
de contracter la tuberculose et, à vrai dire, n’atteignent jamais
un stade où ce dernier devient infime», regrette Xavier Anglaret.
Consciente de la nécessite de combattre conjointement les deux
affections, l’OMS, en association avec des partenaires interna-
tionaux, a mis en place le groupe de travail « Tuberculose/VIH »
afin d’élaborer une politique mondiale cohérente.
Traitement préventif antituberculeux. Pour prévenir les nouvelles
infections par le BK ou ses réactivations, l’OMS recommande
depuis 1993 une prophylaxie basée sur l’administration quoti-
dienne d’isoniazide (l’un des antibiotiques antituberculeux les
plus puissants), à raison de 5 mg par kg pendant six mois. Cette
prophylaxie n’est préconisée que chez les sujets ayant déjà eu
une tuberculose et chez lesquels le risque d’une tuberculose
© Institut Pasteur
17
Transversal n° 38 septembre-octobre dossier

18
Transversal n° 38 septembre-octobre dossier
dossier par Victoire N’Sondé
une personne naïve de tout traitement est diagnostiquée comme
tuberculeuse et séropositive. « L’urgence est alors de traiter la
tuberculose», indique le DrFrançois-Xavier Blanc, pneumologue
à l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre). Le traitement contre la tuber-
culose est aujourd’hui bien codifié. Il est globalement le même
quelles que soient la forme de tuberculose rencontrée et la séro-
logie au VIH. Mais le schéma se complique quand il doit être
associé à des ARV. Tout d’abord, le traitement contre la tubercu-
lose est long (six mois minimum) et nécessite, comme pour la
prise en charge du VIH, la combinaison de plusieurs molécules. Ce
qui peut perturber l’observance. Ensuite, il existe des interactions
médicamenteuses entre ARV et antituberculeux. Par exemple,
l’association rifampicine (antituberculeux le plus puissant avec
l’isoniazide) et antiprotéases peut être à l’origine d’effets secon-
daires. Dans les pays en développement qui ont peu accès à cette
classe d’ARV, les praticiens ont davantage à gérer des interac-
tions avec des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase
inverse. Enfin, la prise d’ARV par une personne traitée pour une
tuberculose active conduit parfois à une réaction immunitaire
«paradoxale», dénommée «syndrome de restauration immuni-
taire» (SRI)
1
. Cette réaction est observée dans les premiers mois
qui suivent la mise sous ARV. Le PrAutran étudie ce syndrome qui
surviendrait dans un cas sur deux. « En restaurant le taux de
CD4, on redonne au patient la capacité de se défendre contre le
BK, d’où un conflit immunologique. Le système immunitaire
redevient en mesure de créer des cavernes contre le BK, c’est
pourquoi on constate une exacerbation des lésions. C’est très
impressionnant, mais pas nécessairement grave. Le plus pro-
blématique est quand la tuberculose touche le cerveau, le péri-
toine ou d’autres organes fragiles avec un risque de rupture des
abcès. En tout cas, le SRI ne doit jamais être considéré comme
une rechute de la tuberculose. » Il est donc indispensable de
n’interrompre aucun traitement, ni contre le VIH ni contre le BK.
À noter que le SRI n’est pas spécifique de l’infection par le BK. On
l’observe également dans d’autres maladies opportunistes.
À quel moment introduire les ARV ? Face aux spécificités du
cotraitement tuberculose/VIH, la grande question est donc de
savoir quel est le moment le plus propice à l’introduction des
ARV. « Au-delà de 350 CD4 par mm3de sang, il faut d’abord
traiter la tuberculose. Vous avez tout le temps d’inclure les
ARV, répond François-Xavier Blanc. Entre 200 et 350 CD4,
c’est une zone un peu incertaine. Il faut considérer la prise
d’ARV, mais probablement attendre pour cela que soient pas-
sés les deux premiers mois du traitement antituberculeux ou
phase d’attaque.» En dessous de 200 CD4, la situation est cri-
tique. Et, actuellement, les recommandations internationales
officielles sont relativement floues. « Elles préconisent de com-
mencer les ARV entre deux semaines et huit semaines après
le début du traitement contre la tuberculose. Nous menons
l’un des rares essais qui tentera de répondre plus précisé-
ment à cette question, informe François-Xavier Blanc, inves-
tigateur principal de l’étude. Il s’agit de l’essai Camelia (ANRS
1295-CIPRA KH001) au Cambodge, qui est l’un des pays
comptant le plus de personnes atteintes par la tuberculose au
monde. » Seront inclus 660 patients positifs à l’examen direct
pour la tuberculose (tous modes de prélèvements confondus) et
séropositifs au VIH avec moins de 200 CD4. Les participants
devront également être naïfs de tout traitement contre les deux
infections. « Il s’agit d’un essai randomisé en deux bras, com-
plète le pneumologue. Tous les patients reçoivent le même
traitement antituberculeux et la même combinaison antiré-
trovirale. Une seule différence : dans le premier bras, les
ARV sont introduits deux semaines après le début du traite-
ment contre la tuberculose ; et seulement à huit semaines
dans le second bras, c’est-à-dire à la fin de la phase d’at-
taque contre la tuberculose. » Les résultats de l’essai Camelia,
élaboré en partenariat avec les National Institutes of Health
américains, devraient être disponibles vers la fin de 2009.
Le visage de la tuberculose associée au VIH est atypique et
rend d’autant plus délicate la prise en charge des personnes
victimes de cette coïnfection. Malgré une prise de conscience
internationale de la nécessité de coupler les efforts pour venir
à bout de ces deux fléaux, les recherches doivent être pour-
suivies et accentuées, afin notamment d’élaborer des outils de
diagnostic performants, articuler le plus efficacement pos-
sible les traitements contre les deux pathogènes et cerner
davantage l’impact des thérapeutiques sur le système immu-
nitaire. Ces progrès amélioreraient la compréhension et l’ad-
hésion des personnes concernées et de leur entourage,
comme ils faciliteraient le travail des équipes soignantes sur
le terrain. Conclusion de Nelson Mandela, lors de la clôture
de la conférence mondiale sur le sida de Bangkok en 2004 :
«Nous ne gagnerons pas la bataille contre le sida sans com-
battre davantage la tuberculose. »
1
Sur ce syndrome de restauration immunitaire, lire Transversal
n° 27, p. 10.
GLOSSAIRE
Culture cellulaire
Technique consistant à cultiver des prélèvements
contenant des cellules vivantes, comme des bactéries,
qui se multiplient suffisamment pour former des colonies
et deviennent ainsi visibles au microscope.
Essai randomisé
Essai au cours duquel une stratégie thérapeutique ou
un médicament est évalué en comparant plusieurs
groupes de personnes (ou bras). Chaque participant est
inclus dans l’un des bras par tirage au sort.

19
Transversal n° 38 septembre-octobre dossier
personnes, le traitement antirétroviral réduira probablement
le risque de tuberculose UR, tout comme celui de tubercu-
lose ordinaire. »
Un état des lieux impossible à dresser. Des cas de tuberculose
UR ont été signalés dans le monde entier. Mais il est impos-
sible de dresser un réel état des lieux de la situation. Beaucoup
de tuberculoses MR ne sont déjà pas diagnostiquées, faute d’ac-
cessibilité aux outils adéquats. Il en va de même pour la tuber-
culose UR, comme l’explique le DrFrançois-Xavier Blanc, pneu-
mologue à l’hôpital Bicêtre (Kremlin-Bicêtre). « Pour savoir si
une tuberculose est sensible ou résistante, il faut avoir fait un
antibiogramme, c’est-à-dire avoir testé l’effet des médicaments
sur des cultures de bacilles. Or dans la majorité des pays afri-
cains et asiatiques, cela est inaccessible. Le nombre de cas
réels de tuberculose MR est donc certainement beaucoup plus
élevé. »A fortiori, quelques bémols doivent donc être émis à
l’encontre des messages rassurants de l’OMS sur la tuberculose
UR, encore plus délicate à déceler : seuls quelques rares labo-
ratoires sont, sur la planète, capables d’effectuer les tests per-
mettant de savoir in vitro si une tuberculose MR est également
résistante aux médicaments utilisés en deuxième intention.
Quelques repères sur
le traitement antituberculeux
Le traitement curatif standard de première ligne contre la
tuberculose est étalé sur six mois. Les deux premiers mois,
le patient reçoit une quadrithérapie (isoniazide, rifampi-
cine, éthambutol et pyrazinamide), puis une bithérapie les
quatre mois suivants (isoniazide et rifampicine). Tous ces
antituberculeux sont administrés sous forme de comprimés.
On parle de tuberculose multirésistante (MR) quand les
bacilles de Koch résistent au moins à l’isoniazide et à la
rifampicine, les deux plus puissants antituberculeux.
Le traitement de seconde ligne utilise des antituberculeux
injectables, associés à des fluoroquinolones en comprimés
et à d’autres antibiotiques plus anciens qui peuvent provo-
quer des effets indésirables importants. Depuis octobre 2006,
l’OMS parle de tuberculose ultrarésistante quand les bacilles
MR résistent également aux fluoroquinolones et à au moins
l’un des trois antituberculeux injectables de seconde inten-
tion (capréomycine, kanamycine ou amikacine).
L’ultrarésistance,
la nouvelle menace
de la tuberculose
© Institut Pasteur
On connaissait la tuberculose multirésistante.
Il faut désormais compter avec des formes
ultrarésistantes, qui tiennent même en échec
les traitements de seconde ligne et
qui pourraient s’avérer particulièrement
dévastatrices dans les régions à forte prévalence
du VIH.
La tuberculose est une maladie curable. Pourtant, on peine à
l’éradiquer. Parmi les nombreuses raisons, on retiendra la
survenue de souches de bacilles de Koch résistantes à plu-
sieurs molécules du traitement standard de première ligne
(lire encadré ci-dessous). On parle alors de tuberculose mul-
tirésistante ou MR. Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 450 000 personnes contracteraient ces formes de
tuberculose chaque année dans le monde.
Ultrarésistance en Afrique du Sud. Depuis 2006, la situa-
tion est encore plus préoccupante après qu’une publication a
présenté une forme de tuberculose multirésistante particu-
lière chez quelque 500 patients séropositifs sud-africains,
contre laquelle, cette fois, même les médicaments de seconde
ligne seraient inefficaces. Elle est dénommée tuberculose ultra-
résistante (UR) ou XDR (pour « Extensively Drug-Resistant »).
Cette publication a produit l’effet d’une bombe dans la com-
munauté scientifique. Pour preuve, l’OMS a depuis mis en
place un groupe de travail spécialement dédié à cette forme
particulière de pharmacorésistance. Des cas isolés de tuber-
culose UR avaient déjà été observés dans le passé, mais
l’agence onusienne a tout récemment constaté une recrudes-
cence du nombre de cas. À l’heure d’une pandémie mondiale
de sida et sachant la vulnérabilité à la tuberculose des per-
sonnes vivant avec le VIH, cette annonce pourrait faire croire
à l’émergence d’une nouvelle épidémie de tuberculose contre
laquelle les traitements disponibles seraient extrêmement limi-
tés. Sur ce point, l’OMS se veut rassurante : « Heureusement,
dans la plupart des régions à forte prévalence du VIH, la
tuberculose UR est rare. C’est pourquoi la plupart des por-
teurs du VIH qui contractent la tuberculose n’auront qu’une
forme ordinaire de la maladie, qu’il est possible de traiter
avec des antituberculeux de première intention. Chez ces

20
Transversal n° 38 septembre-octobre dossier
dossier par Victoire N’Sondé
patient. Le traitement de la tuberculose est long. S’ils ne dis-
posent pas d’indications suffisantes, un certain nombre de
patients risquent d’arrêter les médicaments trop tôt. Il faut
donc une assistance. Le quatrième élément est la mise en
place par les gouvernements d’un système efficace d’approvi-
sionnement et de gestion des médicaments pour éviter les rup-
tures de stocks. Enfin, le dernier élément, extrêmement impor-
tant, est un système de suivi, d’évaluation et une mesure de
l’impact national. En général, l’unité de base est le district.
Le responsable fait remonter son rapport au niveau régional,
puis national, chaque trimestre. Ce document mentionne le
nombre de cas nouveaux et de patients qui ont terminé ou
non le traitement au terme de la première année. Ce sont des
éléments essentiels, standardisés depuis une vingtaine d’an-
nées et utilisés comme indicateurs.
La nécessité, inscrite dans la stratégie DOTS,
de superviser la prise de médicaments est très critiquée.
Pourquoi ?
Beaucoup de gens se réfèrent à la stratégie DOTS des origines.
Mais depuis 1995, elle a énormément évolué. En 2002, l’OMS
a publié une mise à jour très précise à ce sujet. Aujourd’hui,
dans le DOTS, il ne s’agit pas de supervision militaire de la
prise de médicaments. L’important est de s’assurer que le
malade a un soutien suffisant pour prendre son traitement.
Voilà la philosophie. Qui peut le faire ? Bien sûr des personnes
proches du malade. Ce n’est pas un acte médical mais de sou-
tien social ou psychologique. Au Bangladesh, il existe des
exemples très intéressants de boutiquiers qui donnent le trai-
tement au malade. Quand ce dernier ne vient pas, ils se ren-
dent chez lui pour voir ce qui se passe. Dans d’autres endroits,
c’est la communauté ou encore le voisin. C’est très variable. La
personne qui assure ce rôle doit avoir suffisamment d’autorité
sur le patient et bien comprendre les enjeux de l’acte. Pour
cela, la plupart des personnes sont formées.
Quels sont brièvement les autres points de la stratégie
« Halte à la tuberculose » qui complètent le DOTS ?
Ils sont au nombre de cinq : lutter contre la coïnfection
TB/VIH et contre la tuberculose multirésistante, contribuer
au renforcement des système de santé, impliquer tous les
«Obtenir un engagement politique
de lutte contre la tuberculose »
« Halte à la tuberculose »
(« Stop TB » en version originale)
est le nom du département de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) dédié à la lutte
contre la tuberculose.
Coordinateur des stratégies de lutte
contre la tuberculose et responsable
de la coordination des actions menées
dans les pays et régions, le DrLéopold Blanc
présente ce département.
Quelle est la mission de « Halte à la tuberculose »?
Pour comprendre nos principaux objectifs, il faut reprendre le
rôle de l’OMS. Nous définissons les politiques de santé en
matière de lutte contre la tuberculose, les standards interna-
tionaux à suivre, les nouvelles orientations à prendre. Nous
avons également un rôle de collecte de données et de suivi de
la situation. Chaque année, nous publions un rapport sur la
situation de la tuberculose dans le monde. Enfin, nous avons
un rôle de plaidoyer, de coordination et de support technique
dans les zones où les problèmes sont sérieux.
Quand on évoque la politique de l’OMS sur la tuberculose,
on cite souvent la stratégie DOTS. De quoi s’agit-il ?
Actuellement, nous disposons de ce que nous appelons la
stratégie « Halte à la tuberculose », qui est une évolution de
la stratégie DOTS [Directively Observed Treatment Short
Course] mise en œuvre en 1995. Cette dernière, qui corres-
pond aux fondamentaux, est aujourd’hui complétée par de
nouveaux éléments.
La stratégie DOTS consiste avant tout à obtenir un engage-
ment politique de lutte contre la tuberculose. Le deuxième élé-
ment est le dépistage des cas de tuberculose par un examen
bactériologique (microscope, mise en culture ou méthodes
moléculaires). Dans beaucoup de régions du monde, on a
encore uniquement recours à l’examen radiologique, qui n’est
pas approprié. Le troisième élément de la stratégie DOTS est
un traitement standardisé qui a fait la preuve de son effica-
cité. Celui-ci est supervisé et accompagné d’un soutien au
 6
6
1
/
6
100%