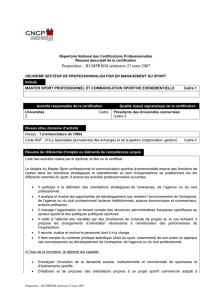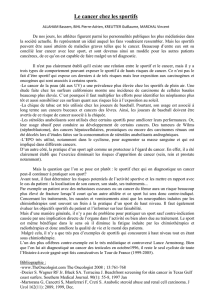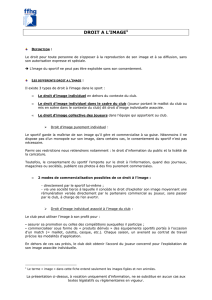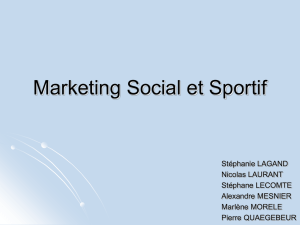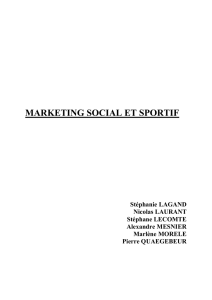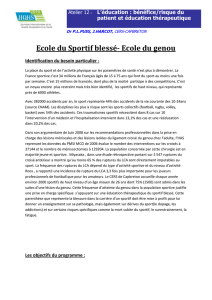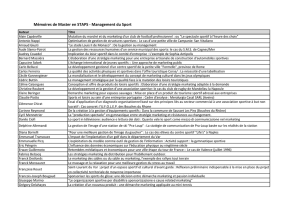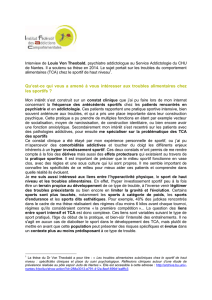Alcool et sport : Contre performance

Alcool et sport :
Contre performance
Dr Daniel Mathelin (Saint-Raphaël [83])
Le sportif entretient avec l'alcool une étrange histoire d'attirance et de rejet.
Nous faisons le point en suivant trois axes principaux:
• L’alcool utilisé comme dopant;
• L’alcool dans la vie quotidienne du sportif [page 10];
• La relation à double sens de l'alcoolo-dépendance et des activités sporti-
ves [page 11].
• Le médecin peut aider sportifs et sportives à garder ou à reprendre pos-
session de leur corps et de leur tête [page 12].
L'alcool dopant
Depuis l'Antiquité, l'alcool est utilisé par les compétiteurs pratiquants
d'activités physiques diverses pour améliorer leurs performances.
N 1919, Suzanne Lenglen gagne son premier Wimbledon grâce à un co-
gnac bu avant le troisième set. En 1988, Y. Noah déclarait prendre
parfois un peu d'alcool avant de rentrer sur le cours. En 1976, le
champion cycliste belge Maertens avouait avoir souvent bu un demi-bidon de
champagne avec une ampoule de caféine et du fructose à trente kilomètres
de l'arrivée. Les grands rendez-vous sportifs sont ainsi marqués par des
anecdotes sur le sujet, avec des témoignages de sportifs connus.
Mais le florilège continue. En 1962, le Guide pratique de la montagne conseil-
lait un peu d'alcool pour un dernier coup de collier... En 1971, nous avons connu
un professeur d'éducation physique de lycée qui faisait boire de l'eau de vie
de poire à ses élèves, footballeurs (17 à 18 ans), quarante-cinq minutes avant
une finale d'académie, victoire à la clé...
La légende de l'alcool est toujours vivace dans le milieu du sport: « Il donne
des forces, réchauffe, étanche la soif, etc. »
Qu'en attendent-ils ?
Les sportifs recherchent la désinhibition, un effet anxiolytique (anti-stress),
une certaine euphorie. Certains athlètes voient leur « capital confiance »
augmenter après une prise d'alcool et se sentent mieux pour finir une
épreuve.
L’effet « anti tremblement » est lui aussi très souvent recherché par les
adeptes des sports de précision, comme le tir, le golf ou la pétanque. L’effet
« anticrampes » est quelquefois souhaité. Certains pensent mieux lutter
E

contre le froid en absorbant de l'alcool. Enfin pour quelques-uns l'alcool aug-
mente les forces, stimule la circulation sanguine et tue les bactéries...
Qu'en obtiennent-ils
Le grand tennisman Andreï Chesnokov
déclarait, il y a quelques années, après un
très mauvais- début de saison: « J'en
avais un peu marre du tennis et j'ai bu
beaucoup trop d'alcool pendant deux
mois... A la reprise j’étais complètement
hors forme. »
Nous ne reviendrons pas ici sur tous les aspects négatifs de la prise d'alcool,
mais nous rappellerons, que la boisson alcoolisée
- est l'ennemie du muscle (acide lactique, perturbation du métabolisme aéro-
bie) ;
- abolit la sensation de fatigue, mais pas la fatigue;
- affaiblit les facultés de coordination gestuelle avec des temps de réaction
modifiés;
- active la sudation, avec un risque de déshydratation plus rapide;
- entraîne une dépendance. Dans un travail récent, on a demandé à un groupe
d'athlètes australiens de bon niveau (spécialistes du 100, 200, 400, 800 ou
1500 mètres) d'effectuer des tests sur leur distance de prédilection selon
qu'ils
- buvaient du jus d'orange avant l'effort;
- ingéraient de la vodka à l'orange à des teneurs variables. L’ordre dans lequel
s'effectuaient ces essais dépendait d'un choix aléatoire.
Les résultats de cette expérience sont très significatifs : si le 100 mètres
n'était pas affecté par la prise préalable d'alcool, tous les autres chronos se
sont dégradés après consommation de vodka ; en outre, plus les quantités ad-
ministrées étaient importantes, plus les résultats étaient mauvais.
Des tests d'endurance pratiqués sur des randonneurs chevronnés ayant
consommé de l'alcool à des fins
expérimentales (alcoolémies
comprises entre 0,4 et 1,1
gramme par litre) ont montré,
après une nuit de repos, une
chute des performances de 10
% par rapport aux résultats ha-
bituels.
A Vos cannettes !
De nombreux sports sont « touchés »
par l'alcool, en particulier les sports de
précision (tir, biathlon, pentathlon).
On peut citer également les sports au-
tomobiles, l'alpinisme, le motocyclisme,
le plongeon, l'escrime, la boxe, le cy-
clisme, le football, le bobsleigh, la luge,
etc.
Reconnu dopant
L'éthanol est un produit dopant de la catégorie 3.
C'est une substance soumise à certaines restric-
tions, comme les corticoïdes, les bêtabloquants,
les cannabincides ou les anesthésiques locaux.
La recherche d'un dopage à l'alcool est décidée
par chaque fédération avant les épreuves. On uti-
lise l'alcoolémie ou l'éthylotest.

Bibliographie
Black D., Lanson 1., « Excessive alcohol use by non elite sportsmen », Drug and Alcohol Rewiev, 1999;
18: 201-205.
Bower B.L., Martin M., « African american female basket-ball players: examination of alcohol and drug
behaviors », Journal of American College Health, 1999; 48 (3) : 129-133.
Bureau C., Vinel J.-P, « Maladies liées à l'alcool », Concours Médical, 2001; 12315:1025-1028.
Choquet M., Bournessol H., « Jeunes, sports, conduites à risque », rapport Inserm, Unité, 472, 1998.
Daulouede C., « Le mystère de la courbe en U », Sport et Vie, 2001 ; HS 14: 6468.
De Witte P., Neurobiologie de l'alcoolisme, compte rendu de la XXX, Journée d'hépatologie de Mont-
pellier, 6 octobre 2000.
De Witte P., « Sport et alcool: une nouvelle piste pour aider les alcoolodépendants », Lettre d'Infor-
mation de NREB, sept. 1998, n° 14.
Francois E., « Sport et prévention », Alcool ou Santé, 1997; 1.
Gutgesell M.E., Timmerman L., Keller A., « Reported Alcohol Use and Behavior in Long Distance Runners
», Medecne and Science in Sports and Exercice (United States), 1996; 28 (8): 1063-1070.
Gutsesell M.E., Timmerman L., « Alcohol Use and Behavior in Women Long Distance Race Participants
Reporting a History of Boulimia and/or Anorexia Nervosa », Journal of Sports Medecine and Physical
Fitness, 1998; 38 (2) : 142-148.
Lejoyeux M., « L'alcoolisme au féminin », Panorama du médecin, mars 2001; 4780 : 36.
Lowenstein W., Arvers F, Gourarier L., « Activités physiques et sportives dans les antécédents des
personnes prises en charge pour addictions, rapport 1999 de l'étude commanditée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports (France) » in Médecine des addictions, Annales de médecine interne, Mas-
son, Paris; 2000, vol. 151, suppl. A, Al 8- A26.
Mathelin D., « Foie et sport », Médecine du sport, 1995 (69) ; 4: 155-157. De Mondenard J.-P., « Les
contreperformances de l'alcool », Cinésiologie, 1994, XXXIII, 158: 201-207.
Riche D., « Boire de l'alcool avant l'effort » in L'alimentation du sportif en 80 questions, éd. Vigot,
1999 : 66-67.
Riche D., « L'alcool et le sport, les dégâts de l'eau-de-vie », Sport et Vie, 1991 ; 7 : 16-23.
Seznec J.-C., « Une addiction à la "gagne" », Synapse, 2001 ; 172: 17-19. Vanderheyden J.-E., Helleman
J.-P., « Impact thérapeutique d'une pratique sportive chez l'alcoolique en postcure », Alcoologie,
(SFA), 1996; 18 (1): 32-66.
Williams M.-H., « Alcohol Intake and Sport Performance », Strength and Conditionning, 1998; 20 (2):
16-17.

L'alcool dans la vie quotidienne du
sportif
L'alcool dans la vie du sportif, et surtout des jeunes sportifs, est un
sujet qui préoccupe beaucoup les autorités françaises. Trois études ré-
centes, de grande importance, ont permis de mieux situer le problème et
de comparer les habitudes des sportifs et des non-sportifs.
Es travaux de l'Inserm (M. Choquet) sur les sports et conduites à
risque (12 000 cas), du Dr Lowenstein et coll. sur les sports et
conduites addictives (11 111 cas [voir encadré]), du Service de santé des
armées françaises sur les habitudes de 4 975 sportifs, ont dégagé quel-
ques conclusions très significatives
• sportifs et non-sportifs présentent une alcoolisation semblable
mais le sportif intensif est plus alcoolisé que le sportif modéré ;
• la consommation d'alcool croît avec l'augmentation du temps
hebdomadaire de sport ;
• l'alcoolisation, plus importante dans le sexe masculin, touche
aussi les sportives ;
• la bière est le premier alcool consommé par les sportifs; ils en
boivent plus que les non-sportifs ; un pratiquant de sport collec-
tif boit deux fois plus de bière qu'un pratiquant de sport indivi-
duel;
• Les ivresses répétées sont plus nombreuses chez le sportif in-
tensif que chez le non-sportif ;
• les ivresses multiples annuelles du sportif sont caractéristiques
des sports collectifs; elles sont plus fréquentes que chez les
non-sportifs et que dans les sports individuels.
Quelques explications
La pratique d'un sport collectif amène à « faire comme les autres, comme les
copains », donc aussi à boire.
Passé un certain niveau, les adolescents n'ont plus de raison valable pour ré-
péter les heures d'entraînement, si ce n'est de poursuivre ce qui est com-
mencé. Leur plaisir diminue, les difficultés augmentent.
Alors, pourquoi pas l'alcool?
L

L’ivresse du sportif
trouverait aussi une ex-
plication dans le fait,
l'athlète s'étant isolé,
concentré sur sa prépa-
ration physique et men-
tale ou sur une épreuve,
qu'il souhaite revenir en
société, comme tout le
monde. Ce n'est pas une
ivresse qui mène à
l'évasion mais, au
contraire, à la réinté-
gration sociale.
L’arrêt du sport (bles-
sure grave retraite, début de la fin de carrière; amène le sujet dans le « dé-
sert » l'ennui, l'état de manque: fini les états seconds, les sensations fortes,
la communion avec le public, la griserie du sport ; celle de l'alcool va redon-
ner à « l'ancien sportif » toutes ces sensations perdues et cet état second.
Celui qui avait l'habitude de prendre des produits divers pour être en forme
(vitamines, dopants, stimulants physiques et psychiques) ne trouve que plus
aisément le chemin de l'alcool.
Quelques similitudes
Certaines similitudes sont troublantes, comme
• le cérémonial autour d'une bouteille ou d'un ballon;
• l'arrosage d'une « occasion » ou d'une victoire;
• l'alcool « ciment » du groupe, que ce soit au bistro ou au sein d'une
équipe;
• la réunion autour du pilier de bar ou du pilier de l'équipe,
• les « je te paie un verre » ou « je te fais une passe ».
On y réfléchira au « Café des Sports » ou à la buvette du stade...
Quelques conseils
Classiquement, la prise de boissons alcoolisées est fortement déconseillée
vingt-quatre heures avant une compétition ou un effort intense.
En conséquence, nous déconseillons la prise d'alcool lors du repas qui pré-
cède un match ou une compétition. Ce point de vue est parfois contesté,
surtout par certains pratiquants qui réclament du vin ou un autre alcool
(bière) à ce repas. Ces athlètes, souvent d'expérience, utilisent des argu-
Trop de sport, trop d'alcool ?
L'étude « dépendance » (Dr Lowenstein et coll.) a ob-
jectivé les éléments suivants :
• sur I III sujets pris en charge pour addictions
dans des centres ou des consultations spécialisés
dans le traitement de la maladie alcoolique, 117
étaient des sportifs de niveau national ou interna-
tional ;
• 75 % de ces athlètes sont devenus alcoolo dépen-
dant un an après l'arrêt du sport ;
• 50 % avaient déjà été traités pour un problème lié
à l'alcool quand ils pratiquaient leur sport;
• 15 % ont eu recours à l'alcool comme dopant pen-
dant leur carrière sportive ;il y avait souvent une
association: alcool-drogue-dopage.
L’étude conclut qu'une activité sportive modérée en-
traîne une consommation alcoolique modérée, alors
qu'une activité sportive intensive peut conduire à une
consommation alcoolique abusive, parfois à une dépen-
dance.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%