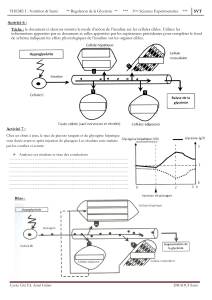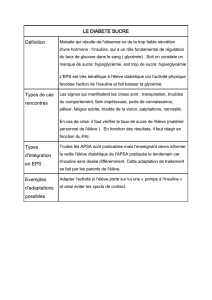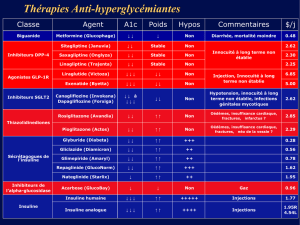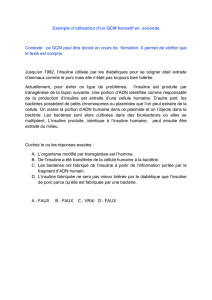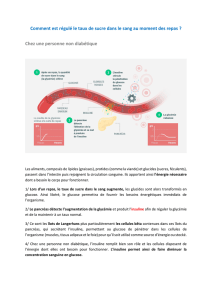Open access

Année 57 - 6 / Novembre - Décembre 2014
A
L
Actualité
Recherche en diabétologie :
l’insulinothérapie par
voie péritonéale
’insuline est une protéine
et ne peut donc être admi-
nistrée par voie orale parce qu’elle
serait digérée. La voie sous-cu-
tanée étant une contrainte non
négligeable pour les patients, de
nombreuses équipes tentent de-
puis de nombreuses années de
trouver des voies alternatives.
Quelles alternatives ?
Tout d’abord, une des raisons
qui a motivé cette recherche est
que la voie sous-cutanée repré-
sente une contrainte pour le
patient. L’autre raison est que
lorsque l’on injecte l’insuline par
voie sous-cutanée, il existe un
certain délai avant que celle-ci
n’arrive dans la circulation san-
guine, et donc, que cette insu-
line injectée soit efficace. Cela
a d’ailleurs amené le dévelop-
pement d’insulines ultra rapides
notamment, pour contrecarrer
l’hyperglycémie liée au repas
- des insulines censées agir
plus vite et donc plus proches
de la physiologie. Néanmoins,
la voie sous-cutanée reste une
barrière posant certains pro-
blèmes. Parmi les voies alter-
natives étudiées, il y a la voie
inhalée qui a connu certains dé-
veloppements. L’objectif de ces
recherches était d’administrer
l’insuline à l’aide d’un inhalateur
afin que l’insuline soit absorbée
par les poumons pour atteindre
ensuite la circulation. Malgré
d’importantes avancées dans
ce domaine, cette voie n’est ac-
tuellement plus envisagée pour
différentes raisons qu’il serait
trop fastidieux d’aborder ici. Une
autre voie étudiée depuis de
nombreuses années est la voie
péritonéale. Il s’agit d’injecter
l’insuline dans le péritoine. En
effet, le péritoine est défini par
la cavité abdominale (Figure 1).
Dr. Régis Radermecker,
Rédacteur en chef,
CHU de Liège, Université de Liège
Les personnes diabétiques nécessitant de l’insuline, comme les personnes diabétiques
de type 1 et certaines personnes diabétiques de type 2, doivent s’injecter cette insu-
line par la voie sous-cutanée. Cela peut se faire à l’aide d’un stylo injecteur ou encore
d’une pompe externe à perfusion continue.
Figure 1. La cavité péritonéale

Année 57 - 6 / Novembre - Décembre 2014 A
Cette cavité est délimitée par
deux feuillets, un feuillet appelé
feuillet viscéral qui couvre les
organes présents dans l’abdo-
men et un feuillet pariétal. Cette
cavité peut représenter jusqu’à
deux mètres carrés. Elle est le
lieu d’échanges importants de
différentes substances. Depuis
plusieurs années, par exemple,
certaines personnes dialysées
rénales (rein artificiel) peuvent
l’être par voie péritonéale. Dès
lors, de nombreuses équipes de
recherches se sont penchées
sur l’administration d’insuline
dans ce péritoine et y ont trouvé
certains avantages.
Quels avantages ?
Avant d’aborder les progrès réa-
lisés dans le domaine de l’insu-
linothérapie intrapéritonéale, il
est important de se souvenir de
la physiologie normale. En ef-
fet, la personne non diabétique
possède une régulation de sa
glycémie parfaite, grâce à une
sécrétion d’insuline appropriée.
Lorsque la glycémie s’élève, les
cellules sécrétant de l’insuline,
appelées cellules bêta présentes
dans le pancréas, sécrètent la
quantité nécessaire d’insuline
pour maintenir la glycémie dans
les normes, en facilitant l’utilisa-
tion du glucose par les cellules
du corps. Cette sécrétion se fait
donc par ces cellules bêta et l’in-
suline est alors sécrétée dans le
sang, en particulier dans une cir-
culation sanguine qu’on appelle
la circulation porte. Cette circula-
tion porte se dirige ensuite vers
le foie. L’insuline peut donc agir
très rapidement après sa sécré-
tion physiologique, à l’inverse
d’une injection sous-cutanée qui
mettra un certain temps avant
d’atteindre le système porte. En
effet, lorsqu’on injecte l’insuline
en sous-cutané, celle-ci est ab-
sorbée par le sang dit périphé-
rique avant de revenir dans le
système porte après un certain
temps. Lorsqu’on injecte de l’in-
suline dans la cavité péritonéale,
celle-ci est absorbée rapidement
par des vaisseaux sanguins fai-
sant partie du système porte.
On comprend dès lors mieux
l’intérêt de cette voie d’admi-
nistration qui se rapproche de
la physiologie normale. Malheu-
reusement, injecter de l’insuline
dans la voie péritonéale néces-
site de franchir la paroi abdo-
minale et donc d’avoir un geste
relativement invasif. On ne peut
donc imaginer que le patient
s’injecte lui-même plusieurs fois
par jour de l’insuline à l’aide
d’aiguilles au travers de sa paroi
abdominale. Cela serait non seu-
lement douloureux, mais présen-
terait d’autre part des risques
infectieux. C’est pour cette rai-
son que certaines équipes de
recherche ont développé depuis
plusieurs années des systèmes
de perfusion continue intrapé-
ritonéale (Figure 2). Une des
premières voies de recherche a
consisté à élaborer des pompes
à insuline implantables. Le prin-
cipe est celui d’une pompe à
insuline placée chirurgicalement
sous la peau de l’abdomen et re-
liée à un cathéter qui entre dans
le péritoine. La pompe est alors
programmée à l’instar d’une
pompe à insuline classique,
c’est-à-dire avec des débits de
base d’insuline couvrant les
besoins de base, ainsi que des
bolus que le patient activerait à
l’aide d’une télécommande au
moment des repas. L’insuline
est alors injectée dans le péri-
toine et absorbée rapidement
par ce système porte, agissant
de manière beaucoup plus phy-
siologique et donc rapide. Mal-
heureusement, cette technique
suppose un geste chirurgical
non négligeable, y compris au
moment de remplir la pompe
: cela doit se faire en milieu
hospitalier dans des conditions
d’asepsie totale (du type salle
d’opération). Par ailleurs, ces
dispositifs sont toujours en
cours d’étude et font partie de
protocoles de recherche - ils
ne sont donc pas disponibles
en pratique médicale courante.
L’équipe française EVADIAC tra-
vaille sur cette technique depuis
plusieurs années. De nombreux
articles scientifiques ont été
publiés démontrant l’intérêt de
cette technique à deux niveaux :
La perfusion en intrapéritonéal,
un autre mode de diffusion de l’insuline
Figure 2. Pompe implantable délivrant de l’insuline dans le péritoine
121 dpi

Année 57 - 6 / Novembre - Décembre 2014
A
non seulement l’absorption de
l’insuline se fait de manière plus
physiologique mais cela permet
également de réduire nettement
les fluctuations glycémiques
avec une moindre prise de poids
et une nette diminution du risque
hypoglycémique. Les principaux
inconvénients résident dans le
coût extrêmement élevé de cette
technique et son caractère relati-
vement lourd puisqu’elle néces-
site à la fois une mise en place
chirurgicale, mais également
des remplissages de la pompe
en milieu hospitalier. D’autres
équipes ont voulu dès lors déve-
lopper un système moins invasif.
Il s’agit notamment du système
Diaport®. Son principe est tou-
jours l’administration d’insuline
dans le péritoine pour les rai-
sons évoquées ci-dessus, mais
de manière moins invasive. En
effet, le Diaport® est une petite
canule métallique placée par un
geste chirurgical relativement
simple au niveau de la paroi ab-
dominale (Figure 3). Cette pe-
tite canule métallique se place
au travers de la peau au niveau
de l’abdomen. Il s’agit donc
d’une jonction entre le monde
extérieur et la cavité péritonéale.
En intra abdominal, ce Diaport®
est relié à un cathéter qui va
dans le péritoine. L’autre jonc-
tion du Diaport® qui se trouve à
l’air ambiant est alors reliée à
une pompe à insuline classique
externe comme celles que l’on
utilise en pratique courante. Ce
dispositif a l’avantage d’une
part de nécessiter un geste
chirurgical plus simple et donc
moins lourd pour le patient, mais
également d’être relié à une
pompe classique externe que
le patient peut gérer lui-même.
Actuellement, cette technique,
tout comme la pompe implan-
table décrite auparavant, n’est
pas remboursée et pas utilisée
en pratique médicale courante.
Elle fait toujours partie de pro-
jets de recherches même si
de nombreuses publications
ont démontré l’intérêt de cette
technique. Ainsi, le fabricant du
Diaport® vient de lancer un plan
pour développer des centres
d’excellences dans différents
pays d’Europe, permettant à
ceux-ci d’acquérir une exper-
tise de manière à être perfor-
mant le jour où cette technique
pourra devenir courante dans la
pratique médicale. Malgré les
avantages décrits plus hauts, il
convient toutefois de préciser
que ce mode d’administration
de l’insuline dans le péritoine
ne peut être proposé à tous les
patients. Il existe effectivement
des indications scientifiques
plus strictes auxquelles les
chercheurs ne peuvent déroger
et par ailleurs cette technique
présente également de nom-
breuses contre-indications qu’il
serait trop fastidieux de dévelop-
per dans le présent article.
En conclusion
La voie intrapéritonéale d’ad-
ministration d’insuline est un
concept séduisant non seule-
ment parce que l’insuline injec-
tée dans le péritoine agit de
manière beaucoup plus physio-
logique que par voie sous-cu-
tanée mais également parce
qu’elle présente des avantages
en termes de contrôle glycé-
mique : moins de variations,
moins d’hypoglycémies, moins
de prise de poids… Néanmoins,
il convient de préciser que cette
technique d’insulinothérapie re-
lève toujours du domaine de la
recherche médicale et ne peut
être actuellement proposée en
pratique courante. Gageons que
des progrès pourront être réali-
sés, notamment via le dévelop-
pement de centres d’expertise
spécialisés dans plusieurs pays
d’Europe dont la Belgique (CHU
de Liège). Grâce à l’expérience
acquise, ces centres pour-
ront alors publier des articles
scientifiques accompagnés de
preuves suffisantes permettant
de constituer un dossier scienti-
fiquement irréprochable et rigou-
reux qu’il sera ensuite possible
d’introduire auprès des autorités
concernées dans les années à
venir. Nous ne manquerons pas
bien évidemment de vous tenir
au courant des progrès réalisés
dans ce domaine. ■
Les demandes de références bibliographiques
peuvent être adressées au Dr Régis Radermecker
via le secrétariat de l’ABD.
L’insuline intrapéritonéale est
absorbée plus rapidement et permet un
meilleur contrôle glycémique
Figure 3. Diaport® permettant
d’être relié à une pompe
externe « classique »
1
/
3
100%