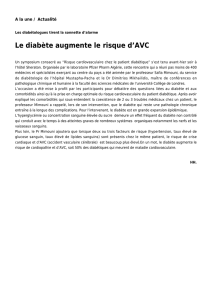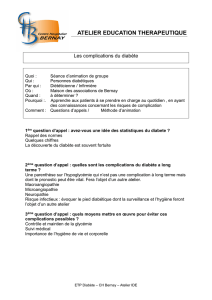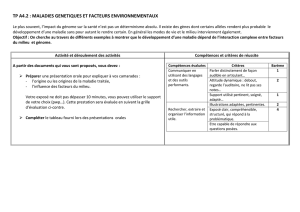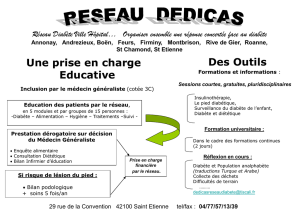Lire l'article complet

DIABÈTE ET COMPLICATIONS CARDIOVASCULAIRES
Un symposium organisé par l’American Heart Association (AHA)
et la Société asiatique de cardiologie a été consacré à l’augmentation
de la prévalence du diabète et de ses complications cardiovascu-
laires. Celle-ci est constatée partout dans le monde parallèlement
à l’augmentation du nombre de personnes en surpoids (index de
masse corporelle entre 25 et 30) ou présentant une obésité (index
de masse corporelle supérieur à 30). Aux États-Unis, cela est net
aussi bien chez l’homme que chez la femme (figure 1). L’aug-
mentation de la prévalence du diabète est aussi fonction de l’eth-
nie, plus importante chez les Hispaniques puis chez les Noirs,
avec le taux le plus faible pour les Blancs non hispaniques
(figure 2). La même constatation a été faite en Asie. Au Japon,
la prévalence de l’obésité est passée de 7,5 % en 1950 à 26,5 %
en 1995. En extrapolant, les épidémiologistes pensent qu’il y aura
dans le monde, en 2010, plus de 220 millions de personnes pré-
sentant un diabète. Cela explique pourquoi le nombre de com-
munications à l’AHA concernant cette maladie a été multiplié
par cinq depuis 1994.
Dans l’étude des infirmières américaines portant sur
84 941 femmes de 1980 à 1996, 3 300 nouveaux cas de diabète
de type 2 on été découverts, le surpoids ou l’obésité étant les
marqueurs prédictifs les plus performants de l’apparition de ce
diabète. La sédentarité, une alimentation pauvre en fibres et
riche en acides gras saturés, un tabagisme et l’absence de prise
d’alcool dans l’alimentation étaient des éléments associés de
façon significative au risque de diabète (N Engl J Med 2001 ;
345 : 790-7).
La majorité des présentations ont concerné la prévention et le traite-
ment du diabète de type 2 et de ses complications cardiovasculaires.
La plus intéressante est sans doute celle du Diabetes Preven-
tion Program (DPP) réalisée par le NIH et présentée juste avant
l’AHA. Dans cet essai, 3 234 personnes ayant une intolérance
au glucose et âgées de 25 à 85 ans ont été randomisées en trois
groupes. Dans l’un ont été institués des changements intensifs
du mode de vie, avec une augmentation de l’activité physique
à au moins 150 minutes par semaine et un régime diététique
personnalisé avec, comme objectif, une perte de 7 % du poids
initial. Le second groupe recevait des consignes “molles” habi-
tuelles plus un placebo. Dans le troisième groupe était admi-
nistrée de la metformine 850 mg deux fois par jour. Après trois
ans, 29 % du groupe standard avait développé un diabète ;
celui-ci n’était apparu que dans 14 % des cas dans le groupe
avec exercice et régime intensif et dans 22 % des cas dans le
groupe prenant de la metformine. La réduction relative du pas-
sage à la maladie diabétique était de 58 % dans le groupe avec
changement important du mode de vie et de 31 % dans le
groupe metformine, ces différences étant très significatives sur
le plan statistique.
Ces dernières années, de nombreuses études ont montré une perte
de poids stable essentiellement dans le groupe de personnes qui
La Lettre du Cardiologue - Supplément au n° 351 - janvier 2002
40
ENDOCRINOLOGIE ET MALADIE VASCULAIRE
Endocrinologie et maladies cardiovasculaires
●F. Berthezene*
■
L’incidence et la prévalence du diabète augmentent de
façon importante dans le monde. On estime qu’en 2010
plus de 220 millions de personnes présenteront un dia-
bète.
■
Une activité physique régulière associée à un suivi dié-
tétique peut, chez des personnes prédisposées, diminuer
de plus de 50 % le risque de survenue d’un diabète.
■
Plusieurs études ont montré que la mise en place d’un
traitement œstrogénique de la ménopause chez des
femmes coronariennes pouvait entraîner, la première
année, une recrudescence de la morbi-mortalité cardio-
vasculaire.
■
Des recommandations concernant le traitement hormo-
nal substitutif de la ménopause et le risque cardiovascu-
laire ont été publiées par l’AHA. L’analyse fine du rapport
bénéfices/risques et la préférence de la femme sont des
éléments essentiels à prendre en compte avant la mise en
place de cette thérapeutique.
Points forts
*Hôpital Édouard-Herriot, Lyon.

suivent des consignes diététiques et ont une activité physique
régulière. La difficulté majeure est d’arriver à motiver suffisam-
ment les personnes sédentaires, afin qu’elles aient une activité
physique suffisante pour entraîner des changements métaboliques.
L’activité moyenne nécessaire étant de 120 minutes par semaine
à au moins 50 % de la VO2max,l’abandon progressif des consignes
se voit très fréquemment et implique une éducation continue des
patients. Plusieurs commentaires (impertinents) ont été faits
concernant la durée de l’étude DPP. D’après les auteurs, celle-ci
a été arrêtée au bout de trois ans car les différences entre les
groupes étaient très significatives ; cependant, les consignes d’hy-
giène de vie étant en général moins bien suivies à partir de
trois ans, on peut se demander si l’effet bénéfique se serait main-
tenu sur une durée plus longue.
Une HOW to Session a été consacrée à l’activité physique chez
les diabétiques. Initialement, elle concernait uniquement les
malades présentant une coronaropathie, mais, du fait des résul-
tats du DPP, elle a été élargie à l’ensemble des diabétiques. Des
recommandations ont été publiées par l’American College of
Sport Medicine pour la prise en charge des diabètes de type 2.
Il est recommandé d’effectuer un électrocardiogramme d’effort
chez toute personne présentant un diabète de type 2 et ayant
plus de 35 ans, afin de lui prescrire un exercice physique opti-
mal. Ces recommandations sont pratiquement impossibles à
mettre en place compte tenu du grand nombre de diabétiques.
Il paraît plus réaliste d’encourager tout sujet diabétique à pra-
tiquer une marche à pied quotidienne et de ne réaliser un élec-
trocardiogramme d’effort que dans un petit groupe de patients
motivés et n’ayant pas de complications pouvant s’aggraver
après un exercice physique intensif. En dehors de la coronaro-
pathie, il faut en particulier rechercher une neuropathie végé-
tative, qui peut entraîner une hypotension artérielle post-exer-
cice, et une neuropathie périphérique, responsable d’anomalies
au niveau du pied ; une rétinopathie proliférante non stabilisée
ou une néphropathie peuvent s’aggraver avec un exercice inten-
sif. Il est enfin toujours essentiel de vérifier la glycémie pen-
dant et après l’exercice. Si le diabète est correctement équilibré
et traité par des sulfamides hypoglycémiants et/ou de l’insuline,
le risque d’hypoglycémie est majeur ; inversement, en cas de
déséquilibre du diabète, il peut y avoir une aggravation de l’hy-
perglycémie avec l’apparition d’une acidocétose après un exer-
cice intensif.
Parmi les traitements oraux du diabète, la metformine a une place
particulière, confortée par les résultats de l’étude DPP. La grande
étude britannique UKPDS avait déjà montré que, chez les diabé-
tiques de type 2 obèses, la prise de metformine en première inten-
tion entraînait une réduction significative des événements liés au
diabète.
Les stimulateurs des PPARγ(peroxisome proliferator-activated
receptors) appelés thiazolinedinediones ou glitazones arrivent
sur le marché en Europe. De nombreux travaux ont été présen-
tés, en particulier lors d’un séminaire cardiovasculaire (PPARs
and atherosclerosis). Les glitazones diminuent l’hyperglycémie
de la même manière que les sulfamides ou les biguanides, en
jouant essentiellement sur les PPAR adipocytaires. S. Farmer,
de Boston, a brillamment démontré les diverses étapes interve-
nant dans la différenciation des fibroblastes en adipocytes sous
l’influence des PPARγ,où interviennent en particulier les
C/EBP α, β, δ,appartenant au groupe des Enhancer binding
proteins. Les glitazones, en augmentant la synthèse des trigly-
cérides par les adipocytes, sont responsables d’un afflux
d’acides gras dans ces cellules, d’une diminution des acides gras
libres plasmatiques et d’une amélioration de l’insulinorésis-
tance, l’effet secondaire le plus gênant étant une prise de poids
de plusieurs kilogrammes.
L’aspect le plus intéressant de ces nouveaux médicaments est sans
doute leurs effets au niveau de l’endothélium et des macrophages
de la paroi artérielle. Il existe des récepteurs PPARγmais aussi α
(point d’action des fibrates) au niveau des cellules endothéliales.
Leur stimulation semble diminuer le nombre de molécules d’ad-
hésion et la synthèse de PAI1. Dans la paroi artérielle, les récep-
teurs PPAR sont exprimés dans les macrophages et dans les cel-
lules spumeuses. Leur stimulation a un certain nombre d’effets
La Lettre du Cardiologue - Supplément au n° 351 - janvier 2002
41
ENDOCRINOLOGIE ET MALADIE VASCULAIRE
70
60
50
40
30
20
10
0
Pourcentage de population
Le surpoid est défini par un BMI > 25 kg/m
2
Source : Respective Health Examination Surveys, CDC/NCHS
et American Heart Association
1960-62 1971-74 1976-80 1988-94
49,1 55,0 53,2
61,0
40,2 41,2 42,2
51,0
Hommes Femmes
Figure 1. Prévalence ajustée à l’âge du surpoid chez les Américains âgés
de 20 à 74 ans.
12
10
8
6
4
2
0
Pourcentage de population
Source : "Prevalence of Diabetes, Impaired Fasting Glucose, and Impaired
Glucose Tolerance in US Adults, The Third National Health and Nutrition
Examination Survey, 1988-1994". Diabetes Care 1998 ; 21 : 4.
Blancs non hispaniques
Noirs non hispaniques
Américains mexicains
5,4
7,6 8,1
4,7
9,5
Hommes Femmes
11,4
Figure 2. Prévalence ajustée à l’âge du diabète chez les Américains âgés
de 20 ans et plus.

qui peuvent être considérés comme anti-athérogènes : baisse du
recrutement des monocytes au niveau de la paroi artérielle, dimi-
nution de la synthèse de TNFα,augmentation de la synthèse des
transporteurs ABC-A1 impliqués dans la voie de retour du cho-
lestérol.
Deux études de prévention cardiovasculaire viennent de débuter
avec ces médicaments.
ŒSTROGÈNES ET ATHÉROSCLÉROSE
La question des relations entre les stéroïdes sexuels et l’athéro-
sclérose n’est toujours pas résolue. Les études épidémiologiques
ont montré que le risque cardiovasculaire était plus bas chez la
femme que chez l’homme tant qu’il existait un fonctionnement
ovarien. Dix ans après la ménopause, le risque augmente chez
la femme, pour atteindre puis dépasser celui de l’homme. De
nombreuses études chez l’animal, réalisées en particulier chez
la souris invalidée pour l’apo E par l’équipe de F. Bayard et de
J.F. Arnal à Toulouse, ont montré que l’administration d’œstra-
diol empêchait l’apparition d’une athérosclérose. Plusieurs
études épidémiologiques, à l’exception notable de l’étude de Fra-
mingham, ont montré que les femmes recevant un traitement
substitutif de la ménopause avaient moins de pathologies coro-
nariennes que celles n’en recevant pas. Il est important de noter
que les femmes avec un traitement substitutif diffèrent en de
nombreux points de celles n’en prenant pas : globalement, elles
ont moins de risque cardiovasculaire et prennent mieux soin de
leur santé.
L’enthousiasme pour le traitement substitutif de la ménopause a
subi un coup d’arrêt en 1998 avec les résultats de l’étude rando-
misée HERS (Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study).
Dans cette étude, 2 763 femmes en prévention secondaire ont reçu
soit un placebo soit des œstrogènes conjugués équins associés à
de l’acétate de médroxyprogestérone. Le suivi à été de 4,1 ans.
Malgré une diminution du cholestérol LDL et une augmentation
du cholestérol HDL sous œstrogènes, l’incidence des maladies
cardiovasculaires a été identique dans les deux groupes avec, pen-
dant la première année, une augmentation de la morbi-mortalité
coronarienne dans le groupe traité.
P. Collins, de Londres, a repris, lors d’un symposium sur estro-
gens and atherosclerosis, les déductions cliniques que l’on peut
tirer des études épidémiologiques et des essais thérapeutiques
publiés.
L’augmentation du risque coronarien chez les femmes en pré-
vention secondaire pendant la première année qui suit la mise
en place d’un traitement œstrogénique substitutif montrée dans
l’étude HERS a été retrouvée dans au moins trois autres études :
dans la Women Health Initiative,étude actuellement en cours
regroupant 27 000 femmes, l’organisme centralisateur de l’étude
a envoyé à l’ensemble des femmes incluses dans l’essai une
lettre leur indiquant une recrudescence des infarctus du myo-
carde la première année du traitement, avec une diminution
ensuite.
Dans une étude publiée fin octobre 2001 dans le New England
Journal of Medicine par C.M. Viscoli et al., 664 femmes méno-
pausées ayant eu récemment un accident ischémique cérébral
ou un accident ischémique transitoire ont été traitées soit par
œstradiol, soit par placebo pendant 2,8 ans en moyenne. Glo-
balement, la mortalité totale et la récidive des accidents vascu-
laires cérébraux n’étaient pas influencées par le traitement
œstrogénique, mais, dans le groupe traité, il y avait dès la pre-
mière année une augmentation du risque d’accident vasculaire
cérébral mortel.
Enfin, en reprenant les résultats de l’étude des infirmières amé-
ricaines, il est apparu qu’il y avait une augmentation du nombre
d’infarctus du myocarde dans l’année qui suivait la mise en place
du traitement chez les personnes en prévention secondaire.
Il n’y a actuellement pas d’étude disponible en prévention pri-
maire. Les résultats négatifs des études en prévention secondaire
ne proviennent pas, comme cela avait été suggéré, du type d’œs-
trogène ou de progestatif administré dans l’étude HERS, puisque,
dans l’étude de C.M. Viscoli et al., l’œstradiol per os était utilisé.
Une autre étude utilisant l’œstradiol par voie transdermique asso-
cié à la noréthistérone présentée sous forme d’abstract (European
Heart Journal 20-12-212) n’a pas mis en évidence d’effet béné-
fique du traitement.
Ces résultats ambigus ont amené à une recrudescence de travaux
sur les diverses actions des œstrogènes. Une partie de ceux-ci ont
été présentés par D. Losordo, de Boston, et E. Levin, de Long
Beach. Au niveau de l’endothélium, les œstrogènes ont de mul-
tiples actions qui apparaissent bénéfiques : activation de l’acti-
vité NO, action sur le Fas ligand, qui est diminué par le TNFα,
inhibition de l’apoptose cellulaire endothéliale induite par le
TNFα,augmentation de la réendothélisation liée à une augmen-
tation des cellules souches, comme l’a montré l’équipe de
J.F. Arnal. Les œstrogènes agissent en grande partie en se fixant
au niveau d’un récepteur membranaire présent dans les cavéoles,
qui sont ensuite endocytées et recyclées.
Tableau. Résumé des recommandations de l’American Heart
Association concernant le traitement hormonal substitutif de la méno-
pause et le risque cardiovasculaire.
Prévention secondaire
• Le traitement ne doit pas être débuté chez une femme en prévention
secondaire.
• La décision de continuer ou d’arrêter un traitement chez une femme
présentant une pathologie coronarienne et prenant ce traitement depuis
longtemps doit être basée sur une analyse des rapports bénéfices/risques
et du désir de la patiente.
• Chez une femme présentant un événement coronarien aigu ou immo-
bilisée alors qu’elle prend le traitement hormonal substitutif, il est
prudent d’envisager l’arrêt du traitement ou de prévoir un traitement
prophylactique de la thrombose veineuse.
Prévention primaire
• Des recommandations ne pourront être données qu’avec le résultat des
essais thérapeutiques en cours.
• Il n’y a actuellement pas assez de travaux permettant de suggérer que
le traitement hormonal substitutif doit être entrepris dans le seul but de
prévenir la maladie coronarienne.
• La mise en place et la poursuite d’un traitement hormonal substitutif
doivent être basées sur une analyse du rapport bénéfices/risques en
dehors de la pathologie coronaire et de la préférence de la malade.
La Lettre du Cardiologue - Supplément au n° 351 - janvier 2002
42
ENDOCRINOLOGIE ET MALADIE VASCULAIRE

La Lettre du Cardiologue - Supplément au n° 351 - janvier 2002
43
ENDOCRINOLOGIE ET MALADIE VASCULAIRE
Deux effets des œstrogènes pourraient expliquer, au moins en
partie, les résultats obtenus dans les essais thérapeutiques : la
Lp(a) est, dans les études épidémiologiques, le plus souvent reliée
au risque cardiovasculaire. On sait depuis longtemps que les
œstrogènes diminuent sa concentration. Dans l’étude HERS, une
analyse en sous-groupe tenant compte du niveau de Lp(a) a mon-
tré que les femmes qui ont bénéficié, en termes de prévention car-
diovasculaire, du traitement œstrogénique étaient celles qui
avaient une concentration élevée de Lp(a).
La protéine C réactive, marqueur inflammatoire d’origine hépa-
tique, est un très bon marqueur du risque d’athérosclérose. Les
œstrogènes augmentent sa concentration. L’inflammation de la
paroi pouvant être impliquée dans la rupture de plaque, l’une des
hypothèses est que, chez les femmes en prévention secondaire,
l’augmentation de l’état inflammatoire de la paroi sous l’influence
des œstrogènes pourrait entraîner à court terme des accidents
aigus, alors qu’à plus long terme l’athérosclérose diminuerait.
En conclusion, si un faisceau d’arguments va dans le sens d’un
effet protecteur des œstrogènes sur l’athérosclérose, on ne sait
actuellement pas quel type de molécule utiliser et chez quelle
femme pour avoir un effet bénéfique sur le plan cardiovasculaire.
En attendant le résultat de trois études de prévention en cours,
l’essentiel est d’être prudent. Des recommandations viennent
d’être publiées par l’American Heart Association (tableau).
Celles-ci paraissent logiques et devraient être reprises au niveau
de l’Europe. ■
Tarif 2002
POUR RECEVOIR LA RELIURE
❐
10 €
avec un abonnement ou un réabonnement
MODE DE PAIEMENT
❐
par carte Visa
N°
ou
Eurocard Mastercard
Signature : Date d’expiration
❐
par virement bancaire à réception de facture (réservé aux collectivités)
❐
par chèque
(à établir à l'ordre de La Lettre du Cardiologue)
EDIMARK - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux
Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 à 6 semaines à réception de votre ordre.
Un justificatif de votre règlement vous sera adressé quelques semaines après son enregistre
ment.
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité .................................................................................
à l’attention de ..............................................................................
❏Particulier ou étudiant
Dr, M., Mme, Mlle ...........................................................................
Prénom ..........................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................
Adresse..........................................................................................
......................................................................................................
Code postal ...................................................................................
Ville ................................................................................................
Pays................................................................................................
Tél..................................................................................................
Avez-vous une adresse E-mail : oui ❏non ❏
Si oui, laquelle :
...............................................................................
Sinon, êtes-vous intéressé(e) par une adresse E-mail : oui ❏non ❏
Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,
changement d’adresse ou demande de renseignements.
ÉTRANGER (autre qu’Europe)
FRANCE / DOM-TOM Europe
❐
110 €
collectivités (127 $)
❐
92 €
particuliers (105 $)
❐
65 €
étudiants (75 $)
❐
90 €collectivités
❐
72 €particuliers
❐
45 ێtudiants
joindre la photocopie de la carte
LC 351
À découper ou à photocopier
✁
1 abonnement = 26 revues “on line”
1
/
4
100%