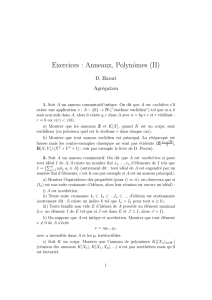Télécharger le cours "algèbre et géométrie"

Universit´e Blaise Pascal
U.F.R. Sciences et Technologies
D´epartement de Math´ematiques et Informatique
Licence de Math´ematiques
Troisi`eme ann´ee
ALG`
EBRE ET G´
EOM´
ETRIE
Polycopi´e du cours
2011-2012
Franc¸ois Dumas

Universit´e Blaise Pascal - U.F.R. Sciences et Technologies - D´epartement de math´ematiques et informatique
Licence de Math´ematiques
L3 S5 “Alg`ebre et G´eom´etrie”
ann´ee 2011-2012
Plan du cours
Franc¸ois DUMAS
Premi`
ere partie
Le¸con 1 - Groupes et sous-groupes
Le¸con 2 - Morphismes de groupes, produit direct de groupes
Le¸con 3 - Groupes monog`enes, groupes cycliques
Le¸con 4 - Groupe sym´etrique
Le¸con 5 - Conjugaison et sous-groupes normaux
Le¸con 6 - Groupes quotients
Le¸con 7 - Groupe op´erant sur un ensemble
Le¸con 8 - Groupes d’isom´etries
Le¸con 9 - Sous-groupes d’isom´etries laissant invariante
une partie du plan ou de l’espace
Le¸con 10 - Quelques compl´ements sur les groupes quotients
Seconde partie
Le¸con 11 - Anneaux, sous-anneaux, morphismes d’anneaux
Le¸con 12 - El´ements inversibles dans un anneau, corps, int´egrit´e
Le¸con 13 - Id´eal d’un anneau
Le¸con 14 - Anneaux quotients
Le¸con 15 - Anneaux euclidiens, anneaux principaux
Le¸con 16 - Divisibilit´e
Le¸con 17 - Arithm´etique dans les anneaux principaux
Le¸con 18 - Arithm´etique dans les anneaux de polynˆomes
Le¸con 19 - Polynˆomes d’endomorphismes
Le¸con 20 - Anneaux de polynˆomes en plusieurs ind´etermin´ees
version r´evis´ee au 16 ao^ut 2011
Ces notes de cours contiennent in´evitablement des coquilles, des erreurs, des points `a am´eliorer ou modifier.
Merci de me les signaler.
F[email protected] http://math.univ-bpclermont.fr/∼fdumas

Universit´e Blaise Pascal, Licence de Math´ematiques
L3 S5 : Alg`ebre et G´eom´etrie ann´ee 2011-2012
Le¸con 1
Groupes et sous-groupes
1.1 Notion de groupe
1.1.1 D´
efinition. Soit Gun ensemble non-vide. On appelle loi de composition interne dans G,
ou op´eration interne dans G, toute application ∗:G×G→G.
Une telle loi de composition interne permet donc d’associer `a tout couple (x, y) d’´el´ements de G
un autre ´el´ement de G, not´e x∗y, et appel´e le produit de xpar ypour la loi ∗.
1.1.2 D´
efinition. On appelle groupe tout ensemble non-vide Gmuni d’une loi de composition
interne ∗, v´erifiant les 3 propri´et´es suivantes (appel´ees axiomes de la structure de groupe):
(A1) la loi ∗est associative dans G;
rappelons que cela signifie que x∗(y∗z) = (x∗y)∗zpour tous x, y, z ∈G.
(A2) la loi ∗admet un ´el´ement neutre dans G;
rappelons que cela signifie qu’il existe e∈Gtel que x∗e=e∗x=xpour tout x∈G.
(A3) tout ´el´ement de Gadmet un sym´etrique dans Gpour la loi ∗;
rappelons que cela signifie que, pour tout x∈G, il existe x0∈Gtel que x∗x0=x0∗x=e.
1.1.3 D´
efinition. On appelle groupe commutatif, ou groupe ab´elien, tout groupe Gdont la loi ∗
v´erifie de plus la condition suppl´ementaire de commutativit´e: x∗y=y∗xpour tous x, y ∈G.
1.1.4 Exemples.
(a) Pour tout ensemble X, l’ensemble S(X) des bijections de Xsur Xmuni de la loi ◦de
composition des bijections est un groupe, appel´e groupe sym´etrique sur X.
Le neutre en est l’identit´e de X, car f◦idX= idX◦f=fpour toute f∈ S(X). Pour toute f∈
S(X), le sym´etrique de fpour la loi ◦est la bijection r´eciproque f−1, car f◦f−1=f−1◦f= idX.
D`es lors que Xcontient au moins trois ´el´ements, le groupe S(X) n’est pas ab´elien (montrez-le).
(b) Pour tout entier n≥1, l’ensemble GLn(R) des matrices carr´ees d’ordre ninversibles `a coef-
ficients r´eels est un groupe pour la multiplication des matrices.
Le neutre en est la matrice identit´e In, car M×In=In×M=Mpour toute M∈GLn(R).
Pour toute M∈GLn(R), le sym´etrique de Mpour la loi ×est la matrice inverse M−1, car
M×M−1=M−1×M=In. D`es lors que n≥2, le groupe GLn(R) n’est pas ab´elien (montrez-le).
(c) L’ensemble Cdes nombres complexes muni de l’addition est un groupe ab´elien.
Le neutre en est le nombre complexe nul 0, car z+ 0 = 0 + z=zpour tout z∈C. Pour tout
z∈C, le sym´etrique de zpour l’addition est son oppos´e −z, car z+ (−z) = (−z) + z= 0.
(d) L’ensemble C∗des nombres complexes non-nuls muni de la multiplication est un groupe
ab´elien.
Le neutre en est le nombre complexe 1, car z.1 = 1.z =zpour tout z∈C∗. Pour tout z∈C∗, le
sym´etrique de zpour la multiplication est son inverse z−1, car z.z−1=z−1.z = 1.
1

1.1.5 Remarques et conventions de notation. Afin d’´eviter la lourdeur de la notation ∗, on
convient g´en´eralement de noter la loi de composition interne d’un groupe quelconque G, soit comme
une multiplication (par un point.), soit comme une addition (par un +). Dans le premier cas, le
sym´etrique d’un ´el´ement est appel´e son inverse, dans le second cas, son oppos´e. Usuellement, on
r´eserve la notation additive au cas des groupes ab´eliens. C’est pourquoi, dans toute la suite de ce
polycopi´e, on adoptera pour les groupes quelconques, conform´ement `a l’usage courant, la notation
multiplicative.
(a) Un groupe Gsera donc un ensemble non-vide Gmuni d’une loi de composition interne .
→associative (x.(y.z) = (x.y).z pour tous x, y, z ∈G),
→admettant un ´el´ement neutre e(x.e =e.x =xpour tout x∈G),
→et telle que tout ´el´ement x∈Gadmette un sym´etrique x−1pour la loi .(x.x−1=x−1.x =e).
(b) De plus, l’´eventuelle commutativit´e de Gse traduira par: x.y =y.x pour tous x, y ∈G.
(c) On utilisera la notation xn=x.x.x ···x(nfacteurs) pour tous x∈Get n∈N∗, ainsi que les
conventions x0=e, et x−n= (xn)−1.
(d) Pour tous x, y ∈G, on a (x.y)−1=y−1.x−1(montrez-le, attention `a l’ordre !)
1.1.6 Quelques remarques techniques, mais parfois utiles, sur les axiomes de la structure de groupe.
(a) Dans un groupe G, l’´el´ement neutre eest n´ecessairement unique, et le sym´etrique d’un ´el´ement
quelconque est n´ecessairement unique.
(b) Si Gest un ensemble non-vide muni d’une loi de composition interne .qui est suppos´ee associative,
il suffit que Gadmette un ´el´ement neutre e`a droite (ce qui signifie que x.e =xpour tout x∈G)
et que tout ´el´ement x∈Gadmette un sym´etrique x0∈G`a droite (ce qui signifie que x.x0=e)
pour conclure que Gest un groupe.
1.2 Sous-groupe
1.2.1 Exemple introductif. Consid´erons le groupe C∗pour la multiplication. Dans C∗, consid´erons
le sous-ensemble R∗. En restreignant `a R∗la multiplication dans C∗, on obtient une loi de composition
interne dans R∗(car le produit de deux r´eels non-nuls est encore un r´eel non-nul). La question de savoir
si R∗est lui-mˆeme un groupe pour la loi .est donc fond´ee.
L’associativit´e de .dans R∗est ´evidemment v´erifi´ee (la relation x.(y.z) = (x.y).z ´etant vraie pour tous
x, y, z ∈C∗, elle est a fortiori vraie pour tous x, y, z ∈R∗).
Le nombre complexe 1 est un ´el´ement de R∗, et il est neutre pour la loi .dans R∗(la relation x.1 = 1.x =x
´etant vraie pour tout x∈C∗, elle est a fortiori vraie pour tout x∈R∗).
Pour tout x∈R∗, l’inverse x−1de xdans C∗appartient `a R∗et est donc l’inverse de xdans R∗(les
´egalit´es x.x−1=x−1.x = 1 ´etant alors vraies dans R∗comme dans C∗).
On conclut que le sous-ensemble R∗est lui-mˆeme un groupe pour la multiplication d´eduite de celle de
C∗par restriction. On dit alors que R∗est un sous-groupe de C∗.
Le mˆeme raisonnement s’applique si on remplace R∗par Q∗, mais pas si on le remplace par l’ensemble
des nombres imaginaires purs (car le produit de deux imaginaires purs n’est pas un imaginaire pur), ou
par l’ensemble Z∗(car l’inverse d’un entier non-nul peut ne pas ˆetre un entier).
1.2.2 D´
efinition. Soit Gun groupe muni d’une loi de composition interne .et soit Hun sous-
ensemble non-vide de G. On dit que Hest un sous-groupe de Glorsque les deux conditions suivantes
sont v´erifi´ees:
(1) Hest stable pour la loi .(ce qui signifie x.y ∈Hpour tous x, y ∈H),
(2) Hest stable par passage `a l’inverse (ce qui signifie x−1∈Hpour tout x∈H).
Dans ce cas, la restriction `a Hde la loi .de Gd´efinit une loi de composition interne dans H, pour
laquelle Hest lui-mˆeme un groupe.
2

1.2.3 Exemples.
(a) Z,Q,Rsont des sous-groupes du groupe Cmuni de l’addition, mais pas N(car l’oppos´e d’un
´el´ement de Nn’est pas n´ecessairement un ´el´ement de N).
(b) L’ensemble Udes nombres complexes de module ´egal `a 1 est un sous-groupe de C∗muni de
la multiplication. Pour tout entier n≥1, l’ensemble Undes racines n-i`emes de l’unit´e est un
sous-groupe de U.
(c) Pour tout n≥2, l’ensemble des matrices triangulaires sup´erieures d’ordre n`a coefficients r´eels
sans 0 sur la diagonale est un sous-groupe non-ab´elien de GLn(R). L’ensemble des matrices
diagonales d’ordre n`a coefficients r´eels sans 0 sur la diagonale en est un sous-groupe ab´elien.
(d) Important: tout groupe Gcontient toujours au moins pour sous-groupes le sous-groupe trivial
{e}form´e du seul ´el´ement neutre, et le groupe Glui-mˆeme.
1.2.4 Remarques.
(a) Les deux conditions de la d´efinition 1.2.2 peuvent ˆetre synth´etis´ees en une seule: soit Hun
sous-ensemble non-vide d’un groupe G, alors
(Hest un sous-groupe de G) si et seulement si (pour tous x, y ∈H, on a x.y−1∈H).
(b) Si Hest un sous-groupe de G, alors l’´el´ement neutre ede Gappartient n´ecessairement `a H
(car pour tout x∈H, on a x−1∈H, et x.x−1=e∈H). A contrario, un sous-ensemble
de Gqui ne contient pas le neutre de Gne peut en aucun cas ˆetre un sous-groupe (ce qui
est dans la pratique une fa¸con pratique tr`es fr´equente de v´erifier qu’un sous-ensemble d’un
groupe connu n’est pas un sous-groupe).
(c) Tout sous-groupe d’un groupe ab´elien est lui-mˆeme ab´elien, mais un groupe non ab´elien peut
contenir des sous-groupes ab´eliens aussi bien que des sous-groupes non-ab´eliens (voir 1.2.3.c).
(d) Dans la pratique, dans la plupart des cas, pour montrer qu’un ensemble donn´e est un groupe,
on ne revient pas `a la d´efinition par les trois axiomes, mais on cherche `a montrer qu’il est un
sous-groupe d’un groupe d´ej`a connu.
(e) Attention, pour v´erifier qu’un sous-ensemble donn´e d’un groupe est un sous-groupe, on
n’oubliera pas de v´erifier au pr´ealable qu’il est non-vide; d’apr`es la remarque (b) ci-dessus, le
plus naturel pour cela est de s’assurer qu’il contient le neutre.
1.2.5 Exemples.
(a) Soit Eun espace vectoriel de dimension finie. L’ensemble GL(E) des automorphismes d’espace
vectoriel de Eest un groupe appel´e groupe lin´eaire de E; pour le montrer, il suffit de v´erifier
que c’est un sous-groupe de S(E). Les ´el´ements de GL(E) qui ont un d´eterminant ´egal `a 1
forment un sous-groupe de GL(E), dit groupe sp´ecial lin´eaire, not´e SL(E).
(b) Supposons de plus que Eest euclidien. L’ensemble O(E) des isom´etries vectorielles de Eest
un groupe appel´e groupe orthogonal de E; pour le montrer, il suffit de v´erifier que c’est un
sous-groupe de GL(E). L’ensemble SO(E) des isom´etries vectorielles positives de Eest un
sous-groupe de O(E), et l’on a SO(E) = O(E)∩SL(E). L’ensemble des isom´etries vectorielles
n´egatives de En’est pas un sous-groupe de O(E) (il ne contient pas le neutre idE).
(c) L’ensemble des bijections continues et strictement croissantes de Rdans Rest un groupe pour
la loi ◦; pour le montrer, il suffit de v´erifier que c’est un sous-groupe du groupe S(R) de
toutes les bijections de Rsur R.
1.2.6 Proposition. L’intersection de deux sous-groupes d’un groupe Gest un sous-groupe de G.
Plus g´en´eralement, l’intersection d’une famille quelconque de sous-groupes d’un groupe Gest un
sous-groupe de G.
3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
1
/
117
100%