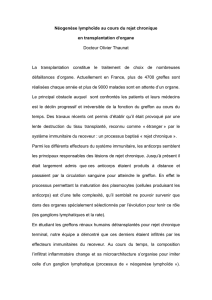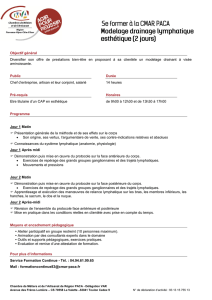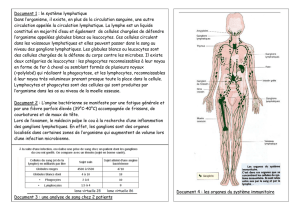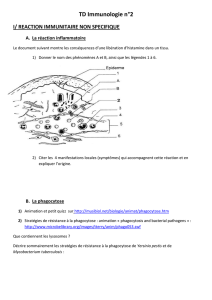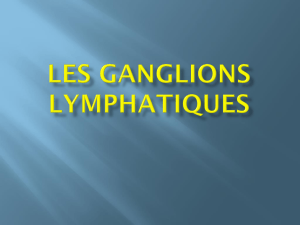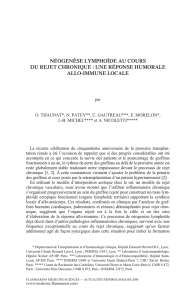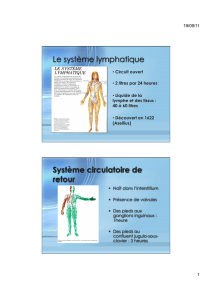au point M Lymphangiogenèse et néogenèse lymphoïde :

Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n
o 3 - juillet-août-septembre 2007
156
Mise
au point
Lymphangiogenèse et néogenèse lymphoïde :
deux nouveaux mécanismes impliqués dans la physiopathologie
du rejet chronique en transplantation d’organe
O.Thaunat*●
* Service d’immunologie clinique et de transplantation rénale, hôpital Édouard-
Herriot, Lyon.
L
a récente célébration du cinquantième anniversaire
de la première transplantation rénale a été l’occasion
de rappeler que, si des progrès considérables ont été
accomplis en ce qui concerne la survie des patients et le
pourcentage de greffons fonctionnels au-delà de la première
année, la demi-vie des greffons est restée globalement stable,
traduisant ainsi notre impuissance devant le processus de
rejet chronique (1).
À cette constatation vient s’ajouter le problème de la pénurie
des greffons.
Ce préambule souligne la nécessité d’améliorer notre connais-
sance de la physiopathologie du rejet chronique an de
proposer des solutions thérapeutiques innovantes et efcaces
qui permettront de prolonger la survie des greffons.
Drainage lyMpHatiQue et rejet cHrOniQue
Le réseau lymphatique est une voie majeure de communi-
cation pour le système immunitaire. En assurant le drainage
des tissus, il permet de concentrer dans l’organe lymphoïde
secondaire spécialisé (le ganglion lymphatique) les différents
acteurs de la réponse immune : cellules dendritiques matures
présentant les antigènes, lymphocytes T et lymphocytes B.
Des travaux pionniers ont montré que quelques jours étaient
sufsants pour que le processus de cicatrisation assure le
rétablissement de la continuité entre les réseaux lymphatiques
du greffon et ceux du receveur (2), mais très peu d’équipes
se sont interrogées sur le rôle du réseau lymphatique dans
la physiopathologie du rejet chronique.
A.J. Demetris et al. (3) ont publié en 1997 ce qui est longtemps
resté la seule contribution dans ce domaine. Dans un modèle
expérimental complexe de transplantation cardiaque chez le
rat, ils ont observé que le développement des lésions de rejet
chronique était corrélé à la destruction des lymphatiques du
donneur par la réponse allo-immune. À partir de ces résultats,
ils ont formulé l’hypothèse que le défaut de drainage lympha-
tique intervenait dans la physiopathologie du rejet chronique
en induisant l’accumulation de cytokines responsables de la
prolifération des cellules musculaires lisses et de l’augmen-
tation de synthèse de la matrice extracellulaire.
Récemment, des avancées considérables ont été faites dans
la compréhension des mécanismes conduisant au dévelop-
pement des vaisseaux lymphatiques : il s’agit de la lymphan-
giogenèse (4).
D. Kerjaschki et al. ont examiné l’implication de ce phéno-
mène au cours du rejet chronique. Ils ont, dans un premier
travail (5), analysé la localisation et la densité des vaisseaux
lymphatiques au sein de pièces de néphrectomies (pour cancer)
et montré que les vaisseaux lymphatiques n’étaient détectables
que dans l’adventice des artères de moyen calibre de ces reins
”normaux”. Ils ont ensuite procédé à la même étude sur des
biopsies de greffons. Ils ont alors constaté que certains greffons
(35/350 [10 %]) présentaient une très nette augmentation de la
densité des vaisseaux lymphatiques. Ils ont pu établir une corré-
lation positive entre l’augmentation de la densité des vaisseaux
lymphatiques au sein des greffons d’une part, et, d’autre part,
l’indice de chronicité de l’échelle de Banff ainsi que le risque de
perte de greffon. Dans un second travail récemment publié dans
Nature Medicine, la même équipe s’est cette fois intéressée
aux mécanismes responsables de la lymphangiogenèse dans les
greffons rénaux en rejet chronique (6). Les auteurs ont étudié
les pièces de détransplantations de 6 patients masculins ayant
reçu des greffons de femmes. Grâce à l’hybridation in situ avec
une sonde reconnaissant le chromosome Y, ils ont pu estimer
que 4,5 % environ (2,2 à 7 %) des cellules endothéliales des
lymphatiques néoformés dans le greffon dérivaient de progé-
niteurs lymphatiques provenant du receveur. Ce mécanisme
semble assez spécique de la lymphangiogenèse accompagnant
le rejet chronique, puisqu’il ne participe pas au turnover physio-
logique des cellules endothéliales lymphatiques de la peau ou
du côlon ni à la lymphangiogenèse associée au développement
des tumeurs cancéreuses. Dans ces dernières situations (comme
pour les 95,5 % de cellules endothéliales lymphatiques non
marquées par la sonde anti-Y au cours de la lymphangiogenèse
du rejet chronique !), les cellules endothéliales des lymphati-
ques néoformés proviennent de divisions cellulaires à partir
des cellules déjà présentes (comme en témoigne le marquage
KI67+). Les auteurs font l’hypothèse que les macrophages
jouent un rôle important dans la lymphangiogenèse au cours
du rejet chronique : pour certains d’entres eux (VEGF-R3+)
en étant les précurseurs des cellules endothéliales lympha-
tiques, et pour tous en étant la source principale de facteurs
lymphangiogéniques tels que le VEGF-C.
néOgenèse lyMpHOïDe et rejet cHrOniQue
La mise en place d’une réponse immune dépend de la
capacité du système immunitaire à réunir en un seul site
l’antigène, les cellules assurant sa présentation et les effec-
teurs lymphocytaires (clones T et B spéciques de cet anti-

Le Courrier de la Transplantation - Volume VII - n
o 3 - juillet-août-septembre 2007
157
Mise
au point
gène). An d’optimiser les chances de rencontre entre ces
protagonistes, le système immunitaire utilise les organes
lymphoïdes secondaires : rate, ganglions lymphatiques et
tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT). Dans ces
organes hautement spécialisés, les clones lymphocytaires T
et B n’ayant pas encore rencontré leur antigène sont stockés.
Ils attendent au repos que les cellules présentatrices de l’anti-
gène (en particulier les cellules dendritiques) leur présentent
les peptides rencontrés dans les tissus qu’elles viennent de
traverser. En réponse à une aide appropriée fournie par les
clones lymphocytaires T, les clones B spéciques du même
antigène entrent dans le centre germinatif où ils réalisent la
commutation isotypique et les hypermutations somatiques
qui vont permettre la production d’Ig plus afnes et plus
efcaces pour déclencher les mécanismes effecteurs.
Cette mécanique complexe a longtemps été considérée
comme spécique des organes lymphoïdes secondaires. On
sait cependant, depuis les travaux de A.E. Schröder (7) et
de A. Kratz (8), que les inltrats inammatoires qui carac-
térisent les réponses immunitaires chroniques de certaines
maladies auto-immunes ont tendance à s’organiser et nis-
sent par reproduire au sein de l’organe cible des structures
lymphoïdes se comportant comme des centres germinatifs
ectopiques. Ce processus, connu sous le nom de néogenèse
lymphoïde, n’est pas restreint aux réponses auto-immunes, et
notre équipe a récemment montré qu’il participait également
au rejet chronique en transplantation (9). Ainsi, au cours du
rejet chronique, l’organe rejeté est non seulement la cible
mais aussi le site où la réponse allo-immune s’élabore.
néOgenèse lyMpHOïDe et lyMpHangiOgenèse
au cOurs Du rejet cHrOniQue
Le développement d’une réponse immune efcace au sein
du ganglion lymphatique dépend d’une part de l’efcacité du
drainage du tissu dont le ganglion assure la défense – c’est
par le réseau lymphatique afférent qu’arrivent les cellules
dendritiques chargées d’antigènes –, et d’autre part du
réseau lymphatique efférent, qui va permettre aux effec-
teurs lymphocytaires activés de quitter le ganglion pour
rejoindre les compartiments de l’organisme où ils assurent
leurs fonctions.
Les raisons pour lesquelles, au cours du rejet chronique,
le système immunitaire délègue au greffon les fonctions
immunes spécialisées d’un organe lymphoïde secondaire
restent pour l’instant imparfaitement comprises. Une des
explications plausibles pourrait être que la néogenèse
lymphoïde permet au système immunitaire de suppléer au
défaut de drainage lymphatique de l’organe rejeté (3). Le
prix à payer pour le système immunitaire serait une réponse
moins bien contrôlée, puisque se déroulant dans un tissu non
lymphoïde (non professionnel) et dans un environnement de
“danger” immunologique (tissu avoisinant détruit).
Cette vision de la relation entre néogenèse lymphoïde et rejet
chronique doit aussi tenir compte des travaux de D. Kerjaschki
et al. sur la lymphangiogenèse, qui suggèrent que le dévelop-
pement du rejet chronique est associé à une densité augmentée
de vaisseaux lymphatiques dans le tissu rejeté.
Nous formulons à ce stade trois hypothèses de travail :
Le réseau lymphatique qui se développe dans les tissus
rejetés est non fonctionnel. Il est incapable de drainer ef-
cacement le tissu, et sa croissance exubérante pourrait alors
correspondre à un cercle vicieux dont le moteur serait juste-
ment le défaut de drainage.
Le réseau lymphatique néoformé est fonctionnel mais il
est drainé vers les organes lymphoïdes ectopiques (et non
vers le ganglion drainant).
Le réseau lymphatique néoformé est fonctionnel et drainé
vers le ganglion drainant. Dans ce cas, les raisons du développe-
ment de la néogenèse lymphoïde sont encore incomprises.
cOnclusiOn
D’importants progrès ont été faits récemment dans la descrip-
tion de deux nouveaux mécanismes impliqués dans la physio-
pathologie du rejet chronique : la néogenèse lymphoïde et
la lymphangiogenèse.
Les relations qui existent entre ces deux phénomènes font
l’objet de travaux qui devront permettre d’identier quelle
est la meilleure cible pour prévenir leur développement. De
nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant ces mécanismes
nous permettront peut-être de prolonger la survie des greffons
en retardant l’apparition des lésions de rejet chronique. ■
RéféRences bibliogRaphiques
1. Sayegh MH, Carpenter CB. Transplantation 50 years later-progress,
challenges, and promises. N Engl J Med 2004;351:2761-6.
2. Malek P, Vrubel J, Kolc J. Lymphatic aspects of experimental and clinical
renal transplantation. Bull Soc Int Chir 1969;28:110-4.
3. Demetris AJ, Murase N, Ye Q et al. Analysis of chronic rejection and
obliterative arteriopathy. Possible contributions of donor antigen-presenting
cells and lymphatic disruption. Am J Pathol 1997;150:563-78.
4. Jain RK, Padera TP. Development. Lymphatics make the break. Science
2003;299:209-10.
5. Kerjaschki D, Regele HM, Moosberger I et al. Lymphatic neoangiogenesis
in human kidney transplants is associated with immunologically active
lymphocytic inltrates. J Am Soc Nephrol 2004;15:603-12.
6. Kerjaschki D, Huttary N, Raab I et al. Lymphatic endothelial progenitor
cells contribute to de novo lymphangiogenesis in human renal transplants.
Nat Med 2006;12:230-4.
7. Schröder AE, Greiner A, Seyfert C, Berek C. Differentiation of B cells in
the nonlymphoid tissue of the synovial membrane of patients with rheumatoid
arthritis. Proc Natl Acad Sci USA 1996;93:221-5.
8. Kratz A, Campos-Neto A, Hanson MS, Ruddle NH. Chronic inammation
caused by lymphotoxin is lymphoid neogenesis. J Exp Med 1996;183:
1461-72.
9. Thaunat O, Field AC, Dai J et al. Lymphoid neogenesis in chronic
rejection: evidence for a local humoral alloimmune response. Proc Natl
Acad Sci USA 2005;102:14723-8.
✓
✓
✓
1
/
2
100%