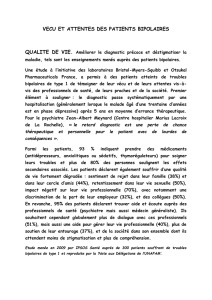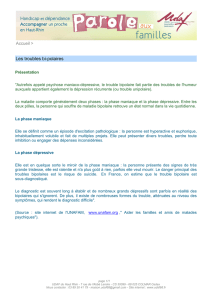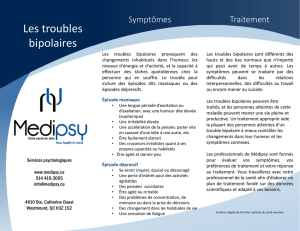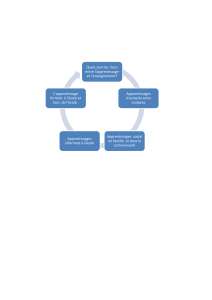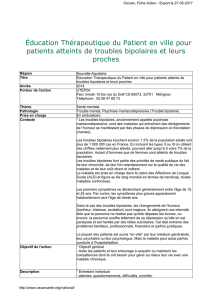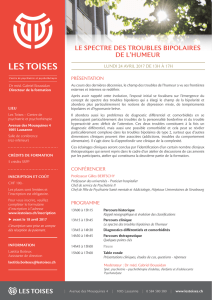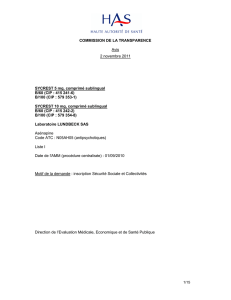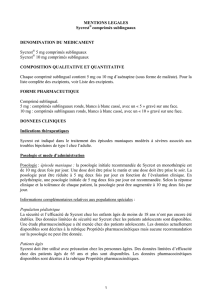• L’accès maniaque et les bipolarités La remédiation cognitive

le courrier du spécialiste
SUPPLÉMENT
Attention, ceci est un compte-rendu de congrès et/ou un recueil de résumés de communications de congrès dont l’objectif est de
fournir des informations sur l’état actuel de la recherche ; ainsi, les données présentées sont susceptibles de ne pas être validées
par les autorités de santé françaises et ne doivent donc pas être mises en pratique.
Société éditrice : EDIMARK SAS
CPPAP : 0915 T 86854 – ISSN : 1774-0789
PÉRIODIQUE DE FORMATION
EN LANGUE FRANÇAISE
Suppl. 2 au n° 2 - Vol. VIII
Mars-avril 2012
Ce numéro a été réalisé avec
le soutien institutionnel des laboratoires
• L’accès maniaque
et les bipolarités
• La remédiation cognitive
• La prévention du suicide
D’après le 10e congrès
de l’Encéphale
Paris, 18-20 janvier 2012
Rédacteur : Dr J.P. Madiou (Paris)

Supplément2 au no 2- Vol. VIII
mars-avril 2012
Sommaire
Directeur de la publication : Claudie Damour-Terrasson
Directeur scientifique : Pr C.S. Peretti (Paris)
Rédacteurs en chef : Pr P. Thomas (Lille) - Dr P. Nuss (Paris)
Comité de rédaction
Prs et Drs M. Abbar (Nîmes) - E. Bacon (Strasbourg)
R. de Beaurepaire (Paris) - M. Benoit (Nice) - O. Blin (Marseille)
P. Courtet (Montpellier) - P. Delbrouck (Saint-Nazaire)
N. Franck (Bron) - M. Godfryd (Étampes)
J.M. Havet (Reims) - P.M. Llorca (Clermont-Ferrand)
P.O. Mattei (Paris) - D. Servant (Lille)
F. Thibaut (Rouen) - B. Verrecchia (Paris)
Comité scientifique
Prs et Drs J.F. Allilaire, Paris (France)
C. Ballüs, Barcelone (Espagne) - H. Beckmann, Wurzbürg
(Allemagne) - G. Besançon, Nantes (France) - D. Clark, Oxford
(Grande-Bretagne) - G.B. Cassano, Pise (Italie) - L. Colonna,
Rouen (France) - J. Cottraux, Lyon (France) - J.M. Danion,
Strasbourg (France) - P. Dick, Genève (Suisse) - M. Escande,
Toulouse (France) - A. Feline, Paris (France) - M. Ferreri, Paris
(France) - R. Girard, Caen (France) - L. Gram, Odense (Danemark)
J.J. Kress, Rennes (France) - M. Lader, Londres (Grande-Bretagne)
M. Marie-Cardine, Lyon (France) - I. Marks, Londres
(Grande-Bretagne) - J. Mendlewicz, Bruxelles (Belgique)
D. Moussaoui, Casablanca (Maroc) - M. Murray, Londres
(Grande-Bretagne) - P.J. Parquet, Lille (France) - M. Patris,
Strasbourg (France) - G. Potkin, Irvine (États-Unis) - W.Z. Potter,
Washington (États-Unis) - C. Pull, Luxembourg (Grand-Duché)
G. Rudenko, Moscou (Russie) - B. Saletu, Vienne (Autriche)
D. Sechter, Besançon (France) - L. Singer, Strasbourg (France)
T. Uhde, Bethesda (États-Unis) - Van der Linden, Liège (Belgique)
A. Villeneuve, Québec (Canada)
Comité de lecture
Drs et Prs P. Alary (Saint-Lô) - D. Barbier (Avignon)
F.J. Baylé (Paris) - N. Bazin (Versailles) - P. Fossati (Paris)
P. Hardy (Paris) - E. Hoffmann (Strasbourg) - J.P. Kahn (Nancy)
C. Lançon (Marseille) - M. Leboyer (Créteil) - P. Martin (Paris)
J. Naudin (Marseille) - P. Robert (Nice) - P. Salame (Strasbourg)
G. Schmit (Reims) - J.L. Senon (Poitiers) - H. Verdoux (Bordeaux)
J.P. Vignat (Lyon) - M.A. Wolf (Montréal)
Société éditrice : EDIMARK SAS
Président-directeur général : Claudie Damour-Terrasson
Rédaction
Secrétaire générale de la rédaction : Magali Pelleau
Première secrétaire de rédaction : Laurence Ménardais
Secrétaire de rédaction : Anne Desmortier
Rédacteurs-réviseurs : Cécile Clerc, Sylvie Duverger,
Muriel Lejeune, Philippe-André Lorin, Odile Prébin
Infographie
Premier rédacteur graphiste : Didier Arnoult
Rédacteurs graphistes : Mathilde Aimée, Christine Brianchon,
Sébastien Chevalier, Virginie Malicot, Rémy Tranchant
Infographiste multimédia : Christelle Ochin
Dessinatrice d’exécution : Stéphanie Dairain
Responsable numérique : Rémi Godard
Commercial
Directeur du développement commercial
Sophia Huleux-Netchevitch
Directeur des ventes : Chantal Géribi
Directeur d’unité : Béatrice Malka
Régie publicitaire et annonces professionnelles
Valérie Glatin
Tél. : 01 46 67 62 77 – Fax : 01 46 67 63 10
Responsable du service abonnements
Badia Mansouri
Tél. : 01 46 67 62 74 – Fax : 01 46 67 63 09
2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 46 67 63 00 – Fax : 01 46 67 63 10
E-mail : [email protected]
Site Internet : www.edimark.fr
Adhérent au SPEPS
Revue indexée dans la base PASCAL (INIST-CNRS)
Photographie de la couverture : © Nikada.
AVANT-PROPOS 3
J.P. Madiou
NOUVELLES LECTURES
DE L’ACCÈS MANIAQUE ET DES BIPOLARITÉS 4
De l’épisode initial aux récidives
Risques cognitifs du trouble bipolaire
Besoins thérapeutiques et nouvelles pistes
pharmacologiques
Actualités dans le trouble bipolaire
Psychoéducation dans les troubles bipolaires
REMÉDIATION COGNITIVE 9
Remédiation et théorie de l’esprit
Présentation du programme RECOS
Cognitive Remediation Therapy
Inhibition cognitive et mémoire implicite
dans le trouble dépressif majeur
PRÉVENTION DU SUICIDE 11
Suicide en période gravido-puerpérale : résultats
d’une enquête épidémiologique française
Reconstitution des processus pathologiques
lorsd’une tentative de suicide
Idées suicidaires aux urgences psychiatriques :
résultats d’une étude comparant auto- et hétéro-
évaluation
APPÉTENCE À L’ALCOOL :
DE LA CLINIQUE À LA THÉRAPEUTIQUE 12
Les articles publiés dans
La Lettre du Psychiatre
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© mars 2005 - EDIMARK SAS - Dépôt légal : à parution.
Imprimé en France - Axiom Graphic SAS - 95830 Cormeilles-en-Vexin

AVANT-PROPOS
J.P. Madiou
Paris
Réunion annuelle incontournable de la psychiatrie francophone
– avec cette année plus de 4 000participants –, le 10econgrès
de l’Encéphale s’est tenu à Paris du 18 au 20janvier dernier.
Leprogramme était particulièrement complet : 16communications
orales en séance plénière, 466 posters sélectionnés et de nombreuses
sessions thématiques et symposiums. Parmi les thèmes retenus
pource supplément de La Lettre du Psychiatre − et parce
qu’ilabienfallu faire un choix non exhaustif −, de nouvelles lectures
del’accès maniaque et des bipolarités (risques cognitifs du trouble
bipolaire, besoins thérapeutiques et nouvelles molécules,
psychoéducation, etc.), les techniques de remédiation cognitive
et la prévention du suicide, sans oublier l’alcoolo-dépendance,
sontautant de sujets qui devraient nous permettre de partager
avecvous l’actualité des connaissances cliniques, physio-
et psychothérapeutiques.
La Lettre du Psychiatre • Supplément 2 au n° 2 - Vol.VIII - mars-avril 2012 | 3

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0Patients bipolaires Témoins
*
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
Patients bipolaires Témoins
**
Comparaison des scores de labilité
affective des patients bipolaires et des témoins
Comparaison des scores d’intensité
affective des patients bipolaires et des témoins
* p < 0,001 ; ** p < 0,01.
Figure 1. Étude réalisée auprès de 179 patients bipolaires normothymiques et 86 témoins : la réactivité émotionnelle
de base chez les patients bipolaires normothymiques est corrélée au nombre d’épisodes (2).
4 | La Lettre du Psychiatre • Supplément 2 au n° 2 - Vol. VIII - mars-avril 2012
L’ENCÉPHALE 2012
Nouvelles lectures de l’accès
maniaque et des bipolarités
J.P. Madiou, Paris
De l’épisode initial aux récidives
D’après la communication orale de C. Henry
La quasi-totalité (90 %) des patients qui ont fait un
épisode maniaque récidivera : la maladie bipolaire est
bien, de ce point de vue, une pathologie récurrente.
Si la survenue des épisodes maniaques peut être
spontanée, on retrouve très souvent des facteurs
“précipitants” ou “déclenchants” : ce sont essentiel-
lement des facteurs de stress, positifs (événements
heureux comme une promotion professionnelle,
un mariage, etc.) ou négatifs (perte d’emploi,
divorce, deuil, etc.), et des événements à fort impact
émotionnel ou qui perturbent les rythmes de la vie
quotidienne (surmenage, examens, etc.). Les modi-
fications du rythme veille/sommeil peuvent ainsi
précipiter un épisode maniaque. La plupart de ces
facteurs précipitants sont d’ailleurs souvent liés à
des perturbations du sommeil (1). Une bonne façon
d’appréhender les facteurs prodromiques est de les
envisager sous l’angle de la réactivité émotionnelle.
Contrairement à l’humeur, les émotions sont des
réponses brèves à des stimuli environnementaux,
elles sont caractérisées par la tonalité des affects
mais aussi par l’intensité de la réponse émotionnelle
aux stimulations. Les patients bipolaires normo-
thymiques présentent une plus grande réactivité
émotionnelle que les sujets témoins, c’est-à-dire
qu’ils ressentent les émotions de manière plus
intense face à des stimuli positifs, négatifs ou neutres
quel que soit le facteur précipitant. On peut mettre
en évidence cette hyperréactivité émotionnelle
grâce à des échelles et des autoquestionnaires, qui
montrent une forte corrélation entre cette réactivité
émotionnelle et le nombre d’épisodes thymiques
survenus au cours de la vie (figure 1) [2, 3].
Cette notion de réactivité émotionnelle a égale-
ment une dimension fondamentale, permettant
de définir les épisodes thymiques. Ainsi, au cours
des épisodes maniaques ou mixtes, l’intensité avec
laquelle les émotions sont ressenties est largement
augmentée. Dans ce contexte, le temps de sommeil
est un élément important. En effet, il existe un lien
entre le sommeil et la réactivité émotionnelle (4)
et l’on sait que la réduction du temps de sommeil
peut être un des facteurs précipitants des épisodes
maniaques (5). On dispose aujourd’hui d’éléments
très cohérents en termes d’imagerie et de clinique
qui corroborent cette hypothèse. La prise en charge
des facteurs prodromiques consiste tout d’abord à
apprendre aux patients bipolaires, dans le cadre de
programmes psychoéducatifs, à faire le lien entre
réduction du temps de sommeil et augmentation
de la réactivité émotionnelle, puisque ces signes
très précoces apparaissent avant que ne s’installe

La Lettre du Psychiatre • Supplément 2 au n° 2 - Vol.VIII - mars-avril 2012 | 5
L’ENCÉPHALE 2012
vraiment un épisode d’euphorie ou d’agitation. Il
s’agit ensuite d’apprendre aux patients à repérer
tout ce qui peut entraîner des perturbations du
sommeil susceptibles de provoquer un embrase-
ment émotionnel. Une échelle (Multidimensional
Assessment of Thymic States [MAThyS]) a été mise
au point et permet d’évaluer la réactivité émotion-
nelle, sous forme d’un autoquestionnaire que les
patients peuvent utiliser pour apprécier les varia-
tions de leur réactivité émotionnelle (5, 6). L’action
quasi immédiate des antipsychotiques atypiques
sur une sémiologie “larvée” permet ainsi d’éviter
les récidives.
Risques cognitifs du trouble
bipolaire
D’après les communications orales de J.M. Azorin
et E. Brunet-Gouet
Des revues systématiques de la littérature et des
méta-analyses (7) ont montré qu’il existe, chez
les patients bipolaires, des troubles cognitifs qui
concernent majoritairement 3 grands domaines :
l’attention et la vitesse de traitement, l’apprentis-
sage et la mémoire verbale, et enfin les fonctions
exécutives. Les altérations cognitives sont d’intensité
légère à modérée dans le domaine de l’attention
et la vitesse de traitement, moyenne dans celui de
l’apprentissage verbal et de la mémoire verbale, et
relativement importante en ce qui concerne les fonc-
tions exécutives. Ces altérations ont été décrites dans
les différentes phases de la maladie mais également
au cours des périodes euthymiques (8). De nombreux
patients, par exemple, oublient complètement ce
qui leur est arrivé pendant l’épisode aigu dépressif
ou maniaque : ils souffrent de véritables troubles
de la mémoire et ne récupèrent pas leurs fonctions
cognitives entre les épisodes aigus. J.M. Azorin a
souligné 2 points importants :
➤un certain nombre de ces altérations − notam-
ment celles qui concernent la mémoire verbale, l’ap-
prentissage verbal et certaines fonctions exécutives
− existent déjà chez les apparentés sains de premier
degré (9). Autrement dit, indépendamment même du
développement de la maladie, il existerait un risque
lié à la génétique de présenter des troubles cognitifs.
Cela explique que l’on peut retrouver ces déficits à
tous les stades de la maladie (épisodes maniaques,
dépressifs, phases interépisodes) ;
➤
un certain nombre de ces altérations cogni-
tives augmente en intensité avec la répétition des
épisodes (en particulier maniaques), ainsi qu’avec
la durée de la maladie.
Deux phénomènes agissent donc sur ces troubles
cognitifs : le contexte génétique et la répétition
des épisodes aigus (10). Cela peut aller jusqu’à une
évolution démentielle, comme l’a démontré une
étude danoise réalisée sur la période 1970-1999
(4 248 patients bipolaires admis en milieu hospi-
talier, puis réadmis avec le diagnostic de démence
après 1985) : le taux de réadmission pour démence
augmente de 6 % avec chaque épisode nécessitant
une hospitalisation, et ce après ajustement sur l’âge
et le sexe (11).
Concernant l’évaluation de ces troubles cogni-
tifs, the International Society for Bipolar Disorders
a proposé, en 2010, la Battery for Assessment of
Neurocognition ou ISBD-BANC : il s’agit d’une
batterie spécifique d’évaluation des troubles cogni-
tifs dans le domaine des troubles bipolaires (12).
L’idée est de regrouper spécifiquement les tests
utilisés jusqu’à présent de manière éparse, un peu
à l’instar de ce qui a été fait dans le domaine de
la schizophrénie avec la batterie MATRICS (13).
L’intérêt est ainsi d’homogénéiser les évaluations
en utilisant un éventail de tests unique.
La prise en charge thérapeutique a pour objectif de
parvenir en priorité à une rémission complète des
symptômes au cours de ces épisodes aigus grâce
à un traitement rapide et efficace qui limitera le
plus possible les effets délétères sur la cognition.
La persistance de symptômes résiduels maniaques,
dépressifs ou hypomaniaques entre les crises fait
assurément le lit des troubles cognitifs (14).
Il a été constaté, sur le fonctionnement cognitif
des patients bipolaires, un effet limité mais parfois
bénéfique de la lamotrigine (attention, fluence
verbale), un effet potentiellement délétère des
tricycliques et un effet généralement décrit comme
neutre pour le lithium (15). Pour compléter l’ap-
proche pharmacologique et obtenir un résultat
thérapeutique optimal, les approches psychoé-
ducatives sont un complément essentiel, avec,
entre autres, la remédiation cognitive. Comme
pour la schizophrénie, ces techniques inspirées de
la thérapie cognitivo-comportementale permettent
aux patients de compenser leurs altérations cogni-
tives. Il s’agit, par exemple, d’apprentissages qui
consistent à donner au sujet un certain nombre de
consignes lui permettant d’organiser sa journée,
d’apprendre à ne pas vouloir tout résoudre à la
fois et de cerner les problèmes… Il faut bien sûr
adapter la remédiation cognitive aux altérations
du patient. Très peu d’études ont été néanmoins
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%