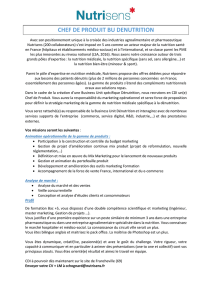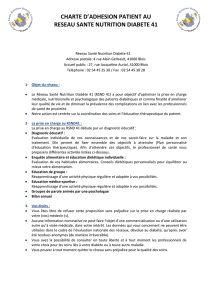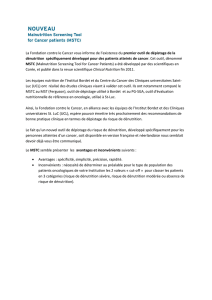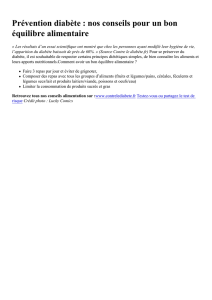nutrition et dietetique

cahiers
de nutrition
et de
diététique
Indexés dans, indexed in Chemical Abstracts, EMbase (Excerpta Medica) et Pascal (INIST/CNRS)
ISSN 0007-9960
Cah. Nutr. Diét., 2001, 36, 2S1-2S163
Société de Nutrition et de Diététique de Langue Française
volume 36 2001 hors série 1
SNDLF
SNDLF
SNDLF
SNDLF
SNDLF
632303
2nd cycle
Collège des Enseignants de Nutrition

Liste des auteurs
A. Avignon
P. Barbe
A. Basdevant
J.-L. Bresson
C. Colette
T. Constans
J. Cosnes
P. Crenn
J. Delarue
D. Fouque
M. Gerber
H. Gin
F. Guebre-Egziabher
B. Guy-Grand
X. Hébuterne
M. Krempf
D. Lalau
F. Lamisse
B. Lesourd
A. Martin
J.-C. Melchior
B. Messing
L. Monnier
P. Moulin
J.-M. Oppert
T. Piche
D. Quilliot
D. Raccah
D. Rigaud
C. Simon
J.-L. Schlienger
P. Vague
K. Vahedi
P. Valensi
B. Vialettes
O. Ziegler
Comité de rédaction
J.-L. Bresson
J. Delarue
M. Romon
C. Simon
Coordination
J.-L. Bresson

2S1
Cah. Nutr. Diét., 36, hors série 1, 2001
SOMMAIRE
7Besoins nutritionnels (16, 21, 24, 34, 110, 111, 179)
• Besoins et apports nutritionnels conseillés
• Besoins nutritionnels au cours de la grossesse et de la lactation
• Conseils nutritionnels, évaluation des apports et prescription d’un régime
• Alimentation du sportif
26 Risques liés à l’alimentation (73)
• Les risques toxicologiques
• Les toxi-infections alimentaires
41 Alimentation et cancer (139)
48 Alcoolisme (45)
57 Sémiologie des troubles du comportement alimentaire de l’adulte -
Anorexie et boulimie (42)
63 Obésité de l’enfant et de l’adulte (267)
73 Diabète de type II (17, 233)
• Physiopathologie
• Prise en charge
• Diabète et grossesse
88 Athérosclérose (128, 129, 130)
• Physiopathologie, évaluation du risque cardio-vasculaire, prévention nutritionnelle
• Facteurs nutritionnels de l’HTA
• Les hyperlipoprotéinémies
• Sédentarité, activité physique et prévention du risque
111 Evaluation de l’état nutritionnel (110)
117 Dénutrition (110, 295)
126 Troubles nutritionnels du sujet âgé (61)
133 Amaigrissement (110, 295)
137 Alimentation entérale et parentérale (110)
150 Anémies nutritionnelles (222, 297)
157 Nutrition et insuffisance rénale (179, 253)

2S2 Cah Nutr Diét, 36, hors série 1, 2001
Première partie :
enseignement transversal
Module 2. De la conception à la naissance
Item 16. Grossesse normale. Besoins nutritionnels d’une
femme enceinte
– Expliquer les particularités des besoins nutritionnels
d’une femme enceinte.
Item 17. Principales complications de la grossesse
– Savoir diagnostiquer et connaître les principes de pré-
vention et de prise en charge du diabète gestationnel.
Item 21. Prématurité et retard de croissance intra-utérin :
facteurs de risque et prévention
– Expliquer les principaux facteurs de risque et savoir
expliquer les éléments de prévention de la prématurité
et du retard de croissance intra-utérin.
Item 24. Allaitement
– Argumenter les techniques et les bénéfices de l’allaite-
ment maternel.
Module 3. Maturation et vulnérabilité
Item 34. Alimentation et besoins nutritionnels du nourris-
son et de l’enfant
– Expliquer les besoins nutritionnels du nourrisson et de
l’enfant.
– Prescrire le régime alimentaire d’un nourrisson.
– Argumenter les principes de la prévention et de la prise
en charge de l’obésité de l’enfant.
Item 42. Troubles du comportement alimentaire de
l’enfant et de l’adulte
– Donner des conseils d’hygiène alimentaire.
– Savoir diagnostiquer une anorexie mentale et une bou-
limie.
– Argumenter les principes de la prise en charge des
troubles du comportement alimentaire.
Item 45. Addictions et conduites dopantes (alcool)
Module 5. Vieillissement
Item 56. Ostéoporose
– Savoir diagnostiquer une ostéoporose.
– Argumenter les principes de traitement et la surveil-
lance (au long cours).
Item 61. Troubles nutritionnels chez le sujet âgé
– Savoir diagnostiquer un trouble nutritionnel chez le
sujet âgé.
– Apprécier les signes de gravité et le pronostic.
– Argumenter les principes du traitement et la surveil-
lance (au long cours).
Module 7. Santé, environnement,
maladies transmissibles
Item 73. Risques sanitaires liés à l’eau et à l’alimentation ;
toxi-infections alimentaires
– Préciser les principaux risques liés à la consommation
d’eau et d’aliments dans les pays développés et en voie
de développement.
– Préciser les paramètres de qualité des eaux d’alimen-
tation et les méthodes de contrôle.
– Savoir diagnostiquer une toxi-infection alimentaire et
connaître les principes de prévention.
– Adopter une conduite pratique devant une toxi-infec-
tion familiale ou collective.
Item 110. Besoins nutritionnels et apports alimen-
taires de l’adulte. Evaluation de l’état nutritionnel.
Dénutrition
– Exposer les besoins nutritionnels de l’adulte, de la per-
sonne âgée, de la femme enceinte.
– Evaluer l’état nutritionnel d’un adulte sain et d’un adulte
malade.
– Argumenter la prise en charge d’une dénutrition.
– Mener une enquête alimentaire et prescrire un régime
diététique.
Item 111. Sports et santé. Aptitude aux sports chez l’en-
fant et chez l’adulte. Besoins nutritionnels chez le sportif
– Exposer les besoins nutritionnels chez le sportif enfant
et chez le sportif adulte.
PROGRAMME DE LA RÉFORME DU DEUXIÈME CYCLE
Arrêté du 10/10/2000 (JO 17/10/2000)

2S3
Cah Nutr Diét, 36, hors série 1, 2001
Module 9. Athérosclérose - hypertension -
thrombose
Item 128. Athérome : épidémiologie et physiopathologie
– Expliquer l’épidémiologie et les principaux mécanismes
de la maladie athéromateuse et les points d’impact des
thérapeutiques. Préciser l’évolution naturelle.
– Savoir réaliser la prise en charge au long cours d’un
malade polyathéromateux.
Item 129. Facteurs de risque cardio-vasculaire et prévention
– Expliquer les facteurs de risque cardio-vasculaire et leur
impact pathologique.
– Prendre en charge les hyperlipoprotéinémies.
– Appliquer la prévention primaire et secondaire des fac-
teurs de risque cardio-vasculaire et les stratégies indivi-
duelles et collectives.
Item 130. Hypertension artérielle de l’adulte
– Expliquer l’épidémiologie, les principales causes et
l’histoire de l’hypertension artérielle de l’adulte.
– Savoir appliquer le traitement et la prise en charge au
long cours de l’hypertension artérielle.
Module 10. Cancérologie
Item 139. Facteurs de risque, prévention et dépistage
des cancers
– Expliquer et hiérarchiser les facteurs de risque des can-
cers les plus fréquents.
– Expliquer les principes de prévention primaire (tabac)
et secondaires (dysplasie du col utérin).
Module 11. Synthèse clinique
et thérapeutique
Item 179. Prescription d’un régime diététique
– Prescrire un régime diététique en fonction de la patho-
logie et du contexte clinique.
Deuxième partie :
maladie et grands syndromes
Item 222. Anémie par carence martiale
– Savoir diagnostiquer une anémie par carence martiale.
– Savoir appliquer le traitement et la surveillance de
l’évolution.
Item 233. Diabète de type I et II de l’enfant et de l’adulte.
Complications
– Savoir diagnostiquer un diabète chez l’enfant et l’adulte.
– Apprécier les signes de gravité et le pronostic.
– Savoir diagnostiquer et traiter une décompensation
acido-cétosique.
– Argumenter les principes du traitement et la surveillance.
Item 253. Insuffisance rénale
Item 267. Obésité de l’enfant et de l’adulte
– Savoir diagnostiquer une obésité chez l’enfant et l’adulte.
– Apprécier les signes de gravité et le pronostic.
– Accompagner le patient et sa famille dans sa démarche
de contrôle pondéral.
– Connaître les facteurs favorisant l’obésité de l’enfant et
de l’adulte et les mesures de prévention ou argumenter
les principes du traitement et de la surveillance.
Troisième partie :
orientation diagnostique
Item 295. Amaigrissement
– Devant un amaigrissement : argumenter les hypothèses
diagnostiques et justifier les examens complémentaires
pertinents.
Item 297. Anémies
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
1
/
163
100%