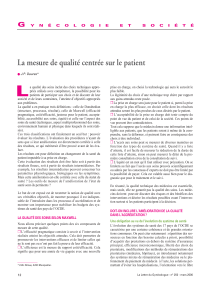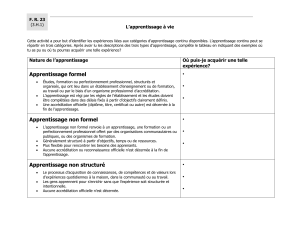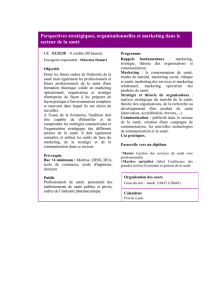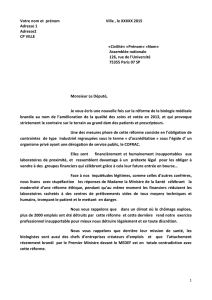Lire l'article complet

3
La Lettre du Gynécologue - n° 311 - avril 2006
l y a quelques années, excédé d’assister à une constante dégrada-
tion des conditions d’exercice de la médecine, tant dans le secteur
public qu’en libéral, je publiais un livre “coup de gueule”**.
En dehors du plaisir lié au défoulement, les retombées de ce petit évé-
nement furent bien maigres ! Pourtant, tout avait bien commencé avec
un très sympathique mot manuscrit du ministre de la Santé de l’époque
qui me félicitait d’avoir eu l’audace, voire le courage, d’avoir écrit tout
cela et m’invitait à participer à une commission qu’il décidait de mettre
en place pour remédier, au moins partiellement, à ce que je dénonçais…
Cela dit, la mise en place d’une commission nécessite d’entendre beau-
coup d’avis, notamment sur sa composition. Elle ne vit pas le jour,
d’autant plus que, quelques mois plus tard, un remaniement ministériel
redistribuait les cartes.
Que s’est-il passé au cours de ces huit années écoulées ? En bref, bien
peu de progrès et beaucoup d’aggravation, au point qu’aux quelques
150 pages que j’avais écrites, il faudrait sans aucun doute en ajouter
une bonne cinquantaine pour décrire la situation actuelle.
Des progrès, il y en a eu, mais à quel prix ! Je critiquais à l’époque la
disparité de financement entre public et privé, entrave à une libre
concurrence entre les deux systèmes, et surtout le principe même du
budget global hospitalier dont l’accomplissement idéal aboutissait à
l’organisation d’un hôpital parfait, mais surtout sans aucun malade, ou
pour le moins ne recevant que les pathologies les moins coûteuses.
La réforme de la tarification est arrivée, la nouvelle T2A dont l’applica-
tion n’est toutefois pas totale dans le secteur hospitalier. Sa mise en
place a mis en péril un bon nombre de cliniques privées et n’est sans
doute pas étrangère au fait que des pans entiers de l’hospitalisation pri-
vée soient tombés aux mains de grands groupes financiers. La consé-
quence en est un grand bouleversement par regroupement de structures
pour réaliser les fameuses “économies d’échelle”.
Certaines restructurations sont sans doute nécessaires ; elles sont toute-
fois mal vécues par bon nombre de praticiens du privé qui voient dispa-
raître des secteurs d’activité aiguë au profit des soins de suite et dénon-
cer la précarisation de leur exercice.
Un autre motif de grogne résidait dans le fait que l’Agence nationale
pour l’accréditation et l’évaluation en santé (ANAES) ait privilégié
l’accréditation au détriment de l’évaluation. Un peu d’eau est passée
sous les ponts : l’accréditation est mise en place pratiquement dans tous
les établissements publics et privés, au prix toutefois d’un “manuel
d’accréditation” rédigé dans un langage administratif tellement obscur
que bon nombre de sociétés de conseil se sont ouvertes pour traduire ce
jargon en une langue plus facilement digeste. L’ANAES a vécu. Elle
est remplacée par la HAS (Haute autorité de santé) qui, sous l’impul-
sion d’un directeur général intelligent et pragmatique, s’intéresse enfin
à l’évaluation des bonnes pratiques médicales. La phraséologie utilisée
pour cette évaluation est loin de briller par sa clarté pour les pauvres
représentants du corps médical qui n’ont fait en moyenne qu’une
dizaine d’années d’études universitaires et vont sans aucun doute avoir
encore besoin de traducteurs !
Parmi mes grands motifs de mécontentement, en 1997, figurait le
chiffre incroyablement restreint du numerus clausus appliqué aux étu-
diants en médecine qui aboutissait déjà à une insuffisance criante
d’effectifs dans une spécialité : l’anesthésie réanimation. La situation
n’a fait que s’aggraver, touchant d’autres spécialités dont la chirurgie,
l’ophtalmologie et, bien sûr, la gynécologie obstétrique. C’est proba-
blement cette dernière qui se trouve le plus sinistrée actuellement. Les
1 500 obstétriciens du secteur privé s’inquiètent, ils ne voient pas venir
la relève alors que leurs effectifs vieillissent et assurent pourtant près de
40 % des naissances en France. Cette situation est d’autant plus préoc-
cupante que la natalité de notre pays augmente pour dépasser 800 000
naissances en 2005. Le phénomène risque d’ailleurs de progresser du
fait d’une importante population issue d’une immigration récente.
Certes, nous dira-t-on, des mesures ont été prises puisque le numerus
clausus est remonté de quelques 3 500 à plus de 7 000 admissions par
an à l’issue du concours de PCEM1. N’oublions pas, malgré tout, compte
tenu du temps de formation, qu’il faut encore attendre une dizaine
d’années pour voir les effets bénéfiques de ce changement de cap.
En attendant, nombreux sont les établissements publics qui fonc-
tionnent bon an mal an avec des effectifs de médecins étrangers
rémunérés sur des postes faisant fonction d’interne ou des postes
précaires et provisoires de médecins contractuels, pour lesquels ils
prévoient un niveau de rémunération inférieur à leurs collègues
français. Je signalais cet état de fait il y a quelques années. Il n’a
fait que s’accentuer. Leurs revendications, qui me semblaient iné-
luctables alors, ont fini par s’exprimer. Ils n’obtiennent que très
partiellement satisfaction, ce qui fait peser un risque sur le fonc-
tionnement de nombreux services dans les hôpitaux, grands et
petits. C’est en particulier sur ces bases précaires que fonctionnent
nombre de services d’urgences et de chirurgie. Pour ces prati-
ciens, outre une formation différente de celle fournie par les struc-
tures françaises classiques, la difficulté d’expression dans notre
langue inquiète souvent les patients qui se présentent à l’hôpital !
Un anesthésiste d’un grand hôpital parisien me racontait, il y a
quelques mois, toute la difficulté qu’il avait à identifier les pres-
criptions administrées à ses patients entre un résident anesthésiste
polonais, un résident chirurgien ukrainien et une infirmière espa-
gnole qui balbutiaient tous le Français. Heureusement, le patient,
épicier tunisien du coin de la rue, a pu le renseigner !
Tout cela parce qu’il y a une vingtaine d’années, nos responsables poli-
tiques ont écouté les conseils de quelques grands penseurs d’économie
de santé qui considéraient, pour rééquilibrer les comptes de la santé,
qu’il suffisait de réduire l’offre de soins, d’où le verrou posé sur
l’entrée en médecine et la diminution du nombre d’écoles et de postes
ouverts à l’enseignement des infirmières. Beau gâchis !
La situation s’est d’autant plus aggravée qu’à l’époque la loi sur les
35 heures n’était qu’à l’état de projet. On sait, depuis lors, l’effet délé-
tère de son application à la santé, alors même que, de l’avis d’un certain
nombre de politiques qui l’ont promulguée, son application dans notre
secteur d’activité de soins a été trop brutale et erronée.
Il est difficile d’exercer la médecine quand les responsables du
pays la considèrent avant tout comme budgétivore et voient ses
ÉDITORIAL
Trop de contrainte tue la médecine
●Jean-Yves Neveux*
* Chirurgien cardiovasculaire, professeur émérite, université Paris Sud, 91405
Orsay Cedex.
** “Tu ne seras pas médecin, mon fils !” aux éditions Plon.
I

acteurs comme des notables nantis que l’on peut critiquer et sur
lesquels on peut tirer à volonté.
Il faudra pourtant qu’un jour, dans ce pays, s’ouvre un vrai et grand
débat sur l’utilité du système de santé et qu’on arrête de s’enorgueillir
du fait que, dans le classement de l’OMS, la France soit classée
numéro un mondial. En réalité, ce classement fait avant tout référence à
l’égalité des citoyens devant l’accès à la santé qui se rapproche de plus
en plus des 100 % grâce à l’institution de la CMU et ne tient guère
compte de la qualité de la médecine dispensée.
C’est dans un débat de ce type qu’il faudrait véritablement réfléchir à
l’augmentation des coûts de santé liée au vieillissement inéluctable de
la population, à l’impact des technologies nouvelles et des moyens dia-
gnostiques et thérapeutiques récents qui permettent de prolonger la sur-
vie ou de guérir des patients atteints de pathologies considérées comme
incurables et mortelles il y a 20 ans. C’est devant une telle tribune qu’il
serait également opportun de quantifier les conséquences néfastes
d’une utilisation abusive de la CMU par des cohortes de patients venant
des pays africains, de l’Europe de l’Est, quand ce n’est pas en prove-
nance d’Asie et qui trouvent facilement la voie de passage pour venir
en France dans le seul but de se faire soigner (ou d’accoucher et profi-
tant ainsi du droit du sol !). Je demandais récemment à un de mes amis,
haut fonctionnaire de la Cour des comptes, spécialisé dans les pro-
blèmes de santé, si l’on avait rapproché le dérapage des comptes de la
“sécu”, de nouveau gravement dans le rouge après un certain équilibre
de l’application concomitante de la CMU, sa réponse fut claire : “cela
ne se fera pas, car ce n’est pas politiquement correct.”
Alors où va-t-on ? Vers une médecine à deux vitesses, divisées entre
les riches et les moins riches ? Certainement pas à mon avis, Dieu soit
loué, dans un pays comme le nôtre protégé par des lois sociales heureu-
sement assez efficaces. Très probablement vers une médecine de qua-
lité médiocre offerte à tous, exercée par des médecins excellents,
d’autres à peine ou mal formés. Heureusement, il y aura toujours de
bonnes équipes dont l’accès est et sera de plus en plus ouvert aux
patients qui ont le bon carnet d’adresses, un ou plusieurs amis médecins
capables de les orienter vers les bonnes filières.
Est-ce cela que nous voulons voir instituer en système ? Je souhaite
vivement, pour ma part, qu’il n’en soit pas ainsi. Une des solutions
serait de tenter de rendre plus attractives les spécialités le plus sinistrées
par manque d’effectifs. De même que le gouvernement envisage
d’augmenter les honoraires des médecins dans les régions où la densité
médicale est la plus faible, pourrait-on imaginer une solution du même
ordre en faveur des spécialités en difficulté. Ceci pourrait être négocié
pour le secteur libéral. Pour ce qui concerne l’activité salariée en éta-
blissement public ou PSPH, il pourrait être envisagé de créer une prime
de pénibilité, dans le but de rendre plus attractives certaines spécialités.
Dans la situation préoccupante que nous connaissons, et qui risque de
s’aggraver encore un peu plus au cours des prochaines années, il
convient d’être vigilant et inventif.
Espérons que nos élus, qui fixent chaque année le budget de la Sécurité
sociale au Parlement, prennent conscience de cet état de fait et écoutent
quelques sages (vieux ou plus jeunes) sans penser qu’il s’agit d’une
banale défense corporatiste, mais qu’il en va de la qualité de la méde-
cine dans notre pays et du service rendu aux patients, qu’ils finiront
bien par devenir, eux aussi, un jour ou l’autre. ■
ÉDITORIAL
4
La Lettre du Gynécologue - n° 311 - avril 2006
PUB bandeau Gamme stérilet
P 32 Quadri
1
/
2
100%