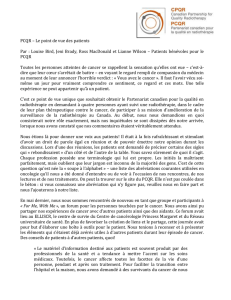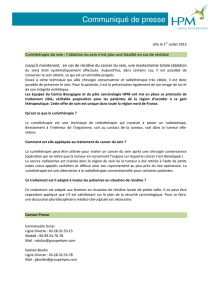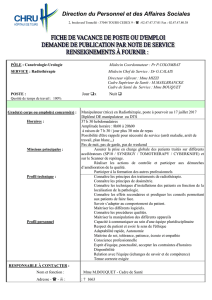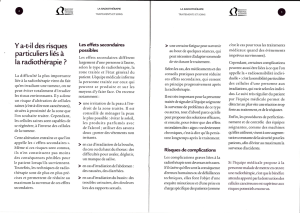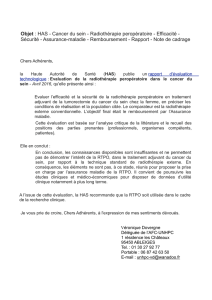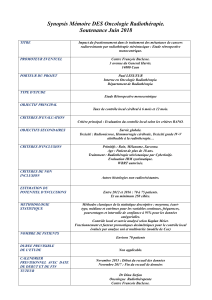Lire l'article complet

14
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003
es conséquences gynécologiques fonc-
tionnelles de la radiothérapie sont long-
temps restées d’évaluation difficile, notamment
dans leurs formes tardives. Après la publication
des premiers lexiques des complications dans
les années 1980, c’est le glossaire dit franco-ita-
lien, établi par un groupe d’experts et publié en
1993 (1), qui servira de référence à l’évaluation
des effets précoces et tardifs de la radiothérapie
des cancers gynécologiques. Les échelles SOMA-
LENT (Subjective/Objective/Management/Analy-
tic - Late Effects of Normal Tissues) sont venues
compléter, depuis 1995 (2), le glossaire franco-
italien prenant en compte entre autres, la durée
des complications et leur prise en charge et faci-
litant la distinction entre séquelles subjectives
Conséquences gynéco-
logiques de la radiothérapie
pelvienne
■
■
B. Fatton*
L
* Maternité Hôtel-Dieu,
CHU de Clermont-Ferrand.
dossier

15
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003
et objectives. Si l’on tient compte du taux de sur-
vie relatif à 5 ans tous cancers confondus, qui est
évalué à 52 % lorsqu’il est ajusté à l’espérance
de vie normale (3), on mesure l’importance d’une
estimation aussi précise que possible des
séquelles imputables au traitement : la survie ne
se justifiant pleinement que dans une préserva-
tion aussi forte que possible de la qualité de vie.
R
APPEL HISTOPHYSIOLOGIQUE DU TISSU
NORMAL
(4-6)
Nous allons exposer quelques notions histolo-
giques succinctes, utiles à la compréhension
physiopathologique de certaines complications
radio-induites, notamment au niveau des revê-
tements de surface. L’ovaire a été volontairement
exclu de notre propos et les conséquences de
son irradiation tant sur la fonction de reproduc-
tion que sur la fonction hormonale ne seront pas
abordées dans cet article.
La vulve
Située entre la face interne des cuisses, la vulve
s’étend de la région hypogastrique à 3 cm envi-
ron en avant de l’anus. On lui décrit une dépres-
sion médiane, le vestibule, surmontée de la saillie
du mont de Vénus et limitée latéralement par
deux replis cutanés juxtaposés, les petites lèvres
en dedans et les grandes lèvres en dehors et au
fond desquelles s’ouvrent le vagin et l’urètre (5).
Le mont de Vénus
Glabre chez l’enfant, il se couvre de longs poils
à la puberté. Il est constitué d’un volumineux
amas de tissu cellulograisseux recouvert d’un
revêtement cutané.
Les grandes lèvres
Ce sont deux replis cutanéograisseux allongés
transversalement du mont du pubis à la région
préanale. Elles sont formées d’un axe conjonc-
tivo-adipeux recouvert sur les deux faces d’un
revêtement cutané. L’épithélium (figure 1) est de
type malpighien kératinisé. Le derme, bien vas-
cularisé, riche en glandes sébacées, sudoripares
et apocrines, présente une structure hétérogène
dans laquelle on individualise une couche de
fibres musculaires lisses, le dartos labial et une
couche de tissu cellulograisseux. Enfin, le corps
adipeux, véritable formation autonome fibro-
graisseuse, située dans la graisse sous-cutanée
est un organe semi-érectile solidarisant les
grandes lèvres aux mouvements des cuisses.
Les petites lèvres
Formées de deux feuillets emprisonnant une
lame fibro-élastique riche en vaisseaux et en
filets nerveux, elles sont recouvertes d’un épi-
thélium malpighien épais mais à couches kéra-
tinisées minces. Il n’y a jamais de tissu adipeux
sous-cutané.
Le vestibule
Il est tapissé d’un épithélium pavimenteux stra-
tifié, lubrifié par les sécrétions des glandes ves-
tibulaires (majeures ou glandes de Bartholin et
mineures, en nombre variable) et para-urétrales
(ou glandes de Skène). Il présente, selon les des-
criptions anatomiques, deux régions : le vesti-
bule d’urètre, en avant, et le vestibule du vagin,
en arrière.
Le vagin
Conduit musculomembraneux s’étendant de
l’utérus à la vulve, il présente une paroi solide et
extensible, épaisse de 3 à 4 mm en moyenne et
formée de trois tuniques :
– externe ou fascia vaginal ;
– moyenne ou musculaire ;
– interne ou muqueuse : l’épithélium pavimen-
teux stratifié non kératinisé repose sur un tissu
conjonctif, riche en collagène et parcouru de
nombreux vaisseaux et filets nerveux. Cepen-
dant, cette structure histologique est soumise à
de nombreuses variations tout au long de la vie
génitale de la femme. Ainsi, à la ménopause, les
parois vaginales s’amincissent et s’assèchent
sous l’effet de la carence hormonale, générant
souvent une dyspareunie.
L’utérus
Organe musculaire creux, l’utérus est un organe
médian, situé dans l’excavation pelvienne entre
la vessie en avant et le rectum en arrière. L’isthme
utérin sépare le corps du col de l’utérus. La paroi
utérine, d’une épaisseur grossière de 1 cm, est
composée de trois tuniques :
– externe ou séreuse ;
– musculeuse ou myomètre : au niveau du corps,
le myomètre occupe la presque totalité de
l’épaisseur de l’utérus. Au niveau du col pour
lequel les études restent plus controversées, les
fibres musculaires seraient plus rares à mesure
que l’on approche de la portion intravaginale du
col, compensées alors par un tissu conjonctif
riche en réseaux élastiques et conférant au col
toute sa fermeté ;
Figure 1. Épithélium vulvaire
normal.
À gauche, l’épithélium est de type
“muqueux” à couche cornée aérée
(région vestibulaire) alors qu’il est
de type “cutané” à droite avec une
couche cornée épaisse et sans
noyaux (5, 7).
Complications de la radiothérapie pelvienne

16
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003
– muqueuse : la muqueuse du corps ou endomètre
subit, au cours du cycle, des transformations suc-
cessives, aboutissant, en l’absence de féconda-
tion, à la desquamation menstruelle. Au niveau du
col, on observe des variations selon que l’on consi-
dère l’exocol ou l’endocol. L’exocol est tapissé par
une muqueuse dermopapillaire constituée d’un
épithélium pavimenteux stratifié mince et riche en
glycogène. Ainsi, la pathologie rencontrée à ce
niveau sera voisine de celle du vagin. L’endocol est
recouvert d’un épithélium unistratifié, de type
mucipare dans les sillons qui séparent les plis de
l’arbre de vie et formé de simples éléments de revê-
tements parfois ciliés à la surface des plis.
En synthèse de ce rappel histologique, il est
important de considérer la variabilité des radio-
lésions en fonction des tissus concernés : les tis-
sus à renouvellement rapide comme les épithé-
liums de revêtement sont le siège de réactions
aiguës précoces alors que ceux à renouvellement
lent comme les tissus de soutien ou les axes
conjonctivovasculaires peuvent être le siège de
complications tardives (8) par détérioration pro-
gressive de la vascularisation et évolution pro-
gressive vers la sclérose.
E
FFETS ANATOMOPATHOLOGIQUES
DES RADIATIONS IONISANTES
SUR LES TISSUS PELVIENS
Ils sont sous dépendance multiple en fonction :
– du type de tissu concerné ;
– de l’importance du volume irradié, de la dose
reçue et de son fractionnement ;
– de l’existence de facteurs aggravants surajou-
tés, qu’ils soient imputables au terrain (obésité,
diabète, antécédent chirurgical, facteurs eth-
nique ou nutritionnel, facteurs vasculaires, etc.),
au traitement lui-même (technique, association
thérapeutique, etc.).
La vulve
Elle subit les effets des radiations comme tout
revêtement cutané mais sa situation anato-
mique, entourée de plis cutanés et soumise à des
frottements répétés et à une atmosphère
humide, la rend plus vulnérable encore. Les
radiovulvites sont la conséquence soit d’une
radiothérapie massive pour tumeur pelvienne,
soit d’une irradiation directe de la vulve. Dans
cette dernière situation, la radiomucite est d’au-
tant plus fréquente qu’il préexiste un lichen sclé-
reux vulvaire (5).
Les radiodermites aiguës se présentent sous
forme d’érythème diffus et prennent habituelle-
ment la forme de réactions exsudatives. Une
radionécrose aiguë est possible essentiellement
dans les suites d’un surdosage.
L’évolution vers une radiodermite chronique
n’est pas obligatoire. Le plus souvent, ces formes
chroniques surviennent à distance d’une radio-
thérapie mal contrôlée avec un défaut de pro-
tection des zones cutanéomuqueuses de voisi-
nage. La vulve prend un aspect blanchâtre,
atrophique et scléreux avec des télangiectasies
et une absence de poils. Le diagnostic différen-
tiel avec un lichen scléreux est parfois difficile
dans les formes où la sclérose prédomine mais
l’altération ou la disparition des mélanocytes,
l’endartérite obstructive et la destruction des fol-
licules pilaires plaident en faveur de la radio-
mucite (5). Les lésions ulcérées, hyperplasiques
ou nécrotiques feront l’objet d’une surveillance
attentive assortie d’un contrôle biopsique en rai-
son du risque de greffe d’un carcinome épider-
moïde in situ ou invasif, même si les ulcérations
correspondent le plus souvent dans ce contexte
à une radionécrose.
Le vagin
Alors que les viscères pelviens (notamment la
vessie, le rectum et l’intestin grêle) sont parti-
culièrement vulnérables aux radiations ioni-
santes, la muqueuse vaginale offre une relative
tolérance à la radiothérapie externe mais cette
tolérance n’est cependant pas sans limite.
Les conséquences, à la fois macroscopiques et
microscopiques d’une irradiation sur le tissu
vaginal, ont été précisément décrites par Abitbol
et Davenport en 1974 (9), complétant ainsi les
études de Pitkin et Bradbury publiées en 1965
(10). Grigsby et al. (4) ont fait une synthèse com-
plète de ces travaux, s’appuyant à la fois sur des
données cliniques, des analyses cytologiques et
l’étude de pièces biopsiques. Nous en repren-
drons ici les conclusions essentielles :
– disparition de tout ou partie des cellules de
l’épithélium vaginal dans les suites immédiates
de la radiothérapie, et ce surtout dans les zones
proches des sources de radiations ;
– persistance de ce déficit cellulaire durant 3 à
6 mois, période à partir de laquelle on va assis-
ter à une réépithélialisation progressive à partir
des cellules de la couche basale ;
– transformation fibreuse du tissu conjonctif
lâche des couches sous-muqueuse et muscu-
laire ;
dossier
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Chassagne D, Sismondi P, Horiot
JC et al. A glossary for reporting
complications of treatment in gyne-
cological cancers. Radiother Oncol
1993 ; 26 : 195-202.
2. LENT SOMA scales for all anato-
mic sites. Int J Radiat Oncol Biol
Phys 1995 ; 31 : 1049-91.
3. Bruner DW, Lanciano R, Keegan M
et al. Vaginal stenosis and sexual
function following intracavitary
radiation for the treatment of cervi-
cal and endometrial carcinoma. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 1993 ; 27 :
825-30.
4. Grigsby PW, Russel A, Bruner D et
al. Late injury of cancer therapy on
the female reproductive tract. Int J
Radiat Oncol Biol Phys 1995 ; 31 :
1281-99.
5. Hewitt J, Pelisse M, Paniel B.
Maladies de la vulve, Name Impri-
meurs (Tours), MEDSI/McGRAW-
HILL, 1988.
6. Mazeron JJ, Gerbaulet A. Effets
tardifs des radiations ionisantes sur
la vulve, le vagin et l’utérus. Can-
cer/Radiother 1997 ; 1 : 781-9.
7. Lessna Leibowitch L, de Belilovsky
C. Pathologie vulvaire, ed Janssen-
Cilag.
8. Gerbaulet A, Haie-Meder C, Larti-
gau E et al. Séquelles pelviennes
après irradiation. In : Pelvis féminin
statique et dynamique, Paris : Mas-
son 1993 : 263-8.
9. Abitbol MM, Davenport JH. The
irradiated vagina. Obstet Gynecol,
1974 ; 44 : 249-56.
10. Pitkin RM, Bradbury JT. The
effect of topical estrogen on irradia-
ted vaginal epithelium. Am J Obstet
Gynecol 1965 ; 92 : 175-82.

17
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003
– disparition des glandes en charge de la lubrifi-
cation normale du vagin ;
– rétrécissement, voire oblitération, de la lumière
des petits vaisseaux ;
– remplacement progressif des fibres muscu-
laires par de la fibrose.
Les conséquences macroscopiques visibles
varient en fonction de l’âge de la patiente, de son
statut hormonal, de la taille de la tumeur et de
son extension, des conditions d’hygiène corpo-
relle, des doses d’irradiation et enfin de l’éven-
tuelle association à une chimiothérapie. Les
modifications observées peuvent aller de la
simple pâleur vaginale avec amincissement et
atrophie muqueuse à des manifestations inflam-
matoires plus sévères avec ulcération, voire
nécrose tissulaire pouvant conduire à la fistule
(rectovaginale, vésicovaginale ou urétrovagi-
nale). Dans ces situations les plus sévères, des
brides vaginales peuvent se constituer, oblité-
rant partiellement ou totalement le vagin.
L’utérus
C’est un organe particulièrement résistant à l’ac-
tion des radiations ionisantes (4, 6). Néanmoins,
l’étude des pièces d’hystérectomie après curiethé-
rapie révèle des plages d’ulcération ou de nécrose.
En l’absence de chirurgie radicale, ces lésions peu-
vent persister plusieurs mois. En cas de cicatrisa-
tion, elles vont évoluer vers la fibrose (4).
Macroscopiquement, les lésions constatées au
niveau du col sont variables. Chez les femmes
jeunes porteuses d’une lésion peu invasive et
traitée par une radiothérapie à dose limitée, l’as-
pect du col peut apparaître normal. A contrario,
l’atrophie est de règle chez la patiente plus âgée
ou chez celle traitée par radiations à fortes doses.
À l’extrême, on peut constater une disparition
plus ou moins complète du col dans les stades
avancés traités par radiothérapie à haute dose.
C
LASSIFICATIONS DES COMPLICATIONS
DE LA RADIOTHÉRAPIE PELVIENNE
L’évaluation des effets aigus ou chroniques de
la radiothérapie s’est trouvée facilitée par la
généralisation des échelles de mesure qui per-
mettent à la fois la gradation de la sévérité de
l’effet constaté mais aussi la prise en compte de
son retentissement en termes de qualité de vie.
Ces paramètres sont essentiels lorsque l’on veut
comparer plusieurs traitements pour des patho-
logies où le résultat s’évalue en termes de sur-
vie mais ne saurait omettre non plus la qualité
de cette survie.
Le WHO Handbook for reporting Results of Can-
cer Treatment a été largement utilisé mais il
concerne plus particulièrement la morbidité
aiguë car il ne consacre que peu de place aux
effets tardifs (11). La classification de
l’EORTC/RTOG (Late Morbidity Scoring Criteria,
LRMSC) permet un recensement assez complet
de l’ensemble des types de réactions constatées
mais reste peu adaptée à la comparaison entre
les différentes études par absence d’un langage
commun dédié à la morbidité détaillée des effets
tardifs (11, 12).
Le glossaire franco-italien (1), auquel de nom-
breuses études font encore référence, a l’avantage
de proposer, pour les cancers gynécologiques, une
évaluation des complications aiguës et chroniques
de la postradiothérapie, ce dont nous ne dispo-
sions pas pour les autres sites anatomiques avant
la parution des échelles SOMA-LENT. Le glossaire
franco-italien est l’illustration d’un système validé
permettant un langage consensuel et le partage
ou la comparaison de données et de résultats issus
d’équipes différentes.
Cette classification, établie en cinq stades et
concernant l’ensemble des organes et tissus pos-
siblement lésés, se décline toujours sur le même
mode :
– G0 : absence de complications ou symptômes
aigus transitoires ne modifiant pas le déroule-
ment du traitement.
– G1 : complications minimes. Ces complications
sont peu invalidantes mais peuvent créer
quelque gêne fonctionnelle.
– G2 : complications modérées. Symptômes et
signes évidents gênant les activités normales par
intermittence ou continuellement.
– G3 : complications sévères. Tous les symp-
tômes et signes qui mettent en jeu le pronostic
vital par eux-mêmes ou en raison des traitements
nécessaires. Toutes les séquelles permanentes
et sévères.
– G4 : décès dû au traitement, à une complica-
tion du traitement ou au traitement des compli-
cations. En résumé, tout décès dû partiellement
ou totalement aux conséquences du traitement
du cancer.
À titre indicatif, l’encadré 1 rapporte la classifica-
tion concernant la vulve, le vagin et l’utérus. Le
glossaire, malgré un groupe de complications de
grade 3 assez hétérogène et avantageusement
divisé par certains en trois sous-groupes (13),
Complications de la radiothérapie pelvienne
Encadré 1. Glossaire franco-italien,
vulve/vagin/utérus.
G1 : tout symptôme de vulvovaginite
aiguë interrompant le
traitement pendant plus de
10 % de la durée prévue ou
durant plus de 2 semaines
après la fin de traitement.
Rétrécissement et/ou
raccourcissement du vagin de la
moitié ou plus. Dyspareunie
minime. Œdème vulvaire ou
vaginal minime avec ou sans
télangiectasies. Perforation
utérine ou pyomètre ou
hématométrie ne demandant
pas une intervention
chirurgicale. Plaie vaginale
réparable immédiatement.
G2 : rétrécissement et/ou
raccourcissement du vagin de
plus de la moitié. Dyspareunie
modérée. Œdème vulvaire
symptomatique et/ou
télangiectasies et/ou fibrose.
Perforation utérine ou
pyomètre ou hématométrie
demandant une laparotomie
exploratrice ou une
intervention chirurgicale de
drainage. Vaginite infectieuse
répétée.
G3 : sténose vaginale complète.
Dyspareunie sévère. Nécrose
vulvaire et/ou vaginale et/ou
utérine demandant une
intervention chirurgicale.
Péritonite iatrogène ou
perforation utérine demandant
une intervention chirurgicale.
G4 : décès dû aux complications.

18
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 4, vol. III - octobre/novembre/décembre 2003
s’est révélé fiable et reproductible et garde encore
la préférence de nombreuses équipes (14).
L’échelle SOMA-LENT (2) est un prolongement
de cette classification vers d’autres organes et
introduit une dimension supplémentaire en dis-
tinguant effets subjectifs et objectifs et en appor-
tant des indicateurs de traitement et d’examens
complémentaires. Le système de graduation
inclut quatre grades :
– Grade 1 : symptômes mineurs qui ne nécessi-
tent pas de traitement.
– Grade 2 : symptômes qui ne nécessitent qu’un
traitement conservateur
– Grade 3 : symptômes sévères qui ont un impact
négatif significatif sur les activités quotidiennes et
qui peuvent requérir un traitement plus agressif.
– Grade 4 : dégâts fonctionnels irréversibles
nécessitant des interventions thérapeutiques
majeures.
En ce qui concerne la sphère gynécologique,
l’échelle prend en compte plusieurs critères,
variables selon les organes et qui seront très pré-
cisément gradés. Pour information, les critères
retenus lors d’une conférence de consensus (4)
pour la vulve, le vagin et la fonction sexuelle sont
rapportés dans les encadrés 2, 3 et 4.
En pratique, les échelles SOMA-LENT restent
encore peu employées (17 % de centres utilisent
l’échelle pour l’évaluation des effets tardifs [14]),
pénalisées par un défaut de validation, la mau-
vaise intégration du concept impact qualité de
vie et la difficulté à employer les échelles telles
qu’elles ont été publiées (2).
D
ESCRIPTION CLINIQUE DES COMPLICATIONS
(4, 5, 6)
Sur le plan clinique, les modifications constatées
après la radiothérapie rendent compte des
observations histologiques précédemment
décrites.
Au niveau de la vulve, les réactions aiguës, de
diagnostic facile dans un contexte évocateur,
prennent souvent la forme d’une radiodermite
suintante et douloureuse, dose et volume dépen-
dante. Les réactions sont souvent plus intenses
dans les régions des plis soumises aussi au frot-
tement et à la macération, et ces problèmes sont
exacerbés chez la femme obèse. Ces effets sont
résolutifs 2 à 6 semaines après la radiothérapie,
laissant généralement place à une épilation com-
plète et parfois à une hyperpigmentation.
Un œdème vulvaire ou du mont du pubis peut
survenir 1 à 3 mois après le traitement restant le
plus souvent indolore même si certains cas de
douleur et de gêne sévères ont été rapportés.
Cet œdème chronique peut se compliquer de
lymphangite streptococcique prenant l’aspect
d’un rash maculeux. Le tableau clinique associe
alors fièvre, céphalées, nausées et vomisse-
ments : ce syndrome reste parfois méconnu,
attribué alors à une infection d’une autre origine.
Sécheresse, atrophie, douleur et prurit vulvaires
peuvent survenir 6 à 12 mois après la fin des
séances de rayons. Des télangiectasies peuvent
apparaître tardivement (figure 2). Une fibrose
des tissus sous-cutanés peut se constituer, res-
ponsable d’une dyspareunie invalidante si elle
touche la région clitoridienne ou l’introït vaginal
(figure 3). Enfin, des ulcérations apparaissent
parfois 1 à 2 ans après la radiothérapie devant
faire éliminer alors une éventuelle récidive.
Au niveau vaginal, les effets aigus de l’irradia-
tion consistent essentiellement en l’apparition
d’un érythème, puis de fausses membranes plus
ou moins étendues et confluentes. Un exsudat
fibrinopurulent peut apparaître au contact des
sources de curiethérapie. La muqueuse prend
parfois un aspect congestif et hémorragique.
Tous ces effets sont habituellement résolutifs 2 à
3 mois après la fin de la radiothérapie. Des réac-
tions plus sévères surviennent parfois avec ulcé-
rations douloureuses et nécroses demandant
jusqu’à 8 mois pour cicatriser.
Les conséquences chroniques (après un délai de
plus de 12 mois) associent amincissement et
atrophie de l’épithélium vaginal et formation de
télangiectasies. Les patientes se plaignent d’un
vagin rétréci, raccourci avec fibrose paravaginale
et perte d’élasticité. Ces transformations anato-
miques assorties d’une diminution de la “capa-
cité d’accueil”, et d’un défaut de lubrification
expliquent la fréquence des dyspareunies. À un
degré de gravité supérieure peuvent se former
des brides et de synéchies vaginales, qui, négli-
gées, peuvent aboutir à une coalescence com-
plète des parois vaginales. La survenue secon-
daire de plages ulcérées ou nécrosées doit faire
envisager la possibilité d’une récidive tumorale.
Des cas de radionécrose du fond vaginal ont été
rapportés dans les suites d’une curiethérapie.
Les ulcérations superficielles du col sont inévi-
tables après radiothérapie pour néoplasie cervi-
cale. Un écoulement vaginal peut persister pen-
dant plusieurs mois mais la survenue de
dossier
Figure 3. Atrophie scléreuse de la
vulve et de l’introït vaginal (d’après
Hewitt et al. [5]).
Figure 2. Lésions de radiovulvite
chronique.
Placard télangiectasique, scléreux
et atrophique sur les grandes lèvres
et la région clitoridienne (d’après
Lessna Leibowitch et al. [7]).
Aspect bigarré alternant sclérose
et télangiectasies (d’après Hewitt
et al. [5]).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%