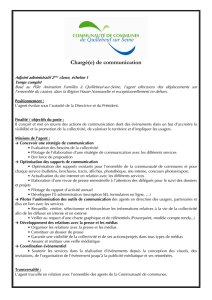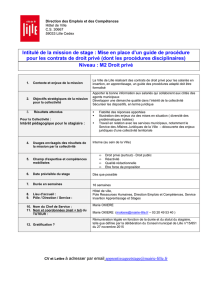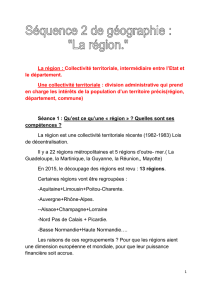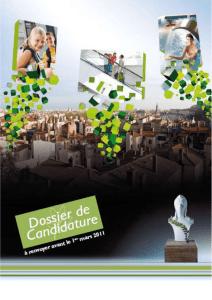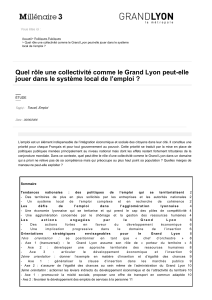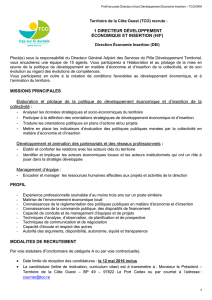Télécharger la page en version PDF

Vous êtes ici :
Accueil> Modes d'action
> Opérateurs de services urbains et collectivités locales : les stratégies mises en
œuvre
Opérateurs de services urbains et collectivités locales :
les stratégies mises en œuvre
INTERVIEW DE ERIC VOGLER
Eric Vogler est professeur en stratégie et management des services depuis 18 ans à EM Lyon. Il propose des
formations sur mesure à diverses entreprises de services urbains et notamment Sita (groupe Suez) dont il a créé
l’Université Interne, Onyx (devenue Veolia Propreté), Bouygues ou Keolis. Il a également écrit « Management
Stratégique des Services - Du diagnostic à la mise en oeuvre d'une stratégie de service », paru chez Dunod en 2004.
Dans cette interview, Eric Vogler nous livre quelques clés de lecture des stratégies mises en œuvre par les opérateurs
de services urbains et nous éclaire sur leurs rapports avec les collectivités locales.Interview réalisée par Geoffroy Bing
(Nova7) le 6 octobre 2009
Force est de constater que la technologie et la technique dans la construction et la gestion des services urbains
n’a cessé de s’intensifier au fil du temps. Est-ce que les opérateurs privés ont toujours une longueur d’avance
sur ce terrain par rapport aux collectivités locales ?
Cela fait longtemps que ces groupes ont des compétences fortes, en particulier sur le plan technique et qu’ils ne se
réduisent pas simplement à des exploitants au service d’un donneur d’ordre. Certains opérateurs ont même des cartes
de réseaux (eau, chauffage urbain, etc.) plus complètes que celles des collectivités locales. On retrouve l’idée d’une
collectivité souvent peu outillée et compétente face au professionnalisme du privé. Mais je tiens à dire que cette vision
est de moins en moins vraie ! Il y a une reprise en main au plan technique de la collectivité qui investit dans la
technologie et du personnel compétent là où elle n’aurait jamais dû lâcher prise de mon point de vue. Donc on assiste à
un rééquilibrage des compétences.
professeur en stratégie et management des
services à EM Lyon.
<< La délégation de service public est un moyen pour la
collectivité locale d’externaliser le risque social >>.
Tag(s) : Service urbain, Institution
Date : 06/10/2009

Une des raisons pour lesquelles les collectivités font appel au privé pour assurer la gestion d’un certain nombre
de services est sa capacité d’innovation. L’innovation est-elle vraiment un puissant moteur des partenariats
avec les opérateurs de services urbains ?
Dans l’innovation technologique « hard », on voit que les opérateurs perdent du terrain et que les collectivités
commencent à monter sur ce créneau. On peut le constater par exemple au Sytral dont la compétence technologique fait
que Keolis a parfois du mal à suivre. Le Sytral a développé un système de bornes qui renseignent l’usager sur l’heure du
prochain bus en temps réel. A charge pour l’opérateur Keolis de suivre en intégrant cette innovation dans son propre
système ! Le dynamisme du privé semble davantage s’exprimer dans les innovations marketing comme l’illustre par
exemple le cas de Vélo’v à Lyon où JC Decaux a apporté une innovation dans l’offre de services incontestable.
Je constate par ailleurs que l’on a plutôt une innovation qui est portée par les industriels et non par les prestataires qui
ont beaucoup de mal à faire de la R&D. Celui qui fait tourner les camions n’est pas celui qui va mener la R&D sur le
camion. C’est le carrossier qui travaille pour Renault Trucks qui va être porteur de l’innovation. La collectivité pourrait
reprendre la main sur l’innovation en se mettant en rapport direct avec les fournisseurs de matériel. Or le plus souvent,
elle laisse le choix de matériel de côté, à la libre appréciation du prestataire. Et le prestataire du coup peut restaurer sa
marge sur le matériel, en acceptant des remises importantes sur la prestation. La collectivité aurait intérêt à négocier
directement avec les fournisseurs pour des raisons financières d’abord et ensuite pour une meilleure maîtrise des
innovations et leur bonne intégration auprès des usagers.
On voit bien que la capacité de l’opérateur à maintenir un bon climat social dans l’entreprise est un élément
important pris en compte par la collectivité délégante. Quels sont les enjeux là derrière ?
Il faut tout d’abord dire tout haut ce que beaucoup disent tout bas : la délégation de service public est un moyen pour la
collectivité locale d’externaliser le risque social. La gestion des ressources humaines dans ces services est quand même
complexe ! Les salariés de ces entreprises n’appartiennent pas vraiment à l’entreprise mais n’ont pas non plus un statut
de fonctionnaire et se sentent culturellement attachés à la ville. C’est ce qui explique un certain nombre de grèves, le
personnel ne voulant pas être considéré et managé comme le sont d’autres salariés d’autres sites. A l’inverse, les cadres
de ces entreprises vivent avec une épée de Damoclès qui est la fin du contrat de délégation ou la menace nucléaire
c’est-à-dire la reprise en main du service par la collectivité. Donc sur le plan managérial, c’est très compliqué, les
évolutions de carrière sont rares car l’attachement au site et la courte durée des contrats d’exploitation ne les permettent
pas.
La rigueur de l’appel d’offre et la définition claire des termes contractuels qui lie une collectivité locale à un
opérateur sont-ils garants d’un partenariat public-privé réussi ?
C’est certainement la clé d’un partenariat réussi mais dans la réalité, c’est loin d’être évident. Nous sommes en effet face
à un enchevêtrement des responsabilités qui implique un enchevêtrement des investissements et donc des conflits entre
la collectivité et les groupes privés. La question récurrente qui est posée est « qui paie quoi ? ». Et face à cette question,
il y a des gens plus ou moins doués pour faire « passer » des investissements à la collectivité sans clarté et sans
transparence, sous couvert d’une complexité technique ou juridique. Cet enchevêtrement contribue en outre à un déficit
de confiance. Donc pour y faire face, il faut mettre au clair dès le départ un maximum de choses avec le risque de
tomber dans un écrit énorme, avec des appels d’offre en plusieurs volumes et la création d’une bulle juridique. Dans le
BTP par exemple, les opérateurs maîtrisent parfaitement la forêt juridique des procédures d’appels d’offres et ont une
équipe juridique de pointe. Ils n’hésitent pas à mener leurs prospects au tribunal en cas de perte d’appel d’offres. Par
ailleurs, la pratique d’avenants au contrat initial est une pratique courante pour remonter une marge trop juste en début
de contrat. De mon point de vue, ces opérateurs ont une expertise juridique bien plus poussée que celle détenue par
leurs clients les collectivités locales. Par contre, les grosses collectivités savent pertinemment que leur marché
représente une énorme manne pour ces opérateurs. Cela les dote d’une force de négociation tout à fait réelle.
Quels sont les principaux leviers auxquels peuvent recourir les collectivités pour s’assurer de la bonne
application du contrat qui les lient avec les opérateurs ?
Il faut éviter la diabolisation du privé sans toutefois lui vouer une confiance absolue ! Le copinage a abouti aux scandales
de l’eau des années 90, avec deux affaires majeures en Rhône-Alpes. Il faut renforcer la supervision par l’Etat ou les
collectivités de l’action du privé. C’est là où la France en particulier est faible. L’organisme qui surveille la tarification des
péages d’autoroute est trop souvent absent et semble dépassé par la subtilité des augmentations tarifaires par tronçons
concoctées par les autoroutiers ! De même, les professionnels des collectivités qui surveillent l’activité de collecte des
déchets sont faibles en France, exception faite de Paris. Les Conseils Régionaux se sont entourées de bons
professionnels pour réguler leurs relations avec la SNCF dans le cadre des TER et ça marche très bien, mais la SNCF
n’est pas (encore) dans le privé. Les collectivités devraient s’en inspirer et embaucher des professionnels de l’eau ou des

déchets pour surveiller mieux les délégataires. Le problème, c’est que cela suppose des moyens du côté des collectivités
locales qu’elles n’ont pas toujours. Elles devraient quand même faire du benchmark au moment de l’appel d’offre pour se
faire une idée des pratiques et des tarifs acceptables.
Du point de vue d’une collectivité locale, qu’est-ce qui fera la différence entre un Veolia ou un Suez ?
Tour d’abord, c’est le simple prix de l’exploitation à l’ouverture des plis. Ensuite, c’est l’accointance managériale qui
rentre en ligne de compte. Le choix de l’entreprise sur le mode de l’intuitu personae est très courant.Telle autorité
organisatrice ne s’entend pas avec tel directeur d’entreprise, alors on change de directeur et le tour est joué. Enfin, les
petits cadeaux offerts en début de contrat, c’est-à-dire les investissements consentis au départ par l’opérateur. Il est
certain que l’on n’est plus sur de la vraie différenciation !
On dit souvent que la recherche du profit par ces grands groupes est incompatible avec la mission d’intérêt
général qui leur est confiée. Face à quels arbitrages se situent la collectivité et l’opérateur pour s’entendre sur
leur mission de service public ?
Pour la collectivité, il ne s’agit pas uniquement de protéger le service public mais d’éviter des rendements de
l’investissement qui soient hors de proportions ! Dans l’eau, les rendements attendus étaient beaucoup trop élevés
pendant des années, ça l’est beaucoup moins en ce moment car la rentabilité a beaucoup baissé. Dans le BTP ou les
autoroutes par contre, les rentabilités sont encore bien trop élevées ! Donc je comprends la collectivité qui se méfie. Mais
le risque qui en découle est de trop encadrer le privé et de briser le dynamisme que l’on recherche en lui, c’est-à-dire sa
capacité à changer ses méthodes de travail, à tester de nouvelles idées, à investir dans la R&D. Le risque est de
cantonner l’opérateur dans un ronron si l’on baisse trop les prix. Dans le médicament par exemple, les industriels
disaient « si vous nous imposez des prix trop bas, nous n’aurons plus les moyens de mener des projets d’innovation ».
Mais ils peuvent aussi exagérer car, sous réserve de dire qu’ils investissent dans la R&D, en fait ils rémunèrent leurs
actionnaires. On a peu de moyen de le vérifier finement. L’exemple de TEO est symptomatique de cet enchevêtrement
public-privé où l’intérêt général côtoie l’exigence de rentabilité de la part des actionnaires. Du côté de l’exploitant,
l’arbitrage est le suivant : Est-ce que je fais des travaux de remise en état ou de sécurité ou est-ce que je reporte ces
investissements à plus tard pour payer l’actionnaire ?
Les comptes de ces entreprises ne sont-ils pas trop opaques pour permettre un contrôle par la collectivité
locale ?
En effet, l’organisation de ces groupes est telle que le contrôle des comptes doit remonter jusqu’à la holding. En clair, les
filiales sont pauvres et la holding est très riche car tous les bénéfices sont rapatriés vers la holding. Pour la collectivité,
c’est un peu dérangeant localement de voir que la filiale d’un grand groupe à qui elle a confié une délégation de service
public est très prospère, car cela veut dire qu’elle s’est fait de l’argent sur le dos des citoyens. Donc il faut plutôt montrer
localement une filiale qui est pauvre et qui a du mal à fonctionner alors que le bénéfice est tout simplement transféré à la
holding. C’est de la consolidation de comptes très classique ! Même la trésorerie, le compte du quotidien, peut être gérée
au niveau de la holding. On observe du coup une perte de l’autonomie locale, même si cela dépend des groupes. Les
filiales sont régulièrement en train de demander de l’argent à leur holding pour investir.
Le contrôle peut quand même être amélioré et il ne faut pas mettre tout sur le dos de l’entreprise. Il y aussi des
dispositifs qui permettent aux collectivités de suivre de manière parfaitement claire les comptes de son délégataire. Je
pense en particulier au secteur de la restauration collective où ils ont instauré un « livre ouvert » grâce auquel le client
connaît exactement les investissements, les salaires et la marge de l’opérateur. Il faudrait peut-être imposer ce système
à d’autres activités ! Parce qu’on veut préserver cette autonomie du privé et son dynamisme, on se refuse quelques fois
à être exigeants en matière de transparence.
Il semblerait que le marché de la délégation soit arrivé à maturité en France. Qu’en est-il de la stratégie
d’expansion qui a depuis longtemps caractérisé ces grands groupes ?
Pour conquérir de nouveaux marchés, ces groupes n’hésitaient pas à dire à la collectivité qu’ils avaient la capacité de
financer des investissements qu’elle était incapable de faire. Les collectivités, et les élus en particulier, sont friands de
ces arguments, car cela permet par exemple de faire une ligne de métro dans le mandat alors que dans d’autres
conditions, deux mandats eurent été nécessaires. Par contre, cela a un coût ! Or aujourd’hui, l’argent coûte plus cher et
surtout les actionnaires veulent maximiser leurs investissements, ce qui interdit l’immobilisation de l’argent dans des
investissements lourds. Par conséquent, la plupart des groupes réduisent leur capacité d’investissement qui n’est plus un
levier pour conquérir de nouvelles collectivités. Du coup, les filiales régionales qui étaient habituées à avoir beaucoup
d’argent facilement pour rapporter rapidement du chiffre d’affaires perdent leur autonomie, et on en arrive à un marché
mature qui fonctionne doucement. Aujourd’hui, on observe plutôt un renouvellement des appels d’offre mais pas de
récupération de nouvelles régies. Par ailleurs, on essaie de rentabiliser au maximum les investissements déjà opérés :

dans la collecte de déchets ménagers, on va faire tourner les camions plus longtemps ou les entretenir moins par
exemple. On le fait également car les collectivités mettent davantage de pression sur les prix, sont plus tenaces dans les
négociations, comme dans le cas de l’eau. Les opérateurs vont donc reporter ces baisses de prix en maximisant
davantage leurs investissements, en se montrant également plus dures en matière de négociations salariales, etc.
Quels sont alors les nouveaux relais de croissance envisagés ?
Confrontés à des pressions sur les prix, voire des menaces de retour en régie d’un côté, et pressés par des actionnaires
de plus en plus exigeants de l’autre, il y a un effet de ciseaux qui n’est pas simple pour ces entreprises. Or lorsque l’on
est un groupe diversifié, ce que l’on perd dans l’eau et les déchets, on va le gagner dans l’énergie. C’est sans doute
l’objectif de la fusion de Suez avec GDF ! Cela devient plus compliqué quand on est dans un groupe mono-activité.
Une des particularités de ces grands groupes tient aussi au fait qu’ils ont cherché, dans les années 90, à se
diversifier dans tout un ensemble d’activités de services urbains. Quel était alors le modèle économique
recherché et ce modèle n’a-t-il pas atteint ses limites aujourd’hui ?
C’était la grande mode, en effet, des multi-utilities. A la fin des années 80, la Lyonnaise avait beaucoup développé le
multi-utilities : ils construisaient des golfs, exploitaient des pompes funèbres. Tout cela a disparu. Il y a eu un recentrage
très fort, d’abord sur les métiers de l’environnement, avec la création de Veolia Environnement puis de Suez
Environnement, et sur l’énergie. On s’est aperçu dans ces groupes que l’interconnection eau-énergie ou eau-déchets
n’était en fait pas propice aux synergies si ce n’est que ces activités s’adressaient au même client. Dans les faits,
manipuler des déchets liquides n’a rien à voir avec la gestion de déchets ! Ce ne sont pas les mêmes business, les
mêmes compétences, ni le même matériel. L’intérêt des multi-utilities, c’est en fait de pouvoir offrir une offre globale aux
collectivités, de réaliser des synergies marketing qui permettaient de faire du lobbying. Mais ils se sont rapidement
heurtés à la méfiance de leurs clients qui ne voulaient pas mettre tous les œufs dans le même panier. Dans les faits, il
est arrivé très rarement de confier à un même opérateur la gestion de l’ensemble des services (eau, déchets, etc.), sauf
quelques cas à l’étranger comme à Casablanca. Aujourd’hui, ces groupes sont donc en train de se recentrer sur
certaines activités, en l’occurrence l’eau et les déchets pour Veolia Environnement et Suez Environnement. Il y a par
contre des synergies opérationnelles possibles entre la collecte des déchets et l’énergie à travers les usines
d’incinération et les réseaux de chaleur.
N’y a-t-il pas derrière l’affichage des « services à l’environnement » une forme de schizophrénie de la part
d’opérateurs dont la rémunération dépend avant tout des consommations d’énergie, d’eau ou de chauffage ?
Ce n’est pas le cas dans les déchets. En effet, dans les déchets, les entreprises ont intérêt d’avoir des citoyens éduqués
même si les tonnages diminuent car la collecte sélective coûte plus chère à la tonne. Donc on comprend bien qu’il vaut
mieux ne pas prendre le tout venant tous les jours mais prendre moins souvent la poubelle jaune et la poubelle verte et
se faire une santé sur les filières spécialisées. Par ailleurs, les entreprises investissent désormais en aval de la filière, à
savoir le traitement et la valorisation des déchets. Toutes ces activités deviennent de plus en plus capitalistiques, avec
des centres de traitement entièrement automatisés par exemple, alors qu’avant elles étaient très intenses en main
d’œuvre. Les exigences de développement durable rejoignent ici les intérêts des entreprises de déchets. Là où les
objectifs de développement durable deviennent plus compliqués, c’est dans le cas de l’eau ou du chauffage urbain où les
intérêts entre la collectivité et l’entreprise sont effectivement plus contradictoires. Dans ce cas, l’opérateur va essayer de
réduire ses coûts pour compenser les économies de consommation exigées par la collectivité locale ou réalisées par les
usagers.
On voit poindre de nouvelles normes environnementales au plan national mais aussi européen. Ce durcissement
juridique ne fait-il pas finalement le jeu des opérateurs privés qui vont pouvoir derrière vendre plus de
technologies et de nouveaux services ?
C’est évident et les actions de lobbying des groupes privés auprès des institutions nationales et européennes en
témoignent. Les opérateurs voient à travers ces actions de lobbying une nouvelle manière de gagner de l’activité
supplémentaire. De surcroît, on peut avoir à Bruxelles ce qu’on n’obtient pas à Paris. Par exemple, SITA a fait du
lobbying à Bruxelles pour imposer l’incinération il y a dix ans et inciter à la mise en place de nouvelles normes qui ont été
des sources de revenus considérables pour SITA ! L’objectif de « zéro décharge » a obligé les collectivités à réfléchir à
d’autres modes de valorisation des déchets qui se sont révélés extrêmement chers et ont contribué à une envolée du
prix du traitement « grâce » ou « à cause » de Bruxelles. Les opérateurs s’en sont mis plein la poche à cette période.
C’est aussi le prix que doivent payer les citoyens pour des services plus performants et moins polluants !

Les partenariats « public-privé » soulèvent la place de l’usager dans la relation de service. Certains opérateurs
peuvent revendiquer une connaissance de terrain de l’usager, de ses attentes et de ses besoins et s’en prévaloir
auprès de la collectivité. Par ce biais, n’y a-t-il pas un risque de récupération par l’opérateur de la relation
usager-collectivité locale ?
Tout dépend du service dont on parle. Dans la plupart des cas, les prestataires sont quand même peu en contact avec
les usagers ! En tant qu’usager, je n’ai aucun contact avec la Lyonnaise des eaux ou avec les camions poubelles qui
passent à 6 heures du matin dans ma rue ! Dans les transports en revanche, le contact avec l’usager est plus clair. Je
note qu’un Keolis a développé plus d’innovation qu’un Sita ou qu’un Veolia qui sont centrés sur la relation avec les
fournisseurs et chez qui l’innovation va venir du back office. D’une manière générale, la relation avec l’usager renvoie à
l’éternel débat où l’acteur privé aimerait s’approprier la relation avec son client, la collectivité aimerait préserver sa
relation avec l’usager et où l’élu aimerait préserver sa relation avec ses électeurs. Tout le monde veut la même personne
et cela finit par produire une grande confusion chez l’usager-client-électeur.
Selon vous, à quels nouveaux services urbains peut-on s’attendre demain ?
Je pense qu’il y a des services privés qui demain entreront dans la sphère publique parce qu’ils répondront à des
besoins essentiels dans la société. Dans la santé par exemple, étant donné le vieillissement de la population et les coûts
croissants de l’hospitalisation, je pense que le soin à domicile pourrait devenir un service urbain régulé par la collectivité
locale à l’avenir. Dans un tout autre ordre d’idée, des entreprises comme Meetic se font de l’argent sur les difficultés que
rencontrent les gens à trouver l’âme sœur. Ce type de service ne devrait-il par être repris par la collectivité comme un
service public ? Pour mémoire, autrefois, le bal annuel était organisé par le comité des fêtes ! Je pense qu’il faut faire
attention à ne pas toujours sanctuariser le service public à quelques services historiques et accepter les changements et
les contradictions de notre société. La libéralisation et la privatisation de secteurs jusque là publics devraient être
accompagnées, selon moi, d’un redéploiement de l’investissement public dans de nouveaux domaines, du plus attendu
comme les services à la personne, jusqu’au plus iconoclaste, comme les services d’intermédiation de rencontres
amoureuses que je viens de citer. Pour faire court, tous les services qui concourent à créer du lien entre les membres de
la collectivité : un grand chantier de réflexion….
1
/
5
100%