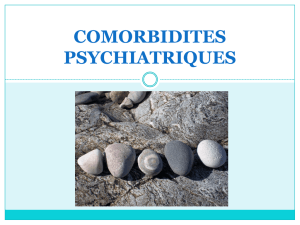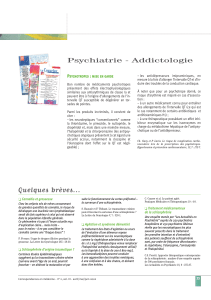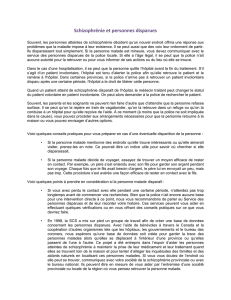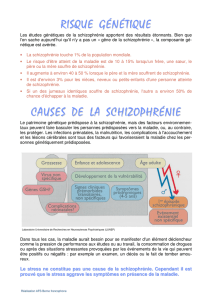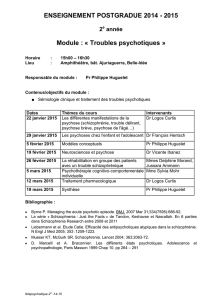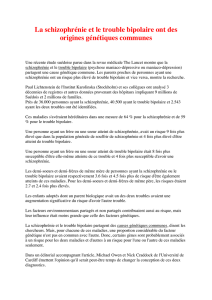ACTUALITÉS SCIENCES // Coordonnées par E. Bacon

110 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 4 - juillet-août 2010
ACTUALITÉS
SCIENCES
Coordonnées par E. Bacon
(Inserm et clinique psychiatrique, Strasbourg)
// American Journal of Psychiatry
// Archive of General Psychiatry
// British Journal of Clinical Psychology
// British Journal of Psychiatry
// Schizophrenia Bulletin
// Schizophrenia Research
Chez la femelle du singe rhésus,
l’infection pendant la grossesse
par le virus de la grippe entraîne
des perturbations postnatales
du cerveau de son petit
Madison (États-Unis)
Il est à présent bien admis que la survenue de
perturbations physiques et psychologiques au
cours de la grossesse est susceptible d’affecter
le développement cérébral du fœtus, et d’aug-
menter le risque d’apparition de troubles
psychiatriques et comportementaux chez
l’enfant. L’infection maternelle par la grippe
ou par d’autres agents pathogènes pendant la
grossesse a été associée à un risque accru de
schizophrénie et de troubles du développement
neurologique chez l’enfant. Dans les études
menées chez les rongeurs, on a pu observer que
les réponses inflammatoires maternelles à la
grippe affectent le développement cérébral du
fœtus. Toutefois, afin de vérifier la pertinence
de ces résultats chez l’humain, il serait néces-
saire de mener de telles recherches auprès de
primates, chez qui la corticogenèse prénatale
est plus avancée. Les singes rhésus constituent
un modèle intéressant, puisqu’il est possible
d’infecter la femelle gestante avec une souche
grippale dérivée d’une souche humaine, et
que le placenta présente des caractéristiques
de perméabilité vasculaire et de communi-
cation entre les physiologies maternelle et
fœtale proches de celles rencontrées dans
l’espèce humaine. Douze femelles rhésus
gestantes ont été infectées par la grippe (la
souche A/ Sydney/5/97 [H3N2]) 1 mois avant
le terme, au début du troisième trimestre,
et leur progéniture a été comparée à celle
de 7 femelles non infectées. Des prélève-
ments nasaux et des échantillons sanguins
ont confirmé l’attaque virale et l’activation
immunitaire. Les chercheurs ont effectué des
mesures d’imagerie par résonance magné-
tique (IRM) chez les petits à l’âge de 1 an. Le
développement comportemental et la réactivité
de la sécrétion de cortisol ont également été
évalués. Les infections grippales de la mère
étaient bénignes et ont guéri spontanément.
À la naissance, les immunoglobulines G
spécifiques de la grippe maternelle ont été
retrouvées chez le nouveau-né, mais il n’y avait
aucune preuve de l’exposition virale directe du
fœtus. Le poids des nouveau-nés et la durée
de la gestation n’ont pas été affectés, et il en
était de même des réponses neuromotrices
comportementales et endocrines des petits.
Toutefois, les analyses par IRM ont révélé
d’importantes diminutions de la matière
grise corticale chez les animaux exposés in
utero à la grippe. Les analyses régionales ont
montré que les réductions de matière grise les
plus importantes se retrouvaient de manière
bilatérale dans les aires cingulaires et parié-
tales. En outre, la substance blanche était
également réduite de manière significative
dans le lobe pariétal. L’infection par la grippe
pendant la grossesse affecte donc clairement
le développement neurologique chez le singe,
entraînant une réduction de la matière grise
dans la plupart des cortex et une diminution
de la substance blanche dans le cortex pariétal.
Ces altérations cérébrales sont susceptibles
d’être permanentes, car elles étaient encore
observées chez les petits à un âge plus avancé.
Elles pourraient donc augmenter la probabilité
d’une pathologie ultérieure du comportement.
>
Short SJ, Lubach GR, Karasin AI et al. Maternal influenza
infection during pregnancy impacts postnatal brain develop-
ment in the rhesus monkey. Biol Psychiatry 2010;67(10):965-73.
Altérations de l’expérience
du soi dans la schizophrénie :
comparaison de 6 perspectives
Indianapolis (États-Unis)
Les perturbations induites par la schizophrénie
font aujourd’hui l’objet de recherches de plus
en plus pointues, mais ces dernières se sont
focalisées principalement sur les processus
biologiques et sociaux qui ont des effets sur
la vie et les parcours individuels. Ces points
de vue, qui procèdent d’une perspective à la
troisième personne, ont enrichi à la fois la
théorie et la pratique et ont permis d’élargir
considérablement notre compréhension de
la maladie. Toutefois, force est de constater
qu’une approche de la schizophrénie qui ne
prendrait pas en compte des dimensions de
la maladie à la première personne, à savoir
l’expérience du soi
(self-experience)
, serait
bien incomplète. La schizophrénie est un
trouble qui altère considérablement la vie des
individus qui en sont atteints. Ces derniers

La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 4 - juillet-août 2010 | 111
se voient obligés de lutter pour trouver leur
place, se sentir en sécurité, et donner une
signification à un monde rempli d’imprévus
et d’impondérables. Ces combats, ainsi que les
expériences auxquelles ils se réfèrent, méritent
d’être étudiés et explorés. Ilexiste certes toute
une littérature portant sur le sujet de l’expé-
rience de soi dans la schizophrénie, mais il
manquait à ce jour une synthèse large de ces
travaux, ainsi qu’une évaluation des possibi-
lités d’application des recherches consacrées
à l’expérience de la pathologie à la première
personne. En outre, il est difficile de déterminer
dans quelle mesure ces diverses approches
sont comparables. P.H. et J.T. Lysaker se sont
attelés à cette tâche et ont passé en revue six
approches de la schizophrénie à la première
personne. Ils ont considéré que l’expérience
du
self
implique une prise de conscience du
soi en tant que personne particulière dans une
situation particulière, et qui se débrouille plus
ou moins bien. Les perspectives auxquelles
ils se sont intéressés sont celles des débuts
de la psychiatrie (E. Bleuler et E. Kraepelin),
de la psychiatrie existentielle (R. Laing et
M. Boss), de la psychanalyse, de la réhabili-
tation psycho-sociale, de la phénoménologie
et de la psychologie dialogique (S. Kierkegaard,
E. Nietzsche, et M. Bakhtine, notamment). Ce
survol des 100 dernières années leur a permis
d’observer que les publications consacrées à
l’expérience du soi convergent et divergent
selon trois points clés. Tout d’abord, toutes
les approches s’accordent sur le fait que la
plupart des patients se sentent diminués
depuis le début de leur maladie. Ils ressentent
moins de force vitale et se sentent moins
capables de s’engager dans le monde, ce qui
intensifie leur anxiété face aux interactions
de la vie de tous les jours. Il existe cependant
des différences concernant le moment et la
manière dont la conscience d’une diminution
de capacités émerge. Selon le point de vue
de la réhabilitation, ces difficultés peuvent
survenir brusquement, alors que, selon les
modèles phénoménologiques et existentiels, le
déficit de sens commun pourrait être à l’œuvre
longtemps avant l’apparition de la maladie. Un
autre point de divergence concerne la question
de savoir si on peut espérer que les patients
puissent un jour récupérer une perception
plus intégrée de l’expérience du soi. Ainsi,
E. Bleuler, E. Kraepelin et les phénoménologues
considèrent cela comme impossible, alors que
les psychanalystes pensent qu’une certaine
forme de récupération est possible. Des études
longitudinales pourraient peut-être contribuer
à éclaircir certains de ces désaccords.
>
Lysaker PH, Lysaker JT. Schizophrenia and alterations in
self-experience: a comparison of 6 perspectives. Schizophr
Bull 2010;36:331-40.
Consommation de cannabis
et survenue d’une psychose :
une étude avec des jumeaux
Wacol et autres villes d’Australie
Un certain nombre d’études prospectives
de cohortes ont démontré l’existence d’une
association entre la consommation précoce
de cannabis et un risque accru de survenue
d’une psychose. Se fondant sur de tels résultats
et sur un certain nombre d’autres éléments,
les revues ont généralement conclu que la
consommation de cannabis est reliée de
manière causale à l’émergence d’une psychose.
Toutefois, cette association pourrait refléter
des biais méthodologiques et l’implication de
variables non maîtrisées dans les études. L’étude
de jumeaux offre un modèle intéressant suscep-
tible d’éliminer certains facteurs d’incertitude.
Des chercheurs australiens ont ainsi exploré
l’association possible entre la consommation
de cannabis et l’émergence de divers types de
psychose, en réalisant une étude prospective
au sein d’une cohorte de naissance. Ils ont
pu bénéficier des données d’une large étude
australienne relatives à un suivi de grossesses
qui incluait plus de 7 000 mères et leurs enfants,
inscrits dans les registres du plus grand hôpital
de Brisbane. Les membres de la cohorte et leurs
mères ont fait l’objet d’un suivi à 5, 14 et 21 ans
après la naissance. À partir d’une cohorte de
3 801 jeunes adultes nés entre 1981 et 1984, les
auteurs ont pu inclure 228 paires de jumeaux
dans leur étude sur le cannabis. La consom-
mation de cannabis a été évaluée à l’issue des
21 ans de suivi par un autoquestionnaire. Les
auteurs ont exploré l’association potentielle
entre la consommation de cannabis et des
mesures de 3 types d’évolution psychotique :
la psychose non affective, les hallucinations
et le délire. La durée de la consommation
de cannabis antérieure à l’apparition de la
psychose, le sexe, l’âge, la maladie mentale
des parents, et la présence d’hallucinations
lors de l’étape de suivi à 4 ans ont été pris en
compte dans les calculs de régression logis-
tique. Les résultats montrent que la durée de
consommation de cannabis était clairement
associée à la survenue de chacun des 3 types
d’évolution psychotique étudiés, en particulier
chez les individus ayant consommé du cannabis
pendant 6 ans ou plus. Cette étude portant sur
des jumeaux, et qui permet d’éliminer un certain
nombre de facteurs confondants, semble donc
confirmer que la consommation précoce de
cannabis peut être associée de manière causale
à une évolution de type psychotique chez les
jeunes adultes.
>
McGrath J, Welham J, Scott J et al. Association between
cannabis use and psychosis-related outcomes using sibling
pair analysis in a cohort of young adults. Arch Gen Psychiatry
2010;67(5):440-7.
Différencier la schizophrénie
du trouble schizo-affectif,
et la psychose de la démence
New York (États-Unis) et Melbourne (Australie)
Depuis son introduction comme entité diagnos-
tique, le trouble psycho-affectif a joué un rôle un
peu incertain dans la nosologie psychiatrique.
Les cliniciens et les chercheurs ont souvent
considéré cette affection comme un sous-type
de la schizophrénie ou du trouble bipolaire. Des
études familiales et génétiques fournissent des
arguments en faveur de l’existence de points
communs entre le trouble psycho-affectif et ces
2 autres pathologies. Toutefois, une approche
génétique d’association n’avait pas encore
été entreprise pour affiner la compréhension
que nous pouvions en avoir. Par ailleurs, on
sait que le
brain-derived neurotrophic factor
(BDNF) s’exprime de manière importante dans
des régions cérébrales critiques comme l’hip-
pocampe, l’amygdale et le striatum. Dans ces
zones, il contribue à des processus clés suscep-
tibles d’être impliqués dans la psychopatho-
logie. Parmi ces fonctions, on peut relever la
mémoire et l’apprentissage associatif, le condi-
tionnement aversif et le stress de perturbation
sociale. En outre, une variation allélique dans
le gène codant pour le BDNF a été associée

112 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 4 - juillet-août 2010
ACTUALITÉS
SCIENCES
à des troubles affectifs, mais généralement
pas à la schizophrénie. L’étude des variations
du BDNF est donc susceptible de contribuer
à clarifier le statut du trouble schizo-affectif.
Une équipe new-yorkaise a entrepris de tester
l’hypothèse selon laquelle des haplotypes du
BDNF seraient associés à des pathologies
psychiatriques caractérisées par une compo-
sante affective importante. Elle a examiné les
fréquences d’un marqueur d’un haplotype du
BDNF chez 381 patients et 222 sujets contrôles.
Les résultats de l’étude génétique révèlent
effectivement l’existence d’une association
statistiquement significative entre une variation
génétique dans le gène codant pour le BDNF
et un diagnostic de troubles de type affectif,
association qui n’est pas retrouvée chez les
sujets sains ou les patients présentant une
schizophrénie. Il s’agit là de la première étude
génétique qui démontre l’existence d’une
distinction entre schizophrénie et trouble
psycho-affectif. Ces résultats ouvrent la voie à
un type d’approche prometteur des pathologies
psychiatriques. Des études complémentaires
pourraient éventuellement révéler l’implication
de variantes du BDNF dans l’expression des
phénotypes cliniques des perturbations affec-
tives dans diverses catégories diagnostiques
du DSM.
>
Lencz T, Lipsky RH, DeRosse P, Burdick KE, Kane JM,
Malhotra AK. Molecular differentiation of schizoaffective
disorder from schizophrenia using BDNF haplotypes. Br J
Psychiatry 2009;194:313-8.
Par ailleurs, les études neurobiologiques de
la schizophrénie ont généralement exclu les
patients présentant des troubles neurologiques,
métaboliques ou d’autres natures. En revanche,
l’étude des pathologies désignées sous les
termes de “psychose organique” ou “schizo-
phrénie symptomatique” a permis d’enrichir
notre connaissance de la schizophrénie. Il existe
peu d’études ayant exploré la relation entre la
schizophrénie et la démence fronto-temporale.
Des chercheurs australiens se sont intéressés
à cette relation à travers l’exploration clinico-
pathologique de 17 cas de démence fronto-
temporale d’apparition précoce, et l’analyse de
la littérature scientifique dans le domaine. Les
patients ont été identifiés au sein de la banque
de cerveaux locale, et l’évolution clinique
et les observations pathologiques ont été
récupérées. Pour la revue de la littérature, des
cas de démence fronto-temporale identifiés par
Medline
ont été sélectionnés selon des critères
définis. Les données démographiques, cliniques,
les caractéristiques pathologiques et génétiques
des patients présentant un trouble psychotique
ont été rassemblées. Les résultats montrent que,
dans la série de cas, 5 des 17 patients atteints
de démence fronto-temporale présentaient
une maladie psychotique (4 schizophrénies ou
troubles schizo-affectifs, et 1 trouble bipolaire)
en moyenne 5 ans avant l’établissement du
diagnostic de démence. Dans les cas de la litté-
rature, un tiers des patients âgés de 30 ans ou
moins et un quart des patients de 40 ans ou
moins avaient reçu un diagnostic de psychose.
Les patients présentant une démence fronto-
temporale d’apparition précoce sont donc
susceptibles d’être diagnostiqués d’abord
comme présentant un trouble psychotique, et
ce souvent de nombreuses années avant que
le diagnostic de démence ne soit établi. Ces
résultats ont des implications pour les clini-
ciens, autant pour les neurologues que pour
les psychiatres, et pour notre compréhension
de la neurobiologie de la maladie psychotique.
>
Velakoulis D, Walterfang M, Mocellin R, Pantelis C, McLean C.
Frontotemporal dementia presenting as schizophrenia-like
psychosis in young people: clinicopathological series and review
of cases. Br J Psychiatry 2009;194:298-305.
Anatomie du trouble bipolaire
et de la schizophrénie :
une méta-analyse
Cambridge (Royaume-Uni)
Historiquement, le trouble bipolaire et la
schizophrénie ont été considérés comme des
entités distinctes. Par conséquent, il se pourrait
qu’il n’y ait aucune similarité dans les modifi-
cations structurales du cerveau induites par
ces 2 pathologies. Toutefois, de plus en plus
de preuves s’accumulent, suggérant que
les 2 pathologies présentent des éléments
communs. Une coagrégation des 2 pathologies
dans les familles est notamment observée, ainsi
que l’existence de gènes communs de suscep-
tibilité. Des anomalies structurales et fonction-
nelles du cerveau ont aussi été évoquées. La
cartographie des modifications structurales du
cerveau est plus avancée pour la schizophrénie

La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 4 - juillet-août 2010 | 113
que pour le trouble bipolaire, et il était jusqu’à
présent difficile de savoir dans quelle mesure
les 2 pathologies pouvaient aussi présenter des
profils similaires d’anomalies cérébrales. Cette
méta-analyse a eu pour but de générer et de
comparer les cartes des anomalies cérébrales
structurales obtenues par IRM avec des échan-
tillons importants de patients présentant l’un
ou l’autre des 2 troubles. Les auteurs ont
rassemblé les résultats de 42 études. Ils ont
ainsi pu confronter les données concernant
2 058 patients schizophrènes à celles de
2 131 sujets témoins d’une part, et celles de
366 patients atteints de trouble bipolaire à
celles de 497 sujets témoins, d’autre part. En
ce qui concerne la schizophrénie, les résultats
montrent d’importantes diminutions de matière
grise dans les cortex frontal, temporal, cingu-
laire et insulaire, ainsi que dans le thalamus,
et une augmentation de matière grise dans les
noyaux gris centraux. Dans le trouble bipolaire,
les diminutions de matière grise étaient
observées dans le cortex cingulaire antérieur
et de manière bilatérale dans l’insula. Les
diminutions observées dans le trouble bipolaire
se superposaient de manière importante avec
les déficits en matière grise repérés dans la
schizophrénie, à l’exception d’une région du
cortex cingulaire antérieur, où la réduction
de la matière grise était spécifique au trouble
bipolaire. Il est aussi intéressant, à propos du
trouble bipolaire, d’observer une réduction de
matière grise dans les régions paralimbiques
impliquées dans le traitement de l’émotion.
Les réductions de matière grise dans la schizo-
phrénie étaient, quant à elles, plus étendues
et impliquaient les structures limbiques et le
néocortex, mais aussi les régions paralimbiques
affectées dans le trouble bipolaire.
>
Ellison-Wright I, Bullmore E. Anatomy of bipolar disorder and
schizophrenia: a meta-analysis. Schizophr Res 2010;117(1):1-12.
Comment la stigmatisation
liée aux stéréotypes sur la
schizophrénie contribue aux
difficultés sociales des patients
Sydney et Saint Lucia (Australie)
La sensation d’être la cible de stéréotypes
dévalorisants est susceptible de perturber les
performances et le bien-être des sujets qui en
sont victimes, et ce dans un grand nombre de
domaines. Les études menées à ce sujet depuis
une dizaine d’années révèlent qu’il n’est, en
outre, pas nécessaire que les personnes soient
traitées d’une manière stéréotypée pour qu’elles
ressentent les effets menaçants et dévalorisants
liés au stéréotype. Il suffit qu’elles croient
avoir été catégorisées dans un groupe parti-
culier pour ressentir les effets négatifs de la
stigmatisation. Une étude a ainsi montré que
les femmes qui pensent que les mathématiques
ne sont absolument pas une spécialité féminine
réussissent moins bien les examens de mathé-
matiques du seul fait de cette croyance, sans
que cela soit lié à une différence de considé-
ration par les autres! La conscience de l’attri-
bution potentielle d’un stéréotype par autrui
perturbe la capacité de l’individu à focaliser tous
ses efforts sur la tâche en cours. Par conséquent,
le seul fait de savoir que les autres connaissent
la maladie dont ils souffrent devrait suffire à
faire apparaître le spectre de la stigmatisation
chez les patients psychiatriques, ce qui risque
d’entraîner une aggravation de leur état. Ce
risque est particulièrement important dans la
schizophrénie, dont l’une des caractéristiques
principales est une perturbation du fonction-
nement social. Or, les stéréotypes qui ont cours
dans la population générale à propos de la
schizophrénie font la part belle aux problèmes
d’insertion sociale, incluant la croyance selon
laquelle les patients sont socialement incom-
pétents. Il est cependant difficile de savoir si
l’expérience vécue de la menace du stéréotype
a un réel effet sur le fonctionnement social des
patients schizophrènes. Une étude a eu pour
objectif de vérifier si les patients schizophrènes
ont de moins bons résultats dans un contexte
social dans lequel ils se sentent catégorisés
comme “malades mentaux”. Trente patients
schizophrènes ambulatoires y ont été inclus. Il
leur était demandé de se livrer à 2 conversations
de 3 minutes, chacune avec un interlocuteur
différent. Au préalable, il leur avait été expliqué
que l’un de leurs interlocuteurs ne savait rien
sur eux, cependant que l’autre était informé
de leur diagnostic. En réalité, aucune des deux
personnes impliquées dans la conversation
ne connaissait le statut mental de son inter-
locuteur, et chaque participant avait à réaliser
une conversation avec un patient d’une part,
et une autre conversation avec un sujet sain,
d’autre part. Les résultats montrent que les
patients schizophrènes ne percevaient aucune
différence dans leur propre comportement
social au cours des deux types de conver-
sation. Cependant, lors de la conversation avec
l’interlocuteur qu’ils pensaient être au courant
de leur diagnostic, leur compétence sociale a
été évaluée par cet interlocuteur comme plus
pauvre pour trois des six mesures utilisées.
Cette exacerbation des difficultés sociales était
observée en dépit du fait que l’interlocuteur
ignorait en fait le diagnostic. Les difficultés
sociales des patients schizophrènes pourraient
donc être exacerbées par la conscience du fait
que les autres connaissent leur diagnostic. Cette
observation n’est pas sans implications quant
à la divulgation de l’état de santé mentale des
individus.
> Henry JD, von Hippel C, Shapiro L. Stereotype threat contri-
butes to social difficulties in people with schizophrenia. Br J Clin
Psychol 2010;49:31-41.
Difficultés respiratoires
et mortalité par suicide
Taïwan (Taïwan) et Séoul (Corée du sud)
La prévalence de l’asthme chez les enfants et
les adolescents a augmenté au cours des deux
dernières décennies et constitue un problème
de santé publique majeur dans les pays indus-
trialisés. L’asthme représente la sixième cause
de mortalité chez les enfants de 5 à 14 ans aux
États-Unis. Cette maladie, qui s’accompagne de
perturbations physiques mais aussi mentales,
est un fardeau pour les enfants. Ainsi, une étude
américaine a révélé que 16 % des enfants de
11 à 17 ans souffrant d’asthme présentaient
des critères du DSM-IV pour un ou plusieurs
troubles anxieux ou dépressifs, alors que ce
taux n’était que de 8,6 % chez les autres
enfants. Le risque de mortalité lié à l’asthme
est relativement élevé, et on peut suspecter
qu’il existe d’autres causes de décès que celles
liées directement à la pathologie respiratoire.
C.J Kuo et al. ont étudié l’association entre suicide
et asthme chez des adolescents taïwanais : ils
ont examiné les dossiers médicaux constitués
pour une vaste étude de cohorte sur l’asthme
et les allergies, qui répertoriait, d’octobre 1995
à juin 1996, des informations concernant près
de 170 000 élèves du secondaire âgés de 11 à

114 | La Lettre du Psychiatre • Vol. VI - n° 4 - juillet-août 2010
ACTUALITÉS
SCIENCES
16 ans. Les participants ont été classés en
3 groupes : ceux présentant un asthme au
moment de l’inclusion (symptômes présents
dans l’année en cours), ceux ayant antérieu-
rement souffert d’asthme (antécédents
d’asthme, mais pas de symptômes dans
l’année) et ceux n’en souffrant pas. Chaque
élève et ses parents ont complété des question-
naires structurés. Dans le groupe, un peu plus
de 20 000 enfants ont déclaré souffrir d’asthme
au moment de l’inclusion, et environ 10 000
ont déclaré avoir souffert d’asthme précé-
demment. Le devenir des participants a été
enregistré jusqu’en décembre 2007 par le suivi
des inscriptions à l’échelle nationale des certi-
fications de décès. Au bout des 12 ans de suivi,
les statistiques démographiques montrent
que 33 % des décès chez ceux qui n’avaient
jamais souffert d’asthme ont été attribués à
des causes non naturelles, alors que ce taux
s’élevait à 42 % chez les personnes atteintes
antérieurement de la maladie, et à 45 % chez
les personnes en souffrant actuellement. Les
chercheurs ont constaté, en outre, que parmi
les jeunes qui souffraient d’asthme, le taux
de suicide correspondait à plus du double de
celui observé chez les jeunes sans problèmes
respiratoires. En effet, parmi les adolescents
sans asthme, 4,3 % des décès étaient attribués
à un suicide, alors que le taux de suicide était
de 8,5 % chez les personnes atteintes antérieu-
rement de la maladie, et de 11 % chez les
personnes souffrant d’asthme. Curieusement,
cependant, il n’y avait pas de différence signi-
ficative entre les taux de décès par causes
naturelles, et les taux de mort naturelle étaient
légèrement, mais non significativement, plus
élevés chez les personnes souffrant alors
d’asthme ou en ayant précédemment souffert
que chez celles qui n’avaient pas la maladie.
À la suite d’une analyse de régression tenant
compte du sexe, de l’âge, du tabagisme d’au
moins un membre de la famille, de la consom-
mation de cigarettes de l’adolescent et de la
rhinite allergique, les auteurs ont constaté que
l’asthme actuel demeurait significativement
lié au suicide, comparativement à l’absence
d’asthme. La différence des taux de suicide
entre les groupes restait donc entièrement
expliquée par l’asthme. Ces résultats démon-
trent l’existence d’un excès de mortalité par
suicide chez les jeunes souffrant d’asthme. Il
semble donc nécessaire d’améliorer les soins
de santé mentale pour les jeunes, particuliè-
rement pour ceux présentant des symptômes
d’asthme sévères et persistants.
>
Kuo CJ, Chen VC, Lee WC et al. Asthma and Suicide Mortality in
Young People: A 12-Year Follow-Up Study. Am J Psychiatry; epub
ahead of print. http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/
abstract/appi.ajp.2010.09101455v1
Une autre étude parue dans le même numéro
de l’
American Journal of Psychiatry
a démontré
l’existence d’une relation entre des difficultés
respiratoires et le suicide. Des chercheurs
sud-coréens, dirigés par C. Kim, ont constaté
que l’augmentation transitoire de la pollution
de l’air à Séoul était associée à un risque accru
de suicide, en particulier chez les personnes
souffrant de maladie cardio-vasculaire.
>
Kim C, Jung SH, Kang DR et al. Ambient Particulate Matter
as a Risk Factor for Suicide. Am J Psychiatry; epub ahead of
print. http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/
appi.ajp.2010.09050706v1
1
/
5
100%