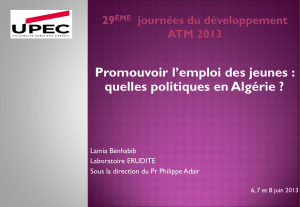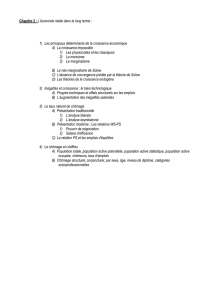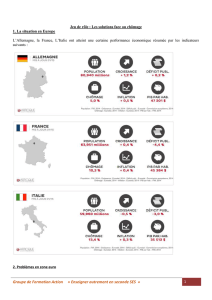Politiques de lutte contre le chômage, précarité du travail et... au noir dans la wilaya de Tizi-Ouzou

Politiques de lutte contre le chômage, précarité du travail et travail
au noir dans la wilaya de Tizi-Ouzou
Mohammed. Khaznadji
1
et Belaid Abrika
2
.
Résumé
La tendance à la décroissance du taux de chômage en Algérie résulte des
dispositifs de création d’emplois et d’activités engagés depuis la fin des années
80, ayant permis la création de nombreux emplois. Toutefois, la nouvelle
tendance du marché du travail est marquée par la progression rapide des emplois
temporaires, l’inadéquation entre la formation suivie et le poste occupé, une
rémunération très insuffisante, etc. Les différents dispositifs de création
d’emplois et d’activités ont contribué considérablement à la précarisation de
l’emploi. Une situation qui a favorisée à son tour la propagation du travail au
noir et le cumul des emplois.
Mots Clés : chômage, politiques d’emploi, précarité, travail au noir
Employment policies, job insecurity and unreported-employment in the
Wilaya of Tizi-Ouzou
Abstract
The decreasing trend in the unemployment rate in Algeria devices resulting job
creation and activities undertaken since the late 80s, which allowed the creation
of many jobs. However, the new trend in the labor market is characterized by
the rapid growth of temporary jobs, there was a mismatch between the training
received and the position occupied a very low pay, etc.. Different devices to
create jobs and activities have contributed significantly to job insecurity. A
situation which in turn favored the spread of the unreported-employment and
accumulated jobs.
Keywords: unemployment, employment policies, job insecurity, unreported-
employment
JEL: I32, I38, J32, E24, O17
1
Maitre assistant classe A à l’Université de Tizi-Ouzou, mk[email protected]
2
Maitre assistant classe A à l’Université de Tizi-Ouzou, abrikamazig[email protected]

1. Introduction
Les statistiques officielles montent une évolution favorable du marché du
travail en Algérie ces dernières années. Entre 1999 et 2011, le chômage a
reculé de 17,5%. Dans une large mesure, cette situation est liée aux
différents dispositifs de création d’emplois et d’activités mis en place
depuis l’adoption du plan d’ajustement structurel en 1994 et permise par
l’embellie financière qu’a connu le pays suite à l’évolution favorable des
prix des hydrocarbures au niveau international. Toutefois, si l’on
considère les emplois créés durant la même période, on constate que la
plupart sont des contrats à durée limitée avec une rémunération très
insuffisante et un minimum de droits. 40.7 % des occupés déclarent être
à la recherche d’un autre emploi dont 62.4% motivent leurs recherches
en raison de l’instabilité de l’emploi actuel, 17.4% pour une meilleure
rémunération et 17.2 % en raison de l’inadéquation de l’emploi actuel
avec leur profil (ONS, Enquête sur l’emploi, 2011).
Au delà des chiffres ou d’une approche quantitativiste, la situation de
l’emploi en Algérie, suite à l’ampleur des changements dans les structures
de l’économie et à la forte progression de la population active, est de plus
en plus préoccupante. La nouvelle tendance du marché du travail est
marquée par la progression rapide des emplois temporaires, la
substitution des emplois publics par des emplois privés dont la sphère
des droits se rétrécie de plus en plus, l’inadéquation entre la formation
suivie et le poste occupé (les emplois crées sont pour la plupart sous
qualifiés), une rémunération très insuffisante et un secteur informel sans
cesse en expansion.
La nouvelle politique d’emploi en Algérie est inscrite dans le social
puisqu’elle ne contribue pas à l’amélioration des conditions de vie des
jeunes, destinataires de la plupart des dispositifs mis en place.
L’hypothèse de notre travail est que les différents dispositifs de création
d’emplois et d’activités mis en place depuis les années 1990, même s’ils
sont indispensables au regard de l’approche philosophique et culturelle
de cette politique, ont contribués considérablement à la précarisation de
l’emploi et cette situation a favorisée à son tour la propagation du travail
au noir. Le travail au noir concerne particulièrement ceux qui sont
soumis à l’instabilité depuis la politique de substitution des emplois
permanents par des contractuels. Cette politique dissimule la réalité de la
situation de l’emploi en Algérie, la tendance à la baisse du taux de
chômage n’est que la face cachée des déclarations des institutions
étatiques qui intègre les emplois précaires dans les statistiques officielles.
A cet effet, dans le cadre de ce travail, en se basant sur le territoire de la
Wilaya de Tizi-Ouzou (WTO) dont le taux de chômage dépasse la
moyenne nationale, nous tenterons de présenter et évaluer les nouveaux
dispositifs de création d’emploi et monter que vu qu’ils constituent des

solutions temporaires et n’assurant en aucun cas un avenir certain aux
jeunes travailleurs, souvent les personnes insérées dans le marché du
travail à travers ces dispositifs recourent au travail au noir sous forme de
cumul.
Le choix de Tizi-Ouzou est lié au fait qu’en Algérie, l’espace local est le
niveau de mise en application de la politique nationale. Pour ce faire,
nous allons : d’abord, mener une enquête auprès des principales
institutions intervenant dans le marché de travail de la Wilaya : Direction
de l’emploi, Agence Locale d’Emploi (ALEM), Caisse Nationale
d’Assurance Chômage (CNAC), Agence Nationale de Soutien à l’Emploi
des Jeunes (ANSEJ) et l’Agence National de Gestion des Microcrédits
(ANGEM). Ceci est pour évaluer et analyser la contribution des
nouveaux dispositifs à la création d’emplois. Ensuite, mener une autre
enquête à travers un questionnaire qui cible l’Assemblée Populaire
Communale de Tizi-Ouzou (une commune urbaine) et celle de Tirmitine
(une commune rurale) afin de relever les conséquences des emplois
précaires créés à travers les dispositifs d’insertion professionnelle des
primo-demandeurs d’emploi.
2. Politique d’emploi en Algérie
La gestion et la régulation du marché du travail relèvent des prérogatives
de l’Etat. La raison d’être des politiques publiques d’emploi est liée aux
conséquences néfastes de ce phénomène aussi bien pour l’Etat que pour
les individus. Le chômage est considéré comme un sous emploi du
facteur travail, donc un manque à gagner pour l’économie nationale.
Aussi, un chômage de longue durée, surtout s’il touche une frange
importante de la population active, entraine la détérioration du niveau de
vie et ainsi favorise la croissance de la pauvreté. Par ailleurs, en l’absence
de perspectives d’emploi, un bon nombre de personnes, notamment les
jeunes, opte pour l’immigration vers l’extérieur du pays et d’autres
rejoignent les rangs de l’informel qui ne cesse de prendre de l’ampleur
chaque année. Egalement, le chômage favorise l’apparition de beaucoup
de fléaux sociaux comme la délinquance, la violence, l’insécurité, etc.
2.1. Contexte
Dans l’histoire de l’Algérie indépendante, le chômage a connu trois
grandes phases distinctes. La première, depuis l’indépendance jusqu’au
milieu des années 80 où le taux de chômage était décroissant. La
deuxième, entre 1986 et 2000, dans laquelle l’évolution de ce phénomène
était sans cesse croissante. Enfin, la dernière phase, depuis l’année 2001
jusqu’à 2012 où le taux de chômage a repris sa tendance à la baisse.
Il est important de souligner que l’essentiel des dispositifs d’emploi que
nous connaissons aujourd’hui en Algérie était engagé durant la deuxième

phase. Au cours de la troisième phase, ces dispositifs n’ont connu que
des réaménagements et des améliorations. La deuxième phase était
marquée par plusieurs événements majeurs qui n’ont pas été sans
conséquences sur l’emploi : réduction drastiques des prix des
hydrocarbures au niveau international, rééchelonnement de la dette
extérieure, l’adoption des plans d’ajustement structurel qui ont engendré
à travers ses différentes mesures la fermeture de plusieurs entreprises
publiques et des licenciements collectifs.
C’est dans ce contexte de crise et de transition de l’économie dirigée vers
l’économie de marché que la majeure partie des dispositifs de lutte contre
le chômage a été mise en place en Algérie.
2.2. Principales caractéristiques du marché du travail
En plus du contexte, le marché du travail algérien est caractérisé par
plusieurs aspects de natures différentes qui n’ont pas été sans
conséquences sur l’évolution des politiques d’emploi.
Le marché du travail algérien a connu une progression plus rapide de la
demande par rapport à l’offre, ce qui donne un niveau de chômage
important même s’il est en régression ces dernières années. Cette
situation est liée au rythme élevé d’accroissement démographique se
situant à plus de 3% en moyenne par an. Les répercutions de la forte
natalité des années 80 se manifestent maintenant par une demande
additionnelle d’environ 300.000 personnes en moyenne par an.
Egalement, l’urbanisation croissante et l’évolution positive de la
scolarisation féminine ont fait que la participation de la femme au monde
du travail est de plus en plus importante.
La demande d’emploi est dominée par une population jeune; trois
personnes en chômage sur quarte ont un âge de moins de 30 ans.
Le chômage touche particulièrement les primo-demandeurs d’emploi
avec niveau faible ou sans qualification.
Les réformes économiques libérales engagées depuis le début des années
90 ont fait que l’emploi public, même s’il demeure toujours le principal
employeur, perd de plus en plus de son importance au profit du secteur
privé en expansion.
Par secteur d’activités, le secteur qui se taille la part du lion en terme
d’emplois est celui du commerce services qui emploie plus de la moitié
(56,6%) des actifs, suivis par les secteurs du bâtiment et travaux publics
(17,2%), agriculture (13,7%) et l'industrie (12,5%).
2.3. Evolution des dispositifs de création de l’emploi
A l’exception des celui de l’ANSEJ et celui de la CNAC, gérés par des
organismes créés à cet effet, l’ensemble des dispositifs présentés dans le
tableau ci-après est géré par la DAS et la DEW.

Dispositif
Bénéficiaires et Objectifs
Programme
d’emploi des jeunes
(1988 -1989)
S’adresse aux personnes âgées de 16 à 27 ans Création d’emplois
à travers les travaux d’utilité publique et la promotion de la
formation professionnelle.
Dispositif
d’insertion
professionnelle des
jeunes (1990-2008)
Concerne les primo-demandeurs d’emploi, âgés de 19 à 40 an et
n’ayant aucune qualification professionnelles. Il est Structuré en
trois axes : 1. Emplois Salariés d’Initiative Locale (ESIL) ; 2.
création de micro-activités dans le cadre de coopératives de
jeunes ; 3. formation professionnelle.
Indemnité pour
activité d’intérêt
général (en 1995)
Création d’emploi par la participation des membres de famille
sans revenus aux activités d’intérêt générale avec une indemnité
mensuelle de 3000 dinars.
Travaux d’utilité
publique à haute
intensité de main-
d’œuvre (en 1997)
Création d’emplois à travers les travaux d’entretien des routes,
d’assainissement, d’agriculture, d’hydraulique… dont le coût de
main d’œuvre est important. Il apporte un plus en matière de
main d'œuvre pour les collectivités locales ayant un réel besoin de
personnel pour les travaux d'assainissement et nettoiement des
voiries.
Création de micro-
entreprises
(dispositifs ANSEJ.
(depuis 1996)
Concerne les personnes âgées de 19 à 35 ans création d’emploi à
travers la création de micro-entreprises. Initialement, trois
formules de financement ont été prévues : l’autofinancement ; le
financement mixte et le financement triangulaire.
Contrat de pré-
emploi (1999-2008)
Concerne les Universitaires et les Techniciens Supérieurs. Il porte
sur le recrutement par des employeurs sur une durée d’une année
renouvelable 6 mois, avec une rémunération total par l’Etat d’un
montant mensuel de 6000 DA pour les universitaires et 4500 DA
pour les techniciens supérieurs.
Microcrédit, (depuis
1999)
Financement d’achat, sous forme d’un prêt non rémunéré d’un
crédit bonifié, d’un montant varie entre 50.000 et 350.000 DA de
petits équipements en vue d’un travail indépendant.
Dispositif d’Aide à
la création
d’activités. depuis
2004 (dispositif
CNAC)
1994 : indemnisation des travailleurs salariés ayant perdu
involontairement leur emploi pour des motifs économiques.
1998-2004 : mise en œuvre des mesures actives pour la
réinsertion des chômeurs allocataires à travers trois structures :
Centre de Recherche de l’Emploi (CRE), Centre d’Aide au
Travail Indépendant (CATI) et Formation-Reconversion (FR).
2004 : mise en œuvre d’un dispositif d’aide à la création
d’activités pour les chômeurs promoteurs âgés de 35 à 50
2010 le dispositif est élargi à la population âgée de 30 à 50 ans, le
montant maximum d'investissement passe de 5 à 10 millions de
dinars avec la possibilité d'extension des capacités de production
pour les entreprises existantes.
A travers l’évolution des dispositifs d’emploi en Algérie, il ressort que le
chômage demeure toujours une préoccupation majeure de l’Etat.
Toutefois, il n’existe pas une approche globale, qui s’étale sur le long
terme, basée sur des anticipations de toutes les variables et la simulation
d’impact des dispositifs sur l’emploi. C’est bien que les politiques soient
évolutives et flexibles, c'est-à-dire, elles s’adaptent aux situations
nouvelles. Néanmoins, il ne faut pas qu’elles soient conjoncturelles et
remises en cause à chaque fois.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%