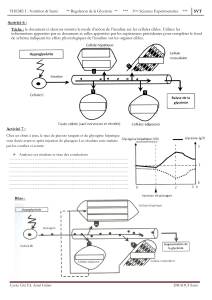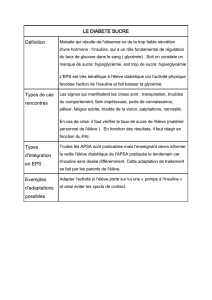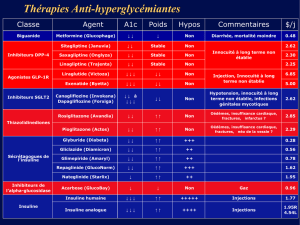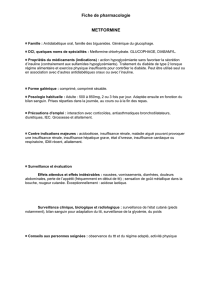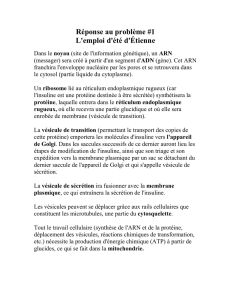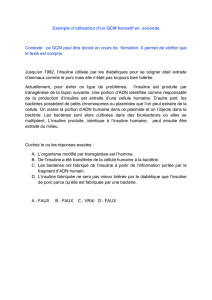Lire l'article complet

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011
312
Échos des congrès
© katia gizzi
47e EASD
Lisbonne, 12-16 septembre 2011
B. Duvillié* , A. Vambergue**
À l’occasion du congrès de l’Association européenne pour l’étude du diabète
(EASD, European Association for the Study of Diabetes), la connaissance des
facteurs régulateurs de la sécrétion d’insuline a fait l’objet d’importantes avan-
cées. En effet, on admet que les défauts de sécrétion d’insuline en réponse au
glucose interviennent avant l’apparition du diabète de type 2 (DT2). Il est donc
important de déterminer par quels mécanismes ces défauts de fonction de la
cellule β apparaissent. B. Duvillié exposera les nouveaux concepts relatifs à ce
sujet. Ensuite, A. Vambergue offrira une vue synthétique des présentations sur
les complications cardiovasculaires au cours du DT2, sur la chirurgie bariatrique
et, surtout, sur les possibilités d’évolution du diabète vers le cancer. Ce dernier
point constitue un sujet d’interrogation croissante.
Les abstracts cités sont consultables sur : http://www.easd.org/easdwebfiles/
annualmeeting/47thmeeting/2011/index.html
La sécrétion d’insuline au cœur du débat
Sécrétion d’insuline : les nouveaux facteurs
impliqués dans sa régulation
L’exocytose précède la sécrétion d’insuline en diri-
geant les granules de sécrétion vers la membrane
plasmique. Ensuite, les granules qui contiennent de
l’insuline fusionnent avec la membrane plasmique. Les
protéines importantes responsables de ces mécanismes
sont SNAP-25, STX1A, VAMP2 et STXBP. Anderson et
al. (OP06, abstr. 32 ; Malmö, Suède) ont étudié l’hypo-
thèse selon laquelle les gènes qui contrôlent l’exocytose
seraient altérés chez les patients diabétiques. Les profils
d’expression de 23 gènes impliqués dans l’exocytose
ont été analysés avec des puces à ADN, sur des prépa-
rations provenant d’îlots de 55 donneurs sains et de
9 diabétiques de type 2. Anderson et al. ont montré
que 5 gènes importants pour l’exocytose étaient signi-
ficativement diminués chez les patients diabétiques
comparés aux témoins. L’expression de ces gènes, dont
STX1A, est corrélée négativement au pourcentage
d’hémoglobine glyquée et corrélée positivement à la
sécrétion d’insuline en réponse au glucose. Cette étude
met donc en évidence l’importance de l’expression des
gènes de l’exocytose dans la fonction des cellules β. La
diminution de leur expression pourrait probablement
être impliquée dans le DT2.
Cantley et al. (abstr. 34 ; Sydney, Australie) ont recherché
le rôle du facteur CBP/p300-interacting transactivator 2
(CITED2) dans les cellules β. En effet, CITED2 est forte-
ment exprimé dans les cellules β et il agit comme cofac-
teur de molécules partenaires qui ont un rôle connu
dans la fonction des cellules β. La mutation spécifique
de CITED2 dans les cellules β n’entraîne pas de phé-
notype apparent chez les souris qui présentent une
masse corporelle et un aspect normaux. Néanmoins,
lorsque ces souris sont soumises à des tests de tolérance
au glucose, on observe une réduction de la sécrétion
d’insuline par rapport aux souris témoins. La masse
de cellules β des souris mutantes est normale mais
l’architecture des îlots est altérée.
De plus, l’expression de CITED2 était diminuée de 38 %
dans les îlots de souris diabétiques Db/Db par rapport
à des souris témoins sauvages. L’ensemble de ces résul-
tats démontre clairement que le facteur CITED2 est
impliqué dans la fonction des cellules β. L’hypothèse
d’un rôle de CITED2 au cours du diabète est soutenue
par l’analyse des souris Db/Db. Néanmoins, l’analyse
de son mécanisme d’action nécessitera des recherches
complémentaires.
* Inserm U845, faculté de
médecine Necker, Paris.
** Clinique Marc-
Linquette, endocrinologie,
diabétologie et
métabolisme, hôpital
Claude-Huriez, Lille.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011
313
47e EASD
Le facteur de transcription et de traduction TFB1M
contrôle l’expression de gènes mitochondriaux.
Sharoyko et al. (OP06, abstr. 31 ; Malmö, Suède) ont
montré, grâce à une analyse génomique, que certains
variants du gène TFB1M sont associés à un accroisse-
ment du risque, pour les patients, de développer un
DT2, du fait d’anomalies de la sécrétion d’insuline et
d’une glycémie élevée lors de tests de tolérance au
glucose. Afin d’élucider le rôle de TFB1M, Sharoyko et
al. ont analysé des souris qui portent une mutation
de TFB1M dans les cellules β du pancréas. À 2 mois
et demi, ces souris affichent un retard d’élimination
du glucose lors de tests de tolérance au glucose et
une absence d’induction de la sécrétion d’insuline. À
4 mois, ces souris deviennent diabétiques et la sécrétion
d’insuline en réponse au glucose est altérée. Il devient
évident que la protéine TFB1M joue un rôle majeur
dans la fonction des cellules β et le développement
du diabète. Elle constitue dès lors une nouvelle cible
thérapeutique potentielle.
La croissance des cellules β est un phénomène adaptatif
qui permet une homéostasie glucidique correcte lors de
la grossesse. Wu et al. (OP08, abstr. 43 ; Nanjing, Chine)
ont montré précédemment que la survivine contrôle
la prolifération des cellules β pendant la période péri-
natale. L’étude présentée à l’EASD avait pour objectif
de mieux comprendre le rôle de la survivine pendant
la gestation. Pour cela, ses auteurs ont généré des
souris avec une mutation de la survivine spécifique-
ment dans les cellules β. Wu et al. ont examiné dans
un premier temps l’expression de la survivine dans des
souris témoins sauvages : la survivine était exprimée
entre E10.5 et E18.5, atteignant un pic d’expression à
E14.5. Cette expression est corrélée à une hausse de
prolifération des cellules β à E14.5. Les souris mutantes
pour la survivine ont des défauts de sécrétion d’insuline
en réponse au glucose pendant la gestation, avec une
diminution de la masse de cellules β par rapport aux
souris témoins sauvages. Cette réduction de la masse
de cellules β est causée par une baisse de réplication.
Ces données montrent un nouveau rôle de la survivine,
gène qui s’avère essentiel pour l’adaptation de la masse
de cellules β pendant la grossesse.
Régénération des cellules β :
un concept revisité lors de la vie néonatale
Pendant de nombreuses années, une question fonda-
mentale a été de savoir si la néogenèse des cellules β
– c’est-à-dire la différenciation de cellules β à partir
d’autres types cellulaires – existait chez l’adulte. Les
études génétiques par traçage de cellules de Dor et
Bhushan ont exclu cette possibilité dans le pancréas
adulte en 2004. Au congrès de l’EASD, Minami et al.
(OP08, abstr. 48 ; Kobe, Japon) ont relancé le débat et
posé la question de l’existence d’une néogenèse des
cellules β pendant la période néonatale. Pour cela, ils
ont généré des souris dans lesquelles on peut marquer
et suivre les cellules β avec l’expression d’un gène rap-
porteur YFP (Yellow Fluorescent Protein). Les cellules β
ont été ainsi marquées à la naissance. Lors du sevrage
des souriceaux (vers 3 semaines postnatales), un grand
nombre de cellules qui avaient été marquées par YFP
ont été remplacées par des cellules non fluorescentes.
Cela indique que ces nouvelles cellules β se sont for-
mées à partir de cellules “non β”, car, si elles prove-
naient de la réplication de cellules β préexistantes,
on s’attendrait à ce qu’elles expriment le facteur YFP.
Or, ces données montrent que la néogenèse des cel-
lules β est possible pendant la période postnatale. Cet
événement devrait permettre d’envisager à l’avenir
des possibilités thérapeutiques importantes pour le
traitement du diabète néonatal.
Insuline et cerveau :
un nouveau rôle dans la satiété
Une autre question majeure soulevée au congrès de
l’EASD était consacrée au rôle de l’expression de l’in-
suline dans le cerveau. Les auteurs ont notamment
recherché les effets de l’insuline du cerveau sur la prise
de poids et sur la régulation de la glycémie. L’équipe
de Johnson (abstract 711 ; Vancouver, Canada) a étudié
le profil d’expression des 2 gènes de l’insuline chez la
souris dans différentes parties du cerveau. Rappelons
que la souris exprime 2 gènes non alléliques codant
pour 2 protéines très voisines, qui diffèrent par 2 acides
aminés dans leur chaîne B et par 3 dans le peptide C.
Chez l’homme, il n’existe qu’un seul gène de l’insuline.
Dans quelques cellules de l’hypothalamus, Johnson et
al. ont détecté des transcrits de l’insuline 2 mais pas
de l’insuline 1. Les transcrits Ins1 et Ins2, en revanche,
sont exprimés dans le pancréas, ainsi que le décrivaient
Duvillié et al. en 1997 (1). Cette étude montre que des
souris Ins1-/-Ins2+/- ont une prise de poids corporelle
et une prise alimentaire plus importantes que celles de
souris Ins1-/-Ins2+/+ lorsque ces animaux sont exposés
à un régime riche en graisse. Ces résultats conduisent à
l’hypothèse d’un rôle de l’expression du gène Ins2 dans
le cerveau sur la satiété. De façon intéressante, il avait
été expliqué précédemment que des souris ayant une
mutation spécifique du gène du récepteur de l’insuline
dans le cerveau développent également une obésité
lors d’un régime riche en graisse. L’ensemble de ces
données soutient l’idée d’un effet de l’expression de
l’insuline dans le cerveau sur la prise alimentaire.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011
314
Échos des congrès
Les complications cardiovasculaires
dans le diabète de type 2
Une session a été consacrée aux “Complications car-
diovasculaires du DT2 : un sujet toujours d’actualité”
(OP26 ; Stehower, Maastricht, Pays-Bas ; Witte, Gentofte,
Danemark). Des questions non résolues concernant la
relation entre le niveau d’HbA1c et le risque de com-
plications cardiovasculaires graves – sous-entendant
le risque de mortalité cardiovasculaire – persistent à ce
jour. Les analyses et méta-analyses qui se sont succédé
après les résultats de l’étude ACCORD (Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes) ont fait état de la possi-
bilité d’une association de courbe en U. Des données
rétrospectives issues d’une cohorte de 40 204 Suédois
âgés de plus de 35 ans, atteints de DT2 et suivis en
médecine générale, ont été présentées au cours de ce
congrès (OP26, abstr. 153 ; Östgren, Linköping, Suède).
Ces données ont été comparées à celles du Registre
national des causes de décès et à celles du Registre
national d’hospitalisation. Le risque d’un premier
événement cardiovasculaire grave a été défini par un
critère composite (infarctus myocardique non mortel,
insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral non
mortel, décès d’origine cardiovasculaire). Pendant la
période de suivi – entre 1999 et 2010 –, 10 018 patients
de la cohorte suédoise (soit 24,9 %) ont présenté un
événement cardiovasculaire grave. La relation entre
le taux d’HbA1c et le risque de ce premier événement
cardiovasculaire grave est de type courbe en J. Le risque
le plus faible est observé pour un taux d’HbA1c de
6,3 % : or, cette relation persiste après ajustement sur
les facteurs confondants que sont l’ancienneté du dia-
bète, la durée du traitement, le niveau socio-éducatif
des patients. Les auteurs en concluent que les futures
recommandations devraient inclure un seuil minimal
à viser de taux d’HbA1c de l’ordre de 6,0 à 6,5 % selon
leurs données.
D’autres données issues de nombreux registres
– notamment ceux des pays nordiques et des Pays-
Bas – ont confirmé une notion déjà connue, à savoir la
réduction du risque cardiovasculaire chez les patients
traités par metformine. Néanmoins, il faut souligner
qu’il s’agit de données observationnelles obtenues
auprès de groupes de patients traités par metformine
versus insuline, non comparables. L’indication de l’in-
sulinothérapie est souvent proposée en présence de
complications plus sévères. Ces résultats ne permettent
en aucun cas d’imputer à l’insuline une augmentation
du risque cardiovasculaire.
Une autre étude observationnelle venant des États-Unis
(OP26, abstr. 156 ; Fu, Cleveland, États-Unis) a comparé
le risque cardiovasculaire dans 2 groupes de patients
traités en monothérapie au moins pendant 90 jours
soit par metformine seule, soit par sulfamides seuls,
et suivis pendant 3 ans. L’avantage de cette étude est
que les patients étaient appariés sur les facteurs de
risque (indice de masse corporelle [IMC], ancienneté
du diabète, niveau d’HbA1c, niveau tensionnel et lipi-
dique). Les résultats restent favorables à la metformine
par rapport aux sulfamides. Néanmoins, il n’y a pas eu
d’information sur les combinaisons de traitements ou
les modifications de traitement au cours du suivi.
Insuline et cancer, metformine et cancer
Ce sujet continue de faire l’objet de toute l’attention de
la communauté diabétologique au cours des différents
congrès nationaux et internationaux.
Quelques notions épidémiologiques déjà connues ont
été rappelées : le risque de cancer chez les patients dia-
bétiques est plus élevé que chez les non-diabétiques,
et ce risque est globalement multiplié par 2. Les méca-
nismes précis de cette association ne sont cependant
pas encore bien compris. Il semble néanmoins que le
mécanisme le plus important soit celui de l’insulino-
résistance associé à celui de l’hyperinsulinisme. Nous
savons que l’insuline est un facteur mitogène et qu’il
n’est pas exclu que l’hyperinsulinisme puisse stimuler
la prolifération de cellules cancéreuses. Toutefois, nous
avons besoin de données complémentaires pour mieux
comprendre ces mécanismes. À l’inverse, le rôle poten-
tiellement bénéfique de la metformine sur la proliféra-
tion tumorale a été rapporté. Les patients diabétiques
sous metformine auraient un risque moins élevé de
cancer. D’après certaines observations in vitro, elle per-
mettrait de freiner la prolifération cellulaire. Nous ne
savons pas si ces données seront confirmées in vivo. La
metformine ne peut certes pas être considérée comme
un antimitotique, mais elle pourrait trouver sa place dans
le traitement adjuvant à la chimiothérapie de certains
cancers comme le cancer du sein. Ces données justifient
bien sûr d’être validées par des données complémen-
taires, expérimentales ou précliniques.
L’ère du bypass est-elle déjà dépassée
dansle traitement chirurgical du diabète
de type 2 ?
Une session a été consacrée aux données issues de la
chirurgie bariatrique dans la prise en charge du DT2
(OP31 ; Mingrone, Rome, Italie ; Nuutila, Turku, Finlande).

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XV - nos 9-10 - novembre-décembre 2011
315
47e EASD
Elles confirment le bénéfice de la chirurgie sur le plan
métabolique et la possibilité d’une nouvelle technique
– cette fois-ci non invasive. Il existe maintenant dans
la littérature de nombreuses données confirmant
l’effet bénéfique, au moins sur le plan métabolique,
chez nos patients atteints de DT2. Il a été démontré
(OP181 ; Barsotti, Pise, Italie) que cet effet bénéfique
de la chirurgie bypass concerne également les sujets
obèses non diabétiques par le biais d’une améliora-
tion de l’insulinosensibilité. La chirurgie bariatrique
serait, d’après une autre étude suisse (OP31, abstr. 182 ;
Svehlikova, Graz, Autriche ; Suisse), suivie d’effets très
précoces et très rapides en termes d’amélioration de
l’insulinosensibilité – quelle que soit l’ancienneté du
diabète. L’insulinorésistance associée aux différents
tissus est également présente au niveau de l’intestin lors
de l’exploration par PET scan effectuée avant chirurgie
et 6 mois plus tard. L’insulinorésistance est nettement
améliorée 6 mois après la chirurgie (OP31, abstr. 185 ;
Mäkinen, Turku, Finlande).
Le contenu le plus spectaculaire de cette session est
venu de la présentation d’une nouvelle technique non
invasive, “l’entérobarrière”, qui pourrait remplacer le
bypass : il s’agit d’une prothèse – ou manchon synthé-
tique – qui fait une barrière au niveau du duodénum
et d’une partie du jéjunum. Elle est posée pour une
durée de 3 mois. Cette technique se fait par fibroscopie.
Les résultats sont comparables à ceux du bypass – une
semaine après la pose, en termes d’amélioration de
l’insulinosensibilité, et après plusieurs mois, en termes
de perte pondérale et d’amélioration de l’HbA1c. Si les
études cliniques à plus long terme confirment ces résul-
tats préliminaires, ce sera une révolution, dans la mesure
où il s’agit d’une technique non invasive entraînant un
risque de morbidité moindre que celui du bypass (OP31,
abstr. 186 ; de Jonge, Maastricht, Pays-Bas).
■
International Diabetes Federation
Dubaï – 4-8 décembre 2011
IDF 2011
Recevez chaque jour les temps forts
du congrès sous forme de billets d’humeur,
interviews vidéos, diapositives à télécharger
et brèves sur votre messagerie électronique.
Coordonnateur : Olivier DUPUY (HIA Bégin)
Journal en ligne
en direct
www.edimark.fr/ejournaux/IDF/2011/
SITE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
* “Attention : les comptes-rendus de congrès ont pour objectif de fournir des informations
sur l’état actuel de la recherche ; ainsi, les données présentées seront susceptibles de ne pas
être validées par les autorités françaises et ne doivent donc pas être mises en pratique.”
“Ces informations sont sous la seule responsabilité des auteurs et du directeur
de la publication qui sont garants de l’objectivité de cette publication.”
versions web + iphone
Pour le consulter,
connectez-vous sur :
www.edimark.fr
Ou adressez une demande
d’inscription à :
Avec le soutien institutionnel de
1.
Duvillié B, Cordonnier N, Deltour L et al. Phenotypic alterations in insu-
lin-deficient mutant mice. Proc Natl Acad Sci USA 1997;94(10):5137-40.
Référence
1
/
4
100%