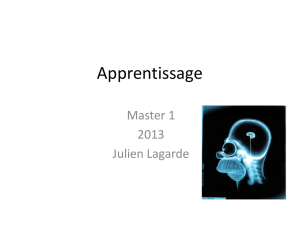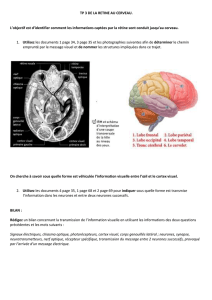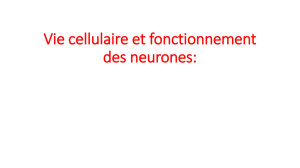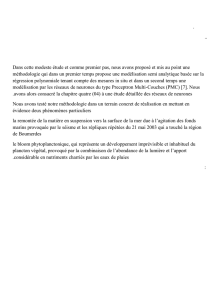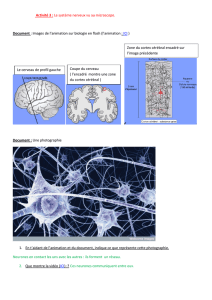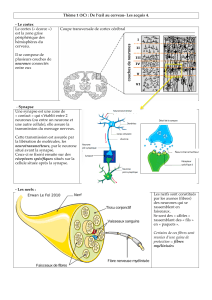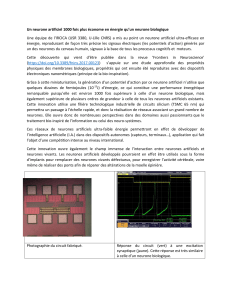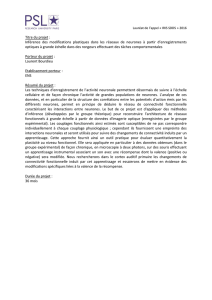Les réseaux de neurones de la conscience Approche multidisciplinaire (et neuro-computationnelle) du phénomène

Les réseaux de neurones
de la conscience
Approche multidisciplinaire
(et neuro-computationnelle) du phénomène
Guy ROLLET
L’Harmattan - Janvier 2013
Ce document à pour but la présentation de l’ouvrage de Guy ROLLET « Les
réseaux de neurones de la conscience ». L’objet de cet ouvrage est de réaliser une
approche multidisciplinaire et neuro-computationnelle du phénomène de la
conscience. Dans ce document sont donnés des résumés de plus en plus précis allant
de la présentation rapide de la quatrième de couverture jusqu’à une présentation
PowerPoint précise. Ont été ajoutés le sommaire de l’ouvrage, un abstract en anglais,
une synthèse des concepts proposés et les références bibliographiques de l’ouvrage.
Plan du document
1.- Couverture
2.- Quatrième de couverture
3.- Sommaire de l’ouvrage
4.- Résumé
5.- Abstract
6.- Synthèse détaillée
7.- Présentation Powerpoint
8.- Synthèse des concepts proposés
9.- Références bibliographiques
Commande de l’ouvrage
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=39191
Sur un moteur de recherche : Rollet « Les réseaux de neurones de la conscience »
Version imprimée
ISBN : 978-2-336-00597-3 Janvier 2013 240 pages
Prix public : 25 € Prix éditeur : 23,75 €
Version numérique
EAN Ebook : 9782296513754 Format Pdf 4 291 Ko
Prix : 18,75 €
Contact

2
1.- COUVERTURE
1.- COUVERTUR

3
2.- QUATRIÈME DE COUVERTURE
Les réseaux de neurones de la conscience
Cet ouvrage vise à la compréhension de la conscience. De
nombreuses approches ont déjà été effectuées dans le cadre
de différentes disciplines : philosophie, intelligence
artificielle, psychologie, neurosciences et psychanalyse. Il
serait vain d’espérer trouver une solution pertinente sans
examiner ces approches et sans tenir compte de l’apport de
ces différentes sciences de l’esprit. Notre premier travail est
dès lors d’étudier ces tentatives et de rassembler les
éléments pertinents existant au sein de ces disciplines.
Il apparaît que les neurosciences computationnelles
amènent incontestablement des éléments décisifs. Un
réseau de neurones original est conçu pour coder une
conscience stricto sensu, capable de raisonnement et de prise
de décision. Celle-ci pourra être orientée par les émotions. La
capacité d’agir, la composition du Soi et la verbalisation de
la pensée pourront alors être envisagées.
Guy ROLLET est ingénieur Centrale – Lille.
Informaticien de profession, il s’est intéressé
aux réseaux de neurones, à la psychologie,
à la psychanalyse et aux neurosciences ainsi
qu’à l’Intelligence Artificielle et à la
philosophie. Depuis 2002, il travaille sur la
modélisation de l’esprit et de la conscience en
tant que chercheur indépendant. Son point de vue est résolument
intégratif en refusant les frontières artificielles établies entre les
différentes disciplines.
25 €
ISBN : 978- 2-336-00597-3

4
3.- SOMMAIRE DE L’OUVRAGE
RÉSUMÉ ………………………………………………………... 7
ABSTRACT ……………………………………………………... 9
REMERCIEMENTS ……………………………………………… 11
1. INTRODUCTION ……………………………………………… 13
2. LES CONCEPTIONS NORMATIVES DE LA CONSCIENCE ………… 17
3. LES CONCEPTION NEUROBIOLOGIQUES ET LE PROBLÈME DE
LA LOCALISATION …………………………………………… 31
4. LES ENJEUX DE LA CONSCIENCE ……………………………... 57
5. ELÉMENTS NEURO-COMPUTATIONNELS ……………………... 69
6. MODÈLE NEURO-COMPUTATIONNEL DE LA CONSCIENCE
STRICTO SENSU ………………………………………............. 83
7. L’INTERVENTION DES ÉMOTIONS ……………………............. 103
8. VERS UNE COMPRÉHENSION DE LA CONSCIENCE ÉTENDUE …... 119
9. CONCLUSIONS GÉNÉRALES ………………………………….. 169
ANNEXE : CONSTRUCTION D’UN PROTOTYPE ET PROGRAMMATION
DU MODÈLE DE LA CONSCIENCE STRICTO SENSU ……………... 187
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ……………………………… 205
INDEX …………………………………………………………..221
TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX …………………………231

5
4.- RÉSUMÉ
Chercher à comprendre la conscience est un exercice aussi ancien que chercher à
comprendre le monde. De nombreuses conceptions ont ainsi vu le jour et il serait illusoire de
traiter de ce phénomène en les ignorant, car les concepts qui les composent et les points de
vue qui les sous-tendent peuvent être encore pertinents. La première partie de notre travail a
donc consisté à en faire une présentation. Nous avons ainsi abordé les conceptions classiques
des XVIIème et XVIIIème siècles, puis les conceptions phénoménologiques, cognitivistes et
fonctionnalistes. Nous avons évoqué la négation comportementaliste. Nous avons ensuite
abordé les conceptions neurobiologiques et leurs tentatives de localisation de la conscience ;
nous avons ainsi examiné les positions émergentistes, celles de Damasio, de Dehaene, puis
celles d’autres auteurs la centrant dans le thalamus, comme Crick et Koch, Llinas, Baars et
Newman. Ces études nous ont permis de comprendre les enjeux présents dans le problème de
la conscience. Nous avons ainsi pu élaborer un cahier des charges spécifiant cette entité, puis
définir nos orientations quant à sa localisation et son mode de prise en compte.
Nous avons pris ensuite une orientation neuro-computationnelle. Nous avons rappelé les
différents modèles de neurone comme les modèles « Intègre-et-tire » et le modèle de
McCulloch et Pitts, puis les modèles de Hopfield et le modèle de l’attention de Taylor et
Alavi. Nous avons rappelé les grandes lignes d’un moteur d’inférence. Nous avons alors
conçu un moteur d’inférence de nature neuro-computationnelle dont nous avons précisé la
structure, le fonctionnement et les paramètres. Nous avons confronté ce modèle au cahier des
charges élaboré précédemment : il est apparu qu’il répondait à plusieurs points, mais qu’il
existait des manques dont la gestion des besoins et des pulsions. Nous avons alors entrepris la
modélisation d’un réseau pulsionnel. Nous avons fait un historique des différentes
conceptions des pulsions et nous avons précisé notre position, ce qui nous a permis de définir
un modèle neuro-computationnel des pulsions. Nous avons vu comment il pouvait s’incarner
et nous l’avons confronté à différentes théories et à notre cahier des charges. Nous avons ainsi
compris ce qu’était la conscience-noyau (dite encore conscience primaire) et comment elle
fonctionnait.
Si le problème des besoins et des pulsions était résolu dans ses grandes lignes, il restait à
examiner certains problèmes comme la planification et les fonctions exécutives, la réflexivité,
la mémoire explicite, la construction du soi et le problème de la verbalisation. Dans ce but,
nous avons abordé l’interface de la conscience-noyau avec différents systèmes de l’esprit dont
le cortex préfrontal. Nous avons traité individuellement chacun de ces problèmes en tentant
d’apporter un point de vue neuro-computationnel. Nous avons compris que le langage avait
un rôle fondamental et donnait à l’homme une conscience d’ordre supérieur.
En annexe, nous avons rendu compte de la construction d’un prototype de notre moteur
d’inférences floues. Celui-ci nous a permis de réaliser un raisonnement simple et de nous
confronter à une tâche de Stroop. Cette simulation a permis de valider notre moteur
d’inférence neuro-computationnel, modèle d’une conscience stricto sensu. Nous avons ensuite
déterminé son pseudo-code. Nous l’avons fait évoluer pour intégrer une condition d’arrêt et
pour qu’il optimise les démonstrations.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
1
/
67
100%