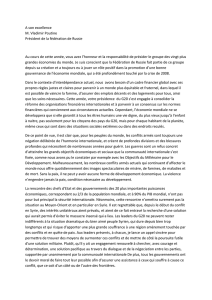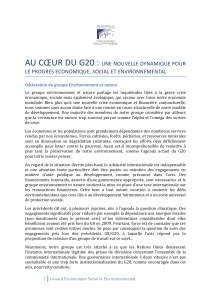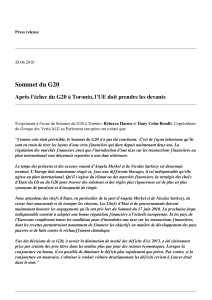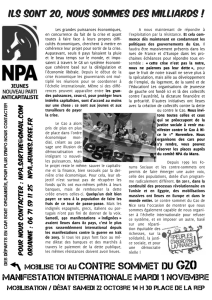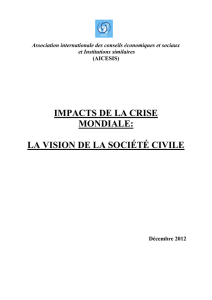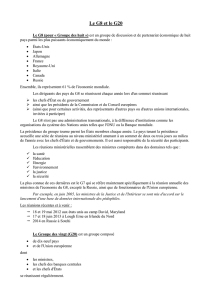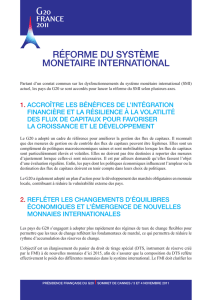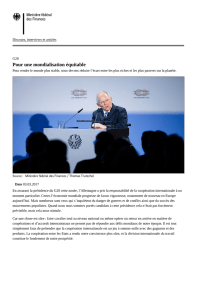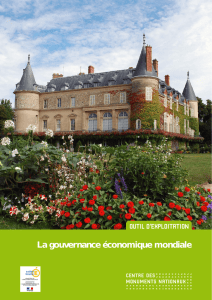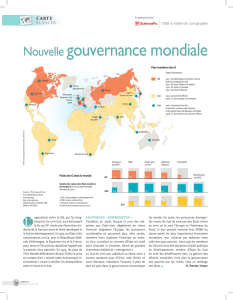Sciences économiques et sociales LA GENESE DU G20

Sciences économiques
et sociales
LE G20 ET LA GOUVERNANCE DES MARCHÉS I
LA GENESE DU G20
La nécessité de la concertation des grandes puissances sur les questions économiques
remonte au milieu des années 1970, au moment où fut réuni le premier G6 à Rambouillet en
1975. Devenu G8 à la fin des années 1990 afin d’intégrer la Russie postsoviétique, ce
directoire des Chefs d’Etat est officiellement élargi à 20 membres en 2009 pour tenir compte
du poids économique nouveau des pays émergents et pour tenter d'apporter une réponse à
la crise financière mondiale. L'institutionnalisation du G20 marque ainsi une étape dans
l'édification d'une gouvernance mondiale.
DOCUMENT 1 : NAISSANCE DU G6, NAISSANCE DU G20 : LE POIDS DE L’EVOLUTION
DE L’ECONOMIE MONDIALE DEPUIS LES ANNEES 1970.
DOCUMENT 2 : LES PAYS DU G8 ET G20 (PIB en dollars et population)
DOCUMENT 3 : DES SOMMETS DU G8 A CEUX DU G20
DOCUMENT 4 : LE G7 ET LA STABILISATION DE L’ECONOMIE MONDIALE
DOCUMENT 5 : NAISSANCE DU G20 ET BILAN DES G20.
DOCUMENT 6 : LES PRIORITES DU G20 EN 2011
DOCUMENT 7 : AGIR AUJOURD’HUI LOCALEMENT OU REGIONALEMENT POUR
OBTENIR DEMAIN UNE GOUVERNANCE MONDIALE ?
*******************
DOCUMENT 1 : NAISSANCE DU G6, NAISSANCE DU G20 : LE POIDS DE L’EVOLUTION
DE L’ECONOMIE MONDIALE DEPUIS LES ANNEES 1970.
De 1945 aux années 1960, les économies européennes et japonaise se reconstruisent et
découvrent l'abondance. Autour des Etats-Unis s'est édifié un système occidental à la
discipline précise, les accords de Bretton Woods de juillet 1944. Les échanges commerciaux
se multiplient et se libéralisent. Mais, avec les années 1970, quatre chocs se cumulent,
balayant à la fois des règles établies et poussant à la recherche de modes de gestion plus
compréhensifs, plus flexibles. […] En janvier 1976, les accords de Kingston (Jamaique)
officialisent l'abandon des parités fixes pour un système de taux de change flottants. […] Les
chocs pétroliers marquent l'entrée dans le jeu économique mondial d'un nouveau groupe
d'États les pays exportateurs d'hydrocarbures. […] Enrichissement des sociétés occidentales
par les Trente Glorieuses, internationalisation des entreprises, création incessante de
techniques financières de plus en plus sophistiquées, interconnexion des marches, tous ces
facteurs créent un marché mondial des capitaux. Au-delà se dessinent déjà d'autres
marchés mondialisés, comme celui de la main-d'œuvre. […] Enfin, dans les années 1970,
électronique, informatique et télécommunications se diffusent, imposant ou rendant

possibles de nouveaux modes de gestion. L’information devient surabondante, elle
appartient à tous. La maîtriser devient un enjeu politique majeur. […] La création du G6 [le
G7 sans le Canada (1977) et le G8 sans la Russie (1991)] est indissociable de cet
environnement.
Dans les années 1970 et 1980, la vague de fond de la mondialisation se gonfle, elle ne
déferle pas encore. Au lendemain de la mort du Grand Timonier (9 septembre 1976), la
Chine de Deng Xiaoping opte pour les Quatre Modernisations et son économie décolle. […]
Les autres colosses du Sud, notamment l'Inde dans les années 1990, admettent que la
seule modernisation efficace et crédible réside dans la plongée dans la compétition
mondiale. En 1989-1991, la banquise soviétique s'effondre, les démocraties populaires
d'Europe centrale et orientale s'écroulent, l'URSS est liquidée. En un quart de siècle (1975-
2000), de nombreux pays dans le monde, de l'Asie dans son ensemble à l'Amérique du Sud,
basculent dans la mondialisation. Les marchés nationaux s'ouvrent, les investissements
étrangers sont avidement courtisés et se multiplient, la libre circulation des capitaux et le
respect de la propriété privée sont acquis, des pans entiers de secteurs publics sont
privatisés. […] Cet élargissement brutal et spectaculaire du paysage économique
international, devenant mondial, appelle inévitablement une restructuration radicale de la
gouvernance internationale, et plus précisément l'invention d'un G… 20.
Source : Ph. Moreau Defarges : « du G7 au G20 : vers une multipolarité élargie », Questions
internationales n°43, mai-juin 2010. Sommaire du numéro consultable à
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/questions-
internationales/43/sommaire43.shtml
DOCUMENT 2 : LES PAYS DU G8 ET G20 (PIB en dollars et population)
Source : http://www.france.fr/connaitre/monde/diplomatie/dossier-thematique/g8-et-g20-la-
france-au-coeur-des-decisions-pour-un-monde-equilibre

DOCUMENT 3 : DES SOMMETS DU G8 A CEUX DU G20
Note : En plus des Sommets réunissant une fois par an les chefs d’État et de gouvernement, le G7 comprend un ensemble d’interactions entre
représentants des États membres qui implique des représentants personnels (les « sherpas ») des ministres, notamment les ministres des finances
parfois accompagnés des gouverneurs des Banques centrales et qui forment ensemble le « G7 Finances ». Depuis 1999, ce groupe s’est constitué en
« G20 Finances » ouvrant la voie au G20.
Source : travail personnel de l’auteur Mickael SYLVAIN.

DOCUMENT 4 : LE G7 ET LA STABILISATION DE L’ECONOMIE MONDIALE
Le G7 est une coalition informelle d’États, un forum de discussions qui cherche à développer
des visions communes et à construire des consensus sur lévolution de léconomie
mondiale et les orientations à donner à sa gouvernance. Les communiqués et autres
déclarations issus des sommets sont des déclarations de principe, sans aucun engagement
contraignant. Le G7 ne se fixe presque jamais d’objectifs chiffrés.
[Pourtant] Le G7 a joué à plusieurs occasions un rôle important, parfois en intervenant de
manière volontariste dans la gouvernance internationale […] Il a ainsi décidé d’une relance
coordonnée lors du Sommet de Bonn en 1978 pour faire face à la dépression qui s’installait.
La relance budgétaire coordonnée par les économies du G3 (États-Unis, Japon, RFA)
suivant la « théorie de la locomotive » n’a certes pas résisté au second choc pétrolier et à
l’inflation grandissante, mais elle avait bel et bien été amorcée.
Le G7 a ensuite cherché à coordonner les interventions de ses membres pour stabiliser les
changes. L’accord du Plaza (1985) et l’accord du Louvre (1987) ont esquissé le modèle des
« zones cibles » par lequel les autorités monétaires des pays du G3 et les autres s’accordent
sur une bande de fluctuation à lintérieur de laquelle les taux de change peuvent varier. Les
Banques centrales interviennent lorsque les taux de change dépassent les bornes établies
(et tenues secrètes). Ce genre d’expérience a été abandonné au cours des années 1990.
Les États-Unis ont renoué avec la politique de la « douce insouciance » (benign neglect) et
le G7 s’est retranché sur un « consensus de l’inaction » ou « pacte de non-agression ».
L’absence de coordination des politiques économiques ne signifie pas nécessairement que
la discorde règne ou que le G7 serait inefficace. La passivité en la matière peut provenir
d’une relative compatibilité entre les économies ou d’un consensus sur la situation
économique actuelle. À l’heure du consensus néolibéral, le principe premier est que chaque
pays mène, de son côté, une politique macroéconomique saine. Ces résultats en matière de
coordination des politiques économiques n’épuisent pourtant pas le bilan de l’action du G7.
Ils attestent plutôt de son évolution vers d’autres formes d’action sur l’économie. Le G7 a
ainsi initié la création de forums et d’Organisations internationales destinés à améliorer
certains aspects de la gouvernance mondiale. Le sommet de Paris en 1989 a décidé de la
création du Groupe d’action financière (GAFI), dont l’objectif est de lutter contre le
blanchiment des capitaux (et désormais contre le financement du terrorisme). En 1999 le
Forum pour la stabilité financière (FSF) et le Groupe des Vingt (G20) ont été initiés par le
G7/8.
Bien que son efficacité reste sujette à interrogation, le G7 a eu de toute évidence la volonté
et parfois la capacité d’exercer un leadership collectif. »
Note : les participants et les analystes académiques du G7 ne sont pas les seuls à
considérer que le G7 est susceptible de jouer un rôle important. La mobilisation considérable
des altermondialistes, à chaque sommet depuis celui de Gênes en 2001, suggère que les
opposants au G7 considèrent aussi qu’il a un pouvoir important dans la gouvernance de
léconomie mondiale.
Source : Nicolas Simiand, « Le G7 en tant que club hégémonique », in La question politique
en économie internationale, La Découverte, 2006.

DOCUMENT 5 : NAISSANCE DU G20 ET BILAN DES G20.
Le G20 a été créé en 1999, en réponse aux crises financières qui ont touché les pays
émergents pendant les années 1990, notamment la crise asiatique. Les ministres des
finances et les gouverneurs des banques centrales des pays industrialisés et émergents se
sont réunis une fois par an dans ce format. En 2008, face à la crise financière mondiale, le
G20 a été promu en forum de pilotage de l’économie mondiale, désormais au niveau des
chefs d’Etat et de gouvernement. La montée en puissance du G20 va de pair avec une perte
d’importance du G8. Représentant 85% de l’économie mondiale et 66% de la population
mondiale, le G20 reflète mieux les réalités du 21ème siècle.
Bilan de cinq sommets du G20 :
– Coordination des mesures pour limiter les effets de la crise au niveau national (mesures de
soutien aux activités de crédit des banques, injections de liquidités par les banques
centrales, plans de relance, etc.) : l’idée est d’optimiser la réponse politique et d’éviter des
problèmes d’action collective (passagers clandestins). Pourtant, la coopération ne s’est pas
faite sans frictions ou réflexes protectionnistes. Deux exemples sont les querelles sur la
clause « Buy America » du plan de relance américain et les querelles monétaires,
notamment la sous-évaluation du taux de change de la monnaie chinoise.
– Détermination de l’agenda de réforme pour la régulation et la surveillance financières.
– Renforcement des capacités d’aide des institutions financières internationales. Le sommet
de Washington, par exemple, a augmenté les ressources du FMI et des banques de
développement de 850 milliards €.
– Réformes des institutions internationales (FMI, Banque mondiale, CSF*,…) pour accroître
leur efficacité ainsi que leur légitimité, notamment en tenant compte du poids croissant des
pays émergents.
Source : Sebastian Paulo, L’Europe et la crise mondiale expliquée en 10 fiches, Fondation
Robert Schuman, avril 2011.
Note : CSF = Conseil de Stabilité Financière ou FSB, Financial Stability Board en anglais.
DOCUMENT 6 : LES PRIORITES DU G20 EN 2011
Coordonner les politiques économiques et réduire les déséquilibres
macroéconomiques mondiaux
Représentant 85% de l’économie mondiale, le G20 est une enceinte cruciale pour assurer la
coordination des politiques économiques, à court et plus long terme. Au-delà du pilotage
conjoncturel, le G20 a créé un cadre pour une croissance forte, durable et équilibrée, qui
vise à réorienter les stratégies nationales dans un sens plus favorable à l’économie
mondiale. La France poursuivra cet exercice en 2011 en assurant notamment un suivi des
engagements pris lors du sommet de Séoul dans lesquels chaque pays du G20 a accepté de
mettre en œuvre des mesures adaptées à ses circonstances nationales pour réduire les
déséquilibres macroéconomiques et conforter la croissance mondiale.
Renforcer la régulation financière
Il sera impératif pour la France de veiller à la mise en œuvre effective des règles décidées
par le G20 pour renforcer durablement le contrôle du secteur financier. La présidence
française s’emploiera également à renforcer l’action du G20 dans les domaines où les règles
restent insuffisantes, par exemple en matière de régulation du « secteur bancaire fantôme »
(activité bancaire parallèle non régulée à ce jour) et d’intégrité et de transparence des
marchés financiers.
Réformer le Système Monétaire International (SMI)
La période récente a été marquée par une forte volatilité des monnaies, l’accumulation des
déséquilibres, et la recherche d’un niveau toujours plus élevé de réserves de change par les
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%