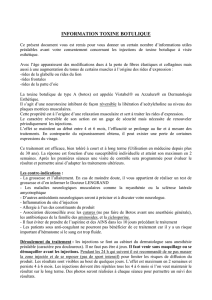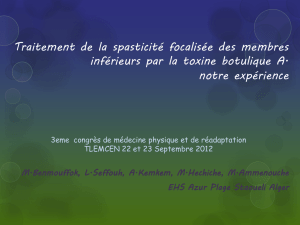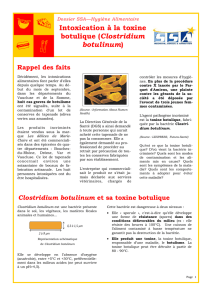Effets fonctionnels de la toxine botulique

20
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
DOSSIER
* Service
demédecine
physique
etderéadaptation,
CHU de Brest.
Effets fonctionnels de la toxine botulique
Is botulinum toxin effective in improving function?
O. Rémy-Néris*
La consommation de toxine botulique est en forte crois-
sance en France. Si les indications récentes comme
l’hyperactivité du détrusor ou l’hyperhidrose ont permis
d’élargir le spectre d’utilisation de ce médicament, les
troubles du tonus restent les indications majoritaires
de ce traitement (64 785actes en2012 en neurologie
pour 4 052 en urologie, selon les statistiques de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation [ATIH]
en2014). Elles nécessitent à ce titre une interrogation
sur les rapports coût-bénéfice-risque. L’effet de la
toxine botulique sur l’hypertonie musculaire est indé-
niable
(encadré)
. De nombreuses études multicentriques
contre placebo ont confi rmé cet effet myorelaxant, tant
au membre supérieur qu’au membre inférieur, princi-
palement après cérébrolésions (hémiplégies adultes,
paralysies cérébrales). Mais l’effet fonctionnel de ce
traitement reste en questionnement. À défaut, la qualité
de vie des patients concernés est-elle améliorée ?
Quel est l’effet sur la marche ?
Très peu d’études randomisées contrôlées contre
placebo ont été réalisées avec la toxine botulique
pour rechercher un effet fonctionnel sur la marche.
En2010, R.Kaji etal.
(1)
montrent qu’après une injec-
tion unique dans le triceps sural de toxine botulique
chez 120patients randomisés en 2groupes (le second
avec placebo) suite à un accident vasculaire cérébral
(AVC), la spasticité est signifi cativement plus dimi-
nuée dans le groupe traité que dans le groupe placebo,
mais qu’il n’existe pas de modifi cation signifi cative de
la marche évaluée par la vitesse de marche et par la
Physician Rating Scale
. Dans une récente revue de
la littérature, R.Teasell et al.
(2)
retrouvent le même
résultat, quel que soit le traitement réalisé dans le
groupe contrôle. Même si d’aucuns ont évoqué un
possible effet –faible mais positif– sur la marche, il
faut bien reconnaître que toutes les études randomi-
sées contrôlées vont dans le même sens chez l’adulte
après AVC, et que cet effet correspond bien à ce qui
est observé en consultation après injection de toxine
botulique dans les membres inférieurs : les patients
nous disent être améliorés, parfois plus stables mais
très peu d’entre eux nous font part d’une amélioration
de leurs capacités de marche en termes d’endurance
ou de vitesse. Seuls les patients ayant une excellente
commande motrice, perturbée par une hypertonie ou
un clonus, modifi ent réellement leurs performances de
marche. Il en est d’ailleurs de même dans les autres
pathologies comme les paralysies cérébrales (PC)
chez l’adulte
[3]
. Même si aucun essai clinique n’a été
réalisé dans d’autres pathologies comme la sclérose
en plaques, il est probable que le même résultat soit
observé pour les mêmes raisons.
Chez l’enfant, il existe une grande inhomogénéité
des populations explorées. La multiplicité des trai-
tements associés et la faiblesse du nombre de sujets
▸
La toxine botulique réduit de façon effi cace l’hyper-
tonie spastique.
▸
L’effet fonctionnel de la toxine botulique est très
probable sur la préhension de l’enfant. La marche
de l’enfant est peu modifi ée par la toxine botulique
seule mais le traitement doit intégrer un programme
de soins plus large, centré sur la réduction de la
spasticité et l’amélioration des capacités motrices.
▸ L’effet fonctionnel chez l’adulte, tant sur la marche
que sur la préhension, n’est pas démontré à ce jour.
▸
Les thérapeutiques chirurgicales n’ont pas forcé-
ment un effet fonctionnel plus important que la
toxine botulique.
▸
L’évaluation de la qualité de la commande motrice
sous-jacente à la spasticité est un critère probable-
ment majeur pour attendre un bénéfi ce fonctionnel
d’une administration de toxine botulique.
▸
Botulinum toxin is effectively reducing spasticity.
▸
The grip of the children is very likely being improved
by botulinum toxin. The gait of the child is only slightly
modifi ed by botulinum toxin injections but this treat-
ment must be incorporated in a broader program of
care focused on reducing spasticity and improving
motor skills.
▸
The functional effects on walking and gripping has
not been demonstrated to date in adults.
▸
Surgical treatment are not necessarily more effective
in producing functional effects than botulinum toxin.
▸
The evaluation of the quality of the underlying motor
control is probably a major criterion to suspect a
functional effect of botulinum toxin injections.
Mots-clés : Spasticité - Marche - Fonction - Toxine
botulique - Préhension
Keywords: Spasticity - Gait - Function - Botulinum toxin -
Grasp
POINTS FORTS
HIGHLIGHTS

21
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
pour chaque étude rend l’évaluation plus complexe. Si
un faible effet sur la marche est reconnu dans la litté-
rature, l’impression générale semble montrer la même
chose que chez l’adulte : l’augmentation de la longueur
du muscle est indéniable au cours du mouvement, mais
l’effet fonctionnel sur la marche reste faible.
Quelles sont les raisons
dufaibleeffet de la toxine
surlaqualité delamarche ?
Si la toxine botulique réduit considérablement la spas-
ticité des muscles, elle ne modifi e pas la qualité de
la marche ; il faut alors conclure soit que l’effet de la
toxine est trop faible pour faire apparaître une diffé-
rence fonctionnelle, soit que la limitation de la marche
résulte d’autres phénomènes que de l’exagération
vitesse dépendante du réfl exe d’étirement. De nom-
breux phénomènes neurophysiologiques coexistent
chez les patients spastiques
(4)
et peuvent contri-
buer à expliquer leur défi cit fonctionnel. Le défaut
de commande motrice reste probablement l’un des
principaux mécanismes de limitation fonctionnelle.
Ce défaut s’exprime essentiellement par une activa-
tion musculaire désordonnée. Celle-ci se manifeste
soit par des défauts d’activation musculaire, soit, au
contraire, par des hyperactivations ou encore par
des co-activations
(5)
. Le rôle de ces co-activations
reste controversé et la part de stabilité qu’elles pro-
curent se partage avec celle de limitation du mouve-
ment. Mais l’une comme l’autre ne participent pas
à la fl uidité du mouvement et sont donc probable-
ment fortement impliquées dans la faible qualité de la
marche. Ce défaut de commande est aussi à l’origine
du défaut d’activation musculaire volontaire et donc
du manque de force au cours des mouvements chez
les sujets ayant une lésion neurologique centrale.
L’une des grandes constantes des études sur le trai-
tement de la spasticité est l’absence de corrélation
entre la réduction de l’intensité de la spasticité des
sujets et leur vitesse de marche, quel que soit le trai-
tement employé. C’est donc probablement ce défaut
de commande motrice qui est à l’origine de l’absence
d’effi cacité fonctionnelle de la toxine botulique sur la
marche dans la plupart des grandes études : la para-
lysie prédomine sur la spasticité dans la limitation
fonctionnelle. Lors d’une analyse clinique précise de
135sujets ayant eu un AVC, la spasticité était jugée
responsable d’une limitation de la marche chez 12 %
seulement des sujets inclus
(6)
.
Il est aussi possible que la toxine provoque une réduc-
tion trop faible de la spasticité pour générer des amé-
liorations fonctionnelles. La neurotomie tibiale a été
proposée comme plus effi cace que la toxine botu-
lique et permettrait d’observer une amélioration plus
importante des paramètres de marche qu’une injec-
tion de toxine botulique dans le triceps sural
(7)
. Les
auteurs proposent que la toxine botulique constitue
un test thérapeutique pour préparer une chirurgie
plus effi cace.
Faut-il limiter le nombre d’injections
de toxine botulique ?
L’existence de solutions thérapeutiques alternatives
plus effi caces sur la spasticité peut inciter les pres-
cripteurs d’injections de toxine botulique à en limiter
l’usage au profi t de ces traitements. Cela suppose
que le patient accepte la chirurgie et que celle-ci soit
réalisable. Mais l’effet fonctionnel supérieur sur la
marche de la neurotomie ne semble pas démontré. La
seule étude randomisée contrôlée
(8)
dans ce domaine
montre que si l’effet antispastique de la neurotomie
tibiale est supérieur à celui de la toxine botulique,
l’effet fonctionnel n’est pas statistiquement signifi -
cativement différent. Même si son effectif est faible
(16sujets), cette étude constitue un argument fi able
pour proposer une alternative à la toxine botulique
lorsque le sujet le souhaite. Pour autant, il ne semble
pas possible d’argu menter cette proposition chirur-
gicale sur un bénéfi ce fonctionnel plus important.
Encadré. Recommandations delaSofmer
(principaux messages)
[d’après l’ANSM. Traitements médicamenteux
de la spasticité. Juin2009].
•
La spasticité a souvent un retentissement péjoratif
sur la motricité et l’appareil locomoteur, mais elle
peut ne pas être gênante ou même être utile. Tout
malade spastique ne nécessite pas systématique-
ment de traitement.
•
La spasticité doit être analysée en tant que symp-
tôme par une démarche identique, quelle que soit
son étiologie.
•
Le contexte, notamment imprimé par l’étiologie,
doit ensuite être pris en compte dans la stratégie
globale de traitement.
•
Le traitement de la spasticité ne doit être mis en
œuvre qu’après une analyse clinique rigoureuse,
afin d’en déterminer l’importance, les consé-
quences réelles et la répartition. Cela suppose une
bonne connaissance et une rigueur dans l’examen.
•
Il faut procéder pour chaque patient à l’établisse-
ment d’une liste d’objectifs personnalisés.
•
Le traitement nécessite d’abord la recherche d’une
éventuelle cause aggravante, stimulus nociceptif
(escarre, infection/lithiase urinaire,etc.), avec
laquelle il y a parfois une étroite intrication.
•
La réfl exion thérapeutique englobe les traitements
médicamenteux ici présentés, mais aussi la kinési-
thérapie, l’appareillage, l’auto-rééducation et la
chirurgie.
•
Les traitements médicamenteux comportent les
traitements per os (baclofène et tizanidine), la
toxine botulique, le baclofène intrathécal et l’appli-
cation locale d’alcool ou de phénol. Les traitements
de première intention (traitements per os et toxine
botulique) s’envisagent selon le caractère localisé
ou diffus de la spasticité et selon l’étiologie.

22
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
DOSSIER
Lerapport bénéfi ce/risque n’a pas non plus été étudié
précisément, tant pour la toxine botulique que pour les
solutions thérapeutiques alternatives. Aucune d’entre
elles n’est en effet dénuée de risques, et il convient
de rester prudent tant sur l’amélioration fonctionnelle
que peut attendre le patient du traitement réalisé que
sur les bénéfi ces comparatifs d’une technique plutôt
qu’une autre.
Mais limiter l’effet de la toxine dans les membres infé-
rieurs à son effet fonctionnel est très insuffi sant. La
prévention des complications orthopédiques, l’amélio-
ration du confort de marche, la réduction de la douleur,
l’amélioration de l’équilibre et, en particulier, la préven-
tion des chutes, sont autant d’éléments qui, rarement
évalués comme critère principal d’une étude, peuvent
faire l’objet d’un intérêt thérapeutique
(7)
. Très large-
ment employée au membre supérieur, on ne retrouve
pratiquement aucune étude utilisant la
Goal Attain-
ment Scaling
pour défi nir le bénéfi ce des injections
de toxine botulique dans les membres inférieurs
(9)
.
Il est pourtant certain que nos patients retirent un
bénéfi ce des injections de toxine dans les membres
inférieurs. Une meilleure description de ces bénéfi ces
serait opportune, afi n de mieux informer les patients
et les professionnels des réelles améliorations qu’ils
peuvent attendre de ce traitement lorsque celui-ci est
appliqué aux membres inférieurs.
Quel est l’effet de la toxine botulique
surlapréhension ?
Après un accident vasculaire cérébral
Si l’effet fonctionnel sur le membre inférieur reste
discuté, la récente méta-analyse chez les patients
hémiplégiques après AVC
(10)
montre que l’effet sur
l’activité des patients après une injection de toxine botu-
lique au membre supérieur est inconstamment positif.
Elle montre qu’un nombre non négligeable parmi les
1 000patients étudiés voit leur état s’aggraver sur le
plan fonctionnel après une injection de toxine botulique.
Globalement, l’effet sur cette très grosse cohorte est
faiblement positif en termes de restrictions d’activité.
Elle invite donc à rester très prudent sur le bénéfi ce
fonctionnel potentiel des injections de toxine botulique
au membre supérieur chez l’adulte.
La très grande majorité des demandes d’injections
dans cette localisation se fait d’ailleurs principalement
pour une prévention des complications neuro-ortho-
pédiques et non en vue d’un bénéfi ce fonctionnel direct.
Pour nombre de patients ayant un membre supérieur
partiellement fonctionnel, les injections de toxine botu-
lique permettent de petites améliorations ciblées (par
exemple, une meilleure ouverture du pouce) qui leur
seront utiles mais ne changeront pas le score fonc-
tionnel, tant global que spécifi que.
L’une des diffi cultés de l’analyse de bénéfi ces fonc-
tionnels vient de l’utilisation fréquente comme critère
principal de scores non spécifi ques tels le
Disability
Assessment Scale,
ou de scores fonctionnels globaux
comme l’index de Barthel. Peu d’études randomi-
sées contrôlées ont employé un score spécifi que du
membre supérieur comme le
Action Research Arm test
(ARAt)
[11]
. Il est alors possible de défi nir précisément
l’effet fonctionnel de la toxine botulique sur le bras et
la préhension. Il semble d’ailleurs que les groupes
les plus améliorés sont ceux qui ne reçoivent pas les
doses les plus fortes, soit parce que de plus petites
doses ciblées permettent de mieux libérer la motricité
volontaire sous-jacente, soit parce que l’ importance
des doses injectées a un effet négatif direct sur la per-
formance motrice du membre injecté. Mais l’analyse
de la littérature montre surtout la très grande varia-
bilité des évaluations fonctionnelles, des doses admi-
nistrées et des populations (âge moyen, délais depuis
l’AVC). Ainsi certaines recommandations européennes
émettent un niveau A de recommandation pour l’effet
de réduction de la déformation, l’amélioration de la
toilette et de l’habillage du membre supérieur mais
une recommandation de niveauC quant à l’effet fonc-
tionnel
(12)
.
Après une paralysie cérébrale
Chez l’adulte avec paralysie cérébrale (PC), la situa-
tion n’est probablement pas fondamentalement diffé-
rente de celle des AVC. Dans la population de sujets
avec PC, il est en revanche beaucoup plus fréquent
d’observer des déformations majeures chez les sujets
très spastiques, très souvent irréductibles en raison de
troubles orthopédiques associés. Très peu d’études ont
été strictement limitées aux personnes adultes avec
PC, et l’effet fonctionnel est au moins aussi incertain
qu’après AVC.
Chez l’enfant, le recours à la toxine botulique se conçoit
dans un programme thérapeutique complexe où la
prévention des troubles neuro-orthopédiques joue
un rôle majeur. Il semble ainsi peu envisageable de
limiter le traitement aux injections de toxine botulique,
tant au niveau du membre supérieur qu’au niveau du
membre inférieur. Certaines recommandations inter-
nationales
(13)
sont très claires à ce sujet et en accord
avec la revue de la littérature de B.J.Hoare
(14)
. Un
niveauA y est attribué pour la prévention des défor-
mations neuro-orthopédiques, et un niveauB pour
l’amélioration fonctionnelle. Cette recommandation
semble confi rmée par la plus récente des études ran-
domisées contrôlées contre placebo
(15)
, pour laquelle
l’effet fonctionnel évalué dans la population d’enfants
porteurs de PC a été réalisé, avec l’échelle fonction-
nelle unilatérale du membre supérieur de Melbourne
comme critère principal. L’augmentation du score fonc-
tionnel était signifi cativement plus importante parmi
les enfants ayant reçu de la toxine botulique que parmi
ceux ayant reçu du placebo et, quel que soit le niveau
fonctionnel, l’amélioration du score de Melbourne était
signifi cativement plus important dans le groupe traité
par toxine botulique que dans le groupe placebo. Il
semble donc que l’effet fonctionnel de ce traitement soit
plus assuré lorsque celui-ci est appliqué au membre
supérieur de l’enfant avec PC que dans les indications
chez l’adulte, quelle qu’en soit l’étiologie.

23
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
Conclusion
En dehors du membre supérieur chez l’enfant avec
PC, il semble que la toxine botulique n’ait pas, à ce
jour, prouvé son effi cacité fonctionnelle chez l’adulte
après lésion cérébrale, tant au membre inférieur qu’au
membre supérieur. Il n’existe pas de donnée dans la
littérature sur l’effi cacité de ce traitement après lésion
médullaire. Toutefois, plusieurs facteurs doivent per-
mettre d’améliorer la connaissance quant aux effets
réels de la toxine botulique sur la fonction. L’emploi
de scores fonctionnels spécifi ques du membre supé-
rieur comme critère principal d’études contrôlées est
encore trop rare. Le développement de nouveaux outils
de mesure de la fonction du membre supérieur chez
l’adulte, comme cela a pu être le cas chez l’enfant
(échelle de Melbourne et
Assisting Hand Assessment
),
est probablement crucial pour mesurer les effets réels
de la toxine botulique. Enfin, l’usage au quotidien
d’outils comme la
Goal Attainment Scale
devrait per-
mettre de mieux cibler les attentes et les possibilités
d’amélioration des patients auxquels des injections de
toxine botulique dans les membres sont pro posées.
Cet outil permet de cibler les objectifs que souhaite
atteindre le patient, parmi lesquels l’amélioration fonc-
tionnelle ne peut être systématiquement incluse.
Références bibliographiques
1.
Kaji R, Osako Y, Suyama K et al. Botulinum toxin type A in post-stroke lower limb spasticity:a multicenter, double-blind, placebo-controlled trial.
JNeurol 2010;257(8):1330-7.
2.
Teasell R, Foley N, Pereira S, Sequeira K, Miller T. Evidence to practice: botulinum toxin in the treatment of spasticity post stroke. Top Stroke
Rehabil 2012;19(2):115-21.
3.
Maanum G, Jahnsen R, Stanghelle JK, Sandvik L, Keller A. Effects of Botulinum toxin A in ambulant adults with spastic cerebral palsy: a rando-
mized double-blind placebo controlled-trial. J Rehabil Med 2011;43(4):338-47.
4.
Burke D, Wissel J, Donnan GA. Pathophysiology of spasticity in stroke. Neurology 2013;80(3Suppl2):S20-6.
5.
Gross R, Leboeuf F, Hardouin JB et al. The infl uence of gait speed on co-activation in unilateral spastic cerebral palsy children. Clin Biomech
2013;28(3):312-7.
6.
Yelnik A, Albert T, Bonan I, Laffont I. A clinical guide to assess the role of lower limb extensor overactivity in hemiplegic gait disorders. Stroke
1999;30(3):580-5.
7.
Rousseaux M, Compère S, Launay MJ, Kozlowski O. Variability and predictability of functional effi cacy of botulinum toxin injection in leg spastic
muscles. J Neurol Sci 2005;15;232(1-2):51-7.
8.
Bollens B, Gustin T, Stoquart G, Detrembleur C, Lejeune T, Deltombe T. A randomized controlled trial of selective neurotomy versus botulinum
toxin for spastic equinovarus foot after stroke. Neurorehabil Neural Repair 2013;27(8):695-703.
9.
Molenaers G, Fagard K, Van Campenhout A, Desloovere K. Botulinum toxin A treatment of the lower extremities in children with cerebral palsy.
JChild Orthop 2013;7(5):383-38.
10.
Foley N, Pereira S, Salter K et al. Treatment with botulinum toxin improves upper-extremity function post stroke: a systematic review and meta-
analysis. Arch Phys Med Rehabil 2013;94(5):977-89.
11.
Suputtitada A, Suwanwela NC. The lowest effective dose of botulinum A toxin in adult patients with upper limb spasticity. Disabil Rehabil
2005;27(4):176-84.
12.
Sheean G, Lannin NA, Turner-Stokes L, Rawicki B, Snow BJ ; Cerebral Palsy Institute. Botulinum toxin assessment, intervention and after-care
for upper limb hypertonicity in adults: international consensus statement. Eur J Neurol 2010;17(Suppl 2):74-93.
13.
Fehlings D, Novak I, Berweck S et al. Botulinum toxin assessment, intervention and follow-up for paediatric upper limb hypertonicity: inter-
national consensus statement. Eur J Neurol 2010;17(Suppl 2):38-56.
14.
Hoare BJ, Wallen MA, Imms C, Villanueva E, Rawicki HB, Carey L. Botulinum toxin A as an adjunct to treatment in the management of the upper
limb in children with spastic cerebral palsy (update). Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD003469.
15.
Koman LA, Smith BP, Williams R et al. Upper extremity spasticity in children with cerebral palsy: a randomized, double-blind, placebo-controlled
study of the short-term outcomes of treatment with botulinum A toxin. J Hand Surg Am 2013;38(3):435-46.
1
/
4
100%
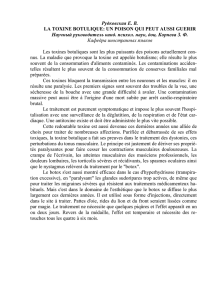
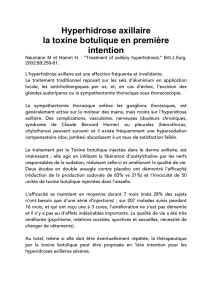
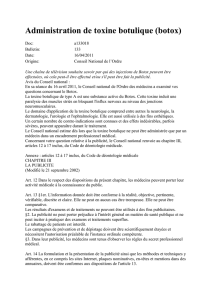
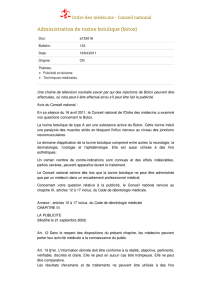
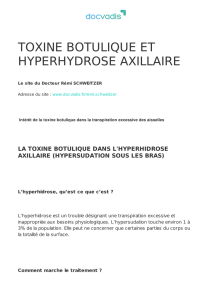
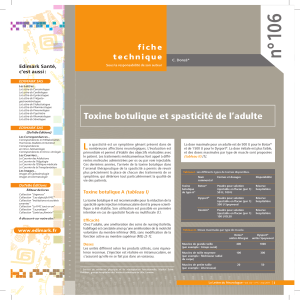

![I] En quoi la toxine botulique est-elle nuisible](http://s1.studylibfr.com/store/data/001631179_1-1c3d501992bf2c546eb864c01681654b-300x300.png)