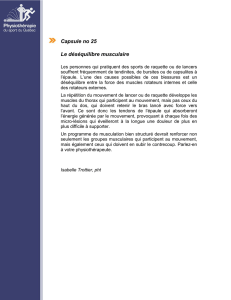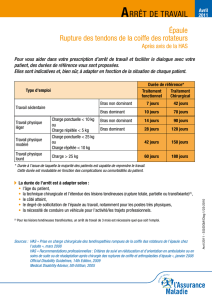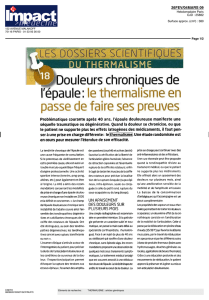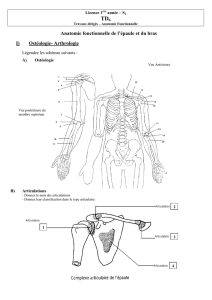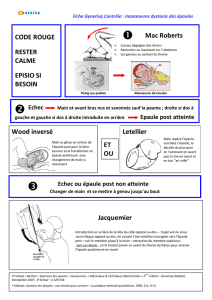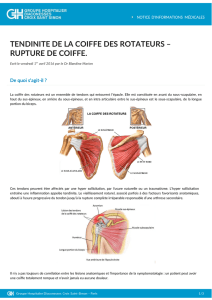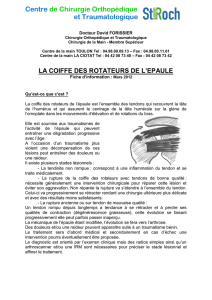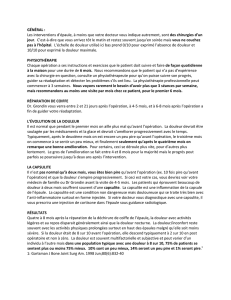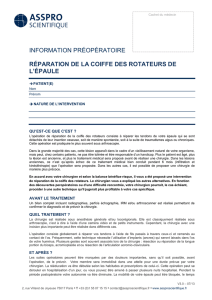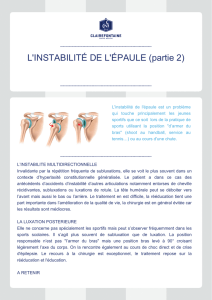Epauledouloureuse : prise en charge ambulatoire

T. Kermode
O. Pasche
J. Cornuz
P. Zufferey
introduction1
L’épaule douloureuse est une plainte fréquente. En médecine
générale, elle représente 5% des motifs de consultation. Sur le
plan médical, on parle alors de scapulalgies ou omalgies.
Dans 60% des cas, ces omalgies sont secondaires à des lésions
de la coiffe des rotateurs. Pour la majorité d’entre elles, il s’agit
d’une atteinte dégénérative souvent liée à l’âge.
Seules 50% des pathologies de l’épaule nouvellement diagnostiquées sont réso-
lues à six mois. Cette tendance à la chronicité entraîne des conséquences à long
terme : absentéisme et coûts médicaux élevés.
Plusieurs facteurs de risque de chronicité sont à rechercher car ils jouent un
rôle déterminant dans la prise en charge et le pronostic. Sur le plan physique, ces
facteurs sont le port de charges lourdes, les mouvements répétitifs, la conduite
automobile prolongée, les troubles du sommeil, le tabagisme et la consomma-
tion de caféine. Les facteurs psychosociaux sont l’insatisfaction au travail, le statut
d’immigré et la détresse psychosociale.
L’épaule présente une structure anatomique complexe avec de multiples couples
musculaires, des tendons, des bourses, l’articulation gléno-humérale elle-même
renforcée d’une capsule de ligaments et d’un labrum. Toutes ces structures sont
susceptibles d’être lésées et dès lors responsables d’algies et d’entraves au fonc-
tionnement. Les figures 1 et 2 résument les éléments anatomiques constitutifs de
l’épaule. La fonction des muscles est la suivante : 1) muscle sus-épineux – début
de l’abduction (jusqu’à 30°) ; 2) muscle sous-épineux – rotation externe ; 3) muscle
sous-scapulaire – rotation interne et adduction ; 4) muscle petit rond
(teres minor)
–
rotation externe ; 5) muscle biceps, long chef – abduction, antépulsion et 6) muscle
biceps, court chef – adduction, antépulsion.
classification des pathologies de l’épaule1-3
On peut classer les douleurs de l’épaule de différentes manières. Nous propo-
sons trois catégories (tableau 1) : 1) une origine post-traumatique ; 2) des causes
intrinsèques consécutives aux lésions des structures anatomiques décrites ci-
Shoulder pain in ambulatory practice
Scapulalgias or omalgias are a frequent com-
plaint, with more than half of them being linked
to an injury of the rotators cuff. As they often
become chronic, omalgias result in higher rates
of absenteeism and significant health care
costs.
Scapulalgias have three main causes : post-
traumatic, intrinsic of the joint, or extrinsic. The
extrinsic omalgias, either of neurologic, cardio-
vascular, pulmonary, or abdominal etiology,
require swift identification, as their treatment
is often an emergency.
Most of the scapulalgias can be treated con-
servatively. Main factors of poor prognosis are
old age, women gender and associated cervi-
calgias.
Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 2205-11
Les scapulalgies ou omalgies sont une plainte fréquente, dont
plus de la moitié sont liées à une lésion de la coiffe des rota-
teurs. Etant donné la tendance à la chronicité de ces douleurs,
elles entraînent un absentéisme et des coûts de la santé élevés.
Parmi les pathologies à l’origine des omalgies, certaines sont
post-traumatiques, d’autres intrinsèques à l’épaule, d’autres,
enfin, extrinsèques. Ce sont ces dernières, relevant des systè-
mes neurologique, cardiovasculaire, pulmonaire ou encore
abdominal, qu’il convient d’identifier rapidement car leur prise
en charge représente souvent une urgence.
Une grande partie des douleurs d’épaule intrinsèques répon-
dent à un traitement conservateur. Les principaux facteurs de
mauvais pronostic sont liés à l’âge, au sexe féminin et à des
cervicalgies associées.
Epaule douloureuse : prise en charge
ambulatoire
pratique
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013 2205
05_11_37564.indd 1 21.11.13 09:06

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013 0
dessus et 3) des causes extrinsèques dont l’origine se situe
à distance.
Le terme de
périarthrite scapulo-humérale
(PSH) est non
spécifique. Il désigne plusieurs affections de l’épaule, dont
les tendinopathies de la coiffe des rotateurs et la capsulite
rétractile. Aussi, ce terme de PSH ne devrait-il pas être em-
ployé sans préciser quelles sont les structures morphologi-
ques concernées.
démarche diagnostique 2-5
Eléments anamnestiques
En présence d’une symptomatologie douloureuse d’épau-
le, certains points spécifiques de la démarche diagnostique
sont particulièrement importants.
Tout d’abord, les drapeaux rouges doivent être passés
en revue chez tout patient à la recherche de critères d’ur-
2206 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013
Figure 2. Vue postérieure de l’épaule
•
•
•
•
•
•
Articulation acromio-claviculaire
Muscle sus-épineux
Humérus
Muscle sous-épineux
Muscle petit rond
Jonction scapulo-thoracique
Acromion
Bourse sous-acromiale
Apophyse coracoïde
Muscle sous-scapulaire
Long chef du biceps
Figure 1. Vue antérieure de l’épaule
N.B. La bourse sous-acromiale est très riche en récepteurs de la douleur.
Muscle sus-épineux Clavicule
Omoplate
•
•
••
•
•
•
•
Tableau 1. Classification des pathologies pouvant générer des douleurs d’épaule
Omalgies post-traumatiques
On trouve communément :
• une entorse ou une luxation acromio-claviculaire de degrés 1 à 3
• une luxation gléno-humérale
• des fractures de l’humérus proximal, de la clavicule, de l’omoplate
• une rupture de la coiffe des rotateurs (tendon du muscle sus-
épineux, le plus souvent)
Omalgies intrinsèques : originaires de l’épaule
• Pathologies de la coiffe des rotateurs : tendinopathie simple ou
calcifiante, conflit sous-acromial, bursite sous-acromiale, rupture
partielle ou totale.
Plus fréquentes chez les patients d’âge moyen (35-75 ans), les
pathologies de la coiffe, en particulier du tendon sus-épineux,
résultent d’une activité répétitive, en général à hauteur ou
au-dessus de l’épaule. Technique sportive inadéquate, manque
d’entraînement, défaut postural sont autant de facteurs facilitant
la progression de l’inflammation aiguë à la calcification, l’amincisse-
ment dégénératif et enfin la rupture tendineuse.
N. B. Les ruptures dégénératives de la coiffe des rotateurs sont
souvent asymptomatiques et bilatérales.
• Pathologies gléno-humérales : omarthrose (L 60 ans), très rare,
conséquence d’un traumatisme ou d’une polyarthrite rhumatoïde.
La capsulite rétractile, également appelée épaule gelée, est un enrai-
dissement de l’articulation gléno-humérale qui est le plus souvent
réversible et touche la tranche d’âge des 40-65 ans. Toute douleur
d’épaule ou condition (gilet, pathologie pulmonaire chronique,
Parkinson…) entraînant son immobilisation peut provoquer une
capsulite rétractile. La cause la plus commune est la tendinopathie
de la coiffe. Le diabète sucré est aussi un facteur de risque décrit.
• L’épaule instable (hyperlaxe ou en subluxation) touche plutôt les
jeunes femmes avec une musculature peu développée, les patients
victimes de rupture de la coiffe des rotateurs et les athlètes
l 40 ans, en particulier les nageurs et lanceurs.
• Pathologies acromio-claviculaires : luxation sur traumatismes anciens
ou chroniques, arthrose, poussées de chondrocalcinose.
• Pathologies du biceps : tendinite (sujet jeune) ou rupture (typique-
ment chez le sujet âgé) du long chef du tendon du biceps au niveau
de son passage dans le sillon bicipital de l’humérus. Le soulèvement
répétitif de charges entraîne une inflammation, des micro-
déchirures et, sans traitement, des lésions dégénératives. A ce
stade, porter subitement une charge lourde peut provoquer la
rupture spontanée du tendon, accompagnée de vives douleurs.
N. B. La faiblesse musculaire est ici attribuée à la douleur de la
tendinite, la rupture du tendon du long chef du biceps est rarement
associée à une faiblesse importante. En effet, la force de flexion
du coude est assurée à 80-85% par les muscles court chef du
biceps et brachio-radial.
Omalgies extrinsèques : douleurs référées ou provoquées par
une pathologie extérieure à l’épaule. Typiquement, le patient a de la
peine à les localiser et décrit une douleur vague ou irradiante.
N. B. Une douleur localisée uniquement en regard du trapèze ou de
l’omoplate n’est qu’exceptionnellement en relation avec une atteinte
gléno-humérale ou de la coiffe des rotateurs.
Causes d’omalgies extrinsèques en fonction de leur origine :
• neurologique : radiculopathie cervicale (C4, C5, C6), par exemple,
hernie discale, lésions du canal rachidien, compression du nerf sus-
épineux, lésions du plexus brachial, zona, névralgie amyotrophiante
de l’épaule (syndrome de Parsonage-Turner).
• cardiovasculaire : infarctus du myocarde, thrombose de la veine
axillaire, syndrome du défilé thoracique, anévrisme aortique.
• pulmonaire : pneumonie lobaire supérieure, épanchement pleural,
tumeur apicale, embolie pulmonaire.
• abdominale : pathologie hépatobiliaire (par exemple, abcès hépa-
tique, cholécystite), affection ovarienne, pyélonéphrite, irritation du
diaphragme (par exemple, lésion de la rate, rupture de grossesse
ectopique, perforation d’ulcère gastrique).
• autres : polymyalgia rheumatica, métastases.
05_11_37564.indd 2 21.11.13 09:06

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013 2207
gence et de situations à risque (tableau 2). Le tableau 3
présente les situations pathologiques à suspecter, en pré-
sence de tel ou tel drapeau rouge.
S’il y a eu
traumatisme
, il est utile d’en spécifier le méca-
nisme. Il s’agit le plus souvent de traumatismes contondants,
comme une chute avec réception sur l’épaule (luxation acro-
mio-claviculaire, fracture de clavicule) ou une chute sur le
bras en extension (fracture de l’humérus proximal). La luxa-
tion gléno-humérale peut être provoquée par des contrac-
tions musculaires violentes, comme celles générées lors
d’une crise épileptique (grand mal) ou d’une électrocution.
En ce qui concerne
la douleur
, il importe de distinguer le ca-
ractère mécanique (à l’effort) ou inflammatoire (nocturne, au
repos), l’irradiation (par exemple, les dermatomes C4 et C5
recouvrent largement l’épaule, C6 le pouce, C7 l’index et le
majeur et C8 l’auriculaire), et la localisation précise si pos-
sible. Une topographie
postérieure en regard de l’omoplate
est
rarement en relation avec une pathologie de la coiffe des
rotateurs ou une arthropathie de l’épaule, mais souvent la
manifestation d’une atteinte viscérale ou, le plus souvent,
d’une atteinte cervicale. Les mouvements et activités qui
exacerbent la douleur sont aussi à rechercher. Dans ce cadre,
il convient de préciser le type de travail, les loisirs et les
sports pratiqués en mettant l’accent sur d’éventuels chan-
gements de charge soulevée et d’équipements utilisés. Cer-
tains symptômes associés sont d’importants indices, comme
une faiblesse ou une raideur
, l’atteinte ou non du côté domi-
nant. Il ne faut pas non plus négliger l’
anamnèse systématique
,
afin de ne pas manquer une douleur référée (tableaux 1 et 3).
On recherchera des symptômes cardio-pulmonaires, digestifs
et neurologiques en particulier, ainsi que des symptômes
généraux (fatigue, etc.) et ostéo-articulaires associés (par
exemple, cervicaux ou du membre supérieur ipsilatéral :
coude, poignet, doigts). Certaines
comorbidités
, comme le dia-
bète, l’hypothyroïdie (tous deux augmentant le risque de
capsulite rétractile) ou une néoplasie sont un contexte par-
ticulier qui implique la considération de pathologies spéci-
fiques. Enfin, les
antécédents
, comme un traumatisme ancien
et les traitements, une éventuelle chirurgie à ce niveau, sont
importants à noter.
Examen clinique
L’
examen clinique de l’épaule doit comporter
une inspection
soigneuse torse nu, en portant une attention particulière sur
les techniques d’habillage et de déshabillage. Il est utile de
noter la
trophicité du deltoïde
; bien développé, ce muscle
permet souvent de compenser, voire de masquer les lésions
sous-jacentes de la coiffe des rotateurs. La
mobilité passive
,
puis la
mobilité active
en position assise, en comparant les
deux épaules. La force sera mesurée dans les différents
plans. Pour vérifier la fonction spécifique de chaque muscle
ou en définir l’atteinte, on peut utiliser des
tests musculaires
spécifiques (figure 3 et tableau 4).
Leur interprétation doit de-
meurer prudente
, en raison de leur faible sensibilité (beaucoup
de faux négatifs) pour la détection d’une atteinte de la coiffe
des rotateurs, pour laquelle peu d’entre eux sont donc
réellement diagnostiques. Leur utilité peut être améliorée
par la combinaison de tests. En fonction des drapeaux rouges
présents et
surtout si la douleur n’est pas reproduite au status de
l’épaule
, l’examen d’autres organes, en particulier cardio-pul-
monaire et digestif, est capital.
Examens complémentaires
Les examens complémentaires ne sont pas toujours in-
dispensables et leur indication dépend du contexte. La
majorité des pathologies articulaires de l’épaule peuvent
être traitées de manière conservatrice,
sans avoir recours à
0 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013
Tableau 2. Drapeaux rouges1-3
Critères d’urgence
• Apparition brutale de la douleur
• Douleur non liée à la mobilisation cervicale ou du membre supérieur
(poignet, coude, épaule) et de localisation vague
• Etat fébrile
• Frissons
• Symptômes associés :
– généraux : fatigue, perte pondérale
– cardiovasculaires
– pulmonaires
– digestifs
R leur présence implique des investigations dont le type et le
degré dépendent du contexte clinique
Situations à risque
• Traumatisme
• Déficit neurologique
R dans ces situations, une prise en charge spécialisée est
nécessaire
Critères d’urgence Suspicion diagnostique
et situations à risque
Etat fébrile, frissons, rougeur locale Arthrite septique (rare au niveau
de l’épaule : l 0,01%)
Apparition brutale de la douleur Urgence cardiovasculaire ou
viscérale, par exemple, infarctus
du myocarde, rupture d’anévrisme
aortique, ulcère gastroduodénal
perforé
Symptômes B (perte pondérale, Tumeur : 7% des métastases
sudations nocturnes, fatigue), osseuses situées au niveau de
contexte de néoplasie connue l’humérus proximal
Douleurs de type inflammatoire, Arthropathie inflammatoire :
bilatérales ou diffuses, symptômes polyarthrite rhumatoïde (PR),
généraux : baisse d’état général, goutte, arthrite psoriasique
fatigue N. B. si L 60 ans : penser à
la polymyalgia rheumatica
Symptômes associés : par exemple, Douleur viscérale : par exemple,
douleur thoracique ou rétro- pneumonie, syndrome coronarien
sternale (DRS), douleur respiro- aigu, anévrisme aortique, ulcère
dépendante, dyspnée, toux, gastroduodénal perforé
hémoptysie, douleur abdominale, N. B. Toute irritation de la plèvre
trouble du transit médiastinale, du péricarde ou du
Douleur non reproductible à la diaphragme peut provoquer des
mobilisation cervicale ou du douleurs d’épaule !
membre supérieur
Douleur cervicale, contexte de Pathologie discale, musculo-
pathologie connue de la colonne vertébrale (surtout C4-5-6)
vertébrale
Notion de traumatisme (même Fracture-luxation
ancien !), de crise d’épilepsie/
électrocution
N. B. patient ostéoporotique à risque
Déficit sensitivomoteur nouveau Lésion neurologique
Tableau 3. Suspicion diagnostique en fonction des
drapeaux rouges
05_11_37564.indd 3 21.11.13 09:06

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013 0
une quelconque imagerie
. Une imagerie n’est nécessaire que si
le diagnostic est incertain ou que la pathologie est intriquée
ainsi qu’en présence de douleurs de l’épaule dans un con-
texte traumatique.
L’
ultrasonographie
(US) permet une très bonne visualisation
des calcifications et des pathologies de la coiffe, par contre
elle a une mauvaise résolution intra-osseuse, puisqu’elle ne
permet de visualiser que la surface corticale. Elle représente
un net avantage en termes de confort pour le patient et de
coût (CHF 100-200.–).
L’
IRM
apporte une très bonne visualisation intra-osseuse
et des pathologies de la coiffe,
Sauf
pour les calcifications,
pour lesquelles l’US reste l’examen de choix. Son prix se
monte à CHF 600-900.–. Trop demandée d’emblée, l’IRM
devrait être réservée aux situations où l’US n’apporte pas
la solution ou lorsqu’une intervention chirurgicale s’avère
indispensable. Dans ce cas, en particulier en présence de
ruptures tendineuses non chroniques pouvant impliquer une
indication chirurgicale, c’est l’
arthro-IRM
qui est l’examen de
choix. Elle permet d’évaluer non seulement l’étendue de la
rupture, mais aussi la rétraction et l’atrophie tendineuses et
l’éventuelle dégénérescence graisseuse des muscles contre-
indiquant une réparation chirurgicale.
La
radiologie standard
(RX) quant à elle reste utile sans
accès à l’US et si l’on recherche une pathologie osseuse : frac-
ture, tumeur, etc.
Les autres examens complémentaires,
comme l’ECG, l’imagerie
thoracique et abdominale, les analyses sanguines sont à
discuter en fonction du contexte et en particulier en pré-
sence de drapeaux rouges.
L’algorithme (figure 4) propose une séquence dans la
démarche diagnostique d’une épaule douloureuse dans le
but de ne pas manquer une étiologie atypique.
prise en charge et traitement 3,6
Le traitement des douleurs d’épaule post-traumatiques
et extrinsèques ne fait pas l’objet de cet article. Pour les
omalgies intrinsèques, en-dehors de la rupture aiguë de la
coiffe des rotateurs, les recommandations de consensus pro-
posent
en première intention un traitement conservateur
. L’objectif
de la
physiothérapie
est le maintien de la mobilité de l’épaule.
Celle-ci est controversée dans le traitement de l’épaule
gelée, en particulier au stade initial qui comprend des dou-
leurs inflammatoires. Lors de la phase 2, si elle provoque
des douleurs, elle est alors contre-productive et risque
d’ag graver la rétraction capsulaire.
L’antalgie médicamenteuse,
notam ment par AINS
systémiques, est généralement recom-
mandée : par exemple, ibuprofène ou diclofénac. Les for-
mes «retard» sont particulièrement utiles pour soulager les
douleurs noc turnes. En cas d’«épaule gelée» ou capsulite
rétractile, certaines études anciennes ont suggéré que la
cal-
citonine
sous forme de spray nasal pouvait être utile asso-
ciée aux AINS.
Les infiltrations locales de corticostéroïdes
peuvent
être utiles dans les situations de crises douloureuses, en
par ticulier en cas de tendinite calcifiante du sus-épineux et
d’arthrose acromio-claviculaire. Les études sont cependant
contradictoires sur leur effet bénéfique à moyen et à long
termes par apport aux autres modalités de prise en charge
conservatrice. De même, la supériorité d’infiltrations faites
sous écho-guidage reste débattue. Finalement, les infiltra-
tions de corticostéroïdes sont partiellement contre-indi-
quées en cas de rupture tendineuse, soit parce qu’en sup-
primant les douleurs, elles favorisent le passage d’une rup-
ture partielle à une rupture complète, soit parce qu’il semble
qu’elles puissent compromettre la réparation tendineuse.
La place de la
chirurgie
reste à préciser, en-dehors de la
rupture traumatique aiguë de la coiffe des rotateurs. De
rares cas méritent une prise en charge chirurgicale relative-
ment précoce, de l’ordre de quelques mois.
Après échec d’un traitement conservateur,
il est habituelle-
ment proposé de traiter les conflits sous-acromiaux et les
pathologies de la coiffe des rotateurs sans rupture par une
acromioplastie. Mais plusieurs études concluent à l’absence
de supériorité de la chirurgie par rapport à la poursuite du
traitement conservateur.
2208 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
27 novembre 2013
Figure 3. Exécution des tests de mouvements de
l’épaule
Test de Neer Test de Jobe ou «empty can»
Test de Patte (2)
N. B. Le test de Patte (1) s’effectue
de la même manière, mais coude collé
au corps
Test «palm up»
Test «belly press» ou de
Napoléon
Test «lift off» ou de Gerber
Tests Mouvements Muscle/tendon
Neer Elévation (passive) Conflit sous-acromial
Jobe * (Empty can) Abduction Sus-épineux
Palm up * Elévation (active) Long biceps
Patte (1) * Rotation externe Sous-épineux
Patte (2) * Rotation externe Sous-épineux,
petit rond
Belly press (Napoléon) * et Rotation interne Sous-scapulaire
Lift off (Gerber) *
Tableau 4. Quel test pour quel muscle ?
* Tests mettant à l’épreuve les muscles de la coiffe des rotateurs.
05_11_37564.indd 4 21.11.13 09:06

L’équilibre retrouvé.
La synergie ecace contre les vertiges
Cinnarizine, Diménhydrinate
Admis aux caisses-maladie*
10% quote-part
L’unique avec double principe actif (système vestibulaire périphérique et central)
Ecace en cas de vertiges vestibulaires aigus (centraux, périphériques ou combinés)1,2
Réduction significative des symptômes déjà après la 1ère semaine3,4
Arlevert® C : cinnarizine 20 mg, diménhydrinate 40 mg. I : traitement symptomatique des états vertigineux passagers. D : adultes : 1 comprimé 3x/jour ; durée du traitement max. 4 semaines ; enfants et adolescents de
moins de 18 ans : déconseillé. CI : insufsance rénale (clairance de la créatinine ≤ 25 ml/min), insufsance hépatique grave, porphyrie, hypersensibilité aux principes actifs, glaucome à angle fermé, crises convulsives,
suspicion de pression intracrânienne élevée, abus d’alcool, rétention urinaire, administration concomitante d’antibiotiques aminoglycosides, patients ayant des antécédents de symptômes extrapyramidaux, parkinsoni-
sme, dépression, troubles cardiaques, administration de médicaments associés à un allongement de l’intervalle QT, grossesse et allaitement. PR : prendre après les repas ; prudence en cas de hypo- ou hypertension
artérielle, pression intraoculaire élevée, sténose pyloroduodénale, hypertrophie de la prostate, hyperthyroïdie ou coronopathie grave, chez les patients âgés examiner la survenue de symptômes extrapyramidaux et de
dépressions pendant traitement. IA : éviter prise concomitante d’inhibiteurs de la monoamine-oxydase ; antidépresseurs tricycliques et parasympatholytiques, médicaments à effet dépresseur sur le système nerveux
central, alcool, produits hyper- et hypotenseurs, procarbazine, glucocorticoïdes, héparine. ES : somnolence, céphalées, sécheresse buccale, douleurs abdominales. Pr : comprimés ; 20, 50, 100 (B* lim.) [Décembre
2009]. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.swissmedicinfo.ch.
Références : 1. Hahn, A., et al., A xed combination of cinnarizine/dimenhydrinate for the treatment of patients with acute vertigo due to vestibular disorders : a randomized, reference-controlled clinical study. Clin Drug
Investig, 2008. 28(2): p. 89-99. 2. Pytel, J., et al., Efcacy and tolerability of a xed low-dose combination of cinnarizine and dimenhydrinate in the treatment of vertigo: a 4-week, randomized, double-blind, active- and
placebo-controlled, parallel-group, outpatient study. Clin Ther, 2007. 29(1): p. 84-98. 3. Cirek, Z., et al., Efcacy and Tolerability of a Fixed Combination of Cinnarizine and Dimenhydrinate versus Betahistine in the Tre-
atment of Otogenic Vertigo : A Double-Blind, Randomised Clinical Study. Clin Drug Investig, 2005. 25(6): p. 377-89. 4. Otto, V., et al., Treatment of vertebrobasilar insufciency-associated vertigo with a xed combination of
cinnarizine and dimenhydrinate. Int Tinnitus J, 2008. 14(1): p. 57-67.
Zambon Suisse SA, Via Industria 13 - CH-6814 Cadempino, www.zambon-ch.ch
1006472
1006472_rms_ct.indd 1 18.01.13 09:51
 6
6
 7
7
1
/
7
100%